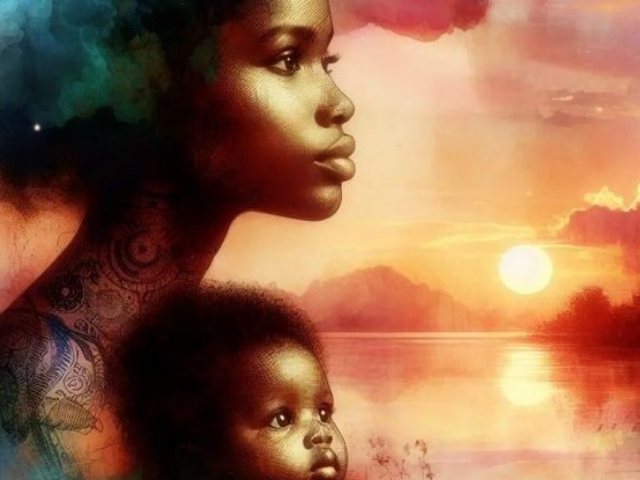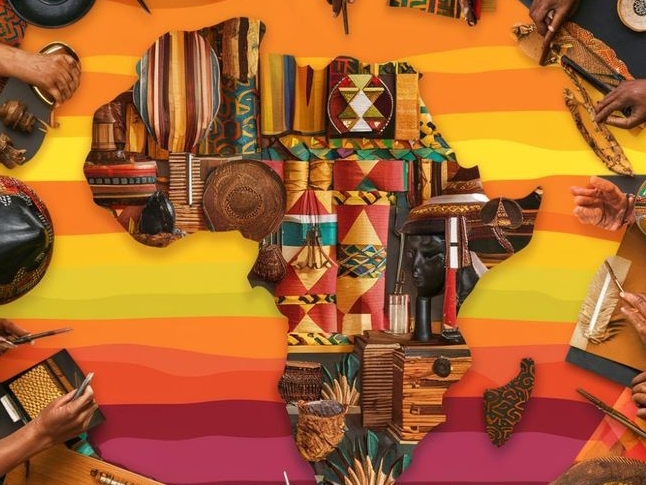Leçon : INTRODUCTION AU PANAFRICANISME : SURVOL HISTORIQUE
Plan du cours
Introduction
- Contexte de naissance du panafricanisme
- Quelques définitions du panafricanisme
I- Le panafricanisme des grandes conférences et congrès panafricains
1- La Première Conférence panafricaine (1900)
2- Le congrès de Paris
3- Le deuxième congrès (Londres, Bruxelles et Paris)
4- Le troisième congrès (Londres et Lisbonne)
5- Le congrès de New-York
6- Le congrès de Manchester
7- La conférence d’Accra
II- Les précurseurs et leurs conceptions du panafricanisme
1- Le panafricanisme comme l’union des noirs
a- Marcus Garvey
b- Cheikh Anta Diop
2- Le panafricanisme comme l’union de tous les peuples présents en Afrique
a- Kwame Nkrumah
b- Mouammar Al Kadhafi
3- Les autres panafricanistes
a- William Dubois
b- Georges Padmore
c- Sylvester Williams
d- Edward Blyden
e- Antenor Firmin
f- Benito Sylvain
III- Les premières tentatives de matérialisation du panafricanisme
1- Les initiatives des associations
a- L’UNIA
b- La LUDRN
c- L’ENA
d- Le WANS
e- Le RDA
f- La NAACP
g- La FEANF et le WASU
2- Les initiatives intellectuelles
a- La revue Présence Africaine
b- La Société Africaine de Culture
IV- L’OUA et l’UA : L’échec consumé du panafricanisme
1- Les bases de l’échec
a- La mauvaise décolonisation du continent
b- Le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca
c- L’éviction des présidents nationalistes et le triomphe du néocolonialisme
2- Les manifestations de l’échec
a- La sacralisation des frontières coloniales
b- Les conflits frontaliers
c- La divergence monétaire
d- La divergence des politiques de gouvernement
e- La divergence des politiques économiques
3- Les faiblesses de l’OUA et de l’UA
a- Le conflit entre les organes de l’UA
b- Le non-respect des décisions prises
c- Le maintien de la rupture entre les révolutionnaires et les autres dirigeants modérés
d- Le NEPAD
V- Les efforts de redressement du panafricanisme
1- La poursuite des conférences et congrès panafricains
a- Le congrès de Dar es Salam
b- Le congrès de Kampala
c- Le congrès de Johannesbourg et d’Accra
2- Les efforts de redressement au niveau culturel et médiatique
a- L’Agence Panafricaine de presse
b- Le festival africain des arts nègres
c- Le festival panafricain d’Alger
d- Le deuxième Festival panafricain d'Alger
e- Les autres festivals mondiaux des arts et de la culture nègres
f- Le fespaco
g- Afrique media et vox africa
3- Les entreprises panafricaines
4- Les universités d’Amérique du Nord et l’université kamite
5- Le kemitisme
6- Le néo panafricanisme
7- Le panafricanisme révolutionnaire
8- Les nouveaux porte-flambeaux du panafricanisme
a- La Ligue Associative Africaine
b- La ligue Panafricaine UMOJA
c- Les Economic Freedom Fighters
d- Afrocentricité International
e- La Dynamique Unitaire Panafricaine
Conclusion
- Urgences stratégiques
- La nécessité de prise de pouvoir politique dans les pays africains
Introduction
Contexte de naissance du panafricanisme
L’idée du panafricanisme nait avec les premières déportations à la fin du XVe siècle. Les négriers pourchassent et attrapent les africains à travers le continent noir. Une fois en Amérique, une conscience de race se crée et se renforce. Les noirs se rendent compte que c’est au nom de la race qu’ils sont réduits en esclavage. Cette conscience est d’autant plus vivace que les négriers attrapent en même temps les intellectuels, les rois et les simples citoyens. Le rôle des intellectuels et des philosophes nègres attrapés devait avoir un impact considérable dans cette conscience de race. Le rapport de force leur étant très défavorable, les révoltes des noirs aux premiers siècles des razzias seront toutes écrasées. Mais ils parviennent à maintenir cette idée de ressortir d’un même endroit, et malgré les brimades, ils font rayonner beaucoup d’éléments de leur culture, maintiennent dans les consciences cette idée de destin commun. Parmi les éléments culturels africains qui survivent en Amérique pendant la longue période des razzias, nous avons les musiques comme le negro spiritual ou la religion comme le Vaudou.
Si pendant les premiers siècles des razzias les révoltes nègres étaient presque toutes écrasées (San Miguel, Gaspar Yanga…), le XVe et le XVIIIe siècle voient la multiplication des révoltes de plus en plus violentes : Rébellion de Stono, Conspiration de New-York… La victoire de la révolte de Saint Domingue et la proclamation de la République d’Haïti renforce les révoltes nègres qui se multiplient. Les nègres, dans le sang et la souffrance, imposent par les armes leur liberté aux négriers. Mais ils sont confrontés à une nouvelle réalité, qui est le racisme. Malgré leur héroïsme, ils sont traités en sous-hommes. Les penseurs européens élaborent des pensées faisant d’eux des barbares. Parmi ces penseurs européens se trouvent Gobineau qui écrit son traité de l’inégalité des races, Hegel qui pense que : « le nègre représente l’homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance ». Kant pour sa part pense que les nègres sont si bruyants qu’il faut les disperser à coups de bâtons. Lévy Brühl estime que le nègre est doué de mentalité prélogique et mystique. Au-delà des penseurs, dans les Etats d’Amérique, les noirs sont assassinés impunément, et les lois sont contre eux. Ce qui provoque la réaction des intellectuels africains, qui pensent une philosophie de défense du noir.
Si l’idée du panafricanisme nait dès les premières razzias, le terme panafricanisme quant à lui est apparu à la fin du XIXe siècle. A cette époque, presque toute l’Afrique noire est sous domination européenne. Devant la pression des noirs américains, les Etats-Unis créent la Société Américaine de Colonisation pour le retour des anciens esclaves en Afrique. Cette société crée l’Etat du Libéria et certains anciens esclaves y retournent. En 1900, ils sont 20.000 sur une population de plus d’un million d’habitants. Mais le Libéria ne résout pas le problème du racisme qui reste entier. Le panafricanisme est donc fondamentalement une réaction au racisme dont sont victimes les noirs, ce que Amzat Boukary Yaraba appelle le pan-négrisme. Le panafricanisme va évoluer pour ne plus seulement intégrer les nègres.
Quelques définitions du panafricanisme
Plusieurs définitions ont été données au panafricanisme. Le panafricanisme est globalement un mouvement et une idéologie politique, économique et socio-culturelle qui recherche l’unité du peuple africain, et l’unité du continent africain. Il prône la solidarité entre les Africains et les descendants d’Afrique qui sont hors du continent. Le panafricanisme vise à unir les africains du continent et de la diaspora pour former un vaste Etat africain, ou une grande nation africaine.
Pour Georges Padmore : « L'idée du panafricanisme surgit d'abord comme une manifestation de solidarité fraternelle entre africains et peuples d'ascendance africaine. »
Amzat Boukari-Yabara va dans le même sens et affirme : « Le panafricanisme est l’idée d’une solidarité entre les peuples africains ».
William Dubois s’éloigne de cette idée de solidarité des peuples africains et centre le panafricanisme sur le nègre. Il écrit : « Le mouvement africain signifie pour nous ce que le mouvement sioniste doit obligatoirement signifier pour les juifs : la centralisation de l’effort racial et la reconnaissance d’une souche raciale. »
I- Le panafricanisme des grandes conférences et congrès panafricains
Pour mûrir leur idée de défense des africains et de leur union, les intellectuels africains de la diaspora engagent des conférences et congrès panafricains.
1- La Première Conférence panafricaine (1900)
Elle se tient à Londres du 23 au 25 juillet 1900, une période où presque toute l’Afrique est sous domination. La décolonisation de l’Afrique devait naturellement faire partir de ses préoccupations. D’ailleurs, Anténor Firmin précisait : « l'on peut, sans être prophète, prédire que toute la politique de la première moitié du XXe siècle, au moins, sera dominée par les questions coloniales ». Comme précédemment évoquée, la conférence se tient dans une période marquée par un violent racisme anti-noir. S’unir devenait une nécessité pour les africains.
Parmi les organisateurs de cette conférence, nous avons Benito Sylvain, Anténor Firmin, Booker T. Washington et Henry Sylvester Williams. La conférence réunit 32 participants, qui sont des Noirs d’une grande notoriété. 4 des participants sont du continent africain. La conférence adopte une adresse aux nations du monde où elle s’oppose au racisme et affirme que la couleur de la peau ne doit plus être un critère de distinction entre les blancs et les noirs. Elle revendique le respect des libertés des « indigènes d'Afrique » ainsi que leur droit d'accéder aux voies du progrès et de la culture.
Elle s’oppose à l’utilisation des missions chrétiennes comme prétexte de « l'exploitation économique et l'effondrement politique des nations les moins développées ». Elle demande au gouvernement britannique d’accorder « les droits dignes d'un gouvernement responsables aux colonies noires d'Afrique et des Indes Occidentales ». Les participants demandent aux États-Unis d’octroyer aux Noirs-Américains le droit de vote, la sécurité des personnes et la propriété. Ils demandent aux puissances impérialistes de respecter l'intégrité et l'indépendance de l'Éthiopie, du Liberia et d'Haïti. Les participants implorent la reine d’Angleterre au sujet de la situation alarmante des autochtones en Afrique du Sud.
2- Le congrès de Paris
19 ans après la conférence de Londres, William Dubois et Ida Gibbs Hunt organisent le premier congrès panafricain à Paris. Le congrès se tient du 19 au 22 février 1919. Cinquante-sept délégués de quinze pays y prennent part. Les délégués des Etats-Unis et d’Angleterre ne parviennent pas à assister, car leurs gouvernements refusent de leur octroyer des passeports. Le congrès se tient à la fin de la première guerre mondiale. Les participants demandent aux Alliés vainqueurs de la guerre d’administrer les territoires africains sous forme d'un condominium et d’associer les africains à la gestion de leurs pays, demande qui sera rejetée.
3- Le deuxième congrès (Londres, Bruxelles et Paris)
Ce congrès est organisé du 28 août au 6 septembre 1921, sous l’initiative de la NAACP (Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur), une organisation américaine de défense des droits civiques créée en 1909, sous l’impulsion de William Dubois. Cent treize délégués participent à ce congrès. Ce dernier table sur les questions de l'inégalité raciale, les obstacles à l’évolution de l'Afrique et à l'auto-gouvernance africaine. Le congrès dénonce l’attitude de l’Angleterre dans les colonies, le fait qu’elle encourage l’ignorance des colonisés, l’esclavagisation et l’asservissement des colonisés, son refus d’accorder aux noirs les droits au gouvernement autonome comme elle le fait dans les autres colonies. Sans le dire ouvertement, le congrès opte pour l’indépendance des colonies africaines. Blaise Diagne représentant le Sénégal et Gratien Candace représentant la Guadeloupe trouvent ces mesures extrêmes et soutiennent la politique coloniale de la France. C’est la première mésentente entre les panafricains francophones et anglophones. Cette mésentente se transformera en clivage.
4- Le troisième congrès (Londres et Lisbonne)
Entre novembre et décembre 1923, un autre congrès est convoqué à Londres et Lisbonne. Le but du congrès est de favoriser l’unité africaine en mettant en place un forum des africains du terroir et de la diaspora. Le congrès aborde les sujets comme le développement de l'Afrique pour les Africains. Il condamne l’exploitation du Congo belge, le recrutement forcé des travailleurs en Afrique portugaise, les expropriations foncières en Afrique du Sud, en Rhodésie et au Kenya, et les lynchages des Noirs aux États-Unis. Deux comités sont créés, l’un pour exiger les réformes dans l’Afrique colonisée, et l’autre pour créer une association panafricaine permanente. Le fossé entre les panafricains francophones et anglophones se creuse d’avantage.
5- Le congrès de New-York
Ce congrès se tient en août 1927 et réunit deux-cent huit délégués représentant treize pays. La question du rapport avec le communisme est posée. Du Bois penche pour l’adoption du communisme. Certains délégués refusent cette alliance avec le communisme.
La crise économique de 1929 et la Seconde Guerre mondiale rendent difficile l’organisation de nouveaux congrès panafricains. Il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que de nouveaux congrès panafricains soient organisés. Ces deux événements créent une rupture dans une mouvance qui, si elle se poursuivait, devait très tôt aboutir à la libération du continent. Mais ces évènements passés, les rencontres panafricaines reprennent, avec de nouveaux leaders.
6- Le congrès de Manchester
Il se tient 15 au 21 octobre 1945. Il est organisé par George Padmore, Kwame Nkrumah et William Dubois. Nkrumah s'impose comme le nouveau chef de file du mouvement panafricain. Il popularise le mouvement et le politise. L’indépendance est désormais clairement posée dans le monde panafricain. Ce congrès est le dernier qui se tient hors d’Afrique.
Le congrès demande l'abolition des lois foncières autorisant les colons à enlever les terres aux Africains. Il revendique le droit pour les Africains de développer les ressources économiques de leur pays sans entrave, l'abolition de toutes les lois de discrimination raciale, la liberté de parole, de presse, d'association et d'assemblée, l'éducation obligatoire et gratuite, l'installation d'un service de santé et d'aide sociale pour tous, le droit de vote à tous les hommes et femmes de plus de 21 ans, l'abolition du travail forcé et l'introduction du principe de salaire égal à travail égal.
A ce congrès assiste d’autres personnalités qui joueront un rôle capital dans la décolonisation de l’Afrique comme Jomo Kenyatta du Kenya et Hastings Banda du Malawi. Les délégués du continent sont plus nombreux à ce congrès que ceux de la diaspora. Nkrumah change le panafricanisme d’un mouvement intellectuel à un mouvement populaire devant supporter la décolonisation.
7- La conférence d’Accra
En 1957, le Ghana devient le premier pays d’Afrique noire à avoir son indépendance. Kwame Nkrumah affirme que cette indépendance n’aura pas de sens si toute l’Afrique n’est pas unie. Le continent à cette époque est en lutte pour sa souveraineté.
La conférence d’Accra se tient du 8 au 13 décembre 1958 et est convoquée par Kwame Nkrumah. Elle concerne le sort du continent. Son appellation originale est la première conférence des peuples africains. Les personnalités les plus influentes du continent comme Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Tom Mboya, Kenneth Kaunda, Modibo Keita, Holden Roberto, Félix Roland Moumié, Patrice Lumumba prennent part à cette conférence. La conférence s’oppose à la colonisation et décide le soutien des Etats libérés au processus de libération de ceux encore colonisés. Ses objectifs sont l’indépendance des colonies et le renforcement des pays indépendants. La conférence exige l’accession immédiate à l’indépendance des peuples africains encore colonisés, l’évacuation totale des forces d’agression présentes en Afrique. Elle proclame la nécessité de libérer tous les peuples dépendants de l’oppression étrangère, la nécessité de coordonner et d’unir les forces de tous les africains.
Elle demande aux africains de ne
négliger aucune forme de coopération dans l’intérêt des peuples africains. Elle
dénonce la discrimination raciale en Afrique du sud, de l’est et centrale. Elle
proclame l’égalité des droits pour tous les citoyens des pays libres d’Afrique.
La conférence apporte son soutien au Gouvernement provisoire de la République
Algérienne et à la lutte du maquis de l’UPC. Lumumba y réalise le retard de son
pays dans le processus de décolonisation et dès son retour, des heurts éclatent
au Congo et il revendique l’indépendance du Congo. La conférence entraine aussi
l’accélération dans le processus de décolonisation des colonies françaises.
II- Les précurseurs du panafricanisme et leurs conceptions du panafricanisme
1- Le panafricanisme comme l’union des noirs
a- Marcus Garvey
Marcus Mosiah Garvey est né le 17 août 1887 en Jamaïque. Les partisans du mouvement rastafri l’ont considéré comme un prophète. Il est né d’une famille très pauvre. A 14 ans, ses parents ne peuvent plus payer ses études. Il quitte l’école et trouve du travail dans une imprimerie de journaux. Marcus Garvey, comme tous les premiers précurseurs du panafricanisme, grandi dans un environnement dominé par le racisme anti-noir. Il est un contestataire. Il organise une grève dans l’imprimerie où il travaille et est renvoyé. Il se lance en journalisme et fonde plusieurs journaux (La Prensa au Panama, La Nacionale au Costa Rica...)
Il se rend compte que ses talents de journaliste et d’orateur ne suffisent pas. Le besoin d’une organisation se pose dans son combat, et il crée l'UNIA (Universal Negro Improvement Association). Cette organisation vise la défense des noirs. Sa devise témoigne la vision culturelle que Garvey attache à sa lutte. La devise de l’UNIA est : « Un Dieu ! Un But ! Une Destinée ! » Pour Garvey, la terre promise des Noirs est l’Afrique, et il faut que les Noirs y retournent. Sa reconnaissance internationale et le poids de son organisation renforce ses idées.
Après la première guerre mondiale et l’écrasement de l’Allemagne, il demande aux vainqueurs de transformer les colonies arrachées à l’Allemagne en un Etat devant accueillir les anciens esclaves qui doivent retourner à la terre africaine où ils ont été arrachés de force. Sa pétition est rejetée et les vainqueurs se partagent les anciennes colonies allemandes. Après ce refus des vainqueurs de la guerre, Garvey décide de préparer cette Nation nègre. Même s’il n’existe pas sur un territoire, cet Etat doit exister dans les mentalités. Il adopte un drapeau (noir, vert et rouge), un hymne national (The Universal Ethiopian Anthem), un corps militaire, un corps médical (Black Cross nurses), des uniformes, une hiérarchie exécutive. Il multiplie des réunions publiques régulières, des conventions annuelles rassemblant des milliers de personnes, de grands défilés dans les rues de Harlem, l’organisation des activités culturelles (poésie, pièces de théâtre), des activités commerciales pour autonomiser cette nation nègre, des activités pédagogiques pour former les futurs citoyens de cette nation. Toutes ces activités renforcent cette nation nègre en construction. En 1920, Garvey organise le premier congrès des peuples noirs du monde (First Convention of the Negro Peoples of the World) auquel 35000 personnes participent.
Le manque de territoire pour la nation nègre commence à impacter négativement son développement. Or toute l’Afrique est colonisée. Ce qui pousse Garvey à se retourner vers le Libéria. Mais le Libéria craint ses idées, et la révolution sociale que ces idées peuvent créer. En 1924, l'UNIA est interdit au Libéria. Du côté de l’Ethiopie, c’est un nouvel échec. Garvey, tout en continuant de poser les bases de la nation noire, poursuit la lutte de la décolonisation mentale. Il rappelle aux Noirs que « La peau noire n'est pas un insigne de la honte, mais plutôt un symbole de grandeur nationale ». Pour Marcus Garvey, la question de la primauté de la race est centrale et toutes les activités de l'UNIA cherchent à développer l'estime que la Garvey clame que les Noirs doivent voir Dieu à leur image. Il soutient ouvertement la rébellion vietnamienne de Hô Chi Minh, le combat de Gandhi en Inde et salue l’œuvre de Lénine. Il refuse de s’allier à l’international des opprimés du monde entier, et pose la race comme le critère fondamental de sa lutte. En 1919, il crée la Black Star Line, une compagnie maritime ayant pour but de servir le projet de rapatriement des anciens esclaves vers l’Afrique. La Black Star Line est financée uniquement par des Noirs et relie les Amériques et les Caraïbes. Le journal de Garvey, « The Negro World » est vendu dans beaucoup de pays. Il est interdit dans certaines colonies africaines, en France et en Grande Bretagne. Marcus Garvey fonde des usines, des réseaux de distribution ainsi que deux journaux. Accusé de fraude postale, Marcus Garvey est emprisonné aux Etats-Unis, ce qui lui fait perdre son influence. En 1927, il est libéré et retourne en Jamaïque. En 1935, il part pour le Royaume-Uni où il décède le10 juin 1940.
b- Cheikh Anta Diop
Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 au Sénégal. Il commence la défense de sa race très tôt. En classe de troisième, il s’oppose vigoureusement à son enseignant de français Monsieur Boyaud, très raciste. Cheikh Anta Diop ne supporte pas la manière dont Monsieur Boyaud traite la race noire. Sachant qu’il va être exclu, il préfère quitter le lycée lui-même. Il quitte Dakar pour Saint Louis. Durant ses années passées au lycée, il élabore un alphabet conçu pour transcrire toute langue africaine et il entreprend également la rédaction de l’histoire du Sénégal. En 1945, il obtient ses baccalauréats en mathématiques et en philosophie. Il va en France poursuivre ses études. A son initiative est créée l'Association des Étudiants Africains de Paris. Dès la création du RDA (Rassemblement Démocratique Africain), il y adhère en rappelant à la direction son devoir de ne pas faillir à sa mission historique : celle d'une véritable libération du continent africain. En 1951, il devient le secrétaire général de l'Association des Étudiants du RDA (AERDA) à Paris. Il donne plusieurs conférences et organise, sous l’égide du RDA, le premier Congrès Panafricain Politique d'Etudiants d'après-guerre, du 4 au 8 juillet 1951.
Cheikh Anta Diop réagit aux écrits racistes des penseurs occidentaux en prouvant que l’Afrique est le berceau de l’humanité et que ce sont les noirs qui ont civilisé le monde et non le contraire. Pour le prouver, il compare l’organisation sociale, la linguistique, le matriarcat, la cosmogonie, la circoncision et l’excision, le totémisme, les pensées des anciens penseurs européens qui n’ont jamais nié le fait que leurs connaissances viennent des Noirs. Ses travaux inquiètent le monde occidental et il reçoit des critiques. En 1970, il est contacté par l’UNESCO pour participer à la rédaction de l’ouvrage Histoire Générale de l’Afrique. Il pose comme condition l’organisation d’un colloque où il pourra exposer toutes ses thèses et les prouver devant tous ses contestataires. Le colloque est organisé en 1974, et ses thèses sont validées. Ce qui lui permet de participer à la rédaction de la collection Histoire Générale de l’Afrique.
Après avoir soutenu sa thèse en France, il rentre au Sénégal par cette pensée célèbre : « Je rentre sous peu en Afrique où une lourde tâche nous attend tous. Dans les limites de mes possibilités et de mes moyens, j'espère contribuer efficacement à l'impulsion de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et celui des sciences exactes. Quant à l'Afrique noire, elle doit se nourrir des fruits de mes recherches à l'échelle continentale. Il ne s'agit pas de se créer, de toutes pièces, une histoire plus belle que celle des autres, de manière à doper moralement le peuple pendant la période de lutte pour l'indépendance, mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire. »
Au Sénégal, il crée un laboratoire de datation par le Carbone 14 (radiocarbone). Constatant que l’indépendance du Sénégal est ratée, il crée un parti politique, le Bloc des Masses Sénégalaises (BMS) en opposition au régime en place dirigé par Léopold Sédar Senghor. Il en est le Secrétaire général. Il refuse les postes ministériels qui sont proposés par Léopold Sédar Senghor à son parti. Le gouvernement Sénégalais dissous le BMS, et Cheikh Anta Diop crée aussitôt un autre parti qui sera à son tour dissous l'année suivante. Ce parti est le Front National Sénégalais. Le gouvernement sénégalais l’empêche d’enseigner à l’université. En 1980, Léopold Sédar Senghor démissionne de la présidence du Sénégal et en 1981, Cheikh Anta Diop est nommé professeur d'histoire associé à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Dakar. Il est enfin autorisé à enseigner à l’université.
Cheikh Anta Diop se situe dans la logique de Garvey et penche pour la construction d’un Etat noir. Dans son ouvrage Les fondements politiques, économiques et culturels d’un Etat noir, il pose les fondements de cet Etat nègre. Il écrit : « Il faut faire basculer définitivement l’Afrique noire sur la pente de son destin fédéral ». Du 6 au 9 janvier 1986, à Yaoundé, il préside le Colloque sur l'Archéologie camerounaise. Il donne, le 8 janvier, dans le Palais des Congrès de la capitale camerounaise, sa dernière conférence intitulée : « La Nubie, l'Égypte et l'Afrique noire ». Il décède 29 jours après son départ du Cameroun et précisément le 7 février 1986, à Dakar.
2- Le panafricanisme comme l’union de tous les peuples présents en Afrique
a- Kwame Nkrumah
Kwame Nkrumah est né en 1909 en Gold Coast, aujourd’hui Ghana. En 1935, quelques années après sa sortie de l'université, il s’en va aux Etats-Unis afin de poursuivre ses études. Pour survivre aux Etats-Unis, il multiplie de petits métiers tout en poursuivant ses études. Il obtient une licence en économie et en sociologie en 1939.
Il adhère à l’association d'étudiants africains et la transforme en Association des étudiants africains des États-Unis et du Canada. Il préside cette association entre 1942 et 1945. Le journal de l'association se fait le relais des idées panafricaines. Il rencontre les grands panafricanistes comme William Dubois et Georges Padmore. Il est l’un des organisateurs de la conférence Manchester. En 1947 ; Nkrumah retourne en Afrique et devient secrétaire général du parti indépendantiste, l'UGCC (United Gold Coast Convention). Nkrumah transforme l'UGCC en un parti de masse. Il multiplie des grèves et des contestations. L'administration coloniale réagit par la répression. Elle emprisonne les dirigeants du parti et assassine des manifestants. Nkrumah est incarcéré pendant deux mois avec d'autres dirigeants de l'UGCC. Les dirigeants de l'UGCC prennent peur de la tournure des évènements et démettent Nkrumah de sa fonction de secrétaire général. Le 12 juin 1949, Nkrumah crée le Convention People's Party (CPP). Il appelle au boycott et à la désobéissance civile, ce qui lui vaut une fois de plus d’être arrêté par les autorités britanniques en 1950 et condamné à trois ans de prison. Aux élections de 1951 à l’assemblée législative, le CPP remporte. Nkrumah profite et oblige le Royaume-Uni à concéder l’indépendance, qui est proclamée le 6 mars 1957.
Nkrumah est conscient que cette indépendance n’aura pas de valeur si l’Afrique entière n’est pas unie. Il organise la conférence d’Accra. Pour faciliter son projet de construction des Etats-Unis d’Afrique, il fait venir les mouvements indépendantistes africains au Ghana pour les former afin qu’ils rentrent secouer les colons et libérer leurs pays. Et une fois libres, ces pays s’unissent en un grand pays africain uni. Il tente un premier pas vers une réalisation concrète du panafricanisme en formant le 1er mai 1959 une union avec la Guinée, rejointe le 24 décembre 1960 par le Mali même si cette union purement symbolique. Pour détruire son projet des Etats-Unis d’Afrique, les Etats colonialistes accordent des indépendances à des personnes sous leur contrôle. Les progressistes que Nkrumah formait au Ghana n’ont plus de valeur. Avec les Indépendances, Nkrumah tente de convaincre les nouveaux pays de former un seul Etat. Cet Etat n’est pas seulement un Etat noir, mais un Etat englobant tous les pays africains. Il définit l’idéologie qui doit animer cet Etat, qu’il appelle le consciencisme. Il écrit : « Le consciencisme est l’ensemble en termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettent à la société africaine d’assimiler les éléments de la culture euro-chrétienne, arabo-musulmane et traditionnelle africaine présentes en Afrique, et de les organiser de manière qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine ». Pour éviter le racisme et les replis identitaires dans ce pays, il propose donc de faire une synthèse entre tous les éléments culturels dominants en Afrique pour faire surgir une culture propre à l’Africain. Mais beaucoup de présidents nouvellement indépendants, au lieu d’aller directement vers un Etat uni, préfèrent organiser l’unité. Au lieu d’un Etat africain avec un gouvernement central comme l’avait souhaité Nkrumah et d’autres présidents progressistes d’Afrique, c’est l’OUA qui a été créée.
Voyant la chute de son projet d’un Etat africain uni, Nkrumah se replie sur lui-même. Ce repli est total avec la mort de Georges Padmore qui était son conseiller. Le numéro deux de son parti, Gbedemah profite pour multiplier des attaques contre lui. Des tentatives d’assassinat se multiplient contre lui. En 1966, il décide de réagir. Il va en Chine demander les conseils à Mao Zedong. Malgré le fait qu’il emporte tous les officiers supérieurs de l’armée avec lui pour qu’ils ne restent pas faire un coup d’Etat, le coup d’Etat est néanmoins fait.
Renversé, Nkrumah va en Guinée Conakry et est nommé coprésident de la Guinée par Sékou Toure. Sa santé se dégrade d’avantage et il décède le 27 avril 1972, il d Bucarest.
b- Mouammar Al Kadhafi
Mouammar Al Kadhafi est né en 1942 en Libye. Il commence son militantisme très tôt. Etant encore à l’école, il se passionne de Nasser et de son combat. Nasser à l’époque incarne le nationalisme arabe. En 1961, une rupture a lieu entre la Syrie et l’Egypte. Kadhafi et ses camarades prennent position pour l’Egypte de Nasser et distribuent des tracts de soutien à l’école. Kadhafi est exclu de l’école de Sebha et va poursuivre ses études à Misrata. Il crée des cellules clandestines au lycée. A l’université, il étudie le droit. En 1963, il entre dans l’armée et y crée une cellule clandestine ayant pour but de renverser le roi comme l’a fait Nasser. En 1969, alors qu’il a 27 ans, il renverse le roi Idris 1er et fait passer la Libye de la monarchie en République. Avec ce coup d’Etat et son jeune âge, il passe déjà pour l’un des plus grands stratèges militaires.
Dès sa prise de pouvoir, Kadhafi nourrit le projet du panarabisme, de l’union des arabes. Il nationalise les entreprises étrangères, expulse les armées britanniques et étasuniennes de la Libye. Il parvient, en 1970, à convaincre les autres Etats arabes d’augmenter les prix de pétrole comme réaction au soutien que les Etats occidentaux apportent à Israël en guerre contre les Etats arabes. Cette montée de prix des pays arabes et des principaux pays producteurs de pétrole crée le choc pétrolier dans les pays occidentaux qui en surconsomment. Kadhafi devient la cible des puissances occidentales et les coups d’Etat se multiplient contre lui. Kadhafi tente de créer un grand Etat arabe comprenant la Libye, l’Egypte et la Syrie. Mais le président égyptien Anouar El Sadate qui a remplacé Nasser fait échouer le projet. Kadhafi se retourne vers l’Algérie et la Tunisie pour tenter une union entre les trois pays pour former la République arabe et islamique. Nouvel échec. Après cet échec de son projet du panarabisme, il se replie vers la consolidation de son pouvoir à l’intérieur de la Libye et à poser les bases de la nouvelles nation. Il met sur pied les comités révolutionnaires.
Au plan international, Kadhafi intervient dans plusieurs conflits en Afrique. Il intervient dans la guerre Ouganda-Tanzanie en soutenant l’Ouganda d’Idi Amin Dada. Dans la guerre civile tchadienne qui oppose les forces gouvernementales de Hissene Habré aux forces de l’ancien président Goukouni Oueddei, Kadhafi soutient les forces de Oueddei. Il soutient le mouvement indépendantiste IRA en Irlande et presque toutes les organisations qui luttent contre Israël en Palestine. Il soutient le Front polisario au Sahara occidental en lutte contre le Maroc. Il soutient l’ANC en Afrique du Sud contre le régime de l’apartheid au pouvoir. Il soutient les mouvements indépendantistes dans les colonies portugaises (PAIGC, FRELIMO, MPLA), tout comme le mouvement érythréen contre l’Ethiopie. Les relations entre les Etats-Unis et la Libye s’effritent. En 1981, un incident a lieu entre les deux pays, et les Etats-Unis abattent deux avions de chasse de la Libye. En 1982, les Etats-Unis mettent la Libye sous embargo. En 1986, comme d’habitude, l’armée des Etats-Unis, sans autorisation, pénètrent dans le golfe de Syrte. Il y a échange de tirs de missiles entre l’armée des Etats-Unis et celle de la Libye. Les Etats-Unis accusent la Libye d’avoir participé à l’attentat d’une bibliothèque à Berlin Ouest et bombardent la capitale libyenne Tripoli. Kadhafi est blessé, et sa fille adoptive tuée.
Déçu par son projet de panarabisme, Kadhafi se tourne vers celui du panafricanisme. Il décide de créer un Etat africain uni qu’il appelle les Etats-Unis d’Afrique. Pour le faire, il doit sortir de son isolement. Il normalise ses relations avec le Tchad, la Tunisie et l’Egypte. Il se rapproche des Etats-Unis et renonce à son programme d’armement nucléaire. Ce qui a été sa plus grande erreur d’ailleurs. Il se rapproche aussi des autres puissances occidentales. Avec son argent, il soutient les projets partout au monde, ce qui accroit sa popularité. Il a besoin de cette popularité pour son ultime projet qui est les Etats-Unis d’Afrique. En se rapprochant des puissances occidentales et en y mettant son argent, il compte en retour que ces puissances n’empêchent pas son projet d’unité de l’Afrique.
Une fois les alliances faites, Kadhafi engage son projet de construction des Etats-Unis d’Afrique, avec un gouvernement central, une seule monnaie et une armée de 2 millions d’hommes (la plus nombreuse du monde, puisqu’à cette époque l’armée chinoise était évaluée à environ 1.300.000 soldats). En 2000, il convainc les pays africains de faire passer l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine) en UA (Union Africaine), qui donne l’impression d’être déjà dans une union. En 2002, l’OUA devient l’UA. La même année 2000, il tente de convaincre les chefs d’Etat africains de créer les Etats-Unis d’Afrique. Mais le Nigéria et l’Afrique du Sud s’opposent à ce projet. Au sommet arabo-africain de Syrte d’Octobre 2010, il demande officiellement des excuses aux noirs pour l’esclavage anti-noir pratiqué par les arabes. A elle seule, la Libye de Kadhafi assure 15 % des cotisations à l’UA et finance les opérations de maintien de la paix de cette organisation au Darfour comme en Somalie. Voyant le peu d’enthousiasme des présidents africains à son projet, il réunit les chefs de tribus africaines à Benghazi, et promet de les financer s’ils font pression sur les gouvernements pour la construction des Etats-Unis d’Afrique.
Alors que les pays africains paient 500 millions de dollars par an pour pouvoir utiliser les satellites occidentaux, ce qui augmente le prix de communication, les pays africains décident de lancer leur propre satellite. Cette opération leur coutera 400 millions de dollars, payable une fois. En 2006, Kadhafi seul apporte 300 millions de dollars pour le projet et en 2007, le premier satellite africain est lancé. Si les coûts de communication chutent en Afrique c’est grandement à cause de ce satellite. L’Europe grâce à ce projet perd 500 millions de dollars chaque année. Le projet d’unité de l’Afrique commence à rencontrer de sérieuses résistances chez les occidentaux. Kadhafi va plus loin et décide de mettre son argent au service de la libération véritable de l’Afrique. Alors que le Fond monétaire international, avec un capital de 25 milliards de dollars à l’époque tient les pays africains avec les dettes, Kadhafi décide de créer le Fond Monétaire Africain avec un capital de 42 milliards de dollars, dont la Libye seule devait payer 30 milliards de dollars. Ce projet devait être effectif en 2011, ayant pour siège Yaoundé au Cameroun. Kadhafi, dans la matérialisation de son projet des Etats-Unis d’Afrique, planifie la construction en 2011 de la Banque Centrale Africaine, devant imprimer la monnaie africaine. Le siège de cette banque devait être à Abuja au Nigéria.
Tous ces projets doivent autonomiser la nouvelle République que veut construire Kadhafi. Ces projets sont imminents puisque la Libye a de l’argent pour cela. Mais avant leur opérationnalisation, la Libye est attaquée par une coalition de puissances occidentales qui accusent Kadhafi d’avoir tiré sur sa population. Kadhafi est vaincu et assassiné.
3- Les autres panafricanistes
a- William Dubois
William Edward Burghardt Dubois est né le 23 février 1868 aux Etats-Unis. Dans le Great Barrington où il grandit, la discrimination raciale n’est pas très forte, et il est admis à l’école, avec les autres enfants blancs. Après ses études secondaires, Dubois entre à l’Université Fisk, une université traditionnellement noire, et y étudie de 1885 à 1888. C'est à cette époque que qu’il expérimente véritablement le racisme pour la première fois, avec l'intolérance et les lynchages. Après l’obtention de son baccalauréat universitaire, il étudie au Harvard College de 1888 et 1890. Pour financer ses études, il fait des travaux parallèles. En 1891, il reçoit une bourse pour étudier à la faculté de sociologie de Harvard. En 1892, il obtient une aide du fond John Fox Slater pour entrer à l'université Humboldt de Berlin. En 1895, il rentre aux États-Unis pour achever ses études. Il est le premier afro-américain à obtenir un doctorat en philosophie de l'université Harvard.
En 1894, Dubois devient enseignant à l'université Wilberforce. Il rejette l’intégration des Noirs dans la communauté blanche. Il estime que les pensées nègres et blanches sont opposées, tout comme les visions du monde nègres et blanches. Il écrit : « On sent toujours sa dualité, une Américaine, une Nègre ; deux âmes, deux pensées, deux efforts irréconciliés ; deux idéaux opposés dans un corps noir dont seule sa force opiniâtre l'empêche d'être déchiré... » En juillet 1897, Dubois enseigne à l'université traditionnellement noire d'Atlanta. Il publie The Philadelphia Negro, une étude sociologique détaillée des afro-américains de Philadelphie. Dubois pense que l'élite d'une nation est la portion critique de la société responsable de la culture et du progrès.
Dans la première décennie du XXe siècle, Booker T. Washington et Dubois émergent comme les principaux porte-paroles du monde noir aux Etats-Unis. La popularité de Washington faiblit quand il conclut le compromis d'Atlanta avec les Blancs des Etats du Sud, demandant aux noirs du Sud de se soumettre aux discriminations, à la ségrégation, à l'exclusion du droit de vote et à l'interdiction du travail syndiqué, et en retour les blancs leur permettent de recevoir une éducation de base, des opportunités économiques et une égalité judiciaire. L’accord prévoit que les blancs du Nord investissent dans les entreprises du Sud et financent les charités éducatives noires. Dubois s’oppose à cet accord et considère que les afro-américains doivent se battre pour obtenir l'égalité des droits plutôt que de subir passivement la ségrégation et la discrimination.
Dans la cadre du mouvement niagarite (L’association Niagara qu’il a créé), Dubois lance le journal Moon Illustrated Weekly, un hebdomadaire illustré. Il lance également A Journal of the Color Line. Il rédige The Souls of Black Folk (« Les Âmes du peuple noir ») pour montrer le génie et l'humanité des Noirs où il écrit : « le problème du XXe siècle est le problème de la ligne de partage des couleurs ». Cet ouvrage met en exergue la double-conscience à laquelle les afro-américains doivent faire face : Être à la fois noir et américain.
En 1906, le président Théodore Roosevelt dégrade 167 soldats noirs accusés sur les bases douteuses d’avoir assassiné un Barman au Texas. Des émeutes éclatent ensuite à Atlanta suite à l’accusation que les noirs ont agressé une femme blanche. Les émeutes font 25 victimes. Dubois demande à la communauté noire de retirer son soutien au parti républicain. Pour lui, le compromis d’Atlanta signé par Booker Washington est un échec, car malgré l’accord les noirs n’ont pas eu la justice. Sous son instigation est fondée la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Les dirigeants de la NAACP offrent à Dubois la position de directeur de la publicité et de la recherche. Il accepte l'offre et en 1910, il démissionne à l’université d’Atlanta et déménage à New York, pour se concentrer à cette tâche. Le journal de la NAACP a un succès phénoménal et il s'en vend 100 000 exemplaires en 1920.
William Dubois assiste à la conférence panafricaine de Londres de 1909. Dans ses livres The Negro, The Quest of the Silver ou The Star of Ethiopia qui paraissent après cette conférence, Dubois s’oppose à l'idée d'infériorité africaine. The Negro insiste sur l'unité et la solidarité des peuples de couleur du monde entier. Dubois affirme que le partage de l’Afrique est la cause principale de la première guerre mondiale. Il affirme à son époque que la civilisation égyptienne est noire et africaine. Il écrivait déjà dans Black Folk Then and Now : « Les Égyptiens étaient des nègres, et non seulement cela, mais par tradition ils se croyaient descendants non pas des blancs ou des jaunes, mais des peuples noirs du Sud ».
En 1917, des émeutes éclatent dans l’Illinois. Une grève a lieu dans les industries de Saint-Louis. Pour ouvriers refusent de travailler. Les autorités les remplacent par des ouvriers noirs, ce qui crée l’émeute. 40 à 250 noirs sont tués lors de ces émeutes. Pour protester, Dubois organise la Silent Parade qui rassemble environ 9 000 Afro-américains sur la Cinquième Avenue de New York. C’est la première parade de ce type à New York et la deuxième manifestation publique de Noirs pour les droits civiques. Dubois continue la lutte pour que les Noirs intègrent l’armée fédérale et y occupent des postes de commandement. La même année 1917, ses efforts portent des fruits et 600 officiers noirs rejoignent les rangs de l’armée. Dubois lui-même est nommé officier dans l'armée au sein du renseignement militaire. Cette position lui vaut des critiques de la part de nombreux noirs qui voulaient utiliser la guerre pour faire pression en faveur des droits civiques.
À la fin de la guerre, Dubois assiste au premier Congrès panafricain. Il critique le racisme dans l’armée. En 1919, des émeutes éclatent dans plus de 30 villes des Etats-Unis, causant la mort de plus de 300 noirs. Les rapports des Etats du Sud des Etats-Unis accusent les noirs d’avoir organisé un complot pour renverser le gouvernement. Plus de 60 Noirs survivants sont arrêtés, jugés et condamnés pour conspiration au cours d'un procès expéditif. Dubois rallie les noirs de tous les États-Unis pour lever des fonds en faveur de la défense de ces accusés et six ans plus tard, la Cour annule les condamnations. Pour l’éducation des enfants afro-américains à la culture africaine, Dubois crée un mensuel pour enfants, The Brownies' Book.
En 1921, Dubois assiste au deuxième congrès panafricain. Ses relations avec Marcus Garvey deviennent de plus en plus tendues. Après la guerre, les ventes du journal The crisis chutent de 100 000 à 60 000. Mais il reste le principal périodique du mouvement des droits civiques. Quand il visite la Russie en 1924, Du Bois est impressionné par les avancées du pays et conclut que le socialisme sera plus bénéfique pour la cause des Noirs. Mais aux Etats-Unis, des tensions éclatent avec le parti communiste qui accuse la NAACP d’être un mouvement d’intellectuels coupés de la masse. La NAACP de son côté accuse le parti communiste de ne pas assez prendre en compte la discrimination raciale. En 1931, Dubois démissionne comme rédacteur en chef du journal The crisis et accepte un poste académique à l'université d'Atlanta. Il fait plusieurs publications pour défendre le socialisme. Il documente le rôle central joué par les noirs dans la Guerre de Sécession et la Reconstruction et montre comment ils firent des alliances avec les politiciens blancs.
En 1932, Du Bois est choisi par plusieurs organisations philanthropiques pour être le rédacteur en chef d'un projet d'Encyclopedia of the Negro. Après plusieurs années de planification et de préparation, les organisations philanthropiques annulent le projet en 1938 car certains membres considèrent Dubois comme trop partial pour produire une encyclopédie objective. Pendant la deuxième guerre mondiale, Dubois sympathise avec le camp de l’axe et le gouvernement japonais l’invite au Japon. Il s’oppose à l’entrée en guerre des Etats-Unis. En 1943, alors qu'il est âgé de 76 ans, son poste à l'université d'Atlanta est brutalement supprimé par le président de l'université. Dubois retourne à la NAACP en tant que directeur du département des recherches spéciales. Il est l’un des 3 représentants de la NAACP à la conférence de San Franscisco qui pose les bases de l’Organisation des Nations Unies. La délégation de la NAACP demande aux Nations Unies de lutter pour l’égalité et de mettre un terme à la colonisation. La Chine, la Russie et l'Inde soutiennent les propositions de la NAACP. Mais cette position est ignorée par les autres grandes puissances. Ces propositions ne figurent donc pas dans la charte de l’ONU.
À la fin de l'année 1945, Dubois assiste au Congrès panafricain à Manchester qu’il co-organise avec Kwame Nkrumah. Quand la guerre froide éclate, la NAACP ne soutient pas le camp communiste. Mais Dubois et d’autres influents membres du mouvement soutiennent le camp communiste. Le FBI organise la pression contre la NAACP et les dirigeants il est le président de Peace Information Center (PIC) dont l'objectif est de faire connaître l'appel de Stockholm aux États-Unis. Cet appel était une pétition mondiale visant à demander aux gouvernements d'interdire les armes nucléaires. Le Département de la Justice des États-Unis considère que le PIC agit comme un agent d'une puissance étrangère. Dubois et les autres dirigeants du PIC protestent et sont inculpés. Albert Einstein demande de comparaître en tant que témoin de moralité de Dubois. La Cour préfère classer l’affaire. Même si Dubois n’est pas condamné, le gouvernement confisque son passeport pendant huit ans. Durant le procès, Dubois ne reçoit pas le soutien de la NAACP, ce qui le désole. Par contre, les noirs et les blancs de la classe ouvrière lui apportent tout leur soutien. En 1955, le gouvernement des Etats-Unis l’empêche d’assister à la conférence de Bandoeng. En 1958, Dubois récupère son passeport et visite la Chine et la Russie. En 1961, à l’âge de 93 ans, il rejoint le parti communiste. En 1960, il visite le Ghana et le Nigéria, et propose à Kwame Nkrumah le projet de l’encyclopédie Africana. Le Ghana met les fonds à disposition et dès 1961, Dubois s’installe au Ghana pour la rédaction de cette encyclopédie. En 1963, les Etats-Unis refusent de renouveler son passeport et il signe la nationalité ghanéenne. Sa santé se dégrade d’avantage et il meurt le 27 août 1963 dans la ville d'Accra à l'âge de 95 ans.
b- Georges Padmore
George Padmore, de son vrai nom Malcolm Ivan Meredith Nurse est né à Trinidad (colonie britannique) le 28 juin 1903. Dès son bas âge, il se familiarise avec les idées du panafricanisme, son père étant un sympathisant de Sylvester Williams. Après ses études secondaires, il va aux Etats-Unis pour continuer ses études universitaires. Il y étudie le droit et la médecine. Il prend le pseudonyme de George Padmore pour ne pas mettre en danger sa famille et adhère au Parti communiste des États-Unis d'Amérique qui luttait contre la ségrégation raciale. Il participe aux activités de plusieurs organisations militantes, dont la Ligue anti-impérialiste et le Comité international des travailleurs noirs. En parallèle, il continue avec le métier de journaliste qu’il avait débuté à Trinidad. Il écrit des livres sur la condition des noirs en Amérique et en Afrique. En juillet 1930, à Hambourg, il lance l’International Trade Union Committee of Negro Workers (ITUCNW), soutenu par le Komintern. En 1931, il devient le chairman du comité international des syndicats de travailleurs noirs et de son journal. Par ce journal, Padmore insuffle un programme d'éducation de masse afin de sensibiliser la population noire à l'importance des syndicats et des actions collectives contre l'exploitation.
En 1933, Padmore, qui s’était installé à Vienne, puis à Hambourg, est expulsé d’Allemagne vers l’Angleterre par le régime nazi d’Hitler. En 1934, déçu par le rapprochement entre la Russie qui dénonçait le colonialisme et la France, puissance coloniale, il quitte l'Internationale communiste et le Parti Communiste des États-Unis. Il reste cependant socialiste. Il veut retourner aux Etats-Unis, mais l’accès lui est refusé. Il s’installe à Paris, puis à Londres où il soutient les mouvements indépendantistes africains. Il parvient à retourner aux Etats-Unis où il fait la rencontre de Kwame Nkrumah. En 1935 quand l’Italie annexe l’Ethiopie, avec les autres figures noires, Padmore met sur pied l'International African Friends of Abyssinia pour protester contre l'invasion de l’Ethiopie. La campagne échoue, puisque l’Italie maintient sa domination sur l’Ethiopie. Padmore écrit dans plusieurs journaux de défense des droits des noirs, parmi lesquels The crisis de William Du Bois.
En 1945, il est l’un des principaux organisateurs du Congrès panafricain de Manchester. Après la seconde guerre mondiale, Padmore crée l'agence de presse panafricaine, et continue d'écrire pour des journaux du monde noir. Il devient alors secrétaire générale de la fédération panafricaine, qui continue à s'impliquer dans les problèmes locaux et internationaux en Afrique et au sein de la diaspora noire. Il rédige plusieurs ouvrages parmi lesquels Panafricanism or communism où il critique les Etats impérialistes qui utilisent l’étiquette communiste pour discréditer les mouvements panafricanistes. Quand le Ghana devient indépendant, Kwame Nkrumah le nomme conseiller aux affaires africaines. Il contribue à l'organisation de la conférence panafricaine d’Accra de 1958. Il est élu secrétaire général de la All African Peoples Conference et s’emploie à tenter d'unir les pays africains contre l’impérialisme et à dénoncer les religions et les rivalités ethniques comme facteurs de divisions. Il meurt le 23 septembre 1959 et est enterré en octobre avec des funérailles nationales.
c- Sylvester Williams
Henry Sylvester-Williams nait le 15 février 1869. D’autres sources situent sa naissance plutôt en 1867 en Barbade. Il rencontre le prince Koffi du royaume ashanti qui lui raconte la situation triste des ghanéens sous domination anglaise. Sylvester Williams est profondément touché, et réagit à cette souffrance ainsi qu’à celle des noirs dans les Amériques et les Antilles. Sylvester Williams grandit au Ghana. Il retourne à Trinidad, et travaille comme enseignant. Puis il continue ses études aux Etats-Unis et au Canada. Il poursuit ses études en Angleterre au collège des rois, avant que ce collège ne ferme ses portes aux noirs en 1894.
Il est de la classe moyenne. En tant que descendant d’esclave, beaucoup de portes lui sont fermées dans sa carrière professionnelle. En 1897 est créée l’association des africains, ayant pour objectifs l’unité et l’amitié entre les africains en général, la promotion et la protection des intérêts des descendants d’Afrique dans les colonies britanniques et autres endroits d’Afrique, la diffusion des informations sur tout ce qui affectent les droits et les privilèges des africains dans l’empire britannique. Sylvester Williams est le secrétaire général de cette association. L’association révèle au monde les atrocités de l’Angleterre dans les colonies anglaises et exige les réparations. Elle organise des rencontres publiques et des manifestations publiques. L’association devient très populaire.
William Dubois engage une série de voyages pour rencontrer les plus influentes personnalités noires de l’époque pour discuter avec eux du sort de leur race, et de ce qu’ils envisagent pour le devenir de cette race. Après cette série de voyages, une grande conférence panafricaine réunissant les personnalités noires les plus influentes est programmée. Sylvester Williams est le principal organisateur de cette conférence. Pour la première fois, sous l’impulsion de Sylvester Williams et autres panafricanistes, les plus grandes personnalités nègres se réunissent pour réfléchir, penser le devenir de leur race. Il décède le 26 mars 1911
d- Edward Blyden
Edward Wilmot Blyden naît le 3 août 1832 à Saint-Thomas, une île des Caraïbes. En mai 1850, le révérend Knox remarque la capacité intellectuelle hors du commun de Blyden et le recommande à l’école de théologie. Mais sa candidature est refusée. Il se rend aux Etats-Unis pour poursuivre ses études et se rapproche de l'American Colonization Society qui le convainc de poursuivre ses études au Liberia afin d’apporter sa contribution à la grandeur de l’Afrique. Blyden migre pour Monrovia. Entre 1852 à 1856, il suit les cours de théologie, de latin, de grec, de mathématiques, de géographie et d'orthographe à Monrovia. Dans les années 1860, il est nommé commissaire du gouvernement du Liberia pour les États-Unis. Blyden se rend aux États-Unis afin d'attirer des investissements pour le Libéria.
En même temps qu’il fait ce travail, Blyden rédige des ouvrages. Il rend hommage à plusieurs personnalités noires célèbres. Il montre leur contribution au monde. Il rappelle également le rôle de l'Afrique comme le « berceau de la civilisation ». Lors de son séjour en Égypte, Blyden s'émerveille de son passé millénaire des noirs. En 1872, il lance un journal intitulé The Negro, visant à consolider les liens entre tous les Africains. Il demande à ses frères de race de ne pas se sous-estimer face aux blancs. Il prône l’égalité entre toutes les races. Il s’attaque aux concepts dévalorisants que les noirs utilisent pour se qualifier. Il quitte le christianisme.
Contrairement aux autres panafricanistes qui se sont battus contre les lois injustes en Amérique et dans autres endroits de la diaspora, Blyden demande aux Noirs de rentrer en Afrique construire le modèle africain. Pour lui, le salut des noirs est en Afrique et nulle part ailleurs.
e- Antenor Firmin
Joseph-Anténor Firmin est né au Cap Haïtien en 1850. D'origine modeste, élève assidu et dur à la tâche, il commence à enseigner à l’âge de 17 ans. Il est titulaire d’une Licence es lettres de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Paris. Il est également Diplômé d'Etudes Supérieures d'histoire (Sorbonne) et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. En plus de ces disciplines, il étudie les mathématiques qui lui permettront de s’orienter vers la comptabilité commerciale. Il étudie aussi le Droit à l’université, ce qui lui permet d’exercer plus tard comme avocat. Antenor Firmin est un autodidacte. Il a eu l’essentiel de ses connaissances par ses propres recherches. Il travaille comme comptable pour le service des douanes d’Haïti, puis pour une maison de commerce. En 1875, il est agent percepteur de la commune du Cap, tout en donnant des cours de grec, de latin et de français dans un établissement privé. Il écrit et parle le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le grec et le latin et possède des connaissances d'un caractère encyclopédique.
Au XIXe siècle, l’Europe est assez forte pour dominer le monde entier. Pour que cette domination soit facilement acceptée par les peuples qu’elle s’apprête à dominer, l’Europe a besoin de les détruire psychologiquement avant d’engager leur destruction physique. Elle a besoin de justifier sa domination sur les autres peuples. Elle considère alors sa race et sa culture comme supérieure aux autres et se donne pour mission de civiliser les autres races. Certains penseurs européens élaborent les théories de l’inégalité des races, affirmant la supériorité de la race blanche sur les autres. Parmi eux, Gobineau publie son Traité de l’inégalité des races. Anténor Firmin s’oppose à cette violence symbolique de l’Europe. Il procède à une critique des thèses de Gobineau. En 1885, il publie son traité De l’égalité des races humaines, en réponse aux thèses racistes des européens tels que Gobineau. L’ouvrage de Firmin a été la seule réplique scientifique aux 26 thèses de Gobineau. Dès sa parution, son livre a été tellement dérangeant pour le milieu blanc qu’il a été ignoré dans les milieux cultivés. Ce livre a été réédité en 2004 par les éditions l’Harmattan.
Anténor Firmin entre en politique en intégrant le parti libéral d’Haïti. Dans ce cadre, il fonde le journal « Le Messager du Nord ». En juin 1883, il est envoyé à Caracas par le président Salomon pour les fêtes du centenaire de Bolivar. Mais ses idées et celles du président Salomon entrent en contradiction. Il refuse les postes ministériels que lui propose le président Salomon et s'exile à Paris où il devient membre de la Société d'Anthropologie. En 1888, il retourne à Haïti et participe activement aux événements qui renversent le président Salomon. L’année suivante, il est nommé ministre des Finances et des Relations extérieures par le président Florville Hyppolite. Il se distingue par ses compétences, ses pratiques et son honorabilité. Il réorganise les administrations qu'il dirige, notamment celles des douanes et de la Banque Nationale, diminue les taux d'intérêt, ce qui facilite la reprise rapide des affaires. Cette croissance augmente la popularité d’Anténor Firmin dans le pays, attirant en même temps la colère de ses adversaires.
Les Etats-Unis d’Amérique ont des visées coloniales vis-à-vis d’Haïti et Firmin s’en méfie. Les Etats-Unis essayent d’installer leur base navale à Haïti, au Môle Saint Nicolas, point stratégique pour le contrôle du Canal de Panama et de tout le bassin caribéen. Anténor Firmin s’oppose et empêche l’installation de cette base. Cette réussite est aussi le fait de la pression de certains noirs des Etats-Unis qui se sont opposés à l’installation de la base navale. En 1891, le président Hyppolite durcit son régime, ce qui amène Anténor Firmin à quitter le cabinet ministériel pour se retirer en France. La même année, il publie à Paris l’ouvrage Haïti au point de vue politique, administratif et économique. Dans cet ouvrage, il répond aux critiques émises par son successeur au ministère des finances d’Haïti. À Paris, il multiplie les contacts avec les milieux latino-américains et adhère au panafricanisme. Avec l’arrivée au pouvoir du président Sam en 1896, Firmin est rappelé comme ministre des Finances et des Relations extérieures, mais la chambre s’oppose à lui et il est renversé au cabinet ministériel. Firmin repart en exil.
L’affaire Lüders éclate en Haïti. Le riche commerçant allemand Lüders brutalise un policier haïtien. Il est jugé par la justice haïtienne et condamné. L’Allemagne réagit et mobilise deux canonnières non loin de la capitale haïtienne Port-au-Prince. L’Allemagne donne à la République haïtienne un ultimatum exigeant une indemnité de 2000$ comme frais de réparation. Toutes les puissances internationales suivent l’affaire pour mesurer la force d’Haïti et voir si le pays peut être colonisé. A cette période de la fin du XIXe siècle, presque tous les pays du monde ont été colonisés. Les quelques pays qui n’ont pas encore été colonisés sont menacés de l’être et tout acte de faiblesse d’un pays peut entrainer sa colonisation. Le président haïtien Sam cède à l’ultimatum allemand. Anténor Firmin voit en cet acte diplomatique un problème racial : « Quoi qu'on fasse, qu'on en parle tout haut ou qu'on veuille la voiler sous des subtilités sournoises, la question de la race domine fatalement le problème de la destinée d'Haïti. » L’orgueil et l’excès de zèle d’Anténor Firmin suscite la colère des grandes puissances engagés dans la colonisation du monde. Ces puissances voient en lui un obstacle à leur entreprise. La suite de sa carrière politique sera compliquée.
Firmin rentre en Haïti en 1902, au moment de la chute du président Tirésias Simon Sam. Ses partisans, appuyés par le général Nord-Alexis et l'amiral Killick entrent dans le gouvernement provisoire dirigé par Adolphe Boisrond-Canal. Firmin se prépare alors à l'élection présidentielle. Sa victoire à cette élection ne fait l’objet d’aucun doute. Mais les ambitions personnelles de Nord-Alexis le poussent à se retourner brutalement contre Anténor Firmin et à déclencher une sanglante guerre civile. Le président provisoire Boisrond-Canal se range au côté de Nord-Alexis, dénonce Killick. Les Etats-Unis d’Amérique également se rangent du côté de Nord-Alexis et combattent les révolutionnaires d’Anténor Firmin. Les pressions internationales se multiplient contre Firmin, lui demandant de mettre un terme à la guerre civile. L’Allemagne entre aussi dans la crise en prenant position contre les partisans d’Anténor Firmin. Elle tente d’arrêter l’Amiral Killick, le principal soutien d’Anténor Firmin, mais Killick préfère se suicider en coulant son navire. Cette perte porte un coup dur aux partisans de Firmin, qui est forcé de négocier. Il repart en exil en octobre 1902 et Nord-Alexis devient le président d’Haïti.
La situation économique se dégrade sous la présidence de Nord-Alexis. Les menaces d’une invasion étrangère du pays s’accentuent. A plusieurs reprises, les navires français et allemands menacent de bombarder la capitale haïtienne Port-au-Prince. Ne contrôlant pas la situation du pays, Nord-Alexis instaure un régime de terreur, particulièrement sur les populations les plus pauvres. Firmin de son côté tente de se rapprocher des Etats-Unis d’Amérique, mais continue d’appeler à la méfiance contre les prétentions impérialistes des Etats-Unis d’Amérique sur Haïti. Croyant Bénéficier du soutien des Etats Unis d’Amérique, ses partisans tentent un coup de force contre Nord-Alexis pour prendre le pouvoir, mais l’aide américaine promise n’arrive pas et ses partisans sont écrasés. Les chefs de l'insurrection sont fusillés. Après la perte de l’amiral Killick et de sa flotte, Firmin vient de perdre les principaux chefs de son mouvement. Il ne se relèvera pas de cette perte. En 1908, Antoine Simon remplace Nord-Alexis à la présidence d’Haïti et rappelle Anténor Firmin, mais craint de l’avoir trop près de lui. Il le nomme ministre et l’envoie à La Havane, puis à Londres. Firmin ne rentrera plus en Haïti. Il s'installe à Saint Thomas, où il publie plusieurs lettres dans lesquelles il met en perspective la construction d’une vaste confédération des Antilles pour résister aux prétentions impérialistes des grandes puissances de l’époque. Il redoute surtout l’impérialisme des Etats-Unis d’Amérique qui s’apprêtent à coloniser le reste de l’Amérique. Anténor Firmin meurt en 1911.
f- Benito Sylvain
Benito Sylvain est né le 21 mars 1868 à Port-de-Paix. Il fait ses études à Paris. Après son baccalauréat, il fait des études de droit et obtient une licence. Entre 1889 et 1890, il est secrétaire à la légation de Haïti à Londres. En 1890, il devient journaliste et fonde à Paris un journal appelé La Fraternité où il défend les intérêts d’Haïti et de la race noire. En 1893, il assiste au congrès antiesclavagiste de Bruxelles. Il essaie d’organiser les étudiants haïtiens en France en fondant en 1894 le cercle de l’union fraternelle dont son journal la Fraternité devient la tribune d’expression. En 1897, il part pour l’Éthiopie qui vient de remporter la bataille d’Adoua face au colonialisme italien et rencontre le roi d’Ethiopie Ménélik II. Avec Menelik II, il parle du sort des noirs à travers la planète et de la nature des rapports avec l’occident impérialiste.
En 1901, il soutient sa thèse intitulée Du sort des indigènes dans les colonies d’exploitation. Il retrace l’histoire de la traite et de l’esclavage moderne. Il accuse les Anglais et les Allemands d’être revenus sur le principe de l’abolition en colonisant l’Afrique, dénonce le sort qui est fait aux africains dans les colonies d’exploitation, la montée en puissance du préjugé de couleur dans des nations européennes. Il s’attaque aux missionnaires catholiques qui ont trahi, selon lui, la cause antiesclavagiste. Il se déclare être le représentant des Africains et Afro-descendants colonisés par la France.
Il meurt le 3 janvier 1915.
III- Les premières tentatives de matérialisation du panafricanisme
Ceux qui pensent le panafricanisme, au fur et à mesure, trouvent la nécessité de tenter de sortir leur idéologie des idées pour la matérialiser, la rendre vivante. Ils vont le faire à travers plusieurs initiatives.
1- Les initiatives des associations
a- L’UNIA
Pour mieux organiser son rêve panafricain, Marcus Garvey et quelques amis fondent en 1914 l'Universal Negro Improvement and Conservation Association and African Communities League (UNIA) à Kingston en Jamaïque. Cette organisation profite de la personnalité de son leader pour s’implanter à la conscience nègre. Elle dispose d’un organe de presse, le Negro World. Au milieu des années 1920, les membres de l’UNIA sont estimés à six millions de membres à travers le monde. La devise de l'organisation est « un Dieu ! Un but ! Un destin ! »
L’UNIA nait dans un contexte de crise sociale. Au lynchage des noirs, aux lois anti-noires s’ajoutent la situation salariale. L’afflux des noirs au nord des Etats-Unis favorise la baisse des salaires. Les travailleurs blancs voient en l’arrivée des noirs la cause de ce problème et renforcent la xénophobie anti-nègre. Les Noirs sont malmenés à travers toute l’Amérique, et ont besoin d’une organisation sociale qui peut leur permettre de se défendre, ce qui justifie leur enthousiasme à l’UNIA. En 1920, l'association revendique 1 100 sections dans 40 pays. Mais les États-Unis resteront la principale base de l'organisation, et ce jusqu'à nos jours. En Plus de son organe de presse, l'UNIA crée des organisations et des entreprises satellites, un groupe paramilitaire, les infirmières de la croix noire africaine, la société de la croix noire africaine, la Universal African Motor Corps, le Black Eagle Flying Corps, la Black Star Line (la ligne maritime de l'étoile noire), la Black Cross Trading and Navigation Company (la société de commerce et de navigation de la croix noire), et Negro Factories Corporation (la société des usines nègres).
L’UNIA se fixe pour but l’amélioration du sort des noirs partout à travers la planète, les indépendances africaines, le retour des noirs américains en Afrique. Il se donne pour but de construire une nation nègre, ayant pour drapeau le rouge, noir et le vert. Le rouge représente le même sang que partage tous les peuples africains et afro-descendants et aussi le sacrifice des ancêtres africains pour la lutte pour la libération des razzias négrières. Le noir symbolise la couleur noire qui unit tous les Africains et afro-descendants. Le vert symbolise l’abondance de la nature africaine. L’organisation décide de produire tout ce dont ont besoin les noirs, à travers ses industries et ses entreprises : restaurants, imprimeries, bâtiments pour location, compagnie maritime.
L’UNIA sait que la longue période de domination a agi sur la conscience du noir et de l’Afro-descendant. Il ne peut pas devenir un acteur de l’histoire s’il ne change pas sa manière de se voir, s’il ne détruit pas un complexe d’infériorité qui l’anime. Ce qui amène l’UNIA à créer des écoles de formation et à multiplier des appels à la grandeur. Marcus Garvey déclare que les noirs doivent se sentir égaux à tous les peuples. Il recommande d’abandonner les poupées à l’image des blancs pour fabriquer des poupées à l’image des noirs. Il déclare que la couleur noire est la couleur de la beauté. Pour étendre son influence, l’UNIA se rend compte que ceux qui influencent le plus la conscience noire et afro descendante sont des pasteurs et prêtres. L’UNIA les recrute dans l’organisation. L’UNIA demande que les chrétiens louent Dieu comme des noirs. Elle considère que Jésus et Marie était des noirs. L’UNIA à un moment ressemble à une organisation nationaliste chrétienne. Mais Garvey s’oppose à ce fait et beaucoup de prêtres et pasteurs quittent l’UNIA. Si l’UNIA, en parlant d’un Dieu noir reste attaché au christianisme, elle pose néanmoins le sérieux problème de la religion et du panafricanisme. Beaucoup de mouvements qui se sont inspirés de l’UNIA ont tout simplement opéré la rupture avec les religions étrangères et appellent aux croyances africaines, sans tenter d’africaniser ou de négrifier les religions étrangères.
Pour imposer ses idées, l'UNIA organise des manifestations publiques et adresse une pétition à la future Société des Nations pour demander à ce que les anciennes colonies allemandes en Afrique deviennent un État noir indépendant. La demande est rejetée. L'UNIA établit des contacts avec le gouvernement du Liberia pour y façonner ce rêve de nation nègre. Nouveau refus. A l’époque le Libéria fonctionne encore comme un Etat des Etats-Unis d’Amérique. A la mort de Garvey, le mouvement est fragilisé, mais parvient à survivre et continue son existence actuellement. Même si l’essentiel de ses buts n’ont pas été atteints, l’organisation a marqué la conscience noire pendant des décennies. L’UNIA reste le mouvement qui a eu le plus grand impact sur la conscience des noirs et afro-descendants. Il a, pendant des décennies, caractérisé le nationalisme nègre. Beaucoup d’organisations influentes comme Nation of Islam où a milité Malcom X, se sont inspirés de l’UNIA. Afrocentricité International d’Ama Mazama et Moléfi Kete Asanté s’en inspire grandement.
Si L’UNIA a beaucoup influencé la conscience noire, elle a aussi été critiquée par presque toutes les figures du panafricanisme de l’époque, et plus précisément Dubois qui qualifie Garvey et l’UNIA comme les plus grands ennemies et la race noire.
b- La LUDRN
En France, confrontés à l'injustice du système colonial et au racisme, influencés par les idées panafricanistes, les noirs du pays tentent de matérialiser ces idées de défense de la race noire dans une organisation. Ce qui pousse les leaders comme Tovalou Houénou et ses camarades à fonder la Ligue Universelle pour la Défense de la Race Noire (LUDRN) en 1924. L’organisation dispose d’un organe de presse appelé Les Continents. Ce journal prend pour principale cible le code de l'indigénat, une juridiction raciste qui renie aux colonisés leurs droits face aux blancs. Cette juridiction que la France applique dans ses colonies renie les droits des colonisés. Ce qui provoque les abus divers contre les colonisés. Le journal Les continents multiplie des articles contre cette juridiction raciale. Les critiques de la Ligue et surtout le combat des colonisés obligent la France à supprimer cette pratique. L’organisation dénonce aussi les abus des gouverneurs dans les colonies ainsi que ceux des députés africains. En 1926, Lamine Senghor change le nom de l’organisation en Comité de Défense de la Race Nègre (CDRN). Son successeur Tiemoko Garan Kouyaté la renomme aussi en Ligue de Défense de la Race Nègre (LDRN).
L’influence des penseurs populaires dans l’organisation comme René Maran lui donne une grande notoriété. Comme toutes les autres organisations panafricaines, le but de la LUDRN est la défense et la protection des droits des noirs et afro-descendants à travers la planète, le développement de la solidarité entre les populations nègres, et l’évolution de la race noire à travers l’éducation. A ses débuts l’organisation est financée par les contributions des membres et les activités culturelles, ce qui l’amène à multiplier des concerts et des séminaires publics.
Dès la création de le LUDRN, ses dirigeants décident de joindre leur mouvement à la grande mouvance panafricaine. Son principal leader Tovalu arrive aux Etats-Unis en 1924 et fait une série de conférences très suivies. Il échange avec les dirigeants de l’UNIA et tient des conférences à l’UNIA pour parler du combat de la race noire, de son mouvement et des objectifs de ce mouvement. Il se rapproche également de la NAACP de William Dubois. Dès son retour en France, Tovalu est expulsée au Dahomey (Benin), son pays natal. La France juge dangereux le rapprochement entre Tovalu et les panafricanistes des pays anglophones. Le départ de Tovalu fragilise assez le mouvement. Un article anonyme, sûrement de Blaise Diagne s’oppose au recrutement des noirs pour faire les guerres de la France. La France réagit et attaque le nouveau dirigeant du mouvement René Maran. Elle oblige le journal Les continents à arrêter de fonctionner en décembre 1924. La LUDRN ne survit pas à cet incident.
Malgré sa très courte vie, la LUDRN a beaucoup influencé la conscience nègre. Beaucoup de journaux et de mouvements s’en sont inspirés. La LUDRN a eu le malheur de se trouver dans la sphère de domination française, qui ne supporte aucune tentative d’autodétermination ou de revendication des noirs. Dans les autres sphères, la LUDRN aurait sûrement été l’un des plus grands mouvements de réveil de la conscience nègre dans le monde.
c- L’ENA
En 1926, s’inspirant des victoires d'Abd el-Krim au Maroc contre les français et les espagnols pendant la guerre du Rif et de la grande mouvance d’union des noirs à travers la planète, Abdel Kader Ali Hadj et quelques camarades créent l'Étoile Nord-Africaine (ENA). Elle mobilise les travailleurs du nord de l'Afrique pour parvenir à l'unité du Maghreb. Elle accorde de la sympathie aux mouvements panafricains nègres. Dès sa création, elle devient une section de l’union inter coloniale (groupe socialiste des originaires des colonies). Cette association, fondée en 1921 par un guadeloupéen, réunit entre autres le Vietnamien Ho Chi Minh et deux Algériens : Hadj Ali Abdelkader (1883-1957) et (Hamouche) Banoune Akli (1889-1983) qui joueront des rôles décisifs dans la décolonisation des territoires français. Les buts de l’ENA sont : la défense des intérêts sociaux, matériels et moraux des travailleurs de l’Afrique du Nord.
En 1927, l’arrivée de Messali
Hadj dans le mouvement le réoriente et le radicalise. Il engage le mouvement
sur le terrain politique en se faisant le porte-parole d'une revendication d'indépendance
de l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie au sein d'un ensemble national
que serait l'Algérie). Lors du congrès anticolonial de Bruxelles de février
1927, Messali Hadj opère une rupture
tranchée avec le colonialisme français. Il déclare : « le peuple algérien
qui est sous la domination française depuis un siècle n'a plus rien à attendre
de la bonne volonté de l'impérialisme français pour améliorer notre sort. »
C’est un appel implicite à la lutte armée de libération. Il demande l’abolition
du code de l’indigénat et toutes les mesures d’exception dans les colonies
françaises, l’amnistie pour tous ceux qui sont emprisonnés, en surveillance
spéciale ou exilés pour infraction au code de l'indigénat ou pour délit
politique, la liberté de voyage absolue pour la France et l'étranger, la liberté
de presse, d'association, de réunions, les droits politiques et syndicaux, le remplacement
des délégations financières élues au suffrage restreint, par un parlement
national algérien élu au suffrage universel, la suppression des communes mixtes
et des territoires militaires, le remplacement de ces organismes par des
assemblées municipales élues au suffrage universel, l’accession de tous les
Algériens à toutes les fonctions publiques sans aucune distinction, l'instruction
obligatoire en langue arabe, l’accession des arabes à tous les degrés de
l’enseignement, la création de nouvelles écoles arabes, la rédaction de tous
les documents officiels en français et arabe, l’application des lois sociales
et ouvrières, le Droit au secours de chômage aux familles algériennes en
Algérie et aux allocations familiales. Il revendique aussi l’indépendance de
l’Algérie, le retrait total des troupes françaises, la constitution d’une armée
nationale algérienne, d’un gouvernement national, d’une assemblée constituante
élue au suffrage universel… Ce discours révèle au public Messali Hadj,
jusque-là inconnu. En 1929, la France dissout l’ENA. Mais le parti continue
d’exister en clandestinité. Messali Hadj devient son président. L’ENA est à
nouveau dissoute en 1937 et ses dirigeants sont poursuivis. Messali Hadj crée
le Parti du peuple algérien (PPA) en mars 1937, qui poursuit les mêmes
objectifs que ceux de l'ENA
d- Le WANS
En décembre 1945, juste après le congrès panafricain de Manchester, Kwame Nkrumah crée le West African National Secretariat (WANS) et voyage en Grande-Bretagne et en France, où il rencontre les nouveaux élus africains tels que Sourou Migan Apithy, Lamine Guèye, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Le WANS compte parvenir à l’union des pays de l’Afrique de l’ouest. Il revendique l'indépendance complète et absolue des peuples d'Afrique occidentale comme l'unique solution aux problèmes soulevés par la domination coloniale. Nkrumah et son organisation sont ouvertement accusés d'être communistes dans les métropoles occidentales. Au sein du WANS, Nkrumah forme un groupe secret de socialistes révolutionnaires appelé le cercle. Le WANS dispose d’un organe de presse appelé The new Africa (La nouvelle Afrique), rédigé en trois langues (Anglais, Français et Belge). Le journal est centré sur les problèmes de l’Afrique de l’ouest.
Le retour de Kwame Nkrumah au Ghana fragilise considérablement le WANS.
e- Le RDA
En 1946, l’union française autorise les colonisés à se faire représenter en métropole. Les élections sont organisées dans les colonies et en France. Les élus africains décident d’organiser un congrès à Bamako, malgré l’opposition de la France. Alors que le dernier congrès panafricain de Manchester de 1945 a tablé sur les revendications de l’indépendance, Houphouët Boigny et quelques leaders, à l’issue du congrès de Bamako de 1946, créent le RDA (Rassemblement Démocratique Africain), pour unir tous les mouvements indépendantistes africains afin d’arriver à l’indépendance en formant un seul Etat. Les principaux mouvements indépendantistes de l’Afrique francophone adhèrent au RDA : UPC (Union des Populations du Cameroun), l'Union démocratique sénégalaise, l'Union soudanaise, l'Alliance pour la démocratie et la fédération de Haute-Volta, Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)… La base de regroupement est l’anticolonialisme. Le but du RDA est de rassembler la plus large union de forces politiques africaines, au-delà des clivages politiques, religieux, et culturels.
Le RDA devient la principale force anticoloniale de l’Afrique francophone. L’adhésion des intellectuels les plus influents comme Cheikh Anta Diop renforcent la notoriété du mouvement.
Le RDA est une double rupture. Elle est une rupture dans la continuité de la vision panafricaine initiée par les pères fondateurs. En fait elle est une rupture dans le mouvement panafricaniste mondiale, en se centrant uniquement sur les pays francophones. Cette logique a divisé le mouvement panafricaniste mondial. Elle est aussi rupture parce qu’elle donne une autre orientation aux partis politiques africains. Beaucoup de partis politiques en Afrique étaient affiliés aux partis politiques français ou aux organisations françaises. Beaucoup avaient été créées avec le soutien du parti communiste français qui les préparait à mieux affronter la colonisation française. La RDA vient fragiliser ces liens en proposant une plateforme de regroupement africaine aux partis politiques de l’Afrique française.
La France empêche les activités et initiatives du RDA. A son deuxième congrès de 1949 à Abidjan en présence de centaines de délégués, le RDA exprime sa solidarité avec les peuples du Vietnam en guerre contre la France et au peuple de Madagascar qui vient de subir une brutale répression sanglante de la France. Le RDA ressemble plus à un cadre de concertation des élus locaux. Houphouët Boigny prend la tête de l’organisation.
Les années 1949 et 1950 sont des années d’effervescence en Afrique, et plus précisément en Côte d’Ivoire. Les grèves se multiplient dans ce pays. La France réagit brutalement, faisant des assassinats, et fait enfermer plus de 3000 personnes parmi lesquels les élus du RDA. En 1950, Houphouët Boigny fait volte-face et est reçu à la présidence de la France. Il décide de collaborer avec la France. Alors que les députés du RDA au parlement français étaient dans le groupe communiste, en octobre, le RDA rejoint le groupe UDSR (parti centriste auquel étaient notamment affiliés René Pleven et François Mitterrand), et appartient dès lors officiellement à la majorité gouvernementale. En France, le RDA ne fait donc plus partir de l’opposition au gouvernement colonial. Il fait désormais partie intégrante du système colonial français. Face aux critiques, Houphouêt Boigny parle de repli stratégique. Le vice-président du RDA, Gabriel d'Arboussier, dénonce cette attitude et la considère comme une trahison. L'Union des populations du Cameroun et l'AERDA (Association des Etudiants du RDA), branche étudiante du RDA dirigée par Cheikh Anta Diop critiquent de manière virulente cette trahison d’Houphouët Boigny. Les principaux dirigeants du mouvement (Gabriel d'Arboussier, Djibo Bakary, etc) démissionnent. Houphouët Boigny profite pour exclure l'UPC du Cameroun et l'UDS du Sénégal en 1955.
En 1960, les territoires d’Afrique française deviennent indépendants. Les différents chefs d'État, imposés presque tous par la France, peinent à s'entendre sur l'application du fédéralisme prôné par le RDA. Presque tous les présidents imposés ont suivi la voie de la trahison initiée par Houphouët Boigny, et sont devenus des sortes de sous-préfets de la France en Afrique. De son coté, Houphouët-Boigny s'active à neutraliser politiquement les dirigeants les plus nationalistes du RDA et à les remplacer par d'autres, mieux disposés à défendre les intérêts du gouvernement français.
f- La NAACP
La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), Association nationale pour la promotion des gens de couleur est créée en 1909 sous l’impulsion de William Dubois. Elle dérive du Mouvement de Niagara, toujours initié sous l’impulsion de William Dubois. Le mouvement de Niagara visait à mettre fin au racisme dont était victimes les noirs. En 1908 aux Etats-Unis, les émeutes raciales éclatent entre les Blanc et les Noirs à Springfield, dans l’Illinois. Les Noirs sont les principales victimes. Le mouvement de Niagara ne peut pas agir. Il n’a pas assez de moyens et pas assez structuré. Le besoin d’une organisation d’avant-garde pour la lutte contre le racisme anti-noir se pose avec insistance. Ce qui pousse les principaux dirigeants du mouvement de Niagara à se réunir le 30 mai 1909 pour créer la National Negro Committee. Le 30 mai 1910, le National Negro Committe devient la NAACP.
Dès sa création, la NAACP s’est fixée pour objectifs : de promouvoir l'égalité des droits et éradiquer les préjugés raciaux ou les préjugés de classe parmi les citoyens des États-Unis ; promouvoir les intérêts des citoyens de couleur ; leur garantir des élections impartiales ; accroître leurs capacités à faire valoir leurs droits devant les tribunaux, à obtenir une éducation pour leurs enfants, et à trouver un emploi, en fonction de leurs compétences et dans le respect d'une complète égalité de tous les citoyens devant la loi. Elle s’oppose au refus du droit de vote aux noirs dans les Etats du Sud des Etats-Unis. Pour pallier aux difficultés économiques qui ont fait la faiblesse du groupe de Niagara, des demandes de soutiens sont envoyées à des personnalités américaines. Le mouvement veut défendre les droits de toute personne victimes de l’injustice, et plus précisément les non blancs. Dans sa première équipe dirigeante, il y a un seul noir, William Dubois lui-même. C’est en 1975 qu’un noir est devenu président de l’organisation.
Pour véhiculer ses idées, la NAACP de dote d’un organe de presse qui est The Crisis. Le mouvement bénéficie d’un grand apport financier de la communauté juive. Mais Dubois y joue le rôle central. Le mouvement attaque en justice les lois ségrégationnistes, comme les lois Jim Crow qui ont légalisé la ségrégation raciale dans les Etats du sud des Etats-Unis. En 1913, la NAACP est la tête de file de l'opposition à l'introduction par le président Woodrow Wilson de la ségrégation raciale au sein du gouvernement fédéral. Elle mène un combat pour l’intégration des Noirs dans l’armée, et pour qu’ils se battent pendant la première guerre mondiale. 700 000 Afro américains s'engagent dans l’armée, et 600 d'entre eux sont faits officiers. L'année suivante, la NAACP lance de nouvelles manifestations nationales contre la sortie du film muet de D. W. Griffith, Naissance d'une nation, qui fait l'apologie du Ku Klux Klan, un mouvement militaire anti-noir aux Etats-Unis. Plusieurs villes boycottent le film.
En 1917, la NAACP mène un autre combat à la Cour suprême des États-Unis contre la séparation des quartiers résidentiels des noirs et ceux des blancs. La NAACP consacre une part importante de son énergie à combattre le lynchage des Noirs partout aux États-Unis. En 1919 dans l’Arkansas, plus de 200 fermiers noirs ont été exécutés par des milices blanches, avec le concours des troupes fédérales appelées en renfort. Les fermiers noirs s'étaient réunis pour exiger de meilleurs prix pour leurs produits de la part de leurs propriétaires blancs. Après cet incident, douze fermiers noirs sont jugés et condamnés à mort. La NAACP se saisit de ce dossier. Les douze fermiers sont rejugés et acquittés. Malgré ces multiples victoires, la NAACP ne parvient à faire voter une loi contre le lynchage des noirs. La NAACP mène la lutte contre le système électoral des Etats du sud qui exclue les noirs des primaires, donc de la compétition électorale. Elle obtient un succès en 1944. Les États du sud sont contraints de modifier leur législation, mais ils mettent rapidement en place d'autres méthodes pour empêcher aux noirs de participer au processus électif. La NAACP entreprend une longue campagne pour le renversement de la doctrine du « séparés mais égaux » qui a été instituée par la Cour Suprême en 1896. Elle obtient d'abord le 27 juin 1941 du Président Franklin Delano Roosevelt l'interdiction de la discrimination raciale dans les emplois de l'industrie militaire. Le 30 juillet 1948 le Président Harry S. Truman fait abroger dans l'armée la séparation des soldats noirs et blancs. La NAACP mène également un combat contre la discrimination à l’université et en 1954, la Cour Suprême des Etats-Unis déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles élémentaires subventionnées par l'État.
Encouragée par cette victoire, la NAACP pousse ses actions en faveur d'une déségrégation complète dans l'ensemble des États du Sud. Le 5 décembre 1955, des militants de la NAACP, dont Rosa Parks, aident à organiser le boycott des bus de Montgomery, dans l'Alabama, pour protester contre la ségrégation dans les bus de la ville, dont les deux tiers des usagers étaient des noirs. Le boycott dure 381 jours. L'État de l'Alabama réagit en interdisant à la NAACP d'exercer ses activités sur son territoire, parce que celle-ci refuse de rendre publique la liste de ses membres. La NAACP redoute que ses membres ne soient licenciés de leur travail ou, pire, qu'ils fassent l'objet de représailles physiques en raison de leur engagement. La NAACP engage des poursuites contre l’Etat d’Alabama, mais perd le procès, et perd en même temps son leadership dans la défense des droits civiques des Noirs. Mais elle continue la bataille, et parvient à obtenir du président John Kennedy à déposer au congrès des Etats-Unis une loi en faveur des droits civiques avant d’être assassiné. En 1965, par la Civil Right Act, la loi fédérale, tous les noirs obtiennent le droit de vote dans tous les Etats. Depuis 1978, la NAACP finance les Afro-Academic, Cultural, Technological and Scientific Olympics (ACT-SO (Jeux olympiques afro académiques de la culture, de la technologie et des sciences).
g- La FEANF et le WASU
Les étudiants ne restent pas en marge de cette vaste tendance panafricaniste qui secoue l’Afrique et le monde noir en général. Parmi les multiples organisations qui se créent pour contenir ces idées panafricaines, deux jouent un rôle déterminant. Il s’agit de la FEANF (Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France) et le WASU (West African Students Union).
La Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France a été créée en 1950 afin de regrouper toutes les associations d'étudiants africains en France. Cette fédération dispose d’un organe médiatique appelé Le journal L'étudiant d'Afrique noire. Dans une période marquée par la lutte pour la décolonisation et l’émergence des idées panafricanistes, l’association sort rapidement de son objectif social et culturel pour prendre position sur l'actualité politique de l’Afrique. Elle prend des positions anticoloniales. Sous la direction du juriste togolais Noé Kutuklui et de l’économiste camerounais Osendé Afana, la FEANF opte pour la poursuite de la lutte pour l'indépendance et l'unité africaine en 1958. Elle dénonce les crimes commis par l'armée française en Algérie. Les autorités françaises réagissent et augmentent les loyers des étudiants africains, réduisent leurs bourses et surveillent les principaux leaders. Les étudiants qui militent dans l'organisation sont systématiquement fichés et leurs candidatures écartées dès qu'elles concernent des emplois publics.
La FEANF est de loin l’organisation estudiantine des étudiants d’Afrique la plus imposante en France. Elle a précédé beaucoup de partis politiques en Afrique francophone et a contribué grandement à la formation des leaders indépendantistes du continent. Si pendant la colonisation elle revendiquait l’indépendance, à partir de 1960 elle maintient ses méthodes et revendique désormais l’indépendance réelle. Elle considère les républiques africaines issues de ces indépendances comme des républiques fantoches. Avec l’OUA, elle dénonce l’échec du panafricanisme et estime que l’unité africaine doit être basée sur l’abandon volontaire de la souveraineté des différents peuples d’Afrique au profit de la Patrie africaine. Elle demande la suppression des bases militaires étrangères en Afrique, l’unité de l’Afrique, la participation à la gérance des fonds distribués par la France au titre de bourses d’études, l’orientation des études en France de façon plus conforme aux besoins de l’Afrique. La rupture entre la Chine et la Russie a de l’impact sur le mouvement. Les prochinois prennent le contrôle de la FEANF, ce qui crée des tensions entre la FEANF et sa plateforme l’UIE (Union Internationale des Etudiants). L’UIE cesse d’attribuer à la FEANF des bourses pour l’Europe de l’Est. Mais malgré cette divergence, tous les membres de la FEANF, toute tendance confondue, restent soudés dans la lutte contre le néocolonialisme et l’impérialisme. Après l’assassinat de Patrice Lumumba, la FEANF organise une grande manifestation qui se solde par de nombreuses arrestations et des expulsions.
Le WASU (West African Students’ Union) est créé en 1925 par Ladipo Solanke et Herbert Bankole-Bright à Londres en Angleterre. Avec l’arrivée des leaders comme Kwame Nkrumah, il devient un mouvement très puissant en même temps en Angleterre et en Afrique de l’ouest. Il a grandement influencé l’Afrique. Ses fondateurs ont voulu qu’il soit une organisation panafricaine. Il s’oppose au racisme anti-noir, et un de ses premiers soutiens est Marcus Garvey. Alors que les étudiants africains avaient du mal à trouver les logements en Angleterre, le WASU crée beaucoup d’Hôtels pour les recevoir. Le WASU disposait aussi d’un organe médiatique appelé The Journal of the West African Students’ Union. Comme la FEANF, le WASU finit par sortir de son simple rôle estudiantin pour toucher les questions politiques. Il demande d’abord la réforme du système colonial et finit par contester ce système et exiger sa fin. En 1942, le WASU demande au gouvernement britannique de donner l’indépendance aux colonies d’Afrique. Même si l’association dans son sigle porte Afrique de l’ouest qui renvoie à une partie de l’Afrique, le WASU recevait les étudiants de tous les coins d’Afrique. Parmi ses membres, on peut citer ceux qui n’appartenaient pas à l’Afrique de l’ouest, et qui ont joué un rôle politique de premier plan dans les colonies britanniques comme Jomo Kenyatta du Kenya ou and Hastings Banda du Malawi.
2-
Les
initiatives intellectuelles
a- La revue Présence Africaine
Influencés par les efforts pour l’émergence du panafricanisme qui se manifeste à travers la planète, Alioune Diop fonde en 1947 la revue Présence Africaine, éditée par la maison d’édition du même nom. Le but est de donner la parole aux noirs, de permettre aux Africains de penser leur continent. Alioune Diop souligne l’influence du congrès de Manchester dans la création de la revue Présence Africaine. Il avait pour but de vulgariser les idées panafricaines à travers la planète. Tels que défini par son créateur, la revue vise à définir l'originalité africaine et de hâter son insertion dans le monde moderne. La revue a un succès retentissant, et les Africains de renom y publient.
Alioune Diop sait que la France ne tolère aucune initiative venant des noirs, et il est conscient que la France, enfermé dans son statut de puissance coloniale, fermera la revue. Pour éviter la censure, il s’entoure de figures intellectuelles dont la légitimité est incontestable: Jean-Augustin Maydieu, Michel Leiris, Jean-Paul Sartre, André Gide, Albert Camus, Emmanuel Mounier, Théodore Monod, Georges Balandier, Marcel Griaule. Il met ces intellectuels français de renom dans le comité de patronage. La France ne peut donc pas facilement censurer la revue sans susciter une colère dans le monde intellectuel. Toujours pour éviter la censure de la France, il fait de Présence Africaine une revue culturelle et non politique. Il ne choisit aucune idéologie. Présence Africaine réunit tous ceux qui veulent s’exprimer sur l’Afrique. Une évocation politique aurait été fatale à la revue. A cette époque, la France vient de noyer dans le sang une revendication à Madagascar. Cette stratégie d’Alioune Diop porte des fruits.
En 1949, Alioune Diop crée la maison d'édition Présence Africaine, qui publie les livres les plus influents du monde noir à l’époque. Le premier ouvrage publié est celle du missionnaire belge Placide Tempels intitulé La Philosophie bantoue. Cet ouvrage suscite une vive polémique sur l’existence d’une philosophie africaine. Cette polémique renforce la renommée de la maison d’édition. L'année suivante, La Rue Cases-Nègres de Joseph Zobel est publiée par la maison d’édition. Ce roman revient sur la vie des Noirs aux Antilles, et reçoit aussi un écho retentissant en France.
Pendant les années 1950 et 1960, la revue milite activement en faveur de l'émergence d'une culture africaine indépendante. Elle offre une tribune de choix aux figures montantes du monde littéraire et politique. Dans cette revue, les intellectuels africains revendiquent l’indépendance d’une manière ou d’une autre, et contestent le colonialisme. En 1951, la revue produit un documentaire, réalisé par Chris Marker et Alain Resnais, Les Statues meurent aussi. Ce documentaire dénonce les méfaits de la colonisation. Le film a un succès et la même année, il reçoit le prix Jean-Vigo, mais il est censuré pendant une dizaine d'années. En 1956, Présence Africaine organise le premier Congrès des écrivains et artistes noirs, pour faire le point sur les avancées des Africains en terme d’écriture et d’art, et pour permettre aux artistes et écrivains de se concerter, d’échanger pour mieux orienter la pensée africaine. En fin 2009, on dénombre près de 300 numéros de la revue et environ 400 ouvrages parus. La revue et la maison d’édition Présence Africaine ont sans aucun doute boosté la pensée nègre. Parmi les africains qui ont publié, on peut citer : Mongo Beti, Amadou Hampaté Ba, Aimé Césaire, Bernard Dadié, Cheikh Anta Diop, Fatou Diome, Kwame Nkrumah, Wole Soyinka…
Présence Africaine n’est donc pas une simple revue et une simple maison d’édition, elle est instrument de combat et de solidarité des peuples africains. Les premiers venus comme Aimé Césaire, Senghor et Alioune Diop lui-même font les notes de lectures des ouvrages des nouveaux venus comme Mongo Beti. Plus tard, les derniers venus font les notes de lectures de ceux qui viennent après eux. Cette stratégie encourage les étudiants africains à publier des ouvrages. Alioune Diop fait partie des rares intellectuels sous domination coloniale à créer, diriger et imposer une revue consacrée au monde négro-africain. Si au début de la revue il utilise le label culturel pour échapper à la censure, à partir de 1949, la politique occupe une place forte dans la revue. Alioune Diop est parvenu à réunir autour de Présence africaine l’élite noire afro-américaine (Richard Wright, Countee Cullen), afro-antillaise (René Maran, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, René Ménil, L. T. Achille) ou africaine (Léopold Sedar Senghor, Sembène Ousmane, Cheikh Anta Diop, Bernard Dadié). Malgré les dissensions politiques, il a également su s’entourer d’intellectuels français pour proposer une perception nouvelle du temps présent.
Présence Africaine a donné aux Africains noirs, diaspora incluse, la possibilité de parler en leur nom, pour eux et à partir d’eux, de leur culture, de leurs arts, de leur littérature, de leur histoire, sans pour autant exclure l’héritage commun.
b- La Société Africaine de Culture
Elle a été également fondée sous l’instigation d’Alioune Diop en 1956. Elle est créée au premier Congrès des Écrivains et Artistes Noirs tenu à la Sorbone en France. Ses initiateurs sont surtout les rédacteurs de la maison d'édition Présence africaine, qui devient l'organe de communication de la SAC. En 1958, la SAC devient une organisation consultative de l’UNESCO. Des sections nationales sont mises sur pied au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Ghana, au Mali, aux États-Unis (en), en Haïti.
La SAC a pour mission d'unir par des liens de solidarité et d'amitié les hommes de culture du monde noir, de contribuer à la création des conditions nécessaires à l'épanouissement des cultures noires par les noirs eux-mêmes, de contribuer au développement et à l'assainissement de la culture universelle. Pour la défense de la culture africaine dont elle s’est fixée pour mission, la SAC organise des colloques comme ceux de 1958 et 1959 à Paris, celui de 1959 à Dakar, l’organisation du deuxième congrès des écrivains et artistes noirs à Rome, les colloques de 1961 (Abidjan, Paris et Venise), 1972 (Abidjan), 1973 (Yaoundé), 1974 (Dakar, Ouagadougou et Abidjan). Elle multiplie des publications pour faire entendre sa voix et réussir la défense de la culture dont il s’est fixé comme objectif.
Mais la SAC se transforme en un mouvement exhibitionniste, pour répertorier les cultures africaines et montrer au monde que les Africains possèdent aussi une culture. La SAC est contestée par les intellectuels comme Frantz Fanon.
IV- L’OUA et l’UA : L’échec consumé du panafricanisme
1- Les bases de l’échec
a- La mauvaise décolonisation du continent
Toute l’euphorie du panafricanisme, avec ses congrès, ses conférences, ses leaders et ses organisations vont échouer avec les indépendances. Dès le congrès panafricain de Manchester, Kwame Nkrumah avait posé la question centrale des indépendances africaines. A la conférence d’Accra de 1958, les premiers pays indépendants avaient pris la résolution de soutenir les mouvements de lutte dans les territoires africains encore colonisés. La pression se faisait sentir partout en Afrique contre les colonisateurs. L’UPC du Cameroun et le FLN d’Algérie étaient déjà en guerre ouverte contre le colonisateur français. Ils se feront bientôt rejoindre par l’ANC en Afrique du Sud, le Frelimo au Mozambique, le PAIGC au Cap-Vert et en Guinée Bissau, le MPLA, l’UNITA et le FNLA en Angola. Dans les autres territoires colonisés, la pression s’organise. Pour assurer la victoire de toutes ces initiatives, Kwame Nkumah recrute, forme et finance les nationalistes de toute l’Afrique. Il les forme au Ghana pour qu’ils rentrent dans leurs pays respectifs secouer le colonialisme étranger. Il est soutenu dans cette tâche par Gamal Abdel Nasser d’Egypte et Sékou Toure de la Guinée Conakry. Les trois leaders forment l’axe de lutte pour la véritable indépendance de l’Afrique.
Les colonisateurs se rendent compte que cette pression qu’ils subissent dans les colonies aboutira à leur chute. Si la lutte continue, les Africains obtiendront par la force les véritables indépendances. Les colons décident de faire tomber le projet de la véritable indépendance que Nkrumah, Nasser et Sékou Toure organisent. Les colons choisissent d’accorder l’indépendance massivement aux colonies en s’assurant d’évincer les nationalistes et de céder le pouvoir à des hommes entièrement sous leur contrôle. Ces hommes pour la plupart, n’ont pas été préparés à gérer un pays, et ne savent d’ailleurs pas le faire. D’autres ont même combattu l’indépendance de leurs pays et ceux qui la réclamaient. La France excelle dans cette logique, et s’assure que ce sont les plus incompétents qui prennent le pouvoir. Sachant que ses incompétents ne peuvent pas gérer un pays, la France déploie auprès d’eux des conseillers techniques qui sont en fait les véritables dirigeants des pays. Et ces présidents fabriqués par la France qui arrivent au pouvoir obtiennent pour mission de combattre et détruire tous les nationalistes. Ce qu’ils font avec une rage extrême. Le cas le plus significatif est celui d’Ahmadou Ahidjo du Cameroun, qui réprime l’UPC avec les armés françaises. Ce sont également les cas de Houphouët Boigny, Léopold Sédar Senghor…
Rares sont les leaders indépendantistes qui échappent à cette fabrication de l’ancien colon. On arrive donc à l’indépendance avec très peu de nationalistes et pleins de traitres, prenant leurs ordres des anciennes puissances coloniales et luttant pour préserver les intérêts des anciennes puissances coloniales. Ce sont ces hommes, qui ont été imposés massivement à la tête des pays africains par les anciennes puissances coloniales qui doivent agir dans la construction d’un Etat africain uni. Leurs maitres qui leur donnent les ordres ont toujours assis leur politique sur le divisé pour mieux régner. Ils ne peuvent pas tolérer la naissance d’un Etat africain uni. Dès les indépendances, le panafricanisme était déjà condamné à l’échec. Ce sont ces présidents aux ordres de l’étranger, avec l’appui de leurs maitres, qui vont plonger le continent dans notre situation actuelle. Ils vont brader les ressources des pays, installer des dictatures militaires, contracté des dettes énormes pour enrichir leurs maitres et condamner les peuples africains à rembourser, ils n’ont pas pris des initiatives en faveur du développement économique, condamnant l’Afrique à la misère, et les Africains à la fuite de leur continent. Ils ont continué la politique du diviser pour mieux régner de leurs maitres, créant un tribalisme à outrance qui met en péril le vivre-ensemble dans les pays. Ces présidents traitres sont protégés de l’extérieur. Quand ils sont menacés, les anciennes puissances coloniales qui leur donnent des ordres déploient leurs armées pour les protéger. En 1964, Léon M’Ba du Gabon est renversé par les jeunes officiers et réimposé au pouvoir par la France. Les anciens colons vont plus loin en renversant et assassinant tous les présidents qui refusent le schéma de soumission. Tout ceci porte le nom de la françafrique, puisque la France a excellé dans ce schéma. C’est elle qui a d’ailleurs mis sur pied ce schéma. Cette situation de décolonisation ne pouvait donc pas favoriser le panafricanisme.
b- Le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca
Si les puissances européennes qui ont installés leurs représentants à la tête des pays africains sont contre le panafricanisme, ils savent que l’idéologie s’est tellement implantée dans la conscience africaine qu’il est presque impossible de la combattre de front. S’ils dressent leurs hommes contre le panafricanisme, ces hommes risquent ne pas tenir longtemps et leurs plans risquent être mis très vite à nu. Ils transformeront même certains de leurs représentants en panafricanistes pour mieux détruire le panafricanisme. Léopold Sedar Senghor devient un grand panafricaniste. Même Ahmadou Ahidjo se proclame panafricaniste. Pour attaquer le panafricanisme, la France donne à ses représentants qu’elle a mis à la tête des pays africains l’ordre de refuser la construction immédiate d’un Etat africain uni. Ces ordres viennent rencontrer les orgueils nationalistes de certains pays qui redoutent un Etat africain uni.
Deux camps directs se constituent. Pour les uns, il faut organiser l’unité et préparer les consciences à un Etat africain uni. Pour les autres, il faut créer directement un Etat africain et le doter immédiatement de tous les éléments de l’Etat afin d’éviter de retourner dans une nouvelle domination étrangère. Les premiers forment ce qu’on a appelé le groupe de Monrovia. En 1960, plusieurs pays africains forment la Conférence des États Africains Indépendants. Ses membres partagent une vision commune du futur de l'Afrique et du panafricanisme. Ils s’opposent à un Etat fédéral africain. Du 8 au 12 mai 1961, ce groupe tient sa première réunion à Monrovia, la capitale du Liberia. Parmi ses membres, on compte le Nigeria et la plupart des pays d'Afrique francophone. Pour eux, les États africains nouvellement indépendants conservent leur autonomie et renforcent leurs structures, leurs armées et leurs économies. Ce groupe avait la supériorité numérique car pour être sûr de maintenir sa domination sur ses territoires pour longtemps, la France avait pris le soin de diviser ses colonies en de très petits Etats qui devaient se trouver obligés de revenir vers elle pour leur défense, leur développement. Or chaque Etat indépendant, qu’il soit grand ou petit, a une voix dans les décisions. La France, contrôlant l’essentiel des pays africains indépendants, contrôlait aussi le continent entier. Elle devait influencer le panafricanisme. Elle était la force de l’ombre qui a fait tomber le panafricanisme. Elle a horreur de tout acte salutaire pouvant venir d’Afrique. Pendant toute son histoire, elle a combattu et réprimé tout nationalisme noir dans ses colonies ou dans les territoires qu’elle influence. Elle ne pouvait pas tolérer un Etat africain uni. Sur les 32 pays africains qui se réunissent pour créer l’OUA, 17 sont des anciennes colonies françaises, et presque tous les présidents de ces pays ont été mis sur pied par la France. En y incluant le Rwanda et le Burudi qui, bien que colonies belges, subissent une grande influence française, on comprend que le panafricanisme était parti pour échouer. Presque toutes les anciennes colonies françaises se sont massivement rangées dans le groupe de Monrovia pour faire échec à l’Etat fédéral d’Afrique.
Le groupe de Casablanca de son côté réunissent les nationalistes africains qui, craignant une nouvelle recolonisation du continent, optent pour la création immédiate d’un Etat africain fédéral. Les membres de ce groupe voient l’avenir du continent dans le panafricanisme. Parmi les tenants de ce groupe, nous pouvons citer : l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, la Guinée Conakry, la Libye, le Mali et le Maroc. La première réunion du groupe se tient à Casablanca en 1961. Elle réunit les figures les plus importantes du continent, tels Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali et Ahmed Sékou Touré de Guinée. Leur point commun est leur croyance en la nécessité de créer une fédération à l'échelle du continent. Ils pensent qu'une intégration forte permet à l'Afrique de se défaire du colonialisme, d'établir la paix, de promouvoir le dialogue interculturel, de développer l'influence géopolitique du continent et d'engager son développement économique.
En 1963, les deux groupes rivaux
se réunissent. Le groupe de Monrovia gagne avec le nombre. Au lieu d’un Etat
fédéral africain uni capable de protéger le continent, est créée l’Organisation
de l’Unité Africaine (OUA), fondée sur les idées du groupe de Monrovia. Les
frontières coloniales sont approuvées, l’idée de l’Etat africain uni est
rejetée, le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays est
approuvé. La nouvelle organisation panafricaine a donc été vidée de tout son
contenu panafricain. Dès sa naissance, elle montre ce qu’elle allait devenir,
c’est-à-dire une réunion de chefs d’Etat pour discuter de leurs problèmes et se
séparer. Le grand rêve nourri pendant des décennies vient de se briser par la
volonté d’une France et ses représentants qu’elle a installés dans les pays
africains. L’Etat africain uni est devenu un mythe. La logique de chacun pour
soi prime, ce qui donne la possibilité aux anciens colonisateurs d’évincer ce
qui reste de nationaliste sur le continent, pour ne laisser que leurs
représentants qui sont sous leurs ordres pour mieux détruire le continent
c- L’éviction des présidents nationalistes et le triomphe du néocolonialisme
L’échec du panafricanisme brise en même temps la solidarité et l’entraide qui avait caractérisé le combat contre les impérialistes étrangers. Ne pouvant survivre seul, chaque pays se sent obligé de se tourner vers les anciens colonisateurs. Toute l’Afrique retombe dans une nouvelle colonisation, plus connue sous le terme de néocolonialisme.
Les leaders nationalistes sont combattus, traqués et assassinés. Toutes les mesures sont prises pour qu’ils ne parviennent jamais au pouvoir. Ceux qui, malgré ces restrictions, parviennent à arriver au pouvoir sont contraints de se conformer à la logique néocoloniale. En cas de refus, ils sont renversés par coup d’Etat et la plupart de temps ils sont tués. Un coup d’État est une tentative illégale et manifeste de l’armée ou de l’élite au sein de l’appareil d’État de renverser l’exécutif en place. Ces coups d’Etat sont fiancés par les anciennes puissances coloniales qui mettent sur pied des rébellions dans les pays dirigés par les nationalistes, financent ces rebellions, les arment, les forment et les dressent contre le régime qui a refusé de se soumettre. Les rebellions sont les plupart de temps plus armées que les armées nationales. Au cas où la rébellion ne parvient pas à opérer un coup d’Etat, les puissances occidentales se déploient eux-mêmes sur le terrain comme cela a été le cas en Côte d’Ivoire et en Libye. Tous ceux qui avaient soutenus les mouvements nationalistes sont victimes de coup d’Etats qui se multiplient. Tous les leaders qui ne se soumettent pas au néocolonialisme et qui refusent de prendre des ordres des anciennes puissances coloniales sont renversés ou victimes de tentatives de coups d’Etat. Les anciennes puissances coloniales, s’appuyant sur leurs représentants à la tête des pays africains, nettoient le continent de tout ce qui est nationaliste et progressiste. Même ceux qui sympathisent avec le nationalisme sont victimes. En 1960, il y a tentative de coup d’Etat contre Hailé Selassié d’Ethiopie, la répression sanglante est renforcée contre l’UPC du Cameroun qui lutte pour la véritable indépendance du pays, aboutissant au génocide des Bamilékés. En 1960, le premier ministre du Congo Patrice Lumumba, qui lutte pour que les ressources du Congo servent prioritairement les congolais est renversé et assassiné le 17 janvier 1961. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio du Togo qui a voulu créer sa monnaie et sortir du Franc CFA est renversé et assassiné. Le 17 février 1964, les militaires gabonais renversent Léon Mba, mais la France le réimpose au pouvoir. Le 19 juin 1965, Ahmed Ben Bella qui était l’une des figures du groupe de Casablanca est renversé par Houari Boumédiène. En 1966, Kwame Nkrumah, la figure emblématique du panafricanisme, est renversé à son tour. Le 19 novembre 1968, c’est le tour de Modibo Keïta du Mali, une autre figure du groupe de Casablanca. La mort de Gamal Abdel Nasser finit de fragiliser le rêve d’un Etat africain uni. Ceux qui avaient porté ce rêve ont été presque tous balayés. Il ne reste que Sékou Touré de la Guinée Conakry qui, pour survivre durcit son régime. Malgré cela, des tentatives d’assassinat se multiplient contre lui. Les anciennes puissances coloniales détruisent le panafricanisme et tout ce qui est nationalistes. Mais de nouveaux nationalistes et panafricanistes ne cessent d’émerger, forçant leur entrée à la scène, renversant eux-aussi des présidents imposés de l’extérieur. C’est le cas par exemple du Coup d’Etat en Libye de 1969 par Mouammar Al Kadhafi, celui de Thomas Sanakara au Burkina Faso ou la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Les nationalistes africains et les puissances néocoloniales sont engagés dans une véritable épreuve de force. L’émergence des régimes d’Assimi Goita au Mali, de Damiba Traoré au Burkina Faso et Doumbouya en Guinée ne sont que l’une des manifestations visibles de ce bras de fer qui est rude et où tombent constamment des têtes. Que ce soit les nationalistes africains ou les néocolonialistes, chacun reçoit des coups. Le salut des africains reste et demeure le panafricanisme et la nation africaine unie que la France empêche par tous les moyens la réalisation.
2- Les manifestations de l’échec
L’OUA symbolise donc l’échec du rêve panafricain nourrit depuis des siècles et dont la réalisation s’est engagée depuis des décennies. Cet échec s’est manifesté sur plusieurs aspects :
a- La sacralisation des frontières coloniales
Dès la création de l’OUA, se pose la question des frontières issues de la colonisation. Pour les uns, il faut maintenir ces frontières. Pour les autres, il faut les contester et les reconfigurer selon la volonté des Africains. La Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) réunie au Caire, opte en faveur du principe de l’intangibilité des frontières en Afrique, le 21 juillet 1964. Ce principe «déclare solennellement que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance ». Il s’agit d’une interdiction faite aux Etats membres d’exprimer toute revendication territoriale ou de vouloir procéder à une modification du tracé colonial. Si les objectifs avancés sont d’éviter les conflits, ce principe a pour but de maintenir l’Afrique en petits Etats non viables, obligés de toujours avoir recours aux anciennes puissances coloniales. Ce principe aussi favorise les nationalismes dans les petits Etats d’Afrique en détruisant la conscience panafricaine qui avait nourri les mouvements de libération des pays africains. La nouvelle organisation l’OUA accepte donc les frontières issues de la colonisation et annonce leur intangibilité. Les Etats africains sont donc les fabrications des luttes coloniales pour la conquête des territoires. Les Etats sont à l’image des anciennes puissances coloniales.
Malgré ce principe, les guerres de sécession et les guerres transfrontalières se sont multiplient en Afrique. C’est pour régler ces conflits l’OUA crée une commission chargée de régler les problèmes frontaliers et les mouvements séparatistes entre les États. C’est la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage (CMCA). Mais les résultats de cette commission ne sont pas visibles. Aux difficultés financières s’ajoute le fait qu’elle n’est pas saisie lors de plusieurs conflits transfrontaliers.
b- Les conflits frontaliers
Dès la création de l’OUA et l’échec du sentiment panafricain, les nouvelles idées sont aux replis nationaux. Le principe d’intangibilité des frontières amène chaque pays à protéger ses frontières issues de la colonisation ou à chercher à l’agrandir. Certains pays contestent ces frontières et des mouvements organisés dans certains pays trouvent ces frontières arbitraires et luttent pour exister comme pays indépendant. Les guerres se multiplient sur le continent au nom des frontières. En 1963, l’Algérie et le Maroc s’affrontent sur le tracé de la frontière dans la région de Figuig. La médiation de l’OUA favorise un cessez-le-feu, laissant la frontière inchangée. Mais en 1976, les deux pays s’affrontent de nouveau à propos du Sahara occidental. L’OUA et l’UA ont du mal à se prononcer sur la République arabe sahraouie Démocratique (RASD). Elle est admise à l’OUA en 1982, mais le Maroc se retire de l’OUA deux ans plus tard. L’UA a du mal à se prononcer sur la question. L’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique) ne reconnait pas aussi ces frontières et vise la création d’un grand Etat musulman transfrontalier. Les Touaregs repartis en 5 pays (le Niger, le Mali, l’Algérie, la Libye et le Burkina Faso) sont en guerre pour créer un Etat non calqué sur les frontières coloniales. Malgré la violence de la répression, ils continuent de se battre. En 1978, c’est la Libye qui est en guerre avec le Tchad à propos de la Bande d’Aouzou. En 1974 et en 1985, le Burkina Faso et le Mali s’affrontent au sujet de l’Agacher. De plus, le Burkina Faso se dispute avec le Bénin pour le contrôle de la zone frontalière de Kourou-Koalou. Un autre différend oppose le Burkina Faso au Niger. Le Burkina Faso est aussi entré en conflit avec le Ghana au sujet du village de Katunga, dans le cercle de Tenkodogo au Burkina Faso. Le Ghana a aussi eu des mésententes frontalières avec le Togo, sans oublier les conflits Cameroun-Nigéria, Niger-Benin, Sénégal-Mauritanie… 57 % de ces conflits n’ont pas été résolus non par l’OUA-UA, mais par la Cour Internationale de Justice. Aux conflits frontaliers se sont ajoutés les guerres de sécession comme celle du Biafra au Nigéria, celle de l’Ambazonie au Cameroun, celle de la Casamance au Sénégal, celles du Katanga, Kivu, Kwilu et Haut Congo, Kasai au Congo… L’Erythrée et le Sud-Soudan se sont imposés comme des pays indépendants après des décennies de luttes de libération. Même l’intangibilité des frontières issus de la colonisation décidé par l’OUA-UA n’a pas pu être respecté, et la même organisation a reçu ceux qui ont contestés ce principe et ont revendiqué leurs indépendances. L’Erythrée et le Sud-Soudan qui se sont opposés à ces frontières coloniales acceptées par l’OUA-UA sont aujourd’hui membres de l’UA.
Le président Nyerere de la Tanzanie Julius Nyerere de 1962 à 1985 a traité l’intangibilité des frontières comme une doctrine cynique qui ne reconnait pas le droit d’autodétermination des peuples. Ce d’autant plus que seulement le tiers des Etats africains ont des frontières tracées. En plus, les frontières coloniales n’ont tenu compte d’aucune spécificité des populations, mais seulement des appétits territoriaux des puissances coloniales. Le cas des Touaregs est très parlant. Les Touaregs se trouvent dans 5 Etats, et le principe d’intangibilité des frontières leur refuse toute tentative de constituer une entité politique autonome, à moins d’être assez fort comme le Sud-Soudan et l’Erythrée.
c- La divergence monétaire
Au lieu d’une monnaie unique que devait instituer un Etat fédéral africain, chaque pays indépendant a institué sa monnaie. Les pays francophones ont adopté une même monnaie, contrôlée et décidée par leur ancienne puissance coloniale la France. Cette disparité monétaire rend les échanges commerciaux très faibles. Même le Franc CFA partagé entre plusieurs pays africains nuit aux échanges de ces pays à cause de sa parité fixe et de son rattachement à l’Euro. L’UA a tenté de mettre sur pied la monnaie de l’Union pour faciliter le commerce entre les Etats membres, mais en vain. La CEDEAO a également tenté de mettre sur pied une monnaie commune appelée l’Eco. Mais l’initiative n’a pas réussie.
d- La divergence des politiques de gouvernement
Dès l’accession à la souveraineté des pays africains, chaque pays a défini sa propre politique de gouvernement, au lieu d’une politique de gouvernement commune que prônait le groupe de Casablanca. D’une part, nous avons des pays pluralistes qui ont gardé une scène politique animée par plusieurs partis politiques, malgré le système de parti unique qui était à une époque pratiquée par presque tous les pays africains. Seulement 5 pays africains ont pu maintenir ce système pluraliste entre 1960 et 1990. Parmi ces pays, nous avons le Sénégal, l’île Maurice, la Gambie, le Botswana et le Zimbabwe. Mais la première transition politique à l’île Maurice est en 1982. Au Sénégal, malgré son pluralisme, c’est en 2000 qu’un parti politique de l’opposition a pu prendre le pouvoir. La Gambie a été dirigée par un seul homme jusqu’en 1994, date de son renversement par un coup d’Etat militaire. Au Zimbabwe, depuis son indépendance en 1980, c’est récemment que Robert Mugabe a quitté le pouvoir. Mais à partir de 1990, presque tous les pays africain ont adopté le pluralisme politique, avec plusieurs partis politiques qui animent la scène politique.
A côté de ces 5 Etats pluralistes, presque toute l’Afrique a basculé entre 1960 à 1990 au système de parti unique, avant d’être contraints par les soulèvements populaires à adopter le pluralisme. Ces partis uniques sont en même temps libéraux comme l’UNC d’Ahmadou Ahidjo au Cameroun, socialistes comme ceux de Julius Nyerere en Tanzanie, Sékou Touré en Guinée ou Houari Boumedienne en Algérie. Pour justifier le système de patrti unique, plusieurs leaders s’appuient sur la volonté de développement et de l’unité nationale. Pour beaucoup, l’introduction du parti unique, la suppression de la séparation des pouvoirs et la mainmise sur l’ensemble de l’appareil étatique étaient présentées comme la meilleure façon de faire le développement. Mais au fond, c’était un moyen utilisé par les anciennes puissances coloniales pour maintenir leur domination sur l’Afrique en obligeant les progressistes et révolutionnaires à se conformer à la logique du parti unique que leurs hommes contrôlaient. Pour les progressistes et révolutionnaires, en adoptant le parti unique, il fallait surtout consolider leur pouvoir et empêcher aux anciennes puissances coloniales de s’appuyer sur l’opposition pour les renverser.
Certains pays sont marxistes, et se qualifient comme des socialistes. Parmi ces pays, nous pouvons citer le Bénin entre1974-1991, Madagascar, du Congo-Brazzaville, L’Éthiopie sous Menguistu Hailé Mariam (1974-1991), le Mozambique. Mais parfois le marxisme était utilisé juste pour attirer les faveurs de l’Union Soviétique. Les cas de véritable marxisme étaient le Mozambique et l’Ethiopie.
D’autres pays encore sont des régimes populaires, s’appuyant sur leur grande capacité de mobilisation du peuple. Ces régimes s’appuient sur leurs peuples et sont capables, en cas de problème, de soulever leurs peuples, et de les dresser contre un ennemi commun. Ce sont des régimes nationalistes qui ont la confiance et l’adhésion de leurs peuples, et en qui leurs peuples croient, et sont prêts à faire d’immenses sacrifices pour eux. Il s’agit de la Libye de Mouammar Al Kadhafi, du Burkina Faso sous Thomas Sankara, de l’Ouganda sous Yoweri Museveni, du Ghana sous Kwame Nkrumah et Jerry Rawlings. Les régimes populaires sont généralement marxistes, avec un surplus qui est l’adhésion sans réserve du peuple à leur idéologie, et aussi leur grande capacité de mobilisation populaire. Ces régimes s’appuient sur la constitution de comités de défense de la révolution, de tribunaux populaires qui sont une manière de donner le pouvoir au peuple. Ces régimes rompent avec les anciennes puissances coloniales et donnent des espoirs au peuple.
En plus des régimes populaires, nous avons les régimes sultanistes, reposant sur des sultans disposant de la direction administrative et militaire de l’État. Il s’agit de régimes dirigés par un homme fort ayant pour seul but de se maintenir au pouvoir. Ce sont des régimes particulièrement sanglants, reposant sur l’arbitraire du chef qui s’attribuent des pouvoirs dans tous les domaines, y compris divin parfois. Ils sont brutaux et recourent excessivement à la force ; ils ne sont limités dans leur arbitraire ni par des principes moraux, ni par des institutions. En Centrafrique, J. Bokassa s’est fait couronner empereur à vie et a transformé la république en empire. Au Cameroun, nous avons Ahmadou Ahidjo qui n’est pas allé jusqu’à s’attribuer des qualités divines et royales comme Bokassa.
En Afrique du Sud, dominait un système violent de division et de répression raciale appelé le régime de l’Apartheid. Ce système a aussi été appliqué en Namibie et au Zimbabwe. L’apartheid se caractérise par l’exclusion de la majorité de la population, notamment les Noirs, des instances de participation et de concurrence politiques par la minorité raciale blanche. Les possibilités d’expression politique, notamment les élections, sont réservées aux seuls Blancs. Le système repose sur la main d’œuvre de la majorité noire pour faire fonctionner l’économie et préserver les privilèges des Blancs, tout en continuant à exclure les Noirs du jeu politique et des retombés économiques. Il repose aussi sur la confiscation de plus de 80 % des terres par la minorité blanche, l’interdiction des mariages mixtes, la séparation dans les autobus, les stades de football, les villes et les plages, l’introduction d’un passeport pour les Noirs voulant rester en ville…
e- La divergence des politiques économiques
L’Etat fédéral que rêvait le groupe de Casablanca devait faire un développement économique harmonieux du continent, utilisant les ressources du continent pour le bien-être du continent. Tandis que certains pays du continent figurent parmi les économies les plus dynamiques du monde, d’autres sont les plus pauvres de la planète. Si certains pays ont un contrôle sur leurs économies, d’autres dépendent encore presqu’entièrement des anciennes puissances coloniales qui exploitent leurs richesses, les imposent une économie de traite (vente des matières premières et achat des produits manufacturés). Tous les pays africains subissent la détérioration des termes de l’échange (ce sont les acheteurs qui fixent les prix des produits africains). Toujours est-il, l’échec du panafricanisme a renvoyé drastiquement certains pays africains à une chute économique drastique. Diverses politiques économiques ont été mises sur pied. Certains pays comme l’Afrique du Sud se sont lancés à un développement industriel. L’essentiel des pays africains ont pratiqué l’économie de traite. D’autres encore se sont lourdement endettés pour financer la bureaucratie au lieu de poser les bases d’un développement.
3- Les faiblesses de l’OUA et de l’UA
L’OUA et l’UA se sont donnés pour buts l'unité et la solidarité des pays d'Afrique, la défense de l'intégrité et de la souveraineté de ces pays, l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent et de la recherche scientifique et technologique, la promotion internationale des positions africaines communes et enfin l'harmonisation et la coordination des politiques économiques régionales. Cette organisation repose sur les principes tels que l'égalité entre les États membres, le respect des frontières, le règlement pacifique des conflits, la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement ou encore le droit des États membres à solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité. Malgré ces objectifs et ces principes, le bilan de l’OUA-UA est triste dans une grande mesure.
a- Le conflit entre les organes de l’UA
Il s’agit plus précisément de la conférence des chefs d’Etat et les organes techniques de l’organisation comme la CUA, le CPS ou l’ECOSOCC. En 2002 par exemple, la CUA et le CPS votent une intervention des casques verts de l’organisation contre le Burundi de Nkurunziza. Mais les chefs d’Etat refusent l’application de cette décision. Même si au fond cette décision ne reposait que sur la haine des médias occidentaux contre le régime de Nkurunziza.
b- Le non-respect des décisions prises
Beaucoup de pays ne respectent pas les décisions de l’Union Africaine. En fait elle ressemble à un lieu de concertation des Etats africains. Ce qui fait que ses décisions n’ont pas de grandes valeurs aux yeux des Etats. C’est ce qui a poussé le président rwandais Paul Kagame à lancer une réforme de l’UA en 2006. Son rapport final stipule : « En ne suivant pas de manière systématique la mise en œuvre des décisions que nous avons prises, nous avons envoyé le message qu’elles n’avaient aucune importance. En conséquence, notre organisation est dysfonctionnelle, les États membres y accordent peu de valeur, les partenaires mondiaux y trouvent peu de crédibilité et nos citoyens n’ont pas confiance en elle. » Le parlement panafricain est devenu coercitif, avec la capacité à obliger les pays à appliquer ses décisions, mais tous les pays n’ont ratifié la charte de ce parlement.
c- Le maintien de la rupture entre les révolutionnaires et les autres dirigeants modérés
Malgré le fait que le camp des
révolutionnaires et progressistes de Casablanca ait échoué devant celui de
Monrovia à la création de l’OUA, ils continuent de lutter dans l’organisation
pour orienter le continent vers le progrès et la libération définitive. Dans
presque tous les conflits, ou toutes les situations, ils prennent des positions
en faveur des mouvements révolutionnaires ou progressistes, ou en faveur de la
libération du continent. En 1964 sur la
crise congolaise, deux blocs se forment. Ces blocs se trouvent plus dans
presque toutes les situations. Les Etats révolutionnaires et les régimes plus ou
moins socialistes rejettent à la fois Moïse Tshombe et le néo-colonialisme qu’il
représente à leurs yeux. Les pays modérés invoquent le droit de non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats membres écrites dans les textes de
l’OUA pour refuser une intervention de l’OUA au Congo.
d- Le NEPAD
Le NEPAD est le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, adopté par l’Union Africaine comme un projet global de développement à long terme du continent. Il est issu de deux plans de développement : le plan Omega d’Abdoulaye Wade et plan Millénium African Plan de Thabo Mbecky. Interviewé sur les causes de l’échec du NEPAD, un de ses penseurs, Abdoulaye Wade, a déclaré que les partenaires ne réagissent pas. Le NEPAD est en fait la matérialisation suprême de la mentalité coloniale issue des fausses indépendances. Il rompt avec les idées d groupe de Casablanca. Les membres du groupe de Casablanca savaient que si la nation fédérale n’existait pas, le continent entier retournera dans le néocolonialisme, avec pour point d’achèvement la mentalité de colonisé exprimée dans le NEPAD. Alors que les pays émergents se battent à compter sur leurs ressources, leurs capacités pour se libérer de la dépendance extérieure et penser leur développement véritable, les pays africains pensent le progrès de l’Afrique en comptant sur les poches des autres. Autrement, les partenaires étrangers doivent donner des fonds pour que les pays africains puissent se développer. C’est comme planifier les dépenses de sa famille en comptant sur les poches du voisin qui ne cherche qu’à nous dominer et qui n’a jamais voulu notre évolution. C’est à cela que ressemble le NEPAD. Il a pensé les financements extérieurs dans presque tous les domaines de la vie africaine. Même si le NEPAD réussit, le prix sera la perte définitive de tout ce qui nous reste comme semblant de liberté. Cela montre aussi la mentalité des dirigeants qui ont pris le contrôle du continent et nous ont conduit vers le chaos actuel.
Les pays africains qui utilisent l’argent des partenaires impérialistes pour leur développement ne peuvent pas résister sérieusement contre la domination étrangère. Ils sont dépendants et acceptent tous les diktats des puissances impérialistes qui financent leur développement. Ils bradent les ressources de leurs peuples pour bénéficier de quelques financements des impérialistes. Heureusement que les pays comme le Rwanda ont fait des progrès considérables sans compter sur les partenaires étrangers que prône le NEPAD. Le pays a réduit sa dépendance à l’aide extérieure. Le Cap-Vert également est devenu un pays à revenu intermédiaire en mobilisant ses propres ressources, tout comme le Burundi. Ces pays ont compris que le NEPAD est suicidaire pour eux s’ils veulent préserver leur dignité. Le NEPAD est en fait suicidaire pour l’Afrique. C’est une manière de certifier que les Africains ne peuvent que compter sur l’extérieur pour leur développement. Cette mentalité est issue de la mauvaise décolonisation de l’Afrique, et des présidents néocoloniaux que les anciens colons ont imposés à la tête des pays africains. L’Afrique dispose de la plus grande densité de ressources naturelles dans le monde et de la population la plus jeune et la plus dynamique du monde, le NEPAD, au lieu de chercher comment mobiliser ces deux ressources pour impulser le développement, dans une mentalité très rétrograde, cherche des partenaires étrangers qui vont financer les projets de développement du continent. C’est la mentalité de mendiant qui caractérise les présidents imposés à la tête de nos pays par les puissances extérieures.
La plupart des fonds du NEPAD
sont alloués au renforcement de la gestion étatique, même si ces États sont de
plus en plus contestés et mal aimés par des populations qui n’y trouvent plus
leurs intérêts. Le NEPAD s’appuie sur les institutions d’intégration régionale
de l’Union Africaine qui sont peu performantes. Le NEPAD est aussi un moyen de
répression des régimes que les anciennes puissances coloniales n’apprécient
pas. Ces anciennes puissances coloniales
avaient pris acte pour une épreuve de force contre Zimbabwe de Robert
Mugabe en 2003. Mais les tergiversations de l’Union Africaine et la position de
Thabo Mbecky, l’un des fondateurs du NEPAD a privé le NEPAD de beaucoup de ses
soutiens, qui voulaient voir la chute du régime zimbabwéen. Thabo Mbecky a
estimé que Robert Mugabe menait un combat juste pour la défense de la race noire
opprimée par la race blanche au Zimbabwe, alors que les pays occidentaux
avaient placé le pays sous-embargo et optaient pour une solution militaire de
l’Union Africaine pour déloger le président Mugabe. Cette position de Thabo
Mbecky n’a pas plu à beaucoup de bailleurs de fonds qui ont tout simplement
réduit ou arrêté leurs soutiens. Le NEPAD est donc aussi en quelque sorte un
soutien conditionné ayant pour but d’évincer les nationalistes africains. C’est
un instrument de répression aux mains des puissances européennes qui le
financent, comme c’est également le cas de l’Union Africaine. Pour Kunle Amuwo,
« une lacune essentielle du NEPAD est son incapacité ou son refus d’expliquer
le sous-développement de l’Afrique comme résultat du colonialisme et de l’impérialisme
mais aussi comme conséquence des mauvaises politiques menées par les dirigeants
africains ». On ne peut pas penser un développement de l’Afrique sans
revenir à ces fondamentaux, à la cause de sa situation actuelle et au rôle
trouble des anciennes puissances coloniales.
V- Les efforts de redressement du panafricanisme
Comme nous venons de le voir, l’Organisation de l’Unité Africaine a consacré la chute du panafricanisme. Mais l’idéologie était déjà assez imposante pour accepter cette chute. Des organisations, des personnalités vont tenter de redresser ce panafricanisme et le porter au triomphe. Les Africains et afro-descendants sont conscients que c’est leur seule voie de survie. Ces efforts relèvent de la nécessité et non de l’utilité. Le racisme qui était au fondement des idées panafricanistes perdure à travers la planète. Si les lynchages de noirs ont considérablement diminué, ils n’ont pas cessé. La colonisation de l’Afrique pour laquelle le panafricanisme s’était dressé a muté en néocolonialisme, et la situation des noirs n’a pas beaucoup progressé. Le panafricanisme reste donc entier, ce qui justifie l’âpreté de la lutte pour le redressement du panafricanisme.
1- La poursuite des conférences et congrès panafricains
Les conférences et congrès panafricains sont de grandes rencontres entre les personnalités les plus influentes du monde noir et de l’Afrique pour organiser le combat panafricain. Ces conférences avaient permis de vulgariser le panafricanisme et de le structurer. Ces conférences étaient l’élément fondamental même du panafricanisme. L’OUA devait normalement se transformer en une vaste tribune ressemblant à ces conférences et congrès. Mais elle s’est transformée en réunion des chefs d’Etat pour discuter de leurs problèmes, et s’est coupée drastiquement des populations africaines. Ce qui a nourri la reprise des conférences et congrès.
a- Le congrès de Dar es Salam
C’est le sixième congrès panafricain. Il se tient en juin 1974 à Dar es Salam, en Tanzanie. Elle critique l’OUA pour son échec et son abandon du panafricanisme. Pour les congressistes, il faut relancer la dynamique panafricaine qui a échoué avec l’OUA. A l’époque où se tient ce congrès, beaucoup de pays africains sont encore sous domination étrangère. Il s’agit de l’Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Zimbabwe et de l’Afrique du Sud. Les cas du Zimbabwe et de l’Afrique du Sud sont une lutte non contre la colonisation étrangère, mais contre des régimes racistes et anti-nègres imposés dans ces pays par les minorités blanches. Dans tous ces pays, des mouvements de libération mènent une âpre lutte de libération. Le sixième congrès entend apporter son soutien à ces mouvements qui utilisent la lutte armée pour défendre leurs droits.
b- Le congrès de Kampala
Le sixième congrès avait annoncé que le septième se déroulerait en Libye. Mais l'ingérence du guide libyen Mouammar Kadhafi dans les affaires intérieures des pays africains amène à une annulation de la capitale libyenne comme ville hôte de ce congrès. Le septième congrès se tient finalement du 3 au 8 avril 1994 à Kampala, en Ouganda. Huit-cents délégués des pays et organisations prennent part à ce congrès. Au total, deux mille personnes participent au congrès, certains comme délégués, et d’autres comme invités. Il souligne l’incapacité de l’OUA à empêcher le génocide qui se passe au Rwanda et sur la période de la fin du régime de l’apartheid en Afrique du Sud. Le président ougandais Yoweri Museveni ouvre le congrès. Les congressistes discutent des réparations des différentes oppressions subies par les noirs à travers l’histoire.
c- Le congrès de Johannesbourg et d’Accra
Ce congrès se tient d’abord à Johannesbourg en Afrique du Sud, du 14 au 16 janvier 2014. C’est le huitième congrès panafricain. Il accueille 160 participants de vingt pays. Les organisateurs de ce congrès rejettent les représentants officiels des États africains, en prétextant que le congrès de Kampala avait été confisqué par les représentants du gouvernement ougandais. Les représentants rejettent également la participation des Arabes d’Afrique sous motif de l’esclavage pratiquée par les arabes sur la race noire. Beaucoup refusent de donner le nom de congrès à cette rencontre prétextant qu’elle viole la logique des congrès de William Dubois, dans la mesure qu’elle a été exclusive. Du 5 au 7 mars 2015, un huitième congrès concurrent est organisé à Accra au Ghana, incluant cette fois les Arabes d’Afrique et les représentants officiels des Etats.
2- Les efforts de redressement au niveau culturel et médiatique
Il faut préciser que beaucoup d’entreprises que nous allons citer ne sont panafricaines que de nom. Ils utilisent le panafricanisme juste pour faire fructifier leurs affaires, et n’apportent aucun soutien aux mouvements panafricains, tandis que d’autres sont fondamentalement panafricanistes.
a- L’Agence Panafricaine de presse
L'Agence panafricaine de presse (PANAPRESS) est née de la volonté de quelques États et opérateurs privés africains de doter l’Afrique d’un outil de communication privilégié. Elle est créée le 20 juillet 1979 par une convention signée par les ministres de l’information de l’OUA réunis à Addis-Abeba, et commence ses activités à Dakar le 25 mai 1983. Elle fait l’objet d’une liquidation en octobre 1997, en tant qu'agence spécialisée de l'OUA. Elle prend alors le statut de Société Anonyme regroupant des actionnaires publics, privés et de la société civile, avec un capital de 12,9 millions de dollars. Son but est de produire et diffuser un flux d’informations qui mettent en exergue les réussites et les échecs d’une Afrique en devenir. Elle dispose d'un réseau d’une centaine de journalistes et de photographes basés dans les différentes capitales africaines et dans deux bureaux extérieurs situés à New York (États-Unis) et à Paris (France). C'est le réseau de correspondants le plus dense du continent.
b- Le festival africain des arts nègres
Ce festival est organisé en avril 1966 à l'initiative de la revue Présence Africaine et de la Société africaine de culture. Le président sénégalais Léopold Sédar Senghor assure l’organisation. Elle est placée sous le patronage de l’UNESCO. Le but est de parvenir à une meilleure compréhension internationale et interraciale, d’affirmer la contribution des artistes et écrivains noirs aux grands courants universels de pensée et de permettre aux artistes noirs de tous les horizons de confronter les résultats de leurs recherches.
Des personnalités de tous horizons participent au festival : André Malraux, Aimé Césaire, Jean Price Mars, Duke Ellington, Joséphine Baker, Langston Hughes, Aminata Fall, Robert Hayden et bien d'autres. Tous les arts sont représentés : arts plastiques, littérature, musique, danse, cinéma… Elle est organisée par des spécialistes africains et français. C’est la première exposition d'art africain d'envergure internationale, montrant des œuvres issues de collections publiques et privées du monde entier. Les spécialistes, écrivains et des artistes de toutes les nationalités se rencontrent pour débattre des productions artistiques de l'Afrique.
Mais ce festival entre dans le cadre de l’exhibition des collections africaines, sans un véritable effort de défense et de promotion de la culture africaine. Les pays progressistes trouvent en ce festival la possibilité de donner de la légitimité à un régime néocolonialiste, anticommuniste et conservateur. Les pays comme Cuba, la Guinée Conakry, le Ghana et l’Algérie n’y participent pas. Des artistes de renom comme Myriam Makeba ou Paul Robeson refusent de s’y rendre. Les communistes sénégalais persécutés par Senghor s’opposent à cette reconnaissance internationale donnée à un dictateur françafricain. D’autres éditions sont organisées plus tard. Trois ans après, l’Algérie organise le Festival panafricain d’Alger.
c- Le festival panafricain d’Alger
Avec les critiques du festival africain des arts nègres, l’Algérie lance le Festival panafricain d'Alger en juillet 1969. Il est axé sur la culture de l'ensemble du continent et pose les bases d'une politique culturelle africaine à l'échelle continentale. C’est l'une des plus grandes manifestations culturelles d'Afrique. Elle regroupe des artistes et des intellectuels africains, ou issus de la diaspora africaine. Elle se déroule en 1969 puis en juillet 2009 à Alger. Les pays indépendants sont conviés à ce festival. Pour les pays encore colonisés, ce sont les mouvements de libération de ces pays qui les représentent au Festival Panafricain d’Alger : le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA), le Parti africain de l’Indépendance de la Guinée et du Cap vert (PAIGC), l’African National Congress (ANC)…
Le festival comprend des concerts, des spectacles de rue, des expositions, des projections, des concours ainsi que des conférences. Les disciplines représentées sont : la musique, la danse, le théâtre, la littérature, le cinéma et les arts visuels. Son ouverture est fêtée par une parade dans les rues d'Alger au cours de laquelle défilent tous les pays participants. Les leadeurs africains de mouvements de libération et les Black Panthers des Etats-Unis d’Amérique sont présents. Le festival est organisé sous l’égide de l’OUA, présidée cette année par le président algérien Houari Boumediene. L’Algérie, après la chute de Nkrumah au Ghana, de Nasser en Egypte, d’Olympio au Togo ou de Lumumba au Congo, reste le plus grand symbole de la lutte anti-impérialiste, après sa victoire militaire sur la France. C’est fort de ce prestige qu’elle invite l’Afrique entière et sa diaspora à venir célébrer l’africanité sur son territoire.
Le festival vise à faire la promotion de l’indépendance africaine, car plusieurs pays africains sont encore colonisés. Le festival montre aussi la réussite des indépendances déjà acquises. L’Algérie compte aussi affermir son prestige international par l’organisation dudit festival. Les figures les plus prestigieuses de l’art et de la culture assistent au festival. Miriam Makeba qui avait refusé d’assister au festival des arts nègres de Senghor assiste à ce festival. Des spectacles se succèdent aux expositions, aux tables rondes, aux compétitions théâtrales et aux conférences.
A la fin du festival, un manifeste est dressé, statuant sur les réalités de la culture africaine, le rôle de la culture africaine dans les luttes de libération nationale et dans la consolidation de l’unité africaine, le rôle de la culture africaine dans le développement social de l’Afrique. Il rappelle le fait que les Africains ont souffert grandement du colonialisme qui a implanté une domination politique et a tenté d’éradiquer les cultures et les personnalités africaines. Il précise que l’unité des peuples africains prend existence dans le destin partagé, la lutte fraternelle de libération contre la même oppression et donc d’un avenir qui doit être assumé en commun. Le manifeste appelle au développement de l’esprit africain, un retour aux sources, l’inventaire des valeurs africaines et de celles qui ont été imposés par des éléments étrangers, l’abandon des schémas culturels qui ne servent plus, l’enrichissement de la culture africaine des acquis sociaux, scientifiques et techniques récents pour amener la population vers la modernité et l’universalisme. Le manifeste estime que la culture africaine considérée comme exotique, un objet d’intérêt pour les musées occidentaux comme cela a été visible au festival des arts nègres de Dakar, doit réaffirmer sa place dans le monde en tant qu’entité vivante. L’éthique africaine, sa solidarité, son hospitalité, sa fraternité, sa spiritualité et sa sagesse tous véhiculées par voie orale et écrite, au travers le conte, les légendes, les dictons et proverbes se doivent d’être une inspiration pour les artistes et artisans de cette culture en marche. Le manifeste estime que par une lutte totale pour la décolonisation, les masses africaines pourront se réapproprier leurs cultures et leurs ressources nationales. Grâce aux apports de ces richesses et des technologies le continent aura finalement la chance de se développer économiquement et de se joindre au concert d’une civilisation universelle.
Plusieurs suggestions seront faites notamment : le rapprochement interculturel, une assistance économique et technique intra-africaine, l’échange d’information, la réforme du système d’enseignement et l’éducation des masses, un rétablissement véridique de l’histoire africaine, la protection de la propriété intellectuelle, le rapatriement des œuvres et archives pillées par les occidentaux, l’usage des instances internationales pour faire avancer le combat africain.
Les artistes de leur côté, au sortir du festival, proposent aux dirigeants de l’OUA la création de l’Union Panafricaine des Cinéastes lors d’une prochaine rencontre à Addis-Abeba. Cette organisation deviendra la FEPACI, aujourd’hui située à Nairobi au Kenya. Les cinéastes encouragent la création d’un festival du film africain. Cet élan consolidera le Festival de cinéma africain de Ouagadougou. Les éditeurs demandent aux dirigeants de l’OUA de donner les outils pour que l’industrie du livre puisse jouer son rôle dans la décolonisation culturelle africaine. Ils créent la Commission d’Édition et de Diffusion du Livre Africain (C.E.D.L.A.) ayant son siège à Alger.
Le Panaf (Festival Panafricain d’Alger) vise brièvement la promotion d’un panafricanisme révolutionnaire, avec la culture comme un élément de lutte de libération. Son vaste échos et ses retombés sont de très loin comparables à ceux du Festival des arts nègres organisés par l’UNESCO, la Société Africaine de Culture et Senghor. C’est plus l’image néocolonial et dictatorial de Senghor qui réduit la portée du festival des arts nègres, mais aussi sa nature visant plutôt une exhibition de la culture africaine qu’à sa véritable promotion comme objet de progrès et comme un élément vivant.
c- Le deuxième Festival panafricain d'Alger
La deuxième édition du festival s'est déroulée en juillet 2009, soit 40 ans après celle de 1969. Elle a rassemblé 49 pays africains ainsi que les États-Unis, le Brésil et Haïti. Elle porte sur la diffusion des œuvres africaines. Elle comprend des rééditions de livres d'auteurs africains ou traitant de l'Afrique, des concours (de nouvelles, de BD...) et elle est divisée en plusieurs festivals spécialisés : Festival de littérature et de livre jeunesse, Festival de théâtre, Festival de la Bande dessinée, Festival Diwane et Jazz, Festival de danses populaires...
d- Les autres festivals mondiaux des arts et de la culture nègres
Le deuxième Festival mondial des Arts et de la Culture nègres et africains réunit à Lagos en 1977 plus de 700 délégués africains autour du thème « civilisation noire et éducation». Au cours de ce festival, Léopold Sédar Senghor du Sénégal tente d’empêcher aux maghrébins d’assister au festival. Ce qui décroit sa réputation mondiale. Mais le Nigéria, pays hôte, préfère recevoir toutes les délégations au festival. En 2010 se tient à Dakar le troisième Festival international des arts nègres et se place sous le signe de « la Renaissance africaine, du métissage culturel et du dialogue entre les peuples ».
e- Le fespaco
Au festival panafricain d’Alger de 1969, les cinéastes avaient demandé une plateforme de concertation et de diffusions de leurs films. Cette demande aboutit en 1972 au Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou au Burkina Faso. Le festival vise à primer les meilleures productions cinématographiques du continent, dans différentes rubriques. Parmi les prix se trouve le prix Thomas Sankara.
f- Afrique media et vox africa
Vox Africa est une chaine de télévision panafricaine appartenant à l’homme d’affaire Paul Fokam, et dirigé par sa fille Rolande Kammogne. La chaine de télévision diffuse ses programmes dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle contribue à la diffusion les idées panafricanistes.
Afrique média pour sa part est la chaine qui a le plus popularisé les idées panafricaines récemment. La chaine de télévision s’est spécialisée sur la dénonciation du néocolonialisme. Si la chaine a le plus véhiculé les idées panafricanistes, elle les a aussi le plus travesti, mettant dans le panafricanisme les présidents répressifs à la solde des puissances étrangères comme Paul Biya du Cameroun, Idris Deby du Tchad ou Obiang Nguema Mbazogo de la Guinée Equatoriale.
3- Les entreprises panafricaines : ASKY, ECOBANK, UBA, NSIA
Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est une société anonyme créée en 1985 à l’initiative de la Fédération des chambres de commerce d’Afrique de l’Ouest avec le soutien de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le principal actionnaire est le Fonds de coopération, de compensation et de développement (Fonds de la CEDEAO), bras financier de la CEDEAO. Ecobank est présente plus de 35 pays d’Afrique de l’Ouest, centrale, de l’Est et du Sud. Elle dispose d'une filiale à Paris, France et des bureaux de représentation à Londres, au Royaume-Uni, à Dubaï aux Emirats Arabes Unis et à Beijing en Chine
En 1948, British and French Bank Limited (BFB) démarre ses opérations au Nigeria. Le 23 février 1961, après l'indépendance du pays, la BFB devient UBA. Le Nigéria devient l’actionnaire majoritaire. En 2008, UBA rachète plusieurs banques en faillite et s’établit dans plusieurs pays africains : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ouganda, Sierra Leone, Liberia… Elle se proclame panafricaine.
Asky est une compagnie aérienne panafricaine basée au Togo. Elle a été fondée en 2007, sous l’impulsion de Charles Konan Banny et Yayi Boni. Le vol inaugural de la compagnie Asky a eu lieu le 14 janvier 2010, entre Lomé et Ouagadougou. Sa création a pour but de remplacer la compagnie Air Afrique, disparue en 2002. ASKY couvre actuellement 22 destinations réparties dans 20 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Le Groupe NSIA quant à lui est un groupe d’assurances et de banques d’Afrique centrale et de l’ouest. Il se proclame aussi panafricaniste.
4- Les universités d’Amérique du Nord et l’université kamite
Des départements d'études africaines existent dans de nombreuses universités d'Amérique du Nord depuis les années 1960. Ama Mazama, professeur antillaise enseigne en Pennsylvanie, ainsi que Théophile Obenga professeur congolais, qui enseigne dans l'État de Californie.
Pour aller plus loin dans le panafricanisme, Afrocentricité International a lancé une université afro centrée, avec des diplômes de Master et de Doctorat. Bien que leurs diplômes ne soient pas encore officiellement reconnus, c’est une grande avancée dans le domaine de la rupture épistémologique (manière de pensée) avec la pensée occidentale. Ces efforts pourront se généraliser quand d’autres organisations panafricaines prendront la relève. Plusieurs écoles kemites existent aussi dans le monde pour la formation d’un nouveau type d’Africain. Plusieurs organisations panafricaines comme la Ligue Associative Africaine ont lancé leurs propres programmes de formation.
5- Le kemitisme
Le kémitisme ou khémitisme (ou netjerisme en France), est un ensemble de croyances et de pratiques qui s'inspirent librement de la religion de l'Égypte antique. Les kémites vénèrent les divinités égyptiennes et ils suivent aussi les lois de Maât (justice). Les kemites partent du fgait que toutes les religions sont des dérivés de la religion égyptienne originale. Au lieu d’aller vers des religions dérivées, il faut retourner à la source de la religion, qui est fondamentalement nègre. Les kemites sont montheistes, même s’ils vénèrent les divinités secondaires comme Isis, Nephtys. Les kemites sont de plus en plus nombreux à travers la planète. Le kemitisme offre au panafricanisme en construction une religion négro-africaine authentique. Les kemites demandent aux Africains de pratiquer le culte des ancêtres qui n’est qu’une manifestation de la religion originale d’Egypte pharaonique. Les kemites s’opposent à toute religion qui n’est pas directement liée à la religion originale de l’Egypte pharaonique. La plupart des lieux de culte et de son clergé sont en Amérique.
6- Le néo panafricanisme
Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence d’un nouveau panafricanisme caractérisé par une influence grandissante des masses populaires. Ce nouveau panafricanisme est particulièrement virulent contre les puissances impérialistes, et plus précisément la France. Ce nouveau panafricanisme est plus présent dans les pays francophones. Il dénonce la nature des relations entre l’Afrique et l’occident, relations qui ont conduit à la paupérisation de l’Afrique et des Africains. Il revient sur la question du Franc CFA et le rôle trouble des multinationales dans le développement de l’Afrique.
Ce nouveau panafricanisme a ses nouvelles lacunes. Il fait une étude parcellaire de la situation africaine. Il revient très peu sur la décolonisation mentale des Africains eux-mêmes. Il est plus critique et ne propose pas un schéma global, ou un projet de société viable à l’Afrique. Certains de ses leaders font même appel à la Russie pour supplanter les puissances occidentales, ce qui rompt avec la vision indépendantiste qui animait les pères fondateurs du panafricanisme. Les néo panafricanistes n’interrogent pas assez le rôle des africains dans leur propre et situation et rejettent presque toute la responsabilité à l’autre, ce qui ne pourra pas permettre la véritable libération du continent, car c’est en étant conscient de ses erreurs qu’on cherche à les corriger. La nation africaine unitaire pensée par les pères fondateurs occupe une place marginale dans ce néo panafricanisme.
Mais au-delà de ces manquements, le néo panafricanisme a, par sa capacité de mobilisation, présenté au peuple africain son véritable ennemi, qui est la France néocoloniale, elle-même le fruit du capitalisme mondial, qui est à sa phase impérialiste.
7- Le panafricanisme révolutionnaire
Le panafricanisme révolutionnaire est juste le retour au panafricanisme original défendu par les pères fondateurs. Il a pour objectif principal la proclamation de l’Etat africain uni. Pour cela, il fait une analyse objective des situations actuelles, établi des responsabilités et opte pour la création et le renforcement des mouvements de libération à travers le continent et sa diaspora, comme l’avait suggérés les conférences de Manchester, d’Accra et le congrès de Kampala. Il combat les puissances néocoloniales en Afrique et vise une lutte politique, économique et sociale pour la proclamation de la République africaine unitaire. Il met un accent particulier sur le réveil des consciences, la formation de la population africaine, qu’elle considère comme le gage principale de la réussite du rêve panafricain. Il se situe dans la logique des congrès et conférences panafricaines.
8- Les nouveaux porte-flambeaux du panafricanisme
a- La Ligue Associative Africaine
Créée en 2013 à Maroua au Cameroun, la Ligue Associative Africaine réunit les organisations panafricaines à travers la planète pour parvenir à la proclamation d’une nation africaine unie qu’elle appelle la République de Fusion Africaine. Elle dispose aussi des entreprises économiques comme la SOPAGRI (Société Panafricaine d’Agriculture). Elle a lancé un programme éducatif (Les études panafricaines), pour la formation des populations africaines. Elle résume les ouvrages, produit des livres et articles pour orienter et former la population africaine afin de la rendre apte à construire une nation africaine unie. L’organisation est présidée par le politicien Yemele Fometio. Pour fixer son combat au sein des masses africaines, la Ligue Associative Africaine organise des conférences, tables-rondes, des émissions télévisées ou radiodiffusées, des commémorations… La Ligue Associative africaine dispose de plusieurs organes de presse. Avec sa chaine Youtube éponyme, elle contribue à la vulgarisation de ses idées.
b- La ligue Panafricaine UMOJA
Elle est créée en 2010 pour soutenir la libération de la famille africaine mondiale (Afrique et diaspora) et l’organisation des conditions d’un processus d’unification politique pour parvenir à un Etat africain uni qu’elle appelle les Etats-Unis d’Afrique. Elle est présente dans plusieurs pays africains : Cote d’ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Mali, Niger, Burundi, Congo, RD Congo, Espagne, France. L’Organisation est actuellement présidée par l’historien Amzat Boukari-Yabara. Pour la Ligue Panafricaine Umoja, c’est seulement en mutualisant leurs efforts au sein d’un Etat fédéral panafricain que nos pays sauront assurer la sécurité politique, économique, militaire et culturelle essentielle à leur développement. Pour fixer son combat, la Ligue Panafricaine Umoja organise ou anime des journées d’échanges, colloques, conférences. Elle fait des formations, commémorations. Elle dispose d’une chaine Youtube permettant de visionner ses interventions, portant son nom. Elle dispose aussi d’un organe de presse appelé Panafrikan et d’une maison d’éditions.
c- Les Economic Freedom Fighters
Les Combattants pour la liberté économique (Economic Freedom Fighters) est un parti politique sud-africain fondé en 2013 par d'anciens membres du Congrès National Africain (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud. L’organisation est présidée par l’opposant sud-Africain Julius Malema, un ancien membre de l’ANC. Les Combattants pour la liberté économique exigent la redistribution des terres et la nationalisation des mines sans compensation. C’est la question de la redistribution des terres qui avait animé le combat de l’ANC. Mais une fois au pouvoir, elle n’a pas fait des efforts dans ce sens. En 2014, les combattants pour la liberté économique obtiennent 6.35 % des parlementaires de l’assemblée nationale. Et remporte 8,31% des voix aux élections municipales de 2016. Lors des élections générales de 2019, le parti améliore son score, remportant 10,79 % des suffrages et progresse dans toutes les élections provinciales. Les combattants défendent les noirs en Afrique du Sud et accusent l’ANC d’avoir vendu les noirs à la minorité blanche. Ils appellent à l’union des peuples noirs à travers la planète. Son leader Julius Malema s’oppose à tout acte de xénophobie contre les noirs en Afrique. En avril 2015, à la suite de l'appel de Julius Malema à détruire tous les monuments et statues liés à l'histoire des Blancs sud-africains, des membres des Economic Freedom Fighters détruisent des monuments à travers le pays. En 2016, les Combattants pour la liberté économique font des manifestations violentes dans les universités pour que l’Afrikaans soit remplacé par les langues africaines. Dans certaines universités, ces manifestations dégénèrent en bagarres entre étudiants noirs et étudiants blancs.
d- Afrocentricité International
Afrocentricité International soutient l'élévation spirituelle, culturelle, éducative et économique des négro-africains qu’elle appelle les kamites en allusion à leur teint noir. La méthode utilisée par l'Organisation est l'Afrocentricité. Elle a pour but de réaliser la renaissance africaine qu’elle appelle le Uhem Mesout, et la création de l'Etat Fédéral d'Afrique Noire, tel que pensé par Marcus Garvey et Cheikh Anta Diop. Pour Afrocentricité International, tout doit être perçu selon la conception négro-africaine. Elle combat les religions étrangères et prône des cultes africains.
Dirigé par Ama Mazama et Moléfi Kete Asante, l’organisation est présente dans plusieurs pays à travers le monde. L’organisation a lancé des écoles et des universités centrées sur l’Afrique, en rupture des écoles et universités généralisées, qui sont calquées sur le modèle de pensée occidental. Elle organise des conventions pour s’étendre et pour mieux organiser les cultes kamites. Elle produit des ouvrages, des articles et des journaux sur son combat, et sur la nécessité d’une vision afro-centrée du monde.
e- Urgences Panafricanistes
Urgences Panafricanistes est une organisation fondée en Décembre 2015 à Dakar. Elle est présente dans plusieurs pays africains. Elle mène un combat contre la françafrique et le néocolonialisme à travers des conférences, des meetings, des interventions médiatiques. Elle accorde aussi des crédits à des familles démunies d’Afrique sans intérêt, pour leur permettre de sortir de la précarité. Elle dispose des structures économiques comme l’espace économique Sankariste, le Centre Panaf qui est un centre commercial de valorisation de la production africaine. L’organisation est dirigée par l’activiste international Kemi Seba.
f- La Dynamique Unitaire Panafricaine
La Dynamique unitaire panafricaine est à l’image du RDA. Elle est une organisation fédérale qui regroupe les principaux mouvements progressistes du continent africain et de sa diaspora. C’est l’une des organisations fédérales ayant le plus grands nombre d’adhérents dans le monde panafricain. Son but est de parvenir à évincer le colonialisme d’Afrique, et assurer une véritable indépendance du continent. Pour y parvenir, elle multiplie des manifestations en France pour contester sa présence néocoloniale en Afrique. Elle assiste les autres organisations dans leurs combats. A son Assemblée Générale de 2023, Augusta Epanya de l’UPC-MANIDEM (parti politique camerounais) a pris la tête de l’organisation.
Conclusion
a- Urgences stratégiques
Le panafricanisme, en gestation depuis les premières razzias négrières se structure avec les conférences et congrès panafricains. Ces conférences et congrès donnent un sens commun au combat des noirs, protègent les noirs et les orientent vers des objectifs communs. Les Africains et afro descendants trouvent en ce panafricanisme leur seule issue dans un monde qui les écrase par des lois et des actes anti-nègres, ce qui justifient la réponse que cette idéologie va avoir chez les populations africaines et d’ascendance africaines. Cette idéologie est portée par des hommes et femmes qui, à travers l’histoire, multiplient des sacrifices et des actions pour organiser des congrès et conférences, se concertent pour penser le sort de leur race et de leur peuple. Dans l’euphorie de cette idéologie, les africains et afro-descendants multiplient des initiatives pour rendre effectif ce panafricanisme. Des organisations panafricaines se créent à travers la planète, portées par des hommes et des femmes leaders qui croient en leur race et qui apportent leur contribution à sa libération finale et à sa grandeur. Parmi tous ces hommes et femmes qui façonnent le panafricanisme, deux émergent comme les figures principales de cette idéologie. Il s’agit de William Dubois et Kwame Nkrumah. Si leurs contributions sont les plus déterminantes dans l’émergence du panafricanisme, le rôle des autres est aussi déterminant.
Mais malgré ces efforts, les anciennes puissances coloniales vont tout faire pour saboter l’initiative panafricaine qui échoue avec l’OUA. L’Afrique arrive à l’indépendance étant divisée, émiettée en petits Etats non viables. Les conflits se multiplient, les anciennes puissances coloniales profitent pour évincer tous les nationalistes. Mais les africains ripostent par de nouvelles initiatives pour redresser le panafricanisme, ce qui permet de maintenir la flamme panafricaine jusqu’à présent. Aujourd’hui les leaders nouveaux font leur apparition dans ce vaste chantier du panafricanisme. Que ce soit la Ligue Associative Africaine, La ligue panafricaine umoja, la dynamique unitaire panafricaine, action sociale africaine, afrocentricité internationale ou convergences panafricaines, les nouvelles organisations panafricaines sont nombreuses et comptent porter l’idéologie à son triomphe. Pour réussir, ces organisations doivent surmonter leurs difficultés internes et empêcher les erreurs des premières organisations. Elles doivent, comme la plupart le font déjà, trouver des moyens pour leur autofinancement, aller vers une convergence de lutte, et mutualiser leurs forces. Elles doivent, au-delà du combat idéologique, engager un sérieux combat politique et penser globalement la riposte panafricaines aux anciennes puissances coloniales et aux forces adversaires endogènes. Les panafricanistes ne doivent pas seulement être des activistes, mais des intellectuels comme l’étaient tous les premiers panafricanistes. Ils doivent beaucoup lire et s’informer, car le panafricanisme est une idéologie, et l’idéologie est pensée.
b- La nécessité de prise de pouvoir politique dans les pays africains
Le panafricanisme est fondamentalement politique. Pour le faire échouer, les anciennes puissances coloniales ont imposé leurs hommes de main à la tête des Etats africains et ont donné à ces hommes de main les ordres de nuire au panafricanisme. Les panafricaniste doivent faire pareil, en imposant à la tête des Etats africains actuels des panafricanistes qui vont converger leurs pays vers l’Etat africain uni qui a toujours été l’aboutissement final du panafricanisme. Il serait donc illusoire de se dire panafricaniste et dire qu’on ne fait pas de la politique. Les panafricanistes doivent être des politiciens dans leurs pays respectifs et doivent y prendre le pouvoir afin de suivre la logique de Kwame Nkrumah pour arriver facilement à l’Etat africain uni.