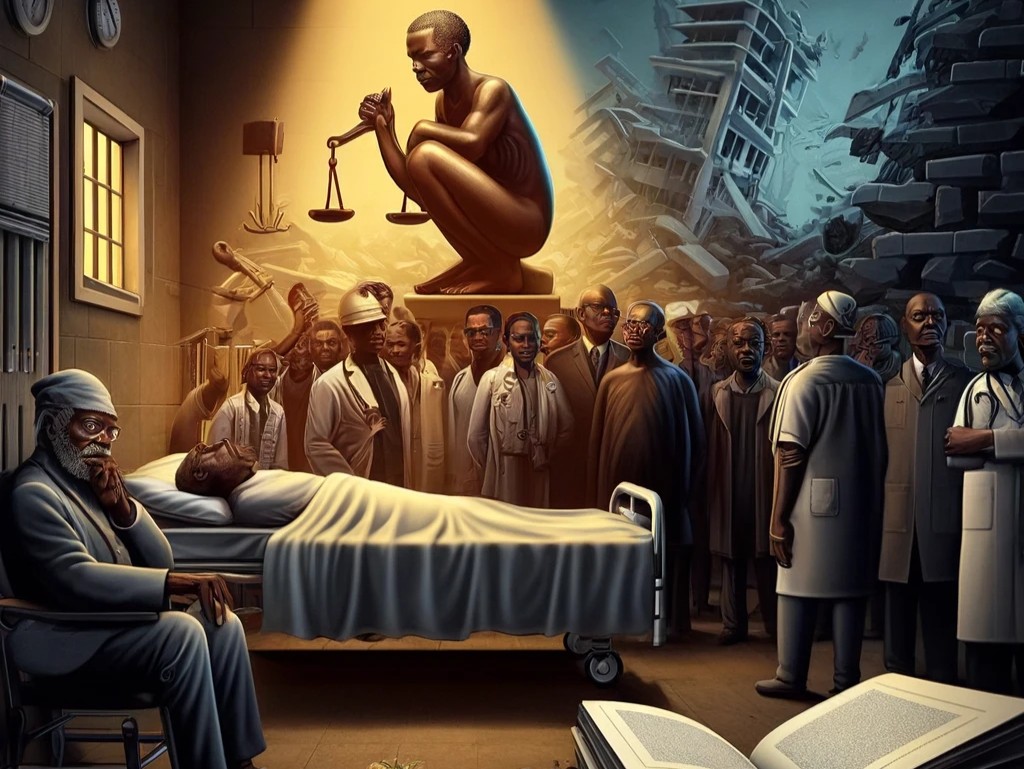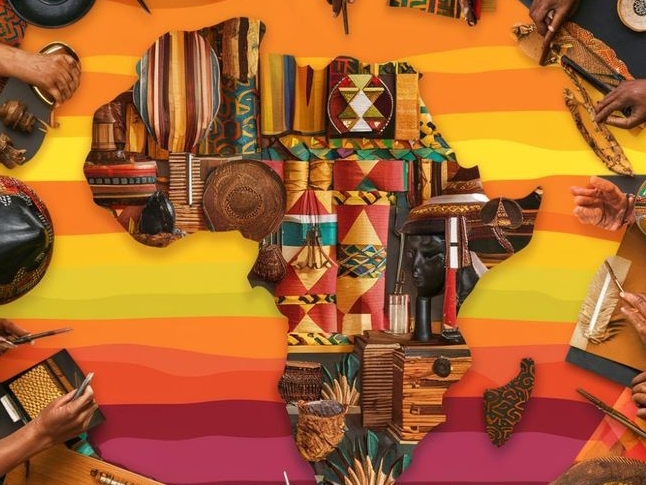Leçon : la détérioration des termes de l'échange
Introduction
Ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation des échanges économiques a consolidé un système de dépendance entre les pays riches et les pays en développement. Ce système repose sur une asymétrie dans les termes de l'échange, où les produits exportés par les pays en développement (matières premières, denrées alimentaires) se déprécient face aux produits manufacturés et technologiques importés des pays riches. La notion de détérioration des termes de l'échange, théorisée par des économistes comme Samir Amin, met en lumière une injustice structurelle qui perpétue les inégalités internationales. Ce sont les pays riches acheteurs qui fixent les prix des marchandises des pays en développement. Ce cours examine les mécanismes, manifestations, conséquences et initiatives de lutte contre cette détérioration.
I- Le système centre-périphérie
Le modèle centre-périphérie, développé par Samir Amin, décrit un système mondial où les pays du "centre" (pays industrialisés) dominent les périphéries (pays en développement). Ce système repose sur une division internationale du travail :
Les pays en développement sont spécialisés dans la production de matières premières (pétrole, cacao, café) et de produits agricoles. Ces exportations servent à alimenter l’industrie et les besoins des pays riches.
Les pays industrialisés transforment ces matières premières en produits à forte valeur ajoutée, qu’ils revendent aux pays en développement.
Ainsi, les termes de l'échange sont biaisés dès le départ.
Par exemple : Le cacao, produit en Afrique, est exporté brut, mais le chocolat transformé génère des revenus bien plus élevés dans les pays européens.
Les pays pétroliers vendent leur pétrole brut à bas prix, tandis que les produits dérivés, comme le carburant, atteignent des prix exorbitants.
Ce système organise une dépendance structurelle et empêche les pays en développement de diversifier leurs économies.
II- Manifestations de la détérioration des termes de l'échange
La détérioration des termes de l’échange se manifeste principalement par le contrôle des prix des matières premières et des denrées agricoles par les pays riches :
1- Le pétrole :
Les grandes puissances économiques et les multinationales fixent les prix du baril, ce qui limite les marges des pays exportateurs. Et les prix fixés sont très désavantageux pour les pays exportateurs.
Exemple : avant la création de l’OPEP, les compagnies occidentales imposaient des prix dérisoires aux pays producteurs.
2- Le cacao :
Les pays africains, grands producteurs (Côte d’Ivoire, Ghana), sont soumis à des fluctuations de prix décidées sur les marchés internationaux (bourses de Londres ou de New York), sans réel pouvoir de négociation. Ils subissent juste les prix fixés très loin d'eux.
3- Le café et les bananes :
Les multinationales dictent les prix, maintenant les producteurs dans une précarité économique. Les producteurs s'appauvrissent dans ce système tandis que les acheteurs s'enrichissent.
Ces déséquilibres entraînent des pertes massives pour les pays exportateurs, aggravant leur dépendance financière.
III- Les mécanismes de maintien du système
Le maintien de ce système repose sur des stratégies politiques et économiques qui visent à éviter tout changement structurel.
1- Renversement des régimes nationalistes :
Les leaders cherchant à instaurer une autonomie économique sont souvent écartés par des interventions étrangères.
Exemple : Patrice Lumumba en République démocratique du Congo, renversé pour avoir défendu le contrôle national des ressources minières. Il avait voulu que les ressources du Congo servent prioritairement les Congolais et les Africains
2- Difficultés d’union des pays en développement :
Les pays producteurs peinent à s’unir face aux puissances industrielles.
Exemple : Les tentatives d’unification africaine prônées par Kwame Nkrumah ont échoué, freinées par des divisions internes, et surtout par des mécanismes des puissances industrielles qui utilisent certains dirigeants africains à leur service pour saboter toute initiative d'unité de l'Afrique.
3- Choix de dirigeants dociles :
Les grandes puissances soutiennent des gouvernements prêts à maintenir des relations économiques favorables au centre, et à accepter le système de détérioration des termes de l'échange. C'est pourquoi les puissances industrielles soutiennent les dictatures dans les pays en développement, réduisant toujours un peu plus leur possibilité de s'industrialiser.
Exemple : La domination de multinationales dans les pays pétroliers africains grâce à des élites corrompues.
IV- Conséquences du système de détérioration des termes de l'échange
1- Pour les pays en développement :
Pauvreté accrue : Les pays restent prisonniers d’une économie de rente, sans diversification industrielle. La misère se renforce, et le plus grand rêve de la population devient de fuir leurs pays pour aller ailleurs respirer une bouffée d'air.
Endettement : Les pays en développement doivent emprunter pour financer leur développement, renforçant leur dépendance vis-à-vis des institutions internationales.
Inégalités sociales : Les bénéfices des exportations sont souvent accaparés par une minorité au pouvoir, et entièrement soumise aux pays industrialisés.
2- Pour les pays développés :
Croissance économique : Ils bénéficient de ressources à bas prix pour soutenir leur industrie.
Crises économiques : Lorsque les pays producteurs résistent (ex. crise pétrolière de 1973), ils subissent une inflation et des perturbations dans leurs économies. En 1973 quand l' OPEP avait imposé une augmentation du prix du pétrole, les pays développés ont eu l'une des plus grandes crises économiques de leur Histoire.
V- Les initiatives de lutte
Face à cette injustice, diverses initiatives ont été mises en œuvre :
1- Organisations comme l’OPEP :
L’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a imposé une hausse des prix du pétrole en 1973, provoquant la première grande crise économique mondiale. Cela a permis aux pays membres de l'organisation de récupérer une partie du contrôle sur leurs ressources. Mais très vite, les pays industrialisés ont réussi à briser l'initiative.
2- Initiatives régionales :
Le Mercosur et l’ALBA : Ces blocs régionaux en Amérique latine prônent des échanges équitables entre pays membres, visant à limiter au maximum les échanges avec les pays industrialisés.
Consommation locale : Des leaders comme Thomas Sankara au Burkina Faso ont encouragé une production et une consommation locales pour réduire la dépendance économique, afin de réduire aussi les échanges défavorables avec les pays industrialisés.
3- Réformes politiques :
Certains gouvernements ont adopté des politiques de nationalisation pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles.
Exemple : Hugo Chávez au Venezuela, avec la nationalisation de l’industrie pétrolière.
Conclusion
La détérioration des termes de l'échange constitue une des principales causes de la marginalisation des pays en développement dans l'économie mondiale. Ce système, consolidé par des mécanismes économiques et politiques, perpétue les inégalités tout en enrichissant les pays du "centre". Cependant, des initiatives comme l’OPEP, le Mercosur et les réformes nationalistes montrent qu’il est possible de renverser cette dynamique. La clé réside dans une solidarité renforcée entre les pays en développement et une gouvernance axée sur l’autosuffisance et l’indépendance économique.