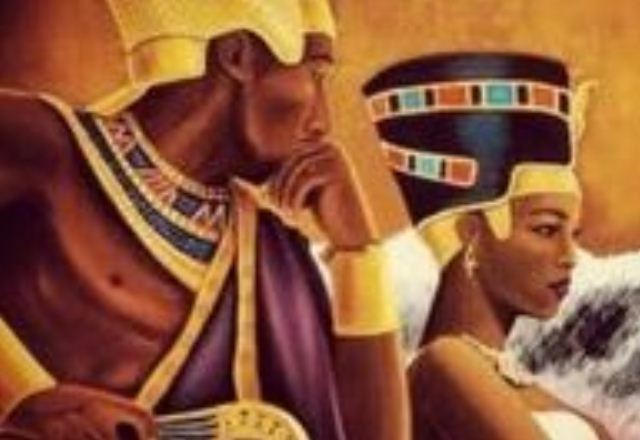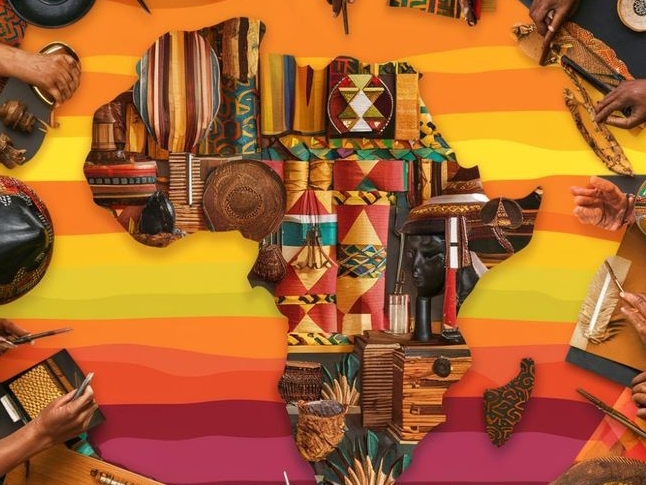Résumé de l’ouvrage NATIONS NEGRES ET CULTURE Tome 1 et Tome 2 Version revue et corrigée
Auteur : Cheikh Anta Diop
Edition : Présence Africaine
Année d’édition : Edition de 1979
Par :
La Ligue Associative Africaine
Sous la coordination de : Yemele Fometio
Juillet 2018
Cet ouvrage de Cheikh Anta Diop est résumé par le Département Panafricain de l’Education et de la Culture de la Ligue Associative Africaine, avec la collaboration de Action Sociale Africaine. Le projet du résumé des grands ouvrages contribue à la Renaissance Africaine. Nous sommes convaincus que cette renaissance ne peut être assise que sur des savoirs solides et inattaquables. Nous avons décidé de résumer des ouvrages capitaux sur l’Afrique pour permettre aux africains d’avoir des connaissances nécessaires à l’émergence du continent, et à la proclamation de la République de la Fusion Africaine.
Une renaissance africaine n’est pas possible sans un Etat unificateur solide et puissant, capable de fédérer toutes les aspirations du peuple africain à travers la planète. C’est pour cette raison que la Ligue Associative Africaine fédère les partis politiques, les syndicats et organisations des pays d’Afrique pour mener la Grande Révolution Panafricaine et proclamer la République de Fusion Africaine. Le résumé de cet ouvrage entre dans le cadre de notre programme éducatif « Les études panafricaines » qui vise à former les cadres de la Grande Révolution Panafricaine dans les partis politiques et organisations membres de la Ligue Associative Africaine. Au-delà, ce résumé s’adresse à tout africain et toute personne désireuse d’avoir des connaissances solides et vraies sur l’Afrique.
Cependant seule une lecture de l’ouvrage en entier peut vous permettre de cerner toute sa quintessence. Bonne lecture de ce résumé.
Première partie
Chapitre premier : Qu’étaient les premiers égyptiens ?
Témoignage des anciens
Les contemporains des Egyptiens qui nous ont laissés des témoignages sur eux affirment qu’ils étaient des nègres. Hérodote à plusieurs reprises insiste sur le caractère nègre des Egyptiens. Pour démontrer que l’oracle grec est d’origine égyptienne, Hérodote écrit : « et lorsqu’ils ajoutent que cette colombe était noire, ils nous donnent à entendre que cette femme était égyptienne. » Pour démontrer que les habitants de la Colchide étaient d’origine égyptienne, Hérodote poursuit : « Je le conjecturai aussi sur deux indices : le premier c’est qu’ils sont noirs et qu’ils ont les cheveux crépus… »
Diodore de Sicile écrit :
Les Ethiopiens disent que les Egyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Egypte par Osiris. Ils ajoutent que les Egyptiens tiennent d’eux, comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande partie de leurs lois, c’est d’eux qu’ils ont appris à honorer des rois comme des dieux et à ensevelir les morts avec tant de pompe ; la sculpture et l’écriture ont pris naissance chez les Ethiopiens…
Strabon, croyant que la migration s’était faite au sens inverse, remarque : « des Egyptiens se sont établis dans l’Ethiopie et dans la Colchide » (livre I, chap 3, page 10). Il ajoute que les Egyptiens, Ethiopiens et Colches appartiennent à la même race, confirmant de ce fait les propos d’Hérodote.
L’opinion de tous les écrivains de l’antiquité sur la race égyptienne est en quelque sorte résumée par Maspero :
Au témoignage presque unanime des historiens anciens, ils appartenaient à une race africaine qui d’abord établie en Ethiopie, sur le Nil moyen, serait descendue graduellement vers la mer en suivant le coin du fleuve…D’autre part, la Bible affirme que Mizraïm, fils de Cham, frère de Koush l’Ethiopien, et de Canaan, vint de Mésopotamie pour se fixer sur les bords du Nil avec ses enfants.
Mizraïm désigne encore l’Egypte pour les peuples du proche orient.
Hérodote visitait l’Egypte quand sa civilisation était vieille de plus de 10000 ans. Si le peuple égyptien était blanc à l’origine, il ne pouvait que le rester quand Hérodote le visitait. Si Hérodote l’a retrouvé nègre après plusieurs métissages avec les éléments blancs, il fallait qu’il fût essentiellement noir à l’origine. Les colonies étrangères qui se sont métissées avec la race égyptienne étaient de race blanche : Arabes à Coptos, Libyens dans le future Alexandrie, Juifs aux environs de la cité d’Hercule, Perses (ou Babyloniens) au-dessous de Memphis, Troyens fugitifs dans la région des grandes carrières à l’orient du Nil, des Cariens et des Ioniens vers le bras pélusiaque, les Grecs à Naucrasis.
Témoignage de la Bible et le mythe de Cham
Ceux qui allaient devenir les juifs entrèrent en Egypte, au nombre de 70 bergers incultes et craintifs, chassés de Palestine par la famine et attirés par le paradis terrestre qu’est la vallée du Nil. Bien que l’Egypte eût une horreur particulière pour la vie nomade et les bergers, grâce à leur frère Joseph ils furent reçus. Selon la Bible, ils se seraient installés dans le pays gazen et devinrent les bergers des troupeaux du pharaon. Après la mort de Joseph et du pharaon « protecteurs » et devant leur multiplication, des craintes naquirent chez les Egyptiens, d’autant plus que les barbares blancs faisaient souvent des coalitions pour attaquer l’Egypte. Le peuple juif étant de race blanche, les égyptiens craignaient une nouvelle coalition de forces blanches entre les barbares à l’extérieur et les juifs à l’intérieur pour faire tomber leur civilisation. La condition des juifs deviendra de plus en plus dure. D’après la Bible, ils seraient employés à des travaux difficiles de terrassement et de construction des villes. Les Egyptiens auraient pris des mesures pour limiter le nombre de naissance et éliminer les enfants mâles, de peur que cette minorité ethnique ne se développe et constitue un danger national qui, en période de guerre pourrait grossir le rang des adversaires. La minorité juive vivra désormais repliée sur elle-même, elle deviendra messianique par la souffrance et l’humiliation. Un tel terrain moral fait de misère et d’espoir était favorable à l’éclosion du sentiment religieux. Ce sentiment fut accentué par leur impossibilité d’envisager une réaction positive devant la supériorité technique du peuple égyptien. Les juifs étaient sans industrie, sans organisation sociale, armés tout au plus de bâtons.
C’est dans ces circonstances qu’apparaitra Moïse, le premier prophète juif qui élaborera et présentera l’histoire du peuple hébreu depuis ses origines sous un angle religieux. Il fera dire à Abraham tant de choses que celui-ci ne pouvait prévoir, telles que le séjour de 400 ans en Egypte. Moïse vivait à l’époque où Aménophis IV tentait de rénover le monothéisme égyptien primitif. Moïse aurait été touché par cette réforme religieuse. Il s’est fait à partir de ce moment, le champion du monothéisme dans le milieu juif. Le monothéisme, dans toute son abstraction, existait déjà en Egypte qui, elle-même, l’avait emprunté en Ethiopie de l’ancien Amon (Seul générateur dans le ciel et sur la terre et qui n’est point engendré, doublé plus tard de Ra (soleil) et pris le nom d’Amon Ra, puis converti en Osiris ou Horus.
Dans l’atmosphère d’insécurité où se trouvait le peuple juif en Egypte, un dieu prometteur de lendemains sûrs était le soutien moral irremplaçable. Ainsi, après les réticences du début, ce peuple qui ne semblait pas avoir connu le monothéisme jusque-là, contrairement à l’opinion de ceux qui veulent en faire son inventeur, le portera néanmoins à un degré de développement assez considérable. A l’aide de la foi, Moïse conduira le peuple hébreu hors d’Egypte. Celui-ci se serait lassé très vite de ce culte et ne serait revenu que progressivement au monothéisme tel que le confirme le Veau d’or d’Aaron au pied du Sinaï. Le peuple juif sort d’Egypte au nombre de 600 000, après 400 ans, après y avoir puisé tous les éléments de sa tradition future et, en particulier le monothéisme.
Si le peuple égyptien a tant fait souffrir le peuple juif comme le dit la Bible, et si le peuple égyptien est un peuple de nègres descendant de Cham comme le dit la même Bible, on ne peut plus ignorer les origines de la légende de Noé ivre. Les causes historiques de la malédiction de Cham sont issues de la littérature juive entièrement postérieure à cette période de persécution. Aussi Moïse dans la génèse attribue à l’éternel s’adressant à Abraham les paroles suivantes : « Sache que tes enfants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses ». (gen, XV, 13).
Les Egyptiens appelaient leur pays Kemet qui veut dire noir en langue égyptienne. Le nom Cham que Moïse a attribué dans la Bible signifiait l’habitant d’Egypte symbolisé par sa couleur noire. Kam en hébreu signifie aussi noir, brulé, chaleur. Nous voyons clairement l’origine de la malédiction de Cham.
Chapitre II : naissance du mythe du nègre
L’Egypte conquise, l’Europe bâtie une grande civilisation
L’Egypte avait déjà depuis un siècle, perdu son indépendance quand Hérodote la visite. Conquise par les Perses en - 525, elle ne cessa plus dès lors d’être dominée par les étrangers : après la Perse, ce furent les Macédoniens avec Alexandre, les Romains avec Jules César (-50), les Arabes au VIIe siècle, les Turcs au XVIe siècle, les Français avec Napoléon, puis les Anglais à la fin du XIXe siècle. Berceau de la civilisation pendant 10 000 ans au moment où le reste du monde était plongé dans la barbarie, l’Egypte détruite par toutes ces occupations successives ne jouera plus aucun rôle sur le plan politique, mais n’en continuera pas moins pendant longtemps encore à initier les jeunes peuples méditerranéens (grecs, romains et autres) aux lumières de la civilisation. Elle restera pendant toute l’antiquité la terre classique où les peuples méditerranéens viendront en pèlerinage pour s’abreuver aux sources des connaissances scientifiques, religieuses, morales etc. C’est ainsi que sur tout le pourtour de la méditerranée se sont édifiées successivement de nouvelles civilisations qui bénéficient d’apports multiples favorisés par la configuration géographique de la région, véritable carrefour.
Le souffle païen qui animait la civilisation gréco- romaine s’épuisa vers le IVe siècle ; deux nouveaux facteurs, le christianisme et les invasions barbares, vont interférer sur le terrain déjà vieux de l’Europe occidentale pour donner naissance à une civilisation nouvelle, celle-là même qui aujourd’hui à son tour, manifeste des symptômes d’épuisement. Cette dernière civilisation qui a hérité des progrès techniques de toute l’humanité grâce à des contacts entre les peuples, se trouvait déjà suffisamment équipée techniquement au XVe siècle pour se lancer à la découverte et à la conquête du monde. C’est ainsi que dès le XVe siècle, les portugais abordaient l’Afrique par l’océan atlantique. Ils établirent les premiers contacts modernes désormais ininterrompus avec le peuple africain.
Les puissantes civilisations d’Afrique Noire ne se lancent pas aux progrès scientifiques et techniques, elles rencontrent une Europe disposant d’armes à feu.
La répartition des nègres sur le continent africain avait connu deux phases principales. On admet communément qu’au début de -7000 le dessèchement du Sahara était achevé. Les derniers nègres qui vivaient encore au Sahara l’avaient quitté soit pour émigrer vers le Haut-Nil, soit pour émigrer vers le sud, attirés par de forêts trop denses. C’est de l’adaptation progressive aux nouvelles conditions de vie que la nature a assigné à ces différentes populations nègres que naitra le plus ancien phénomène de civilisation que la terre ait connue. Pendant cette longue période, les nègres ont pu essaimer progressivement vers l’intérieur du continent, constituer des noyaux qui deviendront des centres de civilisations continentales. Ces civilisations seront de plus en plus coupées du reste du monde, elles tendront à vivre en vase clos, par suite de l’énorme distance qui les sépare des voies d’accès à la Méditerranée. Quand l’Egypte aura perdu son indépendance, leur isolement sera complet.
Désormais coupés de la mère patrie (Egypte) envahie par l’étranger, repliés sur eux-mêmes dans un cadre géographique exigeant un moindre effort d’adaptation, bénéficiant de conditions économiques favorables, les nègres s’orienteront vers le développement de leur organisation sociale, politique et morale, plutôt que vers une recherche scientifique spéculative que le milieu, non seulement ne justifiait pas, mais rendait impossible. Autant l’adaptation à l’étroite vallée fertile du Nil exigeait une technique savante d’irrigation et de digues, des calculs précis pour prévoir les crues du Nil et en déduire les conséquences économiques et sociales, autant il était nécessaire matériellement d’inventer la géométrie pour délimiter les propriétés après les crues du Nil qui en effaçaient les limites, et départager ainsi les cohabitants ; Autant le terrain en longues bandes plates exigeait la transformation de la houe en charrue. Tout cela devenait superflu dans les nouvelles conditions de vie très favorables à l’intérieur du continent. Le nègre se désintéressa du progrès matériel. C’est sous ce nouvel état de civilisation que la rencontre se fera avec l’Europe. Au XVe siècle quand les européens établissent des comptoirs sur la côte occidentale d’Afrique, l’organisation politique des Etats africains était égale et souvent supérieure à celles des Etats européens.
Le nègre, bien qu’il ait été le premier à découvrir le fer, n’avait pas construit de canon. L’Afrique était donc très vulnérable du point de vue technique. Elle devenait une proie tentante, irrésistible pour l’occident pourvu d’armes à feu et de marines.
Esclavage, Colonisation et mythes du Nègre sauvage
L’essor économique de l’Europe de la renaissance poussa donc à la conquête de l’Afrique qui se fit rapidement. C’est à cette époque que l’Europe découvre l’Amérique. La mise en valeur des terres vierges nécessitait une main d’œuvre à bon marché. L’Afrique sans défense apparut alors comme le réservoir humain tout indiqué où il fallait puiser cette main d’œuvre avec le minimum de frais et de risques. La traite des esclaves durera jusqu’au milieu de XIXe siècle.
Un tel renversement de rôles, issu des nouveaux rapports techniques a entrainé sur le plan social, des relations de maitre à esclave entre le blanc et le nègre. Déjà au moyen-âge le souvenir d’une Egypte nègre ayant civilisé la terre, s’était estompé par suite de l’oubli de la tradition antique cachée dans les bibliothèques ou ensevelie sous les ruines. Elle s’estompera davantage encore au cours de ces quatre siècles d’esclavage. Imbus de leur récente supériorité technique, les européens avaient à priori un mépris pour tout le monde nègre. L’ignorance de l’histoire antique des nègres, les différences de mœurs et de coutume, les préjugés ethniques entre deux races qui croient s’approcher pour la première fois, jointe aux nécessités économiques d’exploitation, tant de facteurs prédisposaient l’esprit de l’européen à fausser complétement la personnalité morale du nègre et ses aptitudes intellectuelles.
Le Nègre devient désormais synonyme d’être « primitif », « inférieur », « doué d’une mentalité pré logique ». L’esprit de plusieurs générations européennes sera ainsi progressivement faussé. Comble de cynisme : On présentera la colonisation comme un devoir d’humanité, en invoquant la mission civilisatrice de l’occident auquel incombe la charge d’élever l’africain au niveau des autres hommes. Désormais le capitalisme est à l’aise. Il pourra exercer les plus féroces exploitations à l’abri de prétextes moraux.
Ce climat d’aliénation a fini par agir profondément sur la personnalité du nègre, en particulier du nègre instruit qui a eu l’occasion de prendre connaissance de l’idée que le reste du monde se fait de lui et de son peuple. C’est ainsi que Léopold Sédar Senghor affirme que « l’émotion est nègre et la raison hellène ». Aimé Césaire, l’un des plus grands intellectuels nègres écrit :
« Ceux qui n’ont inventé ni la poudre, ni la boussole,
Ceux qui n’ont jamais su dompter ni la vapeur ni l’électricité.
Ceux qui n’ont exploré ni la mer ni le ciel… »
Peu à peu, une littérature nègre de complémentarité, se voulant enfantine, puérile, bon enfant, passive, résignée, pleurnicharde a émergé avec une grande joie des européens qui attribuent des titres et voyages aux tenants de cette littérature. Par contre, une œuvre nègre parfaitement réussie, mais sortant de ce cadre de soumission apparait prétentieuse, exaspérante et intolérable pour l’occident.
Il devenait difficile, et même inadmissible, pour ceux qui ignoraient sa grandeur passée et pour les nègres eux-mêmes que ceux-ci aient pu être à l’origine de la première civilisation qui se soit épanouie sur la terre et à laquelle l’humanité doit l’essentiel de son progrès. Désormais quand bien même les preuves s’amoncelleront aux yeux des spécialistes, ils ne les verront plus qu’à travers des œillères et les interprèteront toujours faussement.
Volney fait de grands constats
Entre 1783 et 1785, en pleine période de l’esclavage nègre, un savant de bonne foi Volney, se rend en Egypte. Il fit les constatations suivantes sur la race égyptienne, celle-là même d’où étaient issus les pharaons : les coptes.
Tous ont le visage bouffi, l’œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J’étais tenté de l’attribuer au climat, lorsque ayant été visité le sphinx, son aspect me donna le mot de l’énigme. En voyant cette tête caractérisée Nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d’Hérodote où il dit : pour moi, j’estime que les colches sont une colonie des égyptiens, parce que, comme eux ils ont la peau noire et les cheveux crépus : C’est-à-dire que les anciens Egyptiens étaient de vrais Nègres de l’espèce de tous les naturels d’Afrique.
(Voyages en Syrie et en Egypte, par M. C. F. Volney, paris, 1787. Tome I, p 74 à 77).
Chapitre III : falsification moderne de l’histoire
Quand Champollion-le-Jeune réussit à décrypter les Hiéroglyphes, les égyptologues découvrent la grandeur et la perfection d’une civilisation égyptienne qui a engendré toutes les autres. L’impérialisme aidant, il devenait de plus en plus « inadmissible » de continuer à accepter la thèse jusqu’alors évidente d’une Egypte nègre. La naissance de l’égyptologie sera donc caractérisée par la nécessité de détruire à tout prix et dans tous les esprits le souvenir d’une Egypte nègre, de la façon la plus complète. Les égyptologues s’efforcent vainement de trouver à la civilisation égyptienne une origine blanche. Voici quelques de ces efforts vains.
Champollion-le-Jeune réfute l’origine égyptienne à une couche de souche nègre pour la donner à une autre couche nègre
La plus ancienne de ces thèses est celle de Champollion-le-Jeune, exposée dans la treizième lettre adressée à son frère. Elle concerne les bas-reliefs du tombeau d’Ousirei 1er également visité par Rienzi. Ces bas-reliefs datent du XVIe siècle avant J-C (XVIIIe dynastie) et représentent les races d’hommes connues des égyptiens. Ce bas-relief constitue le plus ancien document ethnographique complet que nous connaissons :
Les hommes guidés par le pasteur des peuples, Horus, appartiennent à quatre familles bien distinctes. Le premier, (no 1 de la planche), le plus voisin du dieu est de couleur rouge-sombre… les légendes désignent cette espèce sous le nom de Rôt-en-ne-Rôme, la race des hommes, les hommes par excellence, c’est-à-dire les égyptiens. Il ne peut y avoir aucune certitude sur la race de celui qui vient après (no 2 de notre planche) ; il appartient à la race des nègres… le suivant présente un aspect bien différent : (no3 de la planche) peau couleur de chair tirant sur le jaune… Enfin le dernier, (no 6 de la planche) a la teinte de peau que nous nommons couleur de chair, ou peau blanche de la nuance la plus délicate, le nez droit ou légèrement voussé, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, taille haute et très élancée, vêtu de peau de bœuf conservant encore son poil, véritable sauvage tatoué sur diverses parties du corps, on les nomme tamhou. Je me hâtai de chercher le tableau correspondant à celui-ci dans les autres tombes royales, et, en le retrouvant en effet dans plusieurs, les variations que j’y observai me convainquirent pleinement qu’on a voulu figurer ici les habitants des quatre parties du monde, selon l’ancien système égyptien, savoir : 1- les habitants de l’Egypte qui, à elle seule, formait une partie du monde, d’après le très modeste usage des vieux peuples ; 2- les habitants propres de l’Afrique, les Nègres, 3- les Asiatiques, 4- enfin (et j’ai honte de le dire puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série) les européens qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche habitant non seulement l’Europe, mais encore l’Asie, leur point de départ ». (champollion-Figeac : Egypte ancienne, coll. L’univers ; 1839, pp 30-31.)
La race « rouge-sombre » est utilisée ici juste pour jeter la confusion. Il n’existe pas aussi de noir au sens exact de terme. La couleur du nègre tire en réalité sur le brun et subit des nuances suivant les régions. En peinture, l’on se contente de nuances s’en approchant.
Après ce constat, Champollion réfute l’origine égyptienne à une couche de souche nègre (les Coptes) pour la donner aux Nubiens et Abyssins, oubliant qu’ils sont aussi des Nègres. En fait, Ethiopiens et Coptes sont deux souches nègres métissées ultérieurement avec des éléments blancs. Ils n’ont pas encore perdu les caractères nègres de la race égyptienne primitive. D’ailleurs, les Nubiens sont les ancêtres de presque tous les Noirs au point où Nubiens et Nègres sont synonymes. Les écrits de Champollion-le-Jeune montrent la hiérarchie entre les peuples à l’époque. Les Egyptiens étaient les plus civilisés, ensuite venaient les Nègres de l’intérieur de l’Afrique, puis les Arabes ou Juifs. Les Asiatiques et Européens étaient les derniers et étaient encore dans la sauvagerie.
Champolion Figeac décrit la race Nègre des anciens Egyptiens en affirmant qu’elle n’est pas Nègre !
La deuxième tentative de falsification est la thèse de Champollion Figeac, père de l’Egyptologie. Il réfute obstinément l’origine nègre de la civilisation égyptienne. Il conclut que la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas à caractériser la race nègre. Pourtant ce sont les deux caractéristiques principales de cette race. Se rendant compte de son incapacité à réfuter l’origine égyptienne à la race noire, Champollion Figeac divise les populations d’Afrique en trois races : les nègres proprement dits au centre et en occident, les cafres sur la côte orientale et les maures, semblables par la taille, la physionomie et les cheveux aux européens, donc à la race blanche. C’est à cette dernière race semblable aux européens que Figeac attribue la race des anciens égyptiens.
Le mot cafre qu’il utilise ne signifie pas une race. Il vient d’un mot arabe qui veut dire païen, par opposition aux musulmans. Quant aux maures, ce sont essentiellement des arabes-musulmans dont l’installation en Afrique est très récente (VIIe siècle). Ils sont réfractaires à l’art sculptural alors que la civilisation égyptienne y accorde une grande place. Les maures sont un rameau de ce que l’on est convenu d’appeler les sémites.
Après avoir affirmé que la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas à caractériser la race nègre, Champollion Figeac se contredit trente-six lignes plus bas en écrivant : « les cheveux crépus et lanugineux sont les véritables caractères de la race nègre ». Suivant sa logique, les égyptiens étaient donc des blancs à peau noire et à cheveux longs. On ignore l’existence de tels blancs. Il existe certes, une race noire aux cheveux longs : la race dravidienne dont on fait une race de nègres en Inde, et qu’on veut blanchir en Afrique.
Champollion Figeac continue la description de la race des anciens égyptiens en rappelant que Monsieur Cailliaud, qui a vu les Barabras, les dépeints « Comme des hommes laborieux, sobres, d’un tempérament sec… leurs cheveux sont à demi crépus, courts et bouclés ou tressés comme les anciens égyptiens et habituellement huilés ». Une fois de plus Champollion Figeac décrit la race Nègre en affirmant qu’elle n’est pas Nègre.
Cherubini estime que la couleur des Nègres sur les bas-reliefs du tombeau d’Ousirei 1er est conventionnelle et les autres naturelles
Cherubini écrit :
On sait en effet que les premières lueurs de l’histoire éclairent à peine les commencements des empires les plus puissants de l’Asie, lorsque déjà une organisation mûre, complètement réglée, florissant depuis longtemps sur les bords du Nil où les autres nations venaient successivement puiser des lumières, fruit d’une longue expérience, et recueillir des institutions et des leçons de sagesse consacrées par la sanction du temps.
Une fois de plus un moderne nous rappelle que les anciens savants et philosophes, depuis Hérodote jusqu’à Diodore de Sicile reconnaissent qu’ils avaient puisé cette civilisation chez les nègres des bords du Nil, qu’il s’agisse des Ethiopiens ou des Egyptiens. Il ressort de ce texte que les anciens n’ont jamais disputé aux nègres le rôle de premiers bâtisseurs de la civilisation. Mais après ce brillant travail, Cherubini tente de falsifier la race des bâtisseurs de la civilisation égyptienne. Il estime que la couleur du dieu Horus et des deux peuples les plus proches de lui, les nègres, est une couleur conventionnelle. Pourtant ces couleurs sont des couleurs caractéristiques des nègres. Parmi toutes les couleurs représentées, on ne comprend pas comment une seule serait conventionnelle et d’autres naturelles.
Les spécialistes, en fuyant l’évidence d’une Egypte nègre, tombent dans des invraisemblances et des contradictions sans issus. S’appuyant sur les bas-reliefs du temple d’ibsamboul (Nubie inférieure) où sont représentés les prisonniers capturés par Sésostris après une expédition vers le sud, Cherubini tente de montrer que les nègres appartenaient à deux races différentes afin de réfuter l’origine nègre à la civilisation égyptienne. Mais les traits que Cherubini dit distinguer les deux couleurs (brun foncé et brun rougeâtre) sont en fait les caractéristiques communes à la race nègre. Cherubini lui-même a affirmé que le teint des nègres est quelquefois « nuancé de brun foncé ». Se rendant compte de son incapacité à donner à la race blanche l’origine de l’Egypte, Cherubini se lance dans des propos injurieux de la race nègre, sans aucune résonnance avec la science.
Pour Fontanes, les anciens égyptiens seraient des nègres, mais des nègres du dernier degré
Fontanes nie l’origine égyptienne à la race nègre pour la donner aux libyens. Cette thèse est fausse puisque les égyptiens ont toujours considéré les libyens comme de véritables sauvages, rebelles à la civilisation, et avec eux ils n’avaient garde de se confondre. Ils daignaient, tout au plus, en faire des mercenaires. Ils n’ont jamais cessé de les tenir en respect à l’extérieur de leurs frontières, par des expéditions constantes. Ce n’est que vers la basse époque que l’Egypte sera progressivement imbibée de libyens à moitié apprivoisés, qui s’installeront dans la région du Delta.
Fontanes, en voulant réfuter l’origine nègre de la race égyptienne, l’a plus que quiconque confirmé. Désolé de sa tentative à falsifier l’origine nègre de la civilisation égyptienne, il affirme : « les anciens égyptiens seraient des nègres, mais des nègres du dernier degré ».
Maspero tente d’attribuer l’origine de l’Egypte pharaonique à des peuples venant d’Europe
Maspero tente aussi la falsification en affirmant que les peuples bâtisseurs de la civilisation égyptienne sont venus de l’Europe Occidentale pour apporter en Egypte les éléments de la civilisation. On se demande si ces peuples ont emprunté l’avion qui n’existait pas encore à cette période au point de ne pas laisser de traces dans leur berceau primitif et sur leur chemin.
Contrairement aux hypothèses selon lesquelles l’Afrique du nord aurait, de toute antiquité, été habitée par une race blanche, on peut invoquer les documents archéologiques et historiques qui prouvent unanimement que cette région fut toujours habitée par des nègres. A l’époque historique, les documents latins attestent la présence des Nègres dans tout le nord de l’Afrique. Ces documents attestent encore la présence des Nègres en Europe méridionale d’où l’on veut faire partir la civilisation égyptienne. Les faits montrent plutôt une invasion de l’Eurasie par les Nègres qui auraient conquis le monde. Dumoulin de la piante écrit : « c’est alors qu’une migration de négroïdes du type Hottentot aurait, partant de l’Afrique du nord, l’Algérie, Tunisie, Egypte et apporté, par la force à l’Europe méditerranéenne, une nouvelle civilisation : l’Aurignacien ».
Maspero continue et estime que les Egyptiens paraissent avoir oublié de bonne heure leur origine. Ce qui est faux. Les Egyptiens expriment leur origine dans tout leur art, leur littérature, leurs manifetations culturelles, au point que leur pays même était désigné, par analogie avec leur propre couleur du nom de Kemet, ancêtres des nègres d’après la Bible. Maspero poursuit : « d’autre part, la Bible affirme que Mizraim, fils de Cham, frère de Koush l’éthiopien et de Canaan, vint de Mésopotamie pour se fixer sur les bords du Nil avec ses enfants ». Il néglige d’ajouter que Cham, Mizraim, Canaan, Koush sont des nègres d’après la même Bible qu’il cite. Ce qui veut dire une fois de plus que l’Egypte (Cham, Mizraim), l’Ethiopie (Koush), la Palestine et la Phénicie d’avant les Juifs et les Syriens (Canaan), l’Arabie Heureuse d’avant les Arabes (Pout, Havila, Saba) étaient occupés par des nègres ayant créé des civilisations millénaires en ces régions, et qui étaient restés en relation de parenté.
Maspéro fait cette description des anciens égyptiens : « Nez court et charnus, bouche un peu trop fendue, lèvres épaisses, des yeux grands et bien ouverts, les joues arrondies, le front un peu bas, les épaules larges et pleines, la main fine, la hanche assez peu développée, la jambe sèche ». Bien que tous ces éléments soient la confirmation de la race nègre, Maspero conclut qu’ils sont les caractéristiques des races blanches de l’Europe et de l’Asie occidentale. Une fois de plus, Maspero montre l’impossibilité de prouver le contraire de la vérité.
Furon adopte le culte de la fécondité pour ne pas être coincé
Furon adopte l’idée d’un culte de la fécondité pour ne pas aboutir aux mêmes conclusions selon lesquelles les migrations se sont faites de l’Afrique vers l’Europe : « toutes ces statuettes ayant un ‟air de famille ”, il faut bien admettre l’idée du culte de la fécondité, car il serait incroyable que la France, l’Italie, et la Sibérie aient été peuplées par des gens de mêmes races négroïdes, dont toutes les femmes étaient stéatopyges ». Admettre le culte de la fécondité c’est, en réalité, rester dans l’hypothèse de l’invasion nègre, attestée, au surplus, par les crânes aurignaciens, les squelettes de Grimaldi. Le rôle civilisateur de l’Afrique, dès la préhistoire, est attesté, de plus en plus, par le témoignage des plus savants. Abbe Breuil écrit :
D’autre part, il semble de plus en plus probable que, même au temps des centaines de fois millénaire de la pierre taillée ancienne, l’Afrique non seulement a connu des stades de civilisation primitive comparables à ceux de l’Europe et de l’Asie mineure, mais est peut-être la source de plusieurs de ces civilisations dont les essaims ont gagné vers le Nord ces pays classiques.
Il va plus loin pour affirmer qu’il semble de plus en plus évident que c’est en Afrique que l’humanité a pris naissance. C’est à la quatrième glaciation qui a duré 100 000 ans que la différenciation de cette race négroïde en races distinctes se serait faite par suite d’une longue adaptation de la fraction qui était isolée et emprisonnée dans les glaces : rétrécissement des narines, dépigmentation de la peau, des pupilles…
Emile Massoulard décrit les caractères Nègres des anciens égyptiens et affirme qu’ils n’étaient pas Nègres
Le Dr Emile Massoulard écrit : « Par la hauteur et la largeur de la face, la hauteur nasale, l’indice céphalique et l’indice facial, cette race se rapprocherait des nègres. Par la hauteur nasale, la hauteur de l’orbite, la longueur du palais et l’indice nasal, elle serait plus près des germains » Tous ces indices du Dr. Massoulard sont ceux de la race noire.
Thomson, Randall-mac, Kieth et Falkenburger ont essayé d’établir les caractéristiques de la race égyptienne. La convergence de leurs conclusions prouve que le fond de la population égyptienne prédynastique était nègre. Malgré cette réalité soutenue par des preuves tangibles, on rencontre dans les manuels la version fausse de Breasted qui ne s’appuie sur aucun fondement, selon laquelle les noirs ont été coupés de la civilisation égyptienne et n’y ont pas contribués. La carte de l’Afrique montre qu’on peut aller d’un point quelconque du continent noir à la vallée du Nil sans traverser le Sahara. Avec des preuves sus- évoquées, le caractère nègre de la civilisation égyptienne exclut tout « apanage de la race blanche ».
Amelineau appelle les égyptologues à la bonne foi
Amelineau, un grand égyptologue dont on ne parle pas souvent, fit des fouilles à Om El’Gaab, près d’Abydos. Il découvrit une nécropole royale où il put identifier seize noms de rois qui seraient antérieurs à Menès. C’est à lui qu’on doit la découverte grâce à laquelle Osiris ne serait plus un Héro mythique, mais un personnage historique, un premier ancêtre des pharaons, un ancêtre de la race nègre, ainsi que sa sœur Isis. Amelineau, après avoir critiqué Maspero, appelle les égyptologues à la bonne foi. Il aboutit aux conclusions suivantes :
De diverses légendes égyptiennes j’ai pu conclure que les populations établies dans la vallée du Nil, étaient de race nègre, puisque la déesse Isis est dite être née sous la forme d’une femme rouge et noire, avec la couleur café au lait que présentent certains individus de la race nègre dont la peau semble avoir des reflets métalliques de cuivre. (Prolégomènes à l’étude de la religion égyptienne, 2e partie, ed. Lerroux, 1916, p124)
Les dieux égyptiens étaient toujours peints à la couleur des nègres. Si les égyptiens étaient blancs, il serait paradoxal pour eux de peindre leurs êtres suprêmes en couleur de nègres. Selon Amelineau, c’est la race nègre qui aurait créé au temps ante- historique, tous les éléments de la civilisation égyptienne qui demeurent sans changements notables jusqu’à la fin de celle-ci. Ce sont eux qui auraient, les premiers, pratiqué l’agriculture, irrigué la vallée du Nil, dressé les digues, inventé les sciences, les arts, l’écriture, le calendrier. Ce sont eux qui ont créé la cosmogonie consignée dans le Livre des morts dont les textes ne laissent aucun doute sur le caractère nègre de la race qui en a conçu les idées.
La civilisation égyptienne peut-elle être originaire de Delta ?
Devant l’impossibilité de prouver que le berceau de la civilisation égyptienne se trouve à l’extérieur de l’Afrique, certains égyptologues lui reconnaitront une origine locale, mais venue du Delta. C’est une sorte d’insistance pour établir l’origine blanche de la civilisation égyptienne. Dans cette logique sans aucun fondement historique, si le Delta est civilisé avant la Haute Egypte, cela voudrait dire que la civilisation égyptienne a été influencée par la race blanche asiatique ou indo- européenne. En fait, aucun document historique ne milite en faveur de cette thèse. C’est en Haute Egypte que l’on a trouvé, depuis le paléolithique jusqu’à nos jours, les témoins matériels des étapes successives de civilisation.
Moret estime que les rois du Nord ont eu une prépondérance sur le reste l’Egypte au début du temps. Il soutient sa thèse par la fertilité du Delta par rapport à l’étroite vallée de la Haute Egypte. Il cite l’invention du calendrier qui aurait eu lieu sous la latitude de Menphis. D’autre part, il affirme que les dieux égyptiens, Osiris, Isis, Horus sont originaires du Delta, et ont été imposé à la Haute Egypte par le truchement du calendrier découvert dans le Delta. Or le Livre des morts, antérieur à toute histoire écrite de l’Egypte, nous apprend qu’Isis est négresse, qu’Osiris est un nègre, c’est-à-dire un Anou, tant et si bien que son nom dans les textes les plus anciens qui aient existé en Egypte, est accompagné d’un ethnique qui indique son origine nubienne.
Amelineau nous apprend, par ailleurs, qu’aucun texte égyptien ne dit qu’Osiris et Isis sont nés dans le Delta. Donc Moret ne tire son affirmation d’aucun document. Il veut tout simplement montrer sans aucune preuve que la civilisation égyptienne, même si elle a été bâtie par les nègres, a été fortement influencée par les éléments blancs. Ce qui est faux. D’ailleurs la légende localise la naissance d’Osiris et d’Isis en Haute Egypte : Osiris à Thèbes et Isis à Denderoh. Elle situe de même en Nubie le premier théâtre de la lutte entre Seth et Horus.
Si Osiris et Isis étaient nés en Basse Egypte, on comprendrait difficilement que leurs reliques soient entièrement accaparées par la Haute-Egypte. Analysant le papyrus du musée de Leide qui prouverait l’origine d’Osiris au Delta, Amelineau constate : « depuis que Brugsh l’a copié, le texte a disparu ». Amelineau fait un autre constat et se demande : « pourquoi les villes de la Haute Egypte eussent-elles revendiqué pour elles les parties les plus importantes du corps d’Osiris, si Osiris fut né dans le Delta, fut mort dans Delta, eût été le dieu local d’un petit canton du Delta ! Je n’en vois aucune raison »
Ici intervient aussi un trait caractéristique du culte des nègres : un ancêtre mort devient l’objet d’un culte. Les plus lointains dont les enseignements dans le domaine de la vie sociale se sont révélés efficaces deviennent peu à peu de véritables dieux. Osiris ne serait pas devenu un dieu s’il était né dans le Delta et que la civilisation égyptienne ait été fortement influencée par la race blanche.
L’argument de Moret sur l’invention du calendrier à Menphis subit une entorse grave, quand on l’examine de près. Il précise que ce n’est que sous la latitude de Menphis que l’on peut observer un lever héliaque de Sothis. Il en conclut que le calendrier égyptien a été inventé à Menphis. Or le calendrier était en usage en - 4236, au moment où Menphis était encore de l’eau, puisque c’est le roi Menès qui crée la ville de Menphis après avoir dévié le cours du Nil de cet endroit qui devient une partie de la terre ferme, comme le souligne Hérodote et les documents. L’avènement de Menès date de 3200. Donc Menphis n’existait pas quand le calendrier était inventé.
L’explication de Naville est encore plus édifiante :
De quel côté venaient les conquérants ? Il me semble qu’il ne peut y avoir de doute qu’ils venaient du Sud … c’est de là qu’il part avec son fils Horus, un dieu guerrier qui conquiert pour lui tout seul le pays jusqu’à la ville de Zar, maintenant Kantarah, forteresse bâtie sur la branche pélusiaque, et qui fermait l’arrivée du côté de la péninsule sinaïque et la Palestine. Dans les principales villes d’Egypte, les conquérants règlent ce qui concerne le culte ; en plusieurs localités, Horus établit ses compagnons qui sont appelés forgerons. Ainsi l’introduction du travail du métal est rattachée par la légende à la conquête. Il me semble qu’il y a lieu de tenir compte de cette légende qui doit être une ancienne tradition. Elle concorde tout à fait avec ce que les historiens grecs nous disent, que l’Egypte était une colonie de l’Ethiopie. Ainsi les Egyptiens ou du moins ceux qui sont devenu les Egyptiens pharaoniques auraient suivi le cours du grand fleuve. Nous en avons la confirmation dans certains traits de la religion ou des mœurs. L’Egyptien s’oriente en regardant le sud, l’occident est la droite et l’orient la gauche. Je ne puis croire que par là il veuille dire qu’il marche vers le sud. Au contraire, il se tourne vers son pays d’origine, il regarde à la direction d’où il est venu et d’où il peut attendre le secours. C’est de là qu’est partie la force conquérante, c’est de là aussi que les eaux bienfaisantes du Nil apportent la fertilité et la richesse. En outre, le sud a toujours eu le pas sur le nord ; le mot roi veut dire, en premier lieu, roi de la Haute Egypte, et avant d’avoir réuni sous le même sceptre les deux moitiés du pays, les rois ont été ceux du Sud et d’une partie de la Moyenne-Egypte. Leur dieu nous indique le chemin qu’ils suivent. La divinité qui marche devant ceux a la forme d’un chacal ou d’un chien : c’est le dieu Oupouatou, celui qui montre le chemin. Ce n’est pas un dieu sédentaire, du moins à l’époque la plus ancienne. C’est un dieu qui marche en direction du nord. Il vient du sud, il ne remonte pas le cours du fleuve. » (Edouard Naville : l’origine africaine de la civilisation égyptienne, Revue archéologique, Paris 1913)
Enfin, il est universellement reconnu que le Delta est un foyer permanent de la peste dans le proche orient. Il a été le point de départ de toutes les épidémies de peste qui ont sévir dans cette région au cours de l’histoire. On peut aller plus loin et affirmer sans être téméraire que le Delta, en tant que tel, n’existait pas, même au temps de Menès, puisque Menphis était alors entièrement insalubre et quasi inhabitable. On s’y embourbait. C’est à partir des travaux pratiqués par Menès qu’elle est devenue moins insalubre.
La capitale des premiers rois égyptiens était dans le sud à Thèbes. Menphis a été fondée, surtout pour des nécessités militaires. Elle a été une place forte au point de jonction de la route d’infiltration des bergers asiatiques de l’est et de celle des nomades à l’ouest. Ces barbares tentaient constamment de pénétrer violemment en Egypte, attirés par les richesses qui s’y accumulaient, mais chaque fois ils ont été, après de rudes combats, complètement défaits et rejetés hors des frontières du pays. Le caractère de ces coalitions des peuples du nord et de l’est dans la région du Delta, le caractère féroce des luttes qui s’y sont déroulées, tout en justifiant la fondation de Menphis comme forteresse avancée, construite pour la sécurité du royaume égyptien, devait éviter des nouvelles coalitions de races blanches contre la race nègre d’Egypte, comme le prouve ce passage de Moret :
Vers le mois d’avril 1222, Mernephtah apprit à Menphis que le roi des libyens Meryey, arrivait de la contrée de Tehenou avec ses archers et une coalition de peuples du nord composée de shardames, sicules, archéens, lyciens et étrusques, emmenant l’élite des guerriers de chaque contrée ; son but était d’attaquer la frontière occidentale, dans les plaines de Périr. Le danger était d’autant plus sérieux que la province de Palestine était elle-même atteinte par l’agitation ; il semble bien que les Hittites avaient été entrainés dans la tourmente, quoique Mernephtah eut continué ses bons offices vis-a –vis d’eux, en leur envoyant du blé par ses navires, lors d’une disette, pour faire vivre le pays de Khati. (Moret, Des clans aux empires, p 389)
Après une bataille féroce qui dura six heures, les égyptiens avaient infligé une punition exemplaire à cette coalition de hordes barbares et les avaient complètement disloqués. Les survivants en ont gardé un souvenir d’épouvante transmis par des générations. Moret poursuit :
La bataille dura six heures, pendant lesquelles les archers d’Egypte firent un carnage parmi les barbares : Meryey s’enfuit à toutes jambes, abandonnant ses armes, son trésor, son Harem ; on inscrit au tableau, parmi les tués, 6359 libyens, 222 sicules, 742 étrusques, des shardanes et des achéens par milliers ; plus de 9000 épées et armures et un grand butin furent capturés sur le champ de bataille. Mernephtah grava un hymne de victoire dans son temple funéraire, à Thèbes, où il décrit la consternation de ses ennemis : chez les libyens, les jeunes disent entre eux à propos des victoires : nous n’en avons pas eues depuis le temps de Râ ; et le vieillard dit à son fils : Hélas, pauvre Libye ! Les Tehenou ont été consumés en une seule année. Et les autres provinces extérieures de l’Egypte furent, elles aussi, ramenées à l’obéissance. Tehenou est dévastée, Khati est pacifiée ; le Canaan est pillé. Ascalon est dépouillée, Gazer est saisie, Yanoem est anéantie, Israél est désolée et n’a plus de semences, le Kharou devient comme une veuve sans appui vis-à-vis de l’Egypte. Tous les pays sont unifiés et pacifiés.
Il importe de retenir de cette citation que la victoire a été acquise à Menphis, mais commémorée à Thèbes dans le temple funéraire de Mernephtah. Ce fait confirme que le pharaon Mernephtah n’est retenu à Menphis que par des nécessités militaires, mais sera enterré à Thèbes comme la quasi-totalité des pharaons égyptiens. Même quand le pharaon mourrait à Menphis, en Basse-Egypte, on prenait le soin de transporter son corps en Haute- Egypte et de l’enterrer dans les villes sacrées de la Thébaïde, Abydos, Thèbes, Karnak. C’est dans ces villes de la Haute-Egypte que les pharaons ont eu des tombeaux à coté de leurs ancêtres où ils ont toujours envoyé des offrandes de leur vivant, même s’ils passaient leur existence à Menphis.
Après la révolution qui marque la fin de l’ancien empire, quand le peuple eut accès au privilège de la mort osirienne, c’est-à-dire la possibilité de jouir d’une vie éternelle au ciel (après le jugement au tribunal d’Osiris), tous les éléments du peuple étaient enterrés symboliquement en Thébaïde en Haute –Egypte. Ce dernier fait serait un sacrilège, de la part du peuple égyptien, si la civilisation et la tradition religieuse étaient réellement nées dans le Delta. S’il en était ainsi c’est dans cette région qu’on devrait trouver les villes sacrées, les tombeaux ancestraux, les principaux lieux de culte et de pèlerinage, ce qui n’est pas le cas.
Tant d’arguments devraient suffire pour empêcher de soutenir sous une forme quelconque l’antériorité d’une prétendue civilisation du Delta. Les libyens à qui on veut attribuer l’origine de la civilisation égyptienne au point d’en faire, comble de contradictions leurs soi-disant cousins sauvages ou moins civilisés se fixeront au Delta comme mercenaires avec des lopins de terre attribués par le pharaon, à la basse époque. L’Egypte sera imbibée d’étrangers et c’est à ce métissage que l’on doit l’éclaircissement relatif du teint des Coptes. Si l’Egypte ne fut jamais une puissance maritime, cela s’explique, peut-être par le fait même que sa civilisation a pris naissance à l’intérieur du continent, contrairement à celle des autres peuples du pourtour de la méditerranée. D’après Plutarque (dans Isis et Osiris), les égyptiens considéraient la mer comme une « sécrétion corrompue », conception incompatible avec l’idée d’une origine riveraine.
La civilisation égyptienne peut-elle être d’origine asiatique ?
Pour que la civilisation égyptienne puisse être d’origine asiatique ou d’une origine extérieure quelconque, il est indispensable que l’on puisse démontrer l’existence antérieure d’un berceau de civilisation hors d’Egypte. Or on ne saurait trop insister sur le fait que cette condition élémentaire et indispensable n’a jamais été remplie.
Nulle part ailleurs les conditions naturelles n’avaient favorisé au même degré qu’en Egypte le développement d’une société humaine ; aussi nulle part ne retrouve-t-on une industrie néolithique d’une technique comparable. D’ailleurs il n’existe en Syrie et en Mésopotamie, à part quelques stations néolithiques de Palestine d’âge imprécis, aucune trace de l’homme antérieurement à 4000 avant J C. A cette date, les égyptiens entraient presque dans la période historique de la civilisation. Il convient donc d’attribuer au génie propre des premiers habitants de l’Egypte et aux conditions exceptionnelles présentées par la vallée du Nil, leur précoce développement ; Rien ne prouve que celui-ci soit dû à une invasion d’étrangers plus civilisés dont l’existence même, ou tout au moins la civilisation serait à démontrer. (Moret : des clans aux empires, paris, 1923, p 140.)
La période du calendrier égyptien est de 1461 ans. C’est l’intervalle de temps qui sépare deux levers héliaques de l’étoile Sothis ou Sirius. Il a fallu, pour inventer ce calendrier, des millénaires d’observation au cours d’une vie de sédentaire. Si l’on s’en tient strictement aux faits, on voit combien il est impossible de s’arrêter aux excès dogmatiques des inventeurs de la chronologie courte et ultra-courte qui ramènent à 3200 ou 2800 le début de l’histoire égyptienne, alors que le calendrier était utilisé en Egypte en 4241 avant J. C.
C’est dont en Egypte qu’on rencontre avec une certitude mathématique, la plus ancienne date historique de l’humanité. On ne trouve en Mésopotamie rien qui puisse être daté avec certitude. On y construisait en briques crues, séchées au soleil. Ces briques étaient en argile et la pluie les transformait en une masse de boue. En Egypte, on trouvait des temples, des obélisques, les forêts de colonne de Louqsor et de Karnak et autres, les rochers sculptés, les temples souterrains aux colonnes protodoriques (Deir-el-Bahari) de Thèbes… On décrète que le tumulus de terre cuite de Mésopotamie sont les restes de temples et de tours effondrés que l’on s’efforce de reconstituer. De telles reconstitutions y compris celle de la Tour de Babel sont d’une extrême gravité pour l’histoire de l’humanité de par l’illusion qu’elles peuvent créer : « les restes de ces tours babyloniennes sont le plus souvent retournés à la poussière à cause du manque de solidité de la brique cuite au soleil qui a servi à leur construction. Aussi les archéologues ne sont-ils pas d’accord sur les détails de leur forme. » (Breasted, La conquête de la civilisation, Payot, 1945, p122, note 1)
En Egypte, l’étude de l’histoire est largement étayée par des documents écrits tels que : la Pierre de Palerme, les tablettes royales d’Abydos, le papyrus royal de Turin, la chronique de Manethon... A tous ces documents authentiques, il faut ajouter l’ensemble des témoignages d’écrivains anciens depuis Hérodote jusqu’à Diodore, sans parler des textes des pyramides, du Livre des morts et des milliers d’inscription sur les monuments. En Mésopotamie, on chercher en vain quelque chose de semblable, les tablettes cunéiformes ne portent que des comptes de commerçants. Les anciens sont restés muets sur la prétendue civilisation mésopotamienne d’avant les chaldéens.
« Suivant les égyptiens, dans Diodore, les Chaldéens étaient une colonie de leurs prêtres que Bélus avait transportés sur le modèle de la caste mère, et cette colonie continue de cultiver la connaissance des étoiles qu’elle avait apportée de sa patrie. » (Hoefer : Chaldée, coll. l’univers, 1852, p 390). La Tour de Babel, pyramide à degrés semblable à celle de Saqqarah, connue aussi sous le nom de « Birs Nimroud » et « Temple de Baal », ne serait que l’observatoire astronomique des Chaldéens. Dès lors tout rentre dans l’ordre car Nimroud, fils de Kousch, petit-fils de Cham, ancêtre biblique des nègres, est le symbole de la puissance temporelle : « et Kousch engendra Nimroud, qui commença d’être puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l’éternel. Et le commencement de son règne fut Babel, Erec, Akkad, et Calné, au pays de Sçinhar. De ce pays-là sortit Assour… » (Génèse, X, 8-10). Qu’y a- t-il alors de plus normal que l’existence de pyramides à degrés à Saqqarah, à Babylone (ville koushite de Bel), en Coté d’Ivoire (sous forme de poids de bronze) et au Mexique ou l’émigration nègre par l’atlantique, est attestée par les écrivains et archéologues mexicains eux-mêmes. L’Asie occidentale étant le berceau des indo-européens, si une civilisation comparable à celle de l’Egypte s’était épanouie dans cette région, antérieurement à l’époque chaldéenne, son souvenir, si vague fût-il, aurait dû nous être transmis par les anciens, qui sont un rameau d’indo-européens, ceux-là même qui ont fourni tant de témoignages concordants sur la civilisation nègre égyptienne.
3200 ans avant J.C. selon la chronologie courte, l’Egypte fut unifiée en un royaume par Menès. En Asie occidentale, on n’aura rien de semblable : au lieu d’un royaume puissant et unifié on ne rencontre que des villes (Suse, Our, Lagash, Sumer) attestées parfois par des tombes anonymes qu’on décrète « tombes royales » sans aucune preuve. On élève ainsi au rang de roi des personnages qui, dans les cas où ils ne sont pas fictifs, n’étaient que des patriarches de villages ou de villes. « M.S smith pense que ces tombes pouvaient contenir, non de véritables rois, mais des acteurs du drame sacré qui se jouait à l’occasion des fêtes et où l’on sacrifiait le protagoniste principal… »
Dans l’épopée de Gilgamesh, Anu, le dieu primitif, père d’Ishtar, porte un nom nègre qui était aussi celui d’Osiris l’ancien : « la déesse Ishtar prit la parole et parla ainsi au dieu Anu son père… » D’après Amelineau, les Anus étaient les premiers nègres habitant l’Egypte et dont une fraction est restée durant l’histoire de l’Egypte, en Arabie pétrée.
M. Christian situe l’histoire mésopotamienne à 3100 ou 3000 avant J. C. Cela découle de la nécessité de faire concorder à tout prix, la chronologie égyptienne et la chronologie mésopotamienne, même si tous les documents historiques situent cette histoire à une période bien moindre. Le Dr. Conteneau s’élève en faux contre cette thèse. En fait si l’on se cantonne uniquement dans le cadre des faits probants, on est obligé de ne voir dans la Mésopotamie qu’une fille tardivement née de l’Egypte.
En ce qui concerne les monuments perses, Diodore nous apprend qu’ils ont été construits par des anciens Egyptiens enlevés de force par Cambyse « le vandale » : « Cambyse fit mettre le feu à tous les temples d’Egypte ; Ce fut alors que les Perses transportant tous les trésors en Asie et emmenant même avec eux des ouvriers égyptiens, firent bâtir les fameux palais de Persépolis, de Suse et de quelques autres villes de la Médie. » (Diodore, Livre I, section 2, p. 102)
D’après Strabon, Suse avait été fondée par un nègre : Tithon, roi d’Ethiopie, père de Memnon. Les Susiens s’appelaient aussi Cissiens. Eschyle affirme que la mère de Memnon se nomme Cissia. Cissé est aussi un nom propre africain.
La civilisation égyptienne peut-elle être bâtie par les juifs ?
Il est impensable d’attribuer l’origine de la civilisation égyptienne aux Juifs. Les juifs commencent à compter dans l’histoire au premier millénaire avec David et Salomon, quand la civilisation égyptienne est déjà plusieurs fois millénaire. Salomon n’a été qu’un petit roi régnant sur une petite bande de terre. Il n’a jamais dominé le monde comme le disent les légendes. Il s’est distingué par son esprit de justice et par ses talents de commerçant. La Palestine fut prospère durant son règne, grâce à son activité commerciale. Ce fut le seul règne important de l’histoire juive jusqu’à nos jours. Plus tard le pays sera conquis par Nabuchodonosor qui effectua un transfert de la population juive à Babylone. Les juifs se dispersèrent peu à peu, l’Etat juif s’éclipsa très rapidement pour réapparaitre avec le sionisme prôné par David Ben Gourion.
La Phénicie
Selon la Bible, quand les premières races blanches sont arrivées sur les lieux, elles y ont trouvé une race nègre : les Cananéens descendants de Canaan, frère de Misraim l’Egyptien et de Kush l’Ethiopien, tous fils de Cham, l’ancêtre biblique des nègres.
Après de multiples péripéties, les Cananéens et les tribus de race blanche symbolisées par Abraham et sa descendance (lignée d’Isaac) fusionnèrent pour devenir, avec le temps, le peuple juif d’aujourd’hui :
Hémor donc et Sichem son fils vinrent à la porte de leur ville, et parlèrent aux gens de leur ville, et leur dirent : Ces gens ci sont fort paisibles, ils sont avec nous ; Qu’ils habitent au pays et qu’ils y trafiquent. Et voici, le pays est d’une assez grande étendue pour eux ; Nous prendrons pour nos femmes leurs filles, et nous leur donnerons les nôtres. » (Génèse, XXXIV, 20-21)
Aussi, le terme de Leuco-Syriens appliqué à certaines populations blanches de cette région, au lieu d’être une contradiction, comme le croit Hoefer, est une confirmation des données bibliques : « aussi les cappadociens, tant ceux du Taurus que ceux du Pont, ont conservé jusqu’à présent le nom de Leuco-Syriens (syriens blancs) comme s’il y’avait aussi des Syriens noirs » (Hoefer : Chaldée, Babylonie. Coll.univers, ed. Didot frères, 1852, P 158)
C’est à cette manière que l’on peut expliquer l’alliance éternelle des Egyptiens et des Phéniciens. Même aux époques les plus troublées, aux époques de grande infortune, l’Egypte pouvait compter sur les Phéniciens comme on peut, en quelque sorte, compter sur son frère. La religion et les croyances phéniciennes sont en quelque sorte des répliques de celles de l’Egypte. La cosmogonie phénicienne est révélée par les fragments de Sanchonisation. D’après ces textes, il y avait à l’origine une matière incréé et chaotique, en perpétuel désordre (Bohu), le souffle (Rouah) planait au-dessus du chaos. L’union de ces deux principes fut appelée chephets, le désir qui est à l’origine de toute création. Selon la cosmogonie égyptienne, il y eut à l’origine une matière chaotique incréé, le Noum primitif. Cette matière primitive contenait sous forme de principes tous les êtres possibles. Elle contenait également le principe, ou dieu du devenir Khépru. Par générations successives dans la cosmogonie phénicienne on arrivera à l’ancêtre des Egyptiens Misor, qui engendrera Taout, inventeur des Lettres et Sciences (qui n’est autre que le Thot des égyptiens). Dans la même cosmogonie, on arrive à Osiris et Canaan, l’ancêtre des phéniciens.
La Phénicie commence à civiliser la Grèce
Vers la moitié du second millénaire, sous la poussée croissante de tribus de race blanche qui ont refoulé les Phéniciens vers la côte en occupant l’arrière-pays, les Sidoniens fondèrent les premières colonies phéniciennes en Béotie pour y installer le trop-plein de la population : c’est ainsi que fut créé Thèbes, en souvenir de la ville sacrée de la Haute Egypte d’où les Phéniciens ont emmené les femmes noires qui ont fondées les oracles de Dodone en Grèce et d’Ammon en Libye.
Cadmus le phénicien personnifie la période Sidonnienne et l’apport phénicien à la Grèce. Les Grecs disent que c’est Cadmus qui a introduit l’écriture. Les traditions grecques situent à la même époque l’installation de colonies égyptiennes en Grèce : Cécrops se fixe en Attique ; Danus, frère d’Egyptos, en Argolide. Il enseigne l’agriculture aux Grecs, ainsi que la Métallurgie. C’est à cette époque sidonienne que se situe le passage des éléments de la civilisation égypto-phénicienne à la Grèce.
La Grèce s’émancipe de l’autorité phénicienne
La colonie phénicienne eût la suprématie au début. Mais il y eût très tôt une lutte d’émancipation des Grecs contre les Phéniciens. Cette période de conflit est symbolisée par la lutte de Cadmus (le phénicien) contre le serpent fils de Mars (le grec) ; elle dura environ trois siècles. « Après avoir accepté l’autorité des phéniciens, après en avoir reçu les bienfaits de la civilisation, il (le grec) réagit contre eux et cherche à les expulser… »
Il s’agit là d’une période de démarcation où le monde indo-européen s’émancipait de la domination du monde noir égypto-phénicien. Cette lutte politique et économique est doublée d’une réaction culturelle. Elle marque la rencontre et le conflit de deux conceptions différentes : l’une ayant ses plus profondes racines dans les steppes eurasiatiques et l’autre ayant les siennes au cœur de l’Afrique. C’est aussi la lutte du matriarcat de la civilisation africaine et celle du patriarcat de la civilisation indo-européenne.
Les deux berceaux de civilisation du monde
On ne comprendra pas l’histoire de l’humanité sans distinguer deux berceaux primitifs où la nature a façonné les instincts, les habitudes et les conceptions morales des deux fractions de cette humanité avant qu’elles ne se soient rencontrées, après une longue séparation datant de la préhistoire.
Le premier de ces berceaux est la vallée du Nil. L’abondance des ressources de la vie et son caractère sédentaire vont engendrer chez l’homme, c’est-à-dire le nègre, une nature douce, idéaliste et généreuse, pacifique, imbue d’esprit de justice, gaie. Toutes ces vertus étaient pour la plupart, indispensables à la coexistence quotidienne. Par la voie des exigences de la vie agricole, les conceptions telles que le matriarcat, le totémisme, l’organisation sociale la plus perfectionnée et la religion monothéiste naquirent.
Par contre la férocité de la nature dans les steppes eurasiatiques, l’infertilité de ces régions, l’ensemble des conditions matérielles dans ce berceau géographique, forgeront chez l’homme les instincts nécessaires à son adaptation au milieu. Ici, la nature ne permet aucune illusion sur sa bonté : elle est implacable et ne permet aucune négligence : l’homme tirera son pain quotidien de la sueur de son front. Il apprendra au cours de cette longue et pénible existence, à compter sur ses propres moyens, ses propres possibilités. Il ne peut pas se payer le luxe de croire à un dieu bienfaiteur qui lui prodiguerait, avec abondance, les moyens d’existence : son esprit enfantera surtout des divinités maléfiques et cruelles, jalouses et rancunières : Zeus, Javeh … Tous les peuples de ce berceau, qu’ils soient blancs ou jaunes, auront l’esprit de conquête parce qu’ils auront tendance à s’évader de ce milieu hostile. Ils sont chassés par le milieu. Il leur faut partir ou succomber, tenter de conquérir des milieux plus cléments. Dès qu’un premier contact avec le monde nègre méridional leur apprendra l’existence de pays où la vie est facile, les richesses abondantes, les techniques florissantes, les invasions ne s’arrêteront plus. Depuis 1450 av J.C. jusqu’à Hitler, en passant par les barbares des IVe siècles, Gengis-khan, les turcs… L’homme de ces régions est resté longtemps nomade, il est cruel, tel qu’explique Tacite dans mœurs des germains. Le climat froid engendra le culte du feu qui reste vivace. Le nomadisme engendra l’incinération : on transportait ainsi dans de petites urnes les cendres de ses ancêtres. L’homme était le pilier d’une telle vie. Le rôle de la femme dans la vie économique était beaucoup plus réduit que dans les sociétés agricoles nègres. Le système du patriarcat règlera toute la vie des indo-européens, c’est pour cela que la participation de la femme aux affaires publiques sera plus tardive dans les sociétés européennes que dans les sociétés nègres. Si on trouve apparemment le contraire dans certaines parties de l’Afrique noire, cela est dû à la superposition de l’influence islamique.
Prépondérance du berceau méridional et son évincement du berceau eurasiatique
Ce sont ces deux types de conceptions sociales qui se sont heurtés et superposés autour de la Méditerranée. C’est l’influence nègre qui a précédé celle des indo-européens. D’autres subissaient l’influence économique et culturelle nègre : Grèce, Asie mineure, Troie, Hitites, Etrusques, Gaule, Germains…. C’est ce qui explique l’adoration des « vierges noires » dont le culte survit aujourd’hui en France (Notre Dame sous-terre, ou la vierge noire de Chartes). Le nom même de la capitale de la France s’expliquerait par le culte d’Isis : « le nom de Parisi pourrait bien signifier « temple d’Isis » car il existait au bord du Nil une cité de ce nom » (Pierre Hubac : Carthage, ed. bellinard, 1952. p. 170.) Les premiers habitants de l’emplacement actuel de la ville de Paris, qui se sont battus contre César, portaient le nom de Parisi. Or le culte d’Isis était très répandu en France, en particulier dans des temples d’Isis ou plus exactement « maison d’Isis ». Il y’a aussi une grande ressemblance entre les langues bretonnes, gallaises et africaines, en occurrence la formation du singulier à partir du pluriel par le suffixe enn en breton, gallois et valaf.
Les Etrusques étaient fortement influencés par la culture égyptienne, et ce sont eux qui ont apporté tous les éléments de la civilisation égyptienne sur la presqu’ile italique : agriculture, arts, religion, art divinatoire. Les romains assimileront la substance de cette civilisation quand ils auront détruit les Etrusques tout en éliminant les éléments les plus étrangers à leur conception patriarcale eurasiatique.
Malgré l’évincement de la culture nègre du bassin septentrional de la Méditerranée, elle survivra sous d’autres formes : la Louve romaine rappelle plutôt des pratiques de totémisme méridional nègre. Sabin semble contenir la racine Saba. Malgré les actes de vandalisme répété depuis Cambyse, les romains, les chrétiens du VIe siècle en Egypte, les Vandales, nous avons encore assez de documents pour rédiger une histoire claire de l’humanité. L’occident actuel est parfaitement conscient, mais il n’en a pas le courage intellectuel et moral.
Au Mexique précolombien, le fait que les paysans étaient enterrés alors que les guerriers étaient incinérés peut s’expliquer à partir de la distinction faite si dessus des deux berceaux primitifs de l’humanité. Des peuples de race blanche venus par le nord et les nègres venus d’Afrique par l’océan atlantique se seraient rencontrés sur le continent américain et auraient fusionné progressivement pour donner la race plutôt jaune des indiens.
Dans le fond lorsque les nazis disent que les français sont des négroïdes, si nous écartons l’intention péjorative qui préside à de telles affirmations, elles restent historiquement fondées dans la mesure où elles font allusion à ces contacts de peuples à l’époque égéenne. Mais cela n’est pas seulement vrai des français : Ce l’est davantage pour les Espagnols, les Italiens, les Grecs … Toutes ces populations dont on voudrait justifier la couleur moins blanche que celle des autres européens, par leur habitat méridional. La colonisation romaine n’a fait que supplanter la colonisation phénicienne en Italie d’abord, puis en Espagne et en Afrique par la destruction de Carthage. Carthage était l’une des dernières colonies phéniciennes fondée sur la côte d’Afrique en 822 par la reine Elissar du temps de Lycurgue en Grèce. Il s’ensuivit un métissage avec les races libyennes qui arrivèrent plus tard. D’ailleurs, le général Hannibal qui a failli détruire Rome et qui passe pour l’un des plus grands chefs militaires de tous les temps, était un négroïde.
Avec les défaites de la civilisation nègre, la méditerranée septentrionale dominera désormais la méditerranée méridionale ; L’Europe dominera désormais l’Afrique jusqu’à nos jours. C’est par la victoire romaine sur Carthage que commenceront la pénétration et la domination de l’Europe sur l’Afrique. Cette domination s’est achevée à la fin du XIXè siècle. On ne saurait trop insister sur le rôle primordial joué par les nègres et négroïdes à une époque où les races européennes étaient encore sauvages et tout juste aptes à la civilisation.
Mais ils (les phéniciens) en eurent partout, et ces comptoirs exercèrent une immense influence sur les différents pays où ils s’étaient établis. Tous devinrent le noyau de grandes cités, car les indigènes encore sauvages venaient rapidement se grouper autour de la factorerie phénicienne, attirés par les avantages qu’ils y trouvaient et par les séductions de la vie civilisée. Tous aussi furent des centres actifs de propagation de l’industrie et de la civilisation matérielle. (Lenormant, id., p 543)
Avec la grandeur de la civilisation phénicienne, les indigènes sauvages peu à peu cherchent à pénétrer les secrets de fabrication des produits qui leurs sont vendus. Ce qu’ils finissent par réussir.
Eugène Pittard fait une description des carthaginois et conclut que plusieurs races coexistaient à Carthage. Il souligne les caractéristiques de l’élite politique et religieuse qui est nègre ou négroïde. La prêtresse de Tanit ayant le plus magnifique sarcophage et présentait des caractéristiques négroïdes. On dépense des millions pour aller creuser des tertres d’argile en Mésopotamie, dans l’espoir de trouver des documents permettant de placer avec certitude et une fois pour toutes, le berceau des civilisations en Asie occidentale. Bien que ceux qui l’entreprennent nourrissent des espoirs très minces d’arriver un jour à leurs fins, ils n’en continuent pas moins. Mais on évite de toucher les tombeaux phéniciens parce qu’il sera très évident d’y découvrir des nègres.
L’Arabie
Selon Lenormart, un empire koushite se serait constitué primitivement sur toute l’Arabie. Ce fut l’époque des Adites de Ad, petit-fils de Cham, l’ancêtre biblique des nègres. Cheddade, fils d’Ad et constructeur du légendaire « paradis terrestre » mentionné dans le Coran appartient à cette époque appelée celle des « premiers Adites ». L’empire des premiers Adites fut détruit au XVIIIe siècle avant l’ère chrétienne par une invasion de tribus jectanides de race blanche, incultes, qui seraient venues s’installer parmi les nègres. La prophétie de Hud concerne cet événement. Cependant, l’élément Koushite ne tarda pas à reprendre le dessus au point de vue politique et culturel. Les premières tribus de race blanche furent complétement absorbées par l’élément Koushite. C’est l’époque dite des « second Adites ». Ces faits sur lesquels les auteurs arabes eux-mêmes sont d’accord nous prouvent que le peuple arabe ne se conçoit pas en dehors d’un métissage de nègres et de blancs, qui se poursuit d’ailleurs jusqu’à nos jours. Ces mêmes faits prouvent que les traits communs à la culture nègre et à la culture dite sémitique découlent d’emprunts faits par cette dernière à la première. L’inverse est historiquement faux. C’est pendant les premiers siècles du règne des seconds Adites que l’Egypte conquit le pays, sous Thoutmosis III. Lenormant pense que l’Arabie est le pays de Pount et de la reine de Saba. Il faut rappeler que la Bible localise dans le même pays un des fils de Cham, Put. Au VIIIe siècle avant J.C., les jectanides, devenus suffisamment forts, se seraient emparés du pouvoir, sous la conduite de Iârob, tel que nous l’affirme Lenormant. Après cette défaite, une partie des Adites franchit la mer rouge vers l’Ethiopie, tandis que l’autre restait en Arabie, réfugiée dans les montagnes de l’Hadramant et autres endroits, d’où le proverbe arabe : « se diviser comme les sabéens »
Institutions et mœurs du royaume sabéen
Toujours d’après Lenormant, le régime des castes, étranger aux sémites, était la base de l’organisation sociale comme à Babylone, en Afrique, au royaume de Malabar en Inde : « ce régime est essentiellement Koushite et partout où nous le retrouvons, il est facile de constater qu’il procède originairement de cette race ». La circoncision y était pratiquée. Renan ajoute, parlant de littérature des contes, que « ce mode de fiction caractérisée par le rôle qu’y joue l’animal, nous représente un genre de littérature propre aux Koushites » (Renan : Histoire des langues sémitiques). Lenormant continue en précisant que les Jectanides « qui se trouvaient encore, au moment de leur arrivée, dans un état presque barbare » n’introduisaient, à proprement parler, que le système des tribus pastorales et la féodalité militaire, « deux systèmes chères à tous les arabes ». La religion pratiquée est d’origine Koushite et restera la même jusqu’à l’Islam. Les dieux sabéens étaient les mêmes que les dieux babyloniens, à peu près, et tous appartenaient à la même famille Koushite des dieux égyptiens et phéniciens.
Le dieu Il était l’objet d’un culte national, il était connu partout et jouissait des qualificatifs suivants : Dhou-Samawi = le seigneur des cieux (correspondant au Baol Samaïn de la Phénicie). Le jeûne de 30 jours existait déjà semblable à ce qu’on pratiquait en Egypte. On priait sept fois par jour le visage tourné vers le nord. Ces prières qui sont adressées au soleil aux différents moments de son développement ressemblent assez aux prières musulmanes qui ont lieu aux mêmes phases, mais qui ont été ramenées à cinq obligatoires par le « prophète » « pour alléger l’humanité », les deux autres étant facultatives. Il y avait aussi des sources et des prières sacrées, comme à l’époque musulmane : Zenzen, source sacrée ; Kaaba, prière sacrée. Le pèlerinage à la Mecque existait déjà. La Kaaba aurait été construite par Ismaël, fils d’Abraham et d’Agar l’égyptienne « négresse », ancêtre historique de Mahomet selon tous les historiens arabes. On croyait déjà à la vie future, comme en Egypte. Les ancêtres morts étaient divinisés. Tous les éléments nécessaires à l’éclosion de l’Islam étaient donc en place plus de 1000 ans avant la naissance de Mahomet et l’Islam apparaitra comme une « épuration » du sabéisme, par « l’envoyé de dieu ».
Tout le peuple arabe jusqu’au prophète est métissé de nègre. Tous les arabes cultivés sont conscients de ce fait. Le héros romanesque d’Arabie, Antar, est lui-même un métis, comme nous souligne une fois de plus Lenormant. Le sémite est le produit d’un métissage de nègre et de blanc.
Chapitre IV
Argument pour une origine nègre de la race et de la civilisation égyptiennes
Totémisme
Moret dans son livre Des clans aux empires avait insisté sur le caractère essentiellement totémique de la société égyptienne. Frazer est formel sur l’origine du totémisme : on ne le rencontre que chez les populations de couleur. Les anthropologues, conscients de ce fait, tentèrent de trouver le totémisme chez les populations blanches comme les Berbères et les Touaregs, mais en vain. Cet échec les poussa à dévier le totémisme dans l’abstraction philosophique.
Il est impossible de nier, sans verser dans la philosophie, que le caractère « tabous » de certains animaux et de certaines plantes en Egypte correspond à du totémisme comme c’est le cas dans toutes les régions d’Afrique noire. Par contre les Grecs rallaient la vénération excessive dont témoignaient les Egyptiens pour des animaux et même pour certaines plantes.
Circoncision et excision
Les Egyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Ce sont eux qui ont transmis cette pratique au monde sémitique en général, juifs et arabes en particulier, tel que nous montre Hérodote.
Pour démontrer que les Colches étaient des Egyptiens, Hérodote invoque les deux indices suivants :
… le premier, c’est qu’ils sont noirs et qu’ils ont les cheveux crépus, preuve assez équivoque puisqu’ils ont cela de commun avec d’autres peuples. Le second et le principal, c’est que les Colchidiens, les Egyptiens et les Ethiopiens sont les seuls hommes qui se fassent circoncire de temps immémorial. Les Phéniciens et les Syriens de la Palestine, conviennent eux-mêmes qu’ils ont appris la circoncision des Egyptiens (II, p 104)
Nous comprenons ainsi pourquoi les sémites pratiquent la circoncision sans que leurs traditions en donnent une justification valable. Dans la genèse, dieu demandera à Abraham comme à Moïse de se circoncire en signe d’alliance avec lui. Le fait est d’autant plus étrange qu’Abraham aurait épousé une négresse, Agar l’égyptienne, et mère d’Ismaël. Moïse aurait aussi épousé une mandianite et c’est consécutivement à ce mariage que l’éternel lui a demandé de se circoncire.
Par-delà les détails légendaires, la circoncision ne trouve une interprétation intégrée dans une explication générale de l’univers que chez les nègres. En particulier la cosmogonie Dogon que rapporte Marcel Griaule dans Dieu d’eau. Il nous apprend que la circoncision pour avoir tout son sens, doit être accompagnée de l’excision : ces deux opérations ayant pour buts de retirer à l’homme ce qu’il a de femelle et à la femme ce qu’elle a de mâle. En fait, l’être qui vient au monde est, dans une certaine mesure, androgyne comme le premier dieu :
Tant qu’il conserve son prépuce ou son clitoris, supports du principe de sexe contraire au sexe apparent, masculinité et féminité sont de même force. Il n’est donc pas juste de comparer l’incirconcis à une femme ; il est, comme la fille non excisée, à la fois mâle et femelle. Si cette indécision où il est quant à son sexe devait durer, l’être n’aurait jamais aucun penchant pour la procréation.
« Ce sont donc des raisons diverses qui expliquent la circoncision et l’excision : nécessité de débarrasser l’enfant d’une force mauvaise, nécessité pour lui de payer une dette de sang et de verser définitivement dans un sexe. » (id, p 189)
Champolion-le-Jeune, dans les lettres adressées à Champolion-Figeac lors de son passage en Nubie en 1833 nous instruit de l’androgynie divine d’Amon, Dieu suprême du Soudan méroïtique et de l’Egypte : « Amon est le point de départ et de réunion de toutes les essences divines. Amon-Râ, Etre suprême et primordial, étant son propre père et qualifié de mari de sa mère (Mouth), sa portion féminine renfermée en sa propre essence à la fois mâle et femelle » Amon est également le Dieu de toute l’Afrique noire et lié à l’idée d’humidité, de l’eau. Son attribut dans tous ces pays est le Bélier. Dans la cosmogonie Dogon, il descend du ciel à la terre par l’arc-en-ciel, signe de la pluie et de l’humidité.
Concernant l’excision en Egypte, Strabon nous apprend que : « les Egyptiens observent surtout, avec le plus grand soin, d’élever tous les enfants qui leur naissent et de circoncire les garçons et même les filles, usage commun aux juifs, peuple originaire de l’Egypte, ainsi que nous l’avons dit à l’endroit où il a été question de lui » (Géographie, livre 17, chap I page 29)
Royauté
La conception de la royauté est l’un des traits les plus impressionnants de l’identité qui existe entre l’Egypte et le reste de l’Afrique noire.
La mise à mort rituelle du roi.
Le roi ne devait régner en Egypte qu’étant en pleine force. Quand il devenait vieux, on le mettait à mort rituellement, après une épreuve devenue symbolique, nommée « Fête du Sed ». Le roi passait pour rajeuni aux yeux du peuple et était de nouveau apte à assumer ses fonctions. L’être sacré par excellence, le roi, devait aussi être l’homme qui avait le plus de force vitale. Lorsque le niveau de sa force vitale baissait au-dessous d’un certain minimum, il se produisait une rupture au niveau des forces ontologiques. S’il continuait de régner, il ne pouvait être désormais qu’un danger pour le peuple. Cette conception vitaliste est à la base de toutes les royautés traditionnelles africaines, j’entends de toutes les royautés non usurpées. Elle relève des croyances du monde noir selon lesquelles la fertilité du sol, l’abondance des récoltes, la santé du peuple et des troupeaux, le déroulement normal de tous les événements, de tous les phénomènes de la vie sont intimement liés au potentiel de la force vitale du roi.
Dans d’autres régions de l’Afrique noire, les faits se passent exactement comme en Egypte à propos de la mise à mort effective du roi. Chez certains peuples même, on détermine un nombre d’années au bout desquelles on suppose que le roi est vitalement hors d’état de régner, et on le met alors, effectivement, à mort.
Cosmogonie
Les cosmogonies nègres africaines et égyptienne sont si proches les unes des autres qu’elles se complètent fréquemment. Une vie humaine entière ne suffirait pas pour rapporter tous les traits de parenté qui existent entre l’Egypte et le monde noir tant il est vrai qu’il s’agit d’une seule et même chose.
Paul Hassam-Oursel insiste sur le caractère nègre de la philosophie égyptienne. C’est cette identité de la culture égyptienne et de la culture nègre qui fait que la philosophie égyptienne n’est que le reflet de l’esprit nègre. Surtout que Hassam-Oursel ajoute que cette constatation devrait être une banalité admise par tout le monde, tant il est vrai qu’elle saute aux yeux de tous ceux qui sont de bonne foi.
C’est en raison de cette identité essentielle de génie, de culture et de race que tous les nègres peuvent aujourd’hui, légitimement, rattacher leur culture à l’Egypte antique et bâtir une culture moderne à partir de cette base. C’est un contact dynamique, moderne avec l’antiquité égyptienne, qui permettrait aux nègres de découvrir chaque jour d’avantage la parenté intime de tous les noirs du continent avec la vallée mère du Nil. C’est par ce contact dynamique, que le nègre arrivera à la conviction profonde que ces temples, ces forêts de colonnes, ces pyramides, ces colosses, ces bas-reliefs, ces mathématiques, cette médecine, toute cette science, sont bien l’œuvre de ses ancêtres et qu’il a le droit et le devoir des s’y reconnaitre totalement.
Dans la cosmogonie nègre, tandis que les ancêtres les plus lointains se détachent pour accéder dans les régions divines, les plus proches, ceux qui viennent de mourir, ceux dont le souvenir n’est pas encore assez vague pour qu’on puisse les considérer non plus comme les ancêtres de telle ou telle famille, mais comme ceux de tout le peuple, ces ancêtres proches ne sont que des demi-dieux familiaux.
Dans le cadre de cette unicité de conception entre l’Egypte et le reste de l’Afrique noire, nous pourrions en particulier, insister sur la similitude du Dieu-serpent Dogon et du Dieu-serpent du panthéon égyptien. L’un comme l’autre danse dans les ténèbres. Tous deux sont des ancêtres qui prennent la forme du serpent, se font écraser par un forgeron et vont sous la terre manger le plus ancien vieillard. Ces derniers traits relèveraient d’anthropophagie rituelle que l’on trouvait en Egypte à l’origine et des principes vitalistes qui sont à la base de la société noire. En s’assimilant la substance d’autrui, on s’assimile sa force vitale, on augmente ainsi son invulnérabilité à l’égard des forces destructives de l’univers.
On pourrait aussi établir le même rapprochement entre le Dieu-chacal du panthéon Dogon et le Dieu-chacal du panthéon Egyptien, gardien du bassin où les morts devaient se purifier. Quand on sait que les Dogons connaissent l’étoile Sothis (Sirius), on ne peut que songer au calendrier égyptien qui est fondé sur le lever héliaque de cette étoile.
Organisation sociale
L’organisation sociale de la vie africaine épouse exactement celle de l’Egypte.
Egypte Reste de l’Afrique Noire
-les paysans -les paysans
-les ouvriers spécialisés -les artisans ou ouvriers spécialisés
-les prêtres, les guerriers et fonctionnaires -les guerriers, les prêtres
-le roi -le roi
Matriarcat
Le matriarcat est à la base de l’organisation sociale en Egypte comme dans le reste de l’Afrique noire. C’est un système propre à l’Afrique noire. On note l’absence de reines dans l’histoire grecque, romaine, perse alors que les reines étaient fréquentes en Afrique noire.
Quand le monde indo-européen acquit assez de force militaire pour se lancer à la conquête du vieux pays qui l’avait civilisé, il se heurtera à la résistance farouche de la reine Candace du Soudan méroïtique. La reine impressionna toute l’antiquité par la résistance farouche, irréductible qu’elle opposa à la tête de ses troupes aux armées romaines de César-Auguste. La perte d’un œil au combat ne fit que redoubler son courage. Actuellement, en Afrique noire, dans les régions où le matriarcat n’a pas été altéré par une influence extérieure : Islam, Christianisme etc., c’est la femme qui transmet intégralement les droits politiques. Ce fait découle d’une idée plus générale selon laquelle l’hérédité n’est efficace que quand elle est d’origine maternelle.
Un autre fait caractéristique du matriarcat africain est la dot donnée par l’homme à la femme tandis que nous assistons à la coutume inverse dans les pays européens. En Afrique, la femme occupant une position privilégiée grâce au matriarcat, c’est elle qui reçoit une garantie sous forme de dot dans l’alliance qu’est le mariage. Dans ce système, la femme est la maitresse de maison au sens économique du terme. C’est elle qui dispose de tous les aliments et personne ne peut y toucher, même le mari sans son consentement. Il est fréquent qu’un mari ait à sa portée des aliments préparés par sa propre femme, auxquels il n’ose pas toucher sans autorisation. Entrer dans une cuisine est une déchéance pour un homme en Afrique noire. Ibn Batouta qui visita le Soudan au moyen-âge fut frappé par le matriarcat nègre, il déclare n’avoir trouvé un fait semblable qu’aux indes chez les populations également noires.
On ne doit pas confondre le matriarcat avec le règne des amazones d’Afrique où celui de Gorgones. Ces régimes légendaires dans lesquels la femme aurait dominé l’homme étaient caractérisés par une technique d’avilissement de ce dernier. Le régime du matriarcat proprement dit est caractérisé par la collaboration et l’épanouissement harmonieux des deux sexes, par une certaine prépondérance même de la femme dans la société due à des conditions économiques à l’origine, mais accepté et même défendue par l’homme.
Parenté du Soudan Méroïtique et de l’Egypte. Antériorité du Soudan Méroïtique. Avènement de la dynastie soudanaise méroïtique Piankhi, Shabaka, Sabataka
L’Ethiopie actuelle n’est pas l’Ethiopie des anciens. Ce terme désignait des populations essentiellement noires, incluant la civilisation soudanaise de Sennaar. Les rois qui ont chassés les usurpateurs libyens du trône d’Egypte sous la XXVe dynastie aux environs de 750, étaient des rois soudanais.
Sabaka en 712, monte sur le trône d’Egypte en chassant l’usurpateur Bacchoris. L’accueil enthousiaste que lui réserva le peuple égyptien qui vit en lui le régénérateur de la tradition ancestrale, témoigne une fois de plus en faveur de cette parenté originale des Egyptiens et des Ethiopiens nègres. Ce passage de Cherubini exprime assez clairement ce fait :
Quoi qu’il en soit, il est remarquable que l’autorité du roi d’Ethiopie parut reconnue par l’Egypte, moins comme celle d’un ennemi qui impose sa loi par les armes, qu’à titre de domination tutélaire, appelée par le vœu du pays depuis longtemps souffrant, livré à l’anarchie au dedans, affaibli au dehors et qui trouvait dans ce monarque, représentant d’ailleurs de ses idées et de ses croyances, un régénérateur zélé de ses institutions, un protecteur puissant de son indépendance. (Cherubini, la Nubie, collection « univers », paris, 1847, p 108)
Budge pour sa part souligne que les Egyptiens entretenaient la conviction d’être unis par des liens étroits au peuple du pays de Pount, l’actuelle Ethiopie. Jusqu’à la fin de l’empire égyptien, les noirs de Nubie (Soudan) porteront le même titre que le pharaon d’Egypte. Celui d’épervier de Nubie (Diahây, Maf en Valaf). Ammon, Osiris, sont représentés en noir charbon, Isis est la déesse. Seul un noir peut avoir le privilège de servir le culte du dieu Min ; la prêtresse d’Amon de Thèbes ne pouvait être qu’une Soudanaise Méroïtique. Ces faits sont fondamentaux, indestructibles. « Le Dieu Kousch avait des autels à Memphis, à Thèbes, à Méroe (Sabah) sous le nom de Khons, dieu du ciel pour les Ethiopiens, Hercule pour les Egyptiens » (Pédrals, p 29).
La Nubie est à la fois apparentée à l’Egypte et au reste de l’Afrique noire. Elle semble être le point de départ de l’une comme de l’autre civilisation. Après l’occupation de l’Egypte par les indo-européens à partir du Ve siècle avant J-C, elle restera l’unique foyer de culture et de civilisation du monde nègre jusqu’aux environs du VIe siècle, puis le Ghana prendra le flambeau jusqu’en 1240, date à laquelle sa capitale fut détruite par Sundjata Keita. Ce fut le tour de l’empire Mandingue (capitale Mali), puis l’empire de Gao, l’empire du Yatinga (ou Mossi qui dure jusqu’à nos jours), les royaumes du Djoloff et du Cayor détruits par Faidherbe sous Napoléon III. L’histoire africaine n’a jamais été interrompue.
L’Egyptologie ne sera assise sur un terrain solide que le jour où elle reconnaitra officiellement sa base nègre africaine. Les traditions des peuples d’Afrique noire se rapportent à l’Egypte pharaonique. Petrals citant Morié, qui rapporte une tradition Copte, parle de deux rois non identifiés dont le deuxième est le roi Shango, Iakouta ou Khivioso (selon les dialectes). Ce prince adoré sur toute la côte des esclaves (Guinée) sous divers noms, comme le dieu de la foudre et de la destruction, étaient d’après les récits même des noirs, un roi de Koush, d’où son surnom d’Obba-Kouso : Il aimait la guerre et la chasse avec passion. Ses conquêtes le portèrent jusqu’au Dahomey. Les rois Biri (dieu des ténèbres) furent ses esclaves.
Aux termes de Morié, cet Obba-Kouso serait né à Ifé, localité que notre auteur ignore parfaitement. Paré du titre de ‘premier né du dieu suprème’, il est issu des amours incestueux d’Ourougan, elle-même sœur d’Agandjou, dieu de l’espace. Chango-Obba kouso a pour frères : Dada, dieu de la nature et Ogun, dieu des chasseurs et des forgerons. Il épouse trois femmes : Oya, Osoun et Oba. Il est assez évident que Orougan et Yemadja évoquent le couple incestueux d’Ammon (Kham et Mout), leur fils ayant au demeurant le surnom de roi de Koush ; qu’Osoum évoque Asoum femme de Thouboum-sel-typhon epousée ensuite par Hor, fils de Misraim-Osiris et que Dada évoque Dédan fils de koush selon une version et Reama fils de Koush, selon une autre avec une incertitude que la Bible a encore aggravée. Enfin pour les Ethiopiens, Koush a bien eu aussi trois épouses, lesquelles étaient ses sœurs. Ces dépositions de Morié … résument un morceau essentiel de la tradition commune dans les pays riverains du golfe de Benin (Togo, Dahomey, Nigeria), aux Ewe, Guin, Fon et Yorouba, ces derniers ayant pour ville sainte Ilé Ifé … » (Pédrals, id, p 30 et 31)
La tradition que cette déposition nous révèle a été notée par les Coptes eux-mêmes et se confond avec celle que nous trouvons à l’heure actuelle en Afrique occidentale, chez les populations du Dahomey, du Togo, du Nigéria… Notons que le roi Mossi porte actuellement le titre de Naba, qui est aussi celui d’un roi qui régnait sur une partie de la Nubie.
Lorsque l’armée égyptienne sera maltraitée sous le règne de Psammétique, guidée par ses cadres, elle ira au nombre de 200 000 de l’Isthme de suez au Soudan Nubien, pour se mettre au service du roi de la Nubie. D’après Hérodote, les éléments de cette armée furent tous assimilés par le peuple nubien. Ceci se passe à une époque où la civilisation nubienne était déjà plusieurs fois millénaire.
Tous les premiers savants indo-européens qui étudièrent la Nubie, conclurent l’antériorité de la Nubie sur l’Egypte. Diodore de Sicile affirma que la civilisation égyptienne est issue de celle de la Nubie dont le centre est Méroé. Vers 1820, Cailliaud découvrit effectivement les ruines de Méroé selon les indications de Diodore de Sicile et Hérodote. Hérodote rapporte que parmi les trois cents pharaons égyptiens, de Mènes à la XVIIe dynastie, dix-huit pharaons sont d’origine soudanaise.
C’est en vertu de cette antériorité de la Nubie, berceau de la civilisation et de la religion, qu’Homère nous dit dans un vers de l’Iliade que Jupiter descend chaque année avec le cortège des Dieux, en pèlerinage en Ethiopie, pour se régénérer.
C’est en Nubie qu’on trouve des pyramides telles qu’on en a trouvé en Egypte : pyramide d’Assur et de Nuri. C’est là et non en Ethiopie actuelle qu’on trouve des temples souterrains et autres (temples de Semna, Typhonium, temple d’Athor, d’Istambul.) L’écriture nubienne est plus évoluée que l’égyptienne. Tandis que cette dernière ne s’est jamais débarrassée de son essence hiéroglyphique, l’écriture nubienne est alphabétique.
A la naissance de Mahomet, l’Arabie était une colonie nègre avec la Mecque comme capitale, d’où le verset du Coran connu sous le titre « Alam tara keifa », relatif à l’armée de 40 000 hommes envoyés par le roi d’Ethiopie pour mâter la révolte des arabes : un corps de cette armée était composé de guerriers montés sur des éléphants. Delafosse, lui-même est obligé de constater cette suzeraineté de l’Ethiopie sur l’Arabie :
Si l’on songe à la part qu’a eu cet empire (Ethiopie) dans les destinées de l’Egypte ancienne, si l’on se souvient qu’au moment de la naissance de Mahomet (570), il exerçait sa souveraineté par-delà la mer rouge, sur le Yemen et qu’il envoya contre la Mecque une armée de 40.000 hommes, si l’on pense à l’extraordinaire renommée dont jouissait en Europe au moyen âge la puissance du fameux prêtre-Jean…, on est obligé de supposer qu’une pareille force n’a pas pu ne point rayonner sur les peuples avec lesquels elle s’est trouvée en contact. (Delafosse : les Noirs d’Afrique, pp.114-115.)
Berceaux de civilisation situés au cœur des pays nègres
Un autre fait non moins paradoxal est que les indo-européens n’ont jamais créé de civilisation dans leur berceau primitif, c'est-à-dire dans les steppes eurasiatiques. Les civilisations qu’on leur attribue sont indubitablement des civilisations situées au cœur de pays nègres, sur la partie méridionale de l’hémisphère nord : Egypte, Arabie, Phénicie, Mésopotamie, Elam, Inde. Dans tous ces pays, il y avait déjà des civilisations nègres au moment où les indo-européens y arrivèrent au cours du second millénaire à l’état de nomades frustes. On se demande pourquoi tant d’aptitudes créatrices ne se manifestent-elles qu’en contact avec les noirs et jamais dans le berceau primitif des steppes eurasiatiques.
Les peuples nègres, ethniquement homogènes, ont créé tous les éléments de la civilisation en s’adaptant aux conditions géographiques favorables de leur berceau primitif. Dès lors, leurs pays devinrent des pôles attractifs où tentèrent de s’introduire pour améliorer leur existence, les habitants des régions déshéritées qui les avoisinaient. Le métissage qui est né de ce contact est donc une conséquence de la civilisation déjà créée par les nègres, et non pas la cause de celle-ci.
Langues
M. Reich et Madame Homburger ont étudié la parenté de la langue égyptienne et des langues de l’Afrique et ont abouti à la conclusion que ces langues ont un même socle. La comparaison linguistique de l’égyptien et du valaf n’en sera que plus convaincante, parce que plus précise. Elle laissera difficilement subsister l’idée de deux fonds linguistiques différents.
Pour passer du mot égyptien au mot valaf, il suffit de remplacer le ‘’N’’ égyptien par ‘’L’
Mots égyptiens mots valaf
Nad= demander Lad= demander
Nah=protéger, cacher Lah=protéger, cacher
Nebt=tresse, tresser Let= tresse, tresser
Etude comparative des grammaires égyptiennes et valaf
L’égyptien dont-il est question est la langue classique même, c’est-à-dire celle « écrite de la IXe à la XVIIIe dynastie, entre 2400 et 750 avant J-C ».
Formation du pluriel
L’égyptien forme le pluriel en suffixant un w que je transcris u (lu comme ou)
Bak = serviteur
Baku = serviteurs
La formation du pluriel en u existe en valaf lorsque l’adjectif numéral se rapporte à un substantif, et en forme archaïque
Ñâr= deux Ñâr-u bap (les deux)
Ñatt=trois Ñat-u bap (les trois)
Ñint=quatre Ñint-u bap (les quatre)
Cette règle de la formation du pluriel en u à partir d’une variation du consonnant existe aussi en dolâ. Le Mandé forme le pluriel en lu, ce qui ne serait qu’une variante du pluriel égyptien. Mais c’est en Sarakollé qu’on trouve une complète identité avec l’égyptien quant à la formation du pluriel.
Egyptien Sarakollé
Kompé = Case Kompu = cases
Iaharé = femme Iaharu = femmes
Rapports entre les démonstratifs
Comparons les démonstratifs égyptiens et valaf suivants :
Egyptien Valaf
Puy, Pef, Pu, Pa = Ce, Cet, Celui-ci Bi, Bé, Bu, Ba = Ce, Cet, Celui-ci,
Nen, Nef, Nu, Na = Ces, Ceux-ci, Celui-ci Ni, Né, Nu, Na = Ces, Ceux-ci, Celles-ci
En égyptien comme en valaf, ces démonstratifs ont évolué pour devenir des articles définis Pa et Na (le, les). Na est encore un article défini sérère
Les pronoms suffixes
Tous les pronoms se retrouvant en égyptien se retrouvent en valaf, à l’exception d’un ou deux. En particulier cinq d’entre eux se retrouvent sans altération en valaf.
Egyptien valaf
Maa = voici que Ma a ou Mâ = je, voici que
Nen = nous Nen = nous
Ef=il, lui, on Ef = il, moi, on
Le féminin se forme en ajoutant le « es » au nom ou pronom, de la même manière qu’en valaf.
Egyptien Valaf
Kef-ef=saisi de lui kef-es=il est saisi
Kef-es= saisi d’elle kef-es=elle est saisie
Conjugaison
Conjuguons le verbe kef dans ces deux langues pour mieux saisir la similitude :
Egyptien Valaf
Kef-i ou kef-a Kef-na
Kef-ek Kef-nga
Kef-ef Kef-ef
Kef-es Kef-es
Kef-nen Kef-nen kef-nanu
Kef-ten Kef-ngen
Kef-sen Kef-nanu
Les pronoms utilisés sont quasi-identiques dans les deux langues. Le sens rendu par ce type de conjugaison est aussi le même. Il s’agit d’une nuance de passé rendue par la postposition du pronom suffixe par rapport au radical verbal.
Pronoms indépendants
Ces pronoms présentent les mêmes caractéristiques dans les deux langues
Egyptien Valaf
Inuk, enak = (je suis) Nek = être, suis, nek- na
Antek=tu Yangi = tu es en train
Participe passé
On peut dresser le tableau comparatif de quelques-unes des particules pour mieux faire saisir la parenté entre l’égyptien et le valaf.
Egyptien Valaf
U= suffixe à valeur passive U=suffixe à valeur passive
Tu= suffixe à valeur passive Tu= suffixe à valeur passive,
nuance pronominale
I= suffixe exprimant le futur Î= suffixe exprimant le futur
N= suffixe exprimant le passé N= suffixe exprimant le passé
Ku (i) = pseudo participe Ku= valeur de pseudo participe
Ef= participe à valeur passive Ef= participe à valeur passive
Of, Ef, Nef, Es = Particules à valeur Of, Ef, Nef, Es = Particules à valeur
passive, entre autres significations passive, entre autres significations
Bu= particule à valeur négative Bu= particule à valeur négative
Nen= id Nen= néant…
Ît= particule à sens mal précisé Ît= Particule à sens mal précisé
Formation de nom par redoublement du radical
Egyptien Valaf
Nef nef = désir ardent Nafnaf = désir ardent
Benben= faire jaillir l’eau Belbel= jaillissement d’une source
Habhab= courir le pays en chassant Habhab= action d’aller energiquement par-ci-par-là
On peut à partir du valaf, restituer le type de grammaire égyptienne, avec l’évolution des consonnes. Les infinitifs en « u », les caractères agglutinants, la syntaxe et l’expression du féminin.
Chapitre V
Arguments contre l’idée d’une Egypte nègre
Régression culturelle ?
Si ce sont les nègres qui ont créé la civilisation égyptienne, comment expliquer leur régression actuelle ?
Autour de la vallée mère, les Etats se sont développés de très bonne heure. A travers le temps, les nègres ont pénétré lentement au cœur du continent, irradiant dans toutes les directions. Ces nègres fondèrent des Etats qui se développèrent et entretinrent des relations avec la vallée mère jusqu’à l’étouffement de celle-ci par l’étranger. Du sud au nord, ce sont la Nubie, l’Egypte ; Du nord au sud, ce sont la Nubie, Zimbabwe ; De l’est à l’ouest, Nubie, Ghana, Ilé-Ifé ; De l’est au sud-ouest ; Nubie, Tchad, Congo ; De l’ouest à l’est : Nubie, Ethiopie.
A Zimbabwe qui pourrait bien être le prolongement du pays des Ethiopiens Macrobiens dont parle Hérodote, on trouve des ruines de monuments et de villes construites en pierre, avec la figuration du faucon, « dans un rayon de 100 à 200 miles autour de Victoria », écrit D.P de Pédrals. Autrement dit, ces ruines s’étendent sur un diamètre de près de 800 kilomètres, qui est presque celui de la France.
Dans la région de Ghana, Pédrals parle aussi (p 61) de la ville de Koukia, dont le Tarikh-es -sudan disait qu’elle existait déjà au temps des pharaons, et dont Desplagnes, qui a fait les fouilles dans cette région, estime avoir trouvé les vestiges. Le même auteur parle aussi du site de Koumbi, fouillé par Bonnel de Mézieres, qui trouva des tombeaux de grandes dimensions, des sarcophages de schiste, des ateliers métallurgiques, des ruines de tours et d’édifices divers :
On distingue nettement encore la trace d’une avenue, bordée de maisons, dont les murs dépassent le sol de 1 mètre, 1m 50. Les toitures sont effondrées. Plus loin, le terre-plein d’une place, où les murs cette fois donnent l’impression d’avoir supporté des étages. Parfois, les bâtiments sont si bien conservés qu’il suffirait de peu de choses pour les rendre habitables à nouveau… Les autres constructions sont compliquées. L’une comporte cinq pièces disposées à 4 mètres de profondeur, avec des couloirs de communication. La maçonnerie est parfaite. Les murs ont 30 cm d’épaisseur. (Pédrals, id., p 62)
On a trouvé des éléments similaires dans les autres Etats suscités, mais pas chez les indo-européens. Ce qui confirme une fois de plus les témoignages des anciens et des égyptiens selon lesquels l’origine de la civilisation se trouve en Nubie et a descendu le cours du Nil vers la mer. Ce fait est vrai quand on sait que les éléments fondamentaux de la civilisation égyptienne se retrouvent au cœur de l’Afrique.
Un phénomène naturel tel que la crue périodique du Nil a eu pour conséquence le développement de l’organisation sociale en provoquant des travaux collectifs comme la construction des digues, des canaux d’irrigation. La géométrie, l’arithmétique c’est-à-dire les mathématiques, étaient aussi les conséquences de la crue du fleuve : Il fallait départager les cohabitants en délimitant, après chaque crue, la propriété de chacun ; Il fallait retrouver en quelque sorte, les bornes de celle-ci. Ainsi naquit la géométrie, c’est-à-dire, à l’origine, la mesure de la terre. Les égyptiens avaient l’habitude de mesurer la hauteur de la crue par un « Nilomètre » et ils en déduisaient la richesse annuelle des récoltes par un calcul mathématique.
Le calendrier et l’astronomie sont aussi les conséquences de cette vie sédentaire et agraire. L’adaptation au milieu physique engendra certaines mesures d’hygiène : momification (pour éviter les épidémies de peste du Delta), jeûnes, régimes alimentaires, et la médecine naquit peu à peu. Le développement de la vie sociale et des échanges exigea la naissance et l’usage de l’agriculture. La vie sédentaire engendra la propriété privée et toute une morale (résumée dans les questions posées au mort au tribunal d’Osiris), qui est à l’opposé de la morale guerrière et de rapines des nomades eurasiatiques. La houe paléo nigritique se transforme en charrue, par simple prolongement de la manche.
Quand les nègres du Nil, par suite de surpeuplement de la vallée et des bouleversements sociaux, pénètrent de plus en plus profondément à l’intérieur du continent, ils rencontreront des conditions physiques et géographiques différents. Telle science, naguère indispensable sur les bords du Nil n’est plus d’essence vitale à la boucle du Niger, sur les rives du Lac Tchad, sur les côtes de l’Atlantique, sur les rives du Congo et du Zambèze. On comprend ainsi que certains éléments de la civilisation nègre de la vallée du Nil aient disparu à l’intérieur du continent, tandis que d’autres soient demeurés jusqu’à nos jours.
L’absence du papyrus dans certaines régions citées a contribué à la raréfaction de l’écriture au cœur du continent, sans que celle-ci n’ait jamais été absente en Afrique noire comme on l’affirme solennellement. A Diourbel, chef-lieu du cercle du Baol, au Sénégal, dans le quartier Ndourka, non loin de la voie ferrée, et non loin de la route de Daru Mousli, on trouve un baobab couvert de hiéroglyphes, depuis le tronc jusqu’aux branches. Puisque le sous-sol de l’Afrique noire est pour ainsi dire, intact, on peut s’attendre à ce que des fouilles systématiques ultérieures nous livrent des documents écrits insoupçonnés, malgré le climat et ses pluies torrentielles qui ne sont pas favorable à la conservation de telles pièces. Notons qu’il existe une écriture hiéroglyphique authentique au Cameroun, celle dite de N’Djoya dont il serait intéressant de chercher si elle n’est pas plus ancienne qu’on le dit. Elle est exactement du même type que l’écriture hiéroglyphique égyptienne. Enfin en Sierra Léone, il existe une autre écriture que celle des Bamouns du Cameroun : c’est celle des Vaïs qui est syllabique et celle des bassas qui est cursive, selon le docteur Jeffrey.
Les européens rencontrent de puissantes civilisations africaines et les détruisent
On peut donc dire que jusqu’au XVe siècle l’Afrique noire n’a jamais perdu sa civilisation, comme le prouve ce passage de Frobenius :
Non pas que les premiers navigateurs européens de la fin du moyen âge n’eussent fait dans ce domaine de très remarquables observations. Lorsqu’ils arrivèrent dans la baie de Guinée et abordèrent à Vaïda, les capitaines furent fort étonnés de trouver des rues bien aménagées, bordées sur une longueur de plusieurs lieues par deux rangées d’arbres : ils traversèrent pendant de longs jours une campagne couverte de champs magnifiques, habitée par des hommes vêtus de costumes éclatants dont ils avaient tissé l’étoffe eux-mêmes ! Plus au sud dans le royaume du Congo, une foule grouillante habillée de « soie » et de « velours », de grands Etats bien ordonnés et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes. Civilisés jusqu’à la moelle des os ! Et toute semblable était la condition des pays à la côte orientale, la Mozambique, par exemple. Les révélations des navigateurs du XVe au XVIIIe siècle fournissent la preuve certaine que l’Afrique nègre qui s’étendait au sud de la zone désertique du Sahara était encore en plein épanouissement, dans tout l’éclat de civilisation harmonieuse et bien formée. Cette floraison, les conquistadores européens l’anéantissaient à mesure qu’ils progressaient. Car le nouveau pays d’Amérique avait besoin d’esclaves et l’Afrique en offrait : des centaines, des milliers, de pleines cargaisons d’esclaves ! Cependant, la traite des Noirs ne fut jamais une affaire de tout repos ; elle exigeait sa justification. Aussi fit-on du nègre un demi-animal, une marchandise. Et c’est ainsi que l’on inventa la notion de fétiche (du portugais féticeiro) comme symbole d’une religion africaine. Marque de fabrique européenne ! Quant à moi, je n’ai vu dans aucune partie de l’Afrique nègre les indigènes adorer les fétiches. L’idée du « nègre barbare » est une invention européenne qui a par contre-coup, dominé l’Europe jusqu’au début de ce siècle » (Frobenius : Histoire de la civilisation africaine, traduit par Back et Ermont, Gallimard, paris, 1938, 5e édition, pp. 14 et 15)
Ces textes des explorateurs européens que cite Frobenius s’accordent avec ceux des écrivains arabes qui visitaient l’Afrique noire du Xe et XVIe siècle. Ibn Battuta relate les séances du roi Mandingue Soleiman Mança :
Le Sultan se tient très souvent assis dans une alcôve communiquant par une porte avec le palais. Du côté du michouer, cette alcôve a trois fenêtres en bois revêtues de lames d’argent et, au-dessous, trois autres garnies de plaques d’Or ou de Vermeil… Quand il s’assoit, on passe à travers le grillage d’une de ces fenêtres un cordon de soie auquel est attaché un mouchoir à dessin de fabrique égyptienne… Dougha, l’interprète se tient debout à la porte donnant sur le michouer revêtu de riches habits de Zerdkana et d’autres étoffes. Il est coiffé d’un turban à franges façonnées, d’une manière très élégante d’après la mode du pays ; Il porte à son côté une épée à fourreau d’or ; Il a pour chaussures des bottes.
Les européens rencontrent un peuple de justes vivants en paix
Ibn Batouta nous apprend ensuite que Kankan Mouça, prédecesseur de Souleiman Manca, avait donné à Es-Sahéli, qui avait construit une mosquée à Gao 40 000 mithkals, c’est-à-dire environ 180 kilos d’or. Ce chiffre nous donne une idée de ce qu’était la richesse du pays à l’époque précoloniale. Un autre passage de Ibn Batouta est plus clair sur la sécurité qui régnait en Afrique noire avant la colonisation :
De ce que j’ai trouvé de bon dans la conduite des noirs. Les actes d’injustice sont rares chez eux ; De tous les peuples, c’est celui qui est le moins porté à en commettre, et le sultan (roi nègre) ne pardonne jamais à quiconque s’en rend coupable. De toute l’étendue du pays, il règne une sécurité parfaite ; On peut y demeurer et voyager sans craindre le vol ou la rapine. Ils ne confisquent pas les biens des hommes blancs qui meurent dans leur pays. Quand même la valeur en serait immense ils n’y touchent pas…
Les européens rencontrent un peuple ayant une grande estime de soi
Quel était à l’époque le comportement possible des Noirs à l’égard des Blancs ou des races considérées comme telles ? C’est encore Ibn Batuta qui nous l’apprend dans le texte où il décrit la réception de la caravane qui l’a amené à Walata où le Farba Hosein représentait alors le roi du Mali :
Nos marchands se tinrent debout en sa présence, et il leur adressa la parole par l’intermédiaire d’un tiers bien qu’ils se trouvassent tout près de lui. Ce fut là une marque du peu de considération qu’il avait pour eux et j’en fus tellement mécontent que je regrettai amèrement d’être venu dans un pays dont les habitants se montrent si peu polis et témoignent tant de mépris pour les hommes blancs.
Le roi du Mali avec un siècle de déclin traite d’égal à égal avec le roi du Portugal au sommet de sa puissance
Delafosse, qui considère que l’empire du Mali est un des plus considérables qui ait existé dans l’univers, écrit à ce sujet :
Cependant Gao avait recouvré son indépendance entre la mort de Congo Mouça (kankan Mouça) et l’avènement de Soleiman Mança. Un siècle plus tard environ, l’empire Mandingue allait commencer à décliner sous les coups de Songhaï tout en conservant assez de puissance et de prestige pour que son souverain traitât d’égal à égal avec le roi du Portugal, alors à l’apogée de sa gloire. (Delafosse, les noirs de l’Afrique, 1922, p 61, Payot)
Les documents que nous possédons montrent que les empires néo-soudanais ont précédé de plusieurs siècles l’existence d’empires comparables en Europe. L’empire du Ghana est créé au plus tard en 300 ap. J.C. alors que Charlemagne qui a créé le premier empire d’Europe a été couronné en 800 ap. J.C. Dans le moyen âge occidental où on ne trouvait que des monarques absolus, en Afrique noire, les monarchies étaient déjà constitutionnelles. Le roi était assisté par un conseil du peuple dont les membres étaient choisis parmi les différentes catégories sociales. (Ghana, Mali, Gao, Yatenga, Cayor…) Ce système était l’aboutissement d’une évolution dont les débuts se situent en Egypte.
Lorsque le contact se fit une seconde fois entre l’Europe et l’Afrique Noire, les armes à feu que l’Europe possédait grâce à la continuité du progrès technique en Méditerranée septentrionale, constituait sa seule supériorité. Elles lui permirent de dominer et de falsifier la personnalité du nègre. Et nous en sommes encore là.
Problèmes posés par les cheveux lisses et les traits dits réguliers
Il faut dire ici que ni les uns, ni les autres ne sont l’apanage d’une race blanche. Il existe deux races noires bien définies à l’heure actuelle : l’une à peau noire et à cheveux crépus, l’autre à peau également noire, avec des cheveux lisses, un nez aquilin, des lèvres minces, l’angle des pommettes aigu. Nous avons un prototype de cette race aux Indes : Ce sont les Dravidiens. Nous savons aussi que certains Nubiens relevaient du même type nègre. On a l’habitude d’invoquer les cheveux lisses de quelques momies bien choisies, les seules qu’on rencontre d’ailleurs dans les Musées, pour affirmer qu’elles représentent un prototype de la race blanche, malgré les caractères nègres qu’elles présentent.
Chapitre VI
Peuplement de l’Afrique à partir de la vallée du Nil
Les arguments que l’on invoque pour défendre la thèse du peuplement de l’Afrique noire par l’océan indien, à partir de l’Océanie, ne reposent sur aucune base. Aucun fait archéologique ou autre ne nous autorise, à l’heure actuelle, à trouver aux nègres un berceau extérieur à l’Afrique. On s’est fondé sur les légendes qui, recueillies en Afrique occidentale, font venir les nègres de l’Est, du côté de la grande Eau. Delafosse identifia, sans autre preuve, ladite « grande eau » à l’océan indien. Mais les preuves montrent que l’humanité a pris naissance en Afrique et la dite « grande eau » n’est autre que le Nil. De quelque côté qu’on recueille les légendes relevant les origines d’un peuple en Afrique noire, la direction indiquée nous ramène à la vallée du Nil comme point de départ. (Les légendes Dogons et Yorouba les font venir de l’Est ; Celles des Fangs les font venir du nord-Est, celle des Bakoubas les font venir du nord.)
M. d’Avezac rapporte les légendes suivantes avec une ironie qui n’enlève rien à leur portée :
D’autres, rêveurs érudits ou physiologistes ingénieux, au lieu de redemander l’histoire primitive des Africains à des traditions presque perdues, ont mieux aimé la chercher dans d’aventureuses hypothèses, et leurs conjecturales narrations nous montrent dans le Nègre l’aîné de la création, fils de la terre et du hasard, prenant naissance aux neigeuses montagnes de la Lune (l’Afrique centrale), où trouva plus tard aussi son berceau l’homme qui, depuis, descendu dans la Sennaar, engendra l’Egyptien et l’Arabe et l’Atlante : La race nègre, longtemps plus nombreuse, soumit et domina d’abord la race blanche ; mais celle-ci, graduellement multipliée, secouant le joug de ses maîtres, et d’esclave devenant maitresse à son tour, les condamna à porter désormais ses tyranniques fers qu’elle venait de briser ; des siècles ont passé et sa colère n’est point encore apaisée. (L’Afrique ancienne, coll. L’univers. Didot. 1840, p 26.).
Le Sennaar est ici la plaine située entre le Nil blanc et le Nil bleu, point de départ de la civilisation soudanaise méroïtique. Le même nom est attribué à la plaine de Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate. La seconde appellation semble la réplique de la première. La rectification de cette erreur renverserait une fois de plus le sens de l’histoire. Il devient alors normal que l’Egypte soit peuplée à partir de la plaine du Sennaar et la légende s’accorde avec l’histoire. L’identité des noms propres entre les peuples de la vallée du Nil et d’autres peuples d’Afrique noire milite pour le peuplement de l’Afrique à partir de la vallée du Nil.
Il faut faire une remarque sur les légendaires Ba-fours, dont on dit tantôt qu’ils étaient rouges, tantôt qu’ils étaient noirs. Ba est le préfixe collectif qui précède tous les noms de peuples en Afrique. On peut le comparer au Wa égyptien, copte, valaf, qui signifie : ceux de, eux…
Origine égyptienne des yoroubas
Dans son livre The religion of the yoroubas, J. Olumide Lucas retrace l’origine égyptienne de ce peuple. Parlant des croyances religieuses, il écrit :
La plupart des dieux égyptiens furent bien connus des Yoroubas à un certain moment. Parmi ces dieux sont Osiris, Isis, Shou, Thot, Khepru, Amon, Anou, Khorsoun, Khopri, Hathor, Sokaris, Ra, Seb, les quatre divinités fondamentales et les autres. La plupart des dieux survivent sous leur nom, ou sous leurs attributs ou sous les deux.
Dans le domaine de l’identité de croyances religieuses, l’auteur cite :
- L’idée d’une vie future et celle d’un jugement après la mort ;
- La déification du roi ;
- L’importance accordée aux noms ;
- La forte croyance en une vie future ;
- La croyance à l’existence d’un esprit-gardien qui n’est qu’un aspect du Ka.
L’auteur rappelle ici que toutes les notions ontologiques de l’ancien égyptien, telles que Ka, Akhou, Khou, Sahou et Ba se retrouvent en yorouba. De même nous les retrouvons en valaf et peul. L’auteur signale l’existence des hiéroglyphes yorubas. L’identité du panthéon égyptien et yoruba, à elle seule, suffisait à prouver un contact primitif. La dénomination du mouton en yoruba (a-gu-to) et grec (ai-gup-tos) montre que la migration des yorubas s’est faite quand la Grèce était déjà présente en Egypte. La forme latinisée de Horus, dont semble découler l’Orisha des yorubas va dans le même sens et montre que les yorubas étaient en Egypte non pas seulement à l’époque où la Grèce conquit le pays, mais aussi à la présence romaine.
Origine des Laobés
Ils constituent une fraction de survivants du peuple légendaire des Sao. En effet les caractéristiques données par M. Griaule et Lebeuf aux Sao sont identiques aux Laobbés (géants, passaient la nuit entière à danser, ont laissé d’innombrables figurines de terre cuite, ces statuettes révèlent un type ethnique à crâne piriforme, ils s’appellent Sao ou So). En plus, ils ont des membres d’une beauté extraordinaire et sont toujours taillés en athlètes.
Les laobés semblent être un peuple qui a perdu sa culture et dont les éléments dispersés s’adaptent au hasard des circonstances, en apprenant les langues des régions où ils séjournent. Ils n’ont plus de chefs traditionnels. C’est un rameau disséminé des Sao après la destruction de leur culture, tandis que d’autres fractions se seraient dirigées ailleurs. A ouadi-Halfa, en Nubie, Champolion a découvert une stèle qui figure Mandou, dieu Nubien présentant à Osortasen, pharaon de la XVIe dynastie, les peuples de la Nubie, où figuraient deux tribus portant les noms de : Osaou et Schoat. Ces noms font penser curieusement au nom du peuple légendaire des Sao, dont on sait qu’ils s’étaient établis autour du Lac Tchad. On trouve encore aujourd’hui les Schoats sur les rives du Logone (voir Baumann).
Origine des peuls
Les peuls comme les autres populations de l’Afrique occidentale, seraient venus d’Egypte. Le fait le plus important pour étayer est l’identification des deux seuls noms propres totémiques typiques des peuls, avec deux notions également typiques des croyances métaphysiques égyptiennes : le Ka et le Ba.
Moret résume la place qu’occupent le Ka et le Ba dans les croyances égyptiennes : « Le Ka qui vient s’unir au Zet est un être divin qui vit au ciel et ne se manifeste qu’après la mort… La formule de spiritualisation du roi fait constater : Tandis qu’Horus purifie le Zet, le dématérialise dans le bassin du chacal, il purifie le Ka dans un autre bassin, celui du matin… Ka et Zet étaient donc séparés… et n’avaient jamais vécu ensemble sur terre… Dans les textes de l’ancien empire, pour dire mourir, on emploi l’expression « passer à son Ka ». D’autres textes précisent qu’il existe au ciel un Ka essentiel qui préside aux forces intellectuelles et morales. C’est lui qui, tout à la fois, rend saine la chair, embellit le nom, et donne la vie physique et spirituelle… les deux éléments une fois réunis, Ka et Zet forment l’être complet qui réalise la perfection. Cet être possède des propriétés nouvelles qui font de lui un habitant du ciel, qu’on appelle Ba (âme ?) et Akh (esprit ?). L’âme Ba, figurée par l’oiseau Ba muni d’une tête humaine, vit au ciel… Dès que le roi est muni de son Ka, il est devenu Ba… » Ka et Ba jouent un rôle indéniable dans l’ontologie égyptienne. Or Ka et Ba sont les deux seuls noms totémiques des peuls. Bari, un autre nom totémique des peuls, n’est que la synthèse de Ba + Ra. Quant au quatrième nom Akh, il n’est pas un nom totémique, mais a une signification ontologique évidente, en valaf. Jusqu’à nos jours, Akh signifie en valaf ce qu’on est obligé de rendre à autrui après la mort lors du jugement, avant de gagner la béatitude éternelle.
Quant à la langue peule, elle forme une unité naturelle avec toutes les autres langues sénégalaises en particulier, et nègres en général. Le rapport qui a été établi entre cette langue, le valaf et le sérère, ne laissent plus aucun doute sur leur profonde unité.
A l’origine, les peuls étaient des nègres qui se sont métissés par la suite avec un élément blanc étranger venu de l’extérieur. Ce métissage se situe à la XVIIIe dynastie à la Basse-Egypte, période de grand métissage avec l’étranger.
Origine des toucouleurs
Les toucouleurs sont venus du bassin du Nil, de la région dite « Soudan anglo égyptien ». Ceci est prouvé par le fait qu’on trouve actuellement dans cette région chez les Nouers, sans altération, les noms totémiques des toucouleurs qui vivent aujourd’hui sur les rives du Sénégal, à des milliers de kilomètre de distance :
Soudan anglo-égyptien Sénégal (Fouta Toro)
Kan Kann
Wan Wann
Ci Sy
Lith Ly
Kao Ka
On trouve dans la même vallée, l’endroit appelé Nuba Hills, la tribu des Nyora et celle des Toro, ainsi que celle des Kara dans la région de l’Ouganda-Rwanda. Il existe en Abyssinie une tribu appelée Tekrouri, or le lieu de vie des Toucouleurs est le Tekrour au nord du Sénégal. Il existe également un Nyoro au Soudan français où les Toucouleurs ont séjourné avant d’arriver au Tekrour actuel, d’où ils ont descendu lentement vers ce fleuve dont les rives ont aussitôt porté le nom de Fouta-Toro. Au XIXe siècle, les Toucouleurs déjà islamisés avaient pénétré au cœur du Sénégal pour islamiser les sérères. La région nouvellement acquise à l’islam fut nommée Nyoro. D’après leur tradition, les Toucouleurs du Sénégal auraient séjourné dans la région dite Nyoro au Soudan.
Origine des Sérères
Le docteur Maes écrit un article sur les pierres levées du village du Soudan français Tundi-Daro qui avaient été découvertes par Desplagnes. Il s’agit de pierres représentant les organes mâles et féminins. Le docteur Maes les attribue à des carthaginois et égyptiens qui, dans son esprit, passent pour des blancs. Il conclut que ces monolithes marquent l’emplacement d’un cimetière. Chaque pierre représentant un individu mâle ou femelle inhumé. Mais aucun ossement ne se trouve sous ces pierres.
Ces pierres en fait représentent un culte agraire. Elles symbolisent l’union du ciel et de la terre (par la figuration des deux sexes taillés dans ces pierres) pour que la végétation fille naisse, végétation qui nourrit les hommes. Autrement dit, pour que les semences poussent. La pluie correspond à la fécondation de la terre (déesse-mère), par le ciel (dieu père, dieu céleste). La végétation qui poussait après cette union était considéré comme son produit divin. D’où l’idée d’une trinité cosmique qui évoluera, selon un processus d’incarnations successives, jusqu’à la trinité chrétienne du père, du fils et de la vierge-mère, remplacé par le Saint-Esprit, en passant par la triade Osiris, Isis, Horus.
On taillait dans la pierre les deux sexes pour inviter les divinités à s’unir afin que la végétation qui entretient la vie pousse. Un peuple qui pratiquait un tel culte devait être essentiellement agriculteur, ce qui nous éloigne des steppes eurasiatiques et des régions nordiques, sans compter qu’on ne trouve pas de pierres levées dans ces régions. On n’en trouve que dans les pays habités par des nègres ou des négroïdes, ou dans des pays qui ont été fréquentés par ceux-ci.
Maes poursuit en disant que les corps des défunts ont été incinérés, or l’incinération est une pratique des peuples nomades indo-européens. Il se contredit plusieurs fois dans son article, en tentant de ramener à tout prix ces pierres à un peuple de race blanche. Ce qui montre aussi l’absolue nécessité pour nous de déblayer notre propre passé, travail qu’aucun peuple ne peut faire pour un autre, à cause des passions de l’orgueil national, des préjugés raciaux résultant d’une éducation faussée dès la base.
Les habitants actuels de la région de Tundi-Daro ne sont pas responsables de ces pierres. Les responsables, ce sont les sérères pour des raisons suivantes :
Ils pratiquent encore le culte des pierres levées au Sine Saloum. Ce culte a les mêmes significations pour eux. Ils sont essentiellement agriculteurs et c’est pour des fins agraires qu’ils invoquent la pluie par des rites traditionnels. En analysant le nom Tundi-Daro en sérère, on a ceci : Tund=colline ; Daro= union, dans le sens sexuel du terme. Tundi-daro signifie donc les collines de l’union. Ce rite se pratique sur les montagnes et les collines parce que par leur élévation, ce sont les endroits où la terre et le ciel semblent se toucher : « Idée de centre du monde » … Jérusalem, la Kaaba de la Mecque, la montagne sacrée du Chamon mongolique. D’ailleurs les collines de la région se trouvent à Tundi-Daro.
Il faut donc admettre que les sérères sont passés par Tundi Daro et y ont même séjourné. Un travail de fouille peut être fait pour vérifier ceci. Ce travail doit être fait par nous. Les erreurs de docteur Maes font mieux apparaitre la nécessité pour nous de connaitre et faire connaitre notre culture au lieu de persister à ne vouloir prendre conscience de celle-ci que par des ouvrages occidentaux. Ce qui serait une contradiction. La ville sacrée que les sérères ont créée dès leur arrivée au Sine Saloum est la ville de Kaôn. C’est aussi le nom d’une ville égyptienne où l’on a trouvé des textes hiéroglyphiques. Le Dieu céleste sérère, dont la voix est le tonnerre, s’appelle Rôg ou Sen. Rôg est à comparer avec le dieu égyptien Râ, qui est un dieu céleste. Tandis que Sen fait penser au nom de certains rois de Nubie et certains pharaons d’Egypte : Osorta-Sen, Perib-Sen. Enfin, la plaine du Sen-aar ou Sinn-aar fait penser à la plaine du Sin au Sénégal, plaine habitée par les sérères.
D’après Pierret, sérère signifie : celui qui détermine les limites des temples, en égyptien. Le sens serait bien conforme à la ferveur religieuse des sérères qui sont, jusqu’ici, un des rares peuples du Sénégal non encore convertis à une religion étrangère moderne. D’après Champolion-le-jeune, il existait en Egypte une caste de prêtres du nom de Sen. Plusieurs des pharaons de premières dynasties étaient de race sérère comme on peut en juger par leur nom : Sar (3e dynastie), Sar-teta (3e dynastie), Perib-Sen (1ère dynastie), Osorta-Sen (XVe dynastie).
Chapitre VII
Apport de l’Ethiopie-Nubie et de l’Egypte à la civilisation
Les Ethiopiens d’abord, les Egyptiens ensuite, selon le témoignage unanime de tous les anciens, ont créé et porté à un degré extraordinaire de développement de tous les éléments de la civilisation alors que les autres peuples en particulier les eurasiatiques étaient plongés dans la barbarie. Les Grecs n’ont fait que rependre et développer dans une certaine mesure, les inventions égyptiennes, tout en les dépouillant, en vertu de leurs tendances matérialistes, de la capacité religieuse « idéaliste » qui les entourait. La rudesse de la vie dans les plaines eurasiatiques semble avoir développé d’une part l’instinct matérialiste des peuples qui y vivaient, tout en forgeant en eux une certaine morale. Autant les Egyptiens auront en horreur le vol, le nomadisme et la guerre, autant ces pratiques seront considérées comme des valeurs morales de premier ordre dans les plaines eurasiatiques.
Ne peut entrer au Walhalla (paradis germanique) que le guerrier tombé au champ de bataille. Ne peut gagner la félicité chez les Egyptiens que le mort qui au tribunal d’Osiris, aura prouvé qu’il n’a jamais commis de péchés et qu’il a été charitable à l’égard des pauvres, ce qui est à l’opposé de tout esprit de razzia et de conquête qui caractérise, en général, les peuples du nord que chassait, en quelque sorte, leur pays déshérité par la nature.
La Grèce adopte les divinités égyptiennes et les ravalent au niveau de l’homme
Les facilités de la vie dans la vallée du Nil vont amener l’Egyptien à croire que les bienfaits de la nature lui tombent du ciel. Il finira par adorer ce ciel sous la forme d’un être tout-puissant créateur de tout ce qui existe et dispensateur des biens. Son matérialisme primitif sera désormais un matérialisme transposé au ciel, un matérialisme métaphysique.
Par contre, les horizons du Grec ne dépassent jamais l’homme visible et matériel, vainqueur de la nature hostile. Sur terre, tout gravite auteur de lui. Le but suprême de l’art est de faire sa copie exacte. Au ciel on ne trouvera que lui, avec ses défauts et ses faiblesses terrestres sous la carapace des dieux, que rien d’autre que leur force physique ne distingue du commun des mortels. Ainsi quand le Grec emprunte le dieu égyptien qui, lui, est un vrai dieu dans toute l’acception du mot, pourvu de toutes les perceptions morales pouvant découler de la vie sédentaire, il ne pourra le comprendre et le conserver qu’en le ravalant au niveau de l’homme. Ainsi le panthéon adoptif des grecs n’est qu’une autre humanité. Le miracle grec, à proprement parlé, n’existe pas car il s’agit d’un processus d’acclimatation des valeurs égyptiennes en Grèce.
On peut tout au plus dire que cette tendance au matérialisme qui caractérisa l’occident, était propice au développement de la science. Hérodote écrit : « Presque tous les noms des dieux sont venus d’Egypte en Grèce. Il est très certain qu’ils nous viennent des barbares. Je m’en suis convaincu par mes recherches. Je crois donc que nous les tenons principalement des égyptiens. » Barbare signifie ici étranger, sans aucune nuance péjorative.
L’Egypte forme les deux tiers des savants et philosophes grecs
Dès que les Grecs ont emprunté les valeurs égyptiennes, l’influence des steppes eurasiatiques et leur faible tempérament religieux ont influencé l’existence d’une science laïque, profane, enseignée, publiquement par des philosophes également profanes, au lieu que cette science soit l’apanage d’un corps sacerdotal qui la gardera jalousement sans la répandre dans le peuple, pour la laisser se perdre avec les bouleversements sociaux. Ces profanes dispensaient des enseignements scientifique et philosophique dans des centres érigés en écoles. Aucune sainteté ne les entourait. Plutarque dans Isis et Osiris, relate qu’au témoignage de tous les savants et philosophes grecs qui ont été élevés par les Egyptiens, ces derniers n’aimaient pas profaner leur science. Solon, Thalès, Platon, Lycurgue, Eudoxe, Pythagore ont rencontré des difficultés avant d’être initiés par les Egyptiens. En plus de ces derniers qui sont allé étudier en Egypte, on ajoute Archimède, Eratosthène, et la liste continue. L’Egypte était vraiment la terre classique où sont allés s’initier les deux tiers des savants et philosophes grecs. A l’époque hellénistique, Alexandrie était le centre intellectuel du monde, où se trouvaient réunis tous les savants grecs dont on nous parle maintenant.
L’architecture grecque a ses racines en Egypte
Les monuments gréco-romains ne sont que des miniatures auprès des monuments égyptiens. On sait que Notre Dame de Paris avec ses tours, entrerait aisément dans la salle hypostyle du temple de Karnak. Le genre de fable typiquement nègre-ou Koushite comme l’écrit Lenormant, qui consiste à mettre les animaux en scène a été introduit en Grèce par le nègre égyptien Esope, inspirateur des fables de La Fontaine. Hérodote avait déjà reçu de la bouche des prêtres égyptiens des renseignements révélant l’essence mathématique de la grande pyramide, dite de Chéops. Les mathématiciens y ont relevé la valeur exacte de π (pie), la distance moyenne exacte du soleil à la terre, le diamètre polaire terrestre… on pourrait prolonger la liste.
L’Abbé Moreux, à propos de la grande pyramide, écrit qu’il ne s’agit pas « du commencement tâtonnant de la civilisation et de la science égyptienne, mais plutôt du commencement d’une culture parvenue à son apogée et qui, sur le point de disparaitre, avait voulu en un geste suprême d’orgueil, léguer aux civilisations d’après un témoignage hautain de sa supériorité. »
Pourquoi chercher à oublier l’Egypte en mettant l’accent sur la Grèce ?
L’origine égyptienne de la civilisation et le large emprunt que la Grèce fit à celle-ci étant une évidence historique, on peut se demander avec Amelineau, pourquoi, en dépit de ces faits, on met l’accent sur le rôle joué par la Grèce tout en passant de plus en plus sous silence celui de l’Egypte. La vérité c’est que l’Egypte est un pays de nègres et la civilisation qui s’y est développée est due à des nègres. Toute thèse visant à prouver le contraire ne saurait avoir de lendemain. Les protagonistes des thèses contraires à ce fait le savent.
En disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd’hui principalement en Afrique Noire, qui ont inventés les premiers les mathématiques, l’astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, la religion, l’agriculture, l’organisation sociale, la médecine, l’écriture, les techniques, l’architecture, que ce sont eux qui ont les premiers élevé des édifices de 6 000 000 de tonnes de pierres (grande pyramide) en tant qu’architectes et ingénieurs - et non seulement en tant qu’ouvriers,- que ce sont eux qui ont construit l’immense temple de Karnak, cette forêt de colonnes, avec sa célèbre salle hypostyle où entrerait Notre-Dame de Paris avec ses tours, que ce sont eux qui ont sculpté les premières statues colossales (colosses de Memnon…), en disant tout cela on ne dit que la modeste et stricte vérité, que personne, à l’heure actuelle, ne peut réfuter par des arguments dignes de ce nom.
Dès lors le nègre doit être capable de ressaisir la continuité de son passé historique national, de tirer de celui-ci le bénéfice moral nécessaire pour reconquérir sa place dans le monde moderne, sans verser dans les excès d’un nazisme à rebours, car la civilisation dont- il se réclame eût pu être crée par n’importe quelle autre race humaine placée dans un berceau aussi favorable, aussi unique.
Deuxième partie
Chapitre premier
Développement des langues
Nécessité de développer les langues nationales
Il est plus efficace de développer une langue nationale que de cultiver une langue étrangère. Un enseignement qui serait donné dans une langue maternelle permettrait d’éviter des années de retard dans l’acquisition de la connaissance. Très souvent l’expression étrangère est comme un revêtement étanche qui empêche notre esprit d’accéder au contenu des mots qui est la réalité.
Le jour même où le jeune africain entre à l’école, il a suffisamment de sens logique pour saisir le brun de réalité contenu dans l’expression. Cependant, puisqu’on a choisi de lui enseigner cette réalité dans une langue étrangère, il lui faudra attendre un minimum de 4 à 6 ans, au bout desquels il aura appris assez de vocabulaire et de grammaire pour pouvoir comprendre ce qu’on veut lui enseigner. On peut concevoir que le jour où l’économie africaine sera entre les mains des africains eux-mêmes et qu’elle ne sera plus adaptée à des nécessités d’exploitation mais à leurs besoins, la concentration démographique s’en trouvera modifiée : les langues de certaines régions perdront de leur importance alors que celle des autres en acquerront. Cependant on peut déjà tenter une sélection préliminaire en s’appuyant sur des facteurs tels que : possibilités internes de la langue, littérature écrite et orale déjà existante dans celle-ci, prépondérance politique et sociale, potentiel d’expansion, densité du peuple qui la parle.
La multiplicité des langues est un problème qui a été résolu ailleurs et que nous pouvons résoudre à notre tour. Le fond commun des langues négro-africaines facilite l’émergence d’une langue nationale. On pourrait penser que les langues européennes sont déjà devenues celles de la majorité dans les pays colonisés, et que vouloir revenir sur cette unité linguistique embryonnaire est une régression. Cette illusion est d’autant plus grave qu’elle est partagée par beaucoup d’intellectuels. En dehors d’une minorité de populations dans les villes, les langues européennes sont inconnues partout en Afrique, pour la simple raison que la paysannerie n’est pas scolarisée. D’autre part les inconvénients qu’il y a à vouloir adopter une expression étrangère ne sont pas seulement d’ordre pratique mais culturel. On ne saurait insister suffisamment sur le fait que l’impérialisme culturel est la vis de sécurité de l’impérialisme économique. Détruire les bases du premier c’est donc contribuer à la suppression du second.
On pourrait penser que l’évolution d’une langue est un phénomène naturel sur lequel il serait inefficace d’intervenir. Une telle conception est également erronée. Lorsque la mentalité populaire a créé tout le fond de la langue, il est indispensable qu’un effort conscient soit appliqué à celle-ci pour l’élever au niveau de l’expression abstraite, intellectuelle, de la science et de la philosophie. La facilité avec laquelle nous renonçons, souvent, à notre culture ne s’explique que par notre ignorance de celle-ci, et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause.
Moyens de développer les langues nationales
Il s’agit d’introduire dans les langues africaines des concepts et des modes d’expression africaines capables de rendre les idées scientifiques et philosophiques du monde moderne. Une telle intégration de concepts et d’expressions équivaudra à l’introduction d’une nouvelle mentalité en Afrique, à l’acclimatation de la science et de la philosophie moderne au sol africain, par le seul moyen non-imaginaire. Pour ce faire on peut disposer de trois sources d’inégale importance :
1- L’unité de l’égyptien et des langues africaines étant un fait, les africains doivent bâtir des « humanités » à base d’égyptien ancien, de la même manière que l’a fait l’occident à partir d’une base gréco- latine.
2- Cependant, il ne faudrait pas pousser l’exclusivisme jusqu’à éliminer les mots d’origine occidentale qui ont déjà acquis droit de cité dans nos langues.
3- Exploitation des possibilités internes de la langue, de son génie propre. Nous pouvons étendre conventionnellement le sens dans toute une partie de notre vocabulaire afin d’exprimer l’univers abstrait, intellectuel, c’est-à-dire scientifique et philosophique. Cependant force nous est de composer des mots nouveaux. Il importe dès lors d’étudier le génie propre de la langue que l’on a choisie comme exemple d’étude, d’analyser les lois de formation de noms afin de s’y conformer pour les concepts que l’on veut élaborer. Si les termes parabole, hyperbole évoquent une idée précise dans notre esprit, c’est parce qu’on nous a habitué dès l’école et pendant des années, à associer à ces termes qui, en eux-mêmes ne signifient rien, des définitions conventionnelles précises qui leur donne un sens. De telles définitions sont possibles dans toutes les langues. Il suffit de les sous-entendre pour tous les concepts équivalents que nous aurons créés.
Les langues africaines sont loin d’être frappées d’une « pauvreté naturelle ». Il suffit de leur appliquer un effort comparable à celui qui a été appliqué aux langues occidentales pour qu’elles soient au niveau des exigences de la vie moderne. Un tel développement des langues est inséparable de traductions d’ouvrages étrangers de toutes sortes (poésie, chants, romans, pièces de théâtre, ouvrages de philosophie, de mathématique, de science, d’histoire…) Il est inséparable de la création d’une littérature africaine moderne, qui sera alors, nécessairement, éducative, militante, et essentiellement destinée aux masses. Mais cet effort de langue africaine implique par-dessus tout l’acquisition d’une discipline intellectuelle qui permet d’accepter avec le moins de résistance les néologismes indispensables.
Chapitre II
Traductions
Ce chapitre est consacré à la démonstration de la possibilité de traduire dans une langue africaine quelconque et en valaf en particulier, tous les aspects de la réalité du monde moderne.
Traduction de concepts mathématiques
Notions préliminaires
Point, ligne, pion = tombe, red, mâsalé Triangle = nialkoñ
Surface, volume = yâtu – yâlu (ay), embka Coté = vet
Angle = puhtel Hauteur = koveay
Médiane = dâr-dig
Genres de triangles
Triangle isocèlle = yavivetyam Triangle équilatéral = vetyam
Triangle rectangle : kondub Scalène = yamadi
Rectangle = hubkon Losange = carré doy
Carré = carré Trapèze = niarivetlang
Cercle = mbégé Ciconférence = mbégé gudây
Centre = dig Rayon = Tenen
Mesure des angles : nat koñ
Angle au centre = puhtet digal Rapporteur = nattukai
Transformation : sopi
Homothetie = sopiln Homothétie directe = sopiln dub
Géométrie analytique = kanam déhu
Nombre réel = lim amu Nombre imaginaire = lim dérêr
Trinome et equation du second dégré
Coefficient = nyung Racine = rèn
Axe = digel Coordonnée = nhamikây
Chapitre III
Les problèmes de l’art africain
On ne peut pas parler de l’art sans mentionner les tentatives qui veulent en dépouiller l’Afrique. Devant la richesse extrême de notre art, sa puissance d’intervention, de nombreux spécialistes européens tentent de lui trouver une origine extérieure. On peut dire d’une façon générale que toutes les études des occidentaux sur l’Afrique sont déterminées par un double point de vue :
1- Affirmer dogmatiquement que toutes les civilisations africaines sont récentes, car rien ne saurait être ancien en Afrique Noire,
2- Que l’origine de toute civilisation africaine dont on ne peut pas nier l’existence doit être attribuée à de mythiques races blanches
Frobenius essaiera de faire partir tout du monde méditerranéen et de l’Afrique du nord. Mais il oublie que l’Afrique du nord n’a jamais été le point de départ d’aucune civilisation.
M. Olbrechts enseigne que l’art des Ba – Louba de l’est (ouroua, manyéma) représenté par les grandes figures mendiantes ou figures cariatides sont d’origine chamitique et conclut qu’ils sont blancs, même comme de la tête aux pieds ils sont noirs.
H. Baumann explique les moindres aspects dignes d’intérêt de la vie africaine par l’intervention des Chamites orientaux. Le même auteur explique plus loin l’état arriéré de ces Chamites. On peut alors se demander ce qui, dans leur pauvreté et leur état arriéré pourrait expliquer les degrés élevés de civilisation que l’Afrique a connue. La notion de Chamite, sous quelque angle qu’on l’envisage, est absurde : et particulièrement du point de vue historique, quand on sait que Cham, selon la bible, est l’ancêtre des nègres. On peut se demander comment ce nom a pu finir par désigner la race blanche.
Loin de s’arrêter, cette déformation de l’histoire africaine s’amplifie selon une progression géométrique. C’est ainsi qu’à chaque nouvelle découverte archéologique, qui met au jour des aspects stupéfiants de richesse et d’invention de la culture africaine, correspond une nouvelle vague de théories dont le but est de nous spolier de ces richesses en leur attribuant un hypothétique berceau extérieur. Les sondages faits au Nigéria pour trouver l’étain pendant la seconde guerre mondiale, ayant accidentellement fait découvrir de grandes sculptures de terre cuite, de bronze et de pierres, d’un équilibre et d’une sérénité qui défient les œuvres de l’époque grecque archaïque, la question qui est venue le plus naturellement à l’esprit des spécialistes fut celle de l’origine de ces œuvres, abstraction faite du lieu où elles furent trouvées, comme si elles y étaient tombées du ciel.
Lachery, parlant de l’art d’Ifé et du Benin, écrit : « pourquoi ne pas imaginer quelque artisan venu des établissements romains de l’Afrique du nord, qui aurait possédé un bon métier de sculpteur et de bronzier ? Ses connaissances, il les communique à des élèves noirs et l’un de ceux-ci (ou plusieurs) serait le créateur dont nous admirons les ouvrages. » Lachery commence sa phrase par « pourquoi ne pas imaginer ». Or, par l’imagination on peut résoudre tous les problèmes. On se demande pourquoi ces artistes ambulants ne se sont pas arrêtés en route pour faire bénéficier de leur génie les populations intermédiaires telles que les berbères et autres populations du désert. Peut-être qu’ils sont venus par les airs à une époque où l’avion n’existait pas ou par l’océan atlantique, hypothèse qui se heurte à d’énormes difficultés.
William Fagg, répondant à ceux qui affirment que l’art de l’Afrique est le fruit d’un artisan ambulant grec ou romain, voire italien de la renaissance ou jésuite portugais, écrit : « peut-on concevoir que cet hypothétique maitre dans l’art de couler le bronze (dont aucune œuvre n’a été identifié en Europe) fut aussi grand maitre et plus fécond dans le modelage de l’argile ? » Mais, en dépit de tous les faits objectifs qu’il apporte en faveur des caractères africains de l’art d’Ifé, il conclut à une origine grecque à chercher. On peut se demander pourquoi il n’a pas lui-même envisagé cette recherche.
Quant à Jean-Lebeuf qui a travaillé sur la civilisation Sao, il est tenté de songer à la méditerranée pré hellénistique. Il cite un masque découvert à Kadaba (Cameroun) qui rappelle d’étrange façon une terre cuite du Mont phylakos (Crète). Mais Crète n’a connu ses premières formes de civilisation qu’avec l’Egypte pharaonique en occurrence la dynastie Memphite, vers 2000 av notre ère. Donc le même style pourrait être transporté en Grèce par les migrations des Noirs et aussi au Cameroun par la migration du même peuple en direction du Sud.
Denise Paulme, à partir de l’art du bronze de la Goald Coast, écrit : « il est certain que la forme de certains récipients, le décor de presque tous, évoquent des souvenirs autres que ceux d’un art purement africain. »
Jean Van Bosshe pour lui estime que les masques en Ivoire Ba-pende sont d’origine arabe et déduit que le « travail de l’ivoire lui-même constituerait une importation arabe au Congo belge ». Nous sommes ici au point culminant de ces tentatives de destruction de notre culture. L’Afrique centrale, berceau de l’éléphant, n’aura même pas le bénéfice moral du travail de l’Ivoire. Il faudra que cette technique lui soit importée du désert d’Arabie !
Toutes ces théories ont en commun les points suivants : elles sont échafaudées sur une base purement imaginative, aucune constatation objective ne les étaye ; au contraire, on est effrayé de la minceur des arguments quand les auteurs daignent en citer. Leur caractère téméraire et leur absolue gratuité sont attestés par leur fragilité. On ne les comprend qu’en invoquant une éducation occidentale faussée à la base par l’enseignement millénaire de la Bible. Consciemment ou inconsciemment, elles tendent toutes à détruire notre culture, tant il est vrai que pour dominer un peuple, il faut détruire sa culture, à nous enlever le bénéfice moral de celle-ci, nous faisant croire que nous n’en sommes pas responsables.
Description des styles de sculpture nègre
Qu’est donc cet art qui fait couler tant d’encre, qui suscite tant de convoitises ? Quelle est sa valeur mystérieuse qui pousse l’occident à en revendiquer âprement la paternité par des voies détournées ?
Ce qui caractérise l’art nègre dans son ensemble, c’est la liberté de l’artiste dans la création plastique. L’artiste est sûr de son génie, certain de l’authenticité de ses inventions. Aussi ses œuvres sont-elles exécutées avec une impressionnante simplicité. Liberté audacieuse, rythmes puissants, invention plastique toujours valable, telles sont les caractéristiques générales de l’art nègre. Ces trois facteurs restent intimement mêlés quel que soit le style considéré, fait d’autant plus frappant quand on sait que l’art pour l’art n’a jamais existé en Afrique, depuis l’Egypte jusqu’à l’Afrique occidentale. L’art nègre a toujours été au service du culte religieux et royal. D’un bout à l’autre de l’Afrique Noire en passant par l’Egypte, les statues avaient primitivement pour but d’être le support du « double » immortel de l’ancêtre après la mort terrestre de celui-ci. Placée en un lieu sacré, la statue était l’objet d’offrandes et de libations. Ce fait mal interprété par les occidentaux a créé la fausse idée du fétichisme. En réalité, il n’y a de tendance au fétichisme, c’est-à-dire à l’idolâtrie, que là où la signification du culte a été oubliée par une rupture de la tradition.
L’art africain a donc toujours été au service d’une cause sociale comme il doit le rester. Ainsi l’artiste africain a toujours atteint le beau, l’esthétique à travers l’utile. Puisque le but primitif de la statue était de supporter le double de l’ancêtre, la tâche sociale de l’artiste était achevée en principe dès qu’il avait dégagé du bloc informe de la matière, un être humain suffisamment reconnaissable comme tel. Cette statue était le symbole de l’ancêtre revenu parmi les vivants. Quand les grecs découvrent l’anatomie et réalisent tant d’œuvres conformes au nombre d’or, pour eux, c’est le culte de la nature et le sens du matérialisme. Pour eux, tout était sur terre et gravitait autour de l’homme. L’homme maître de lui-même et maître de sa destinée. Etant le centre du monde, il était le dieu ici-bas. Réaliser son image avec perfection constituait donc le plus haut rêve, l’ultime idéal de l’artiste, c’est le développement de la technique des anciens égyptiens (dépouillé de leur sens religieux) qui constitueront l’apport essentiel de l’occident à la civilisation du monde.
Par contre toute l’Afrique noire y compris l’Egypte, sera traditionnellement le domaine par excellence d’un vitalisme qui, minimisant la modeste puissance de l’homme, cherchera toujours à gagner par des moyens religieux appropriés, l’intervention de forces extra-humaines. Ainsi donc, contrairement aux occidentaux, l’Africain, pour s’assurer une vie matérielle convenable, croira toujours que le moyen le plus sûr est de se consacrer à des pratiques rituelles. L’Africain croit pouvoir agir sur sa destinée en appuyant sur les leviers immatériels. La correction de cette erreur doit lui venir d’occident et c’est le plus grand avantage qu’il puisse tirer de son contact avec celui-ci. Pour toutes ces raisons, l’anatomie humaine retiendra rarement l’attention de l’artiste africain.
Le facteur religieux ne suffit pas à expliquer l’essence de l’art africain. Ce facteur religieux agit en interférence avec la personnalité de l’artiste. Ce dernier dépose toujours, inconsciemment, une partie de lui-même dans son œuvre, qui apparait sous forme de liberté inventive, de rythme plastique toujours diversifié. On peut distinguer en gros en Afrique deux grands courants d’art plastique : un courant réaliste et un courant expressionniste.
L’art réaliste
Art classique pré colonialiste
L’école réaliste la plus typique en Afrique dans l’état actuel de nos connaissances (en dehors de l’Egypte), c’est l’école d’Ifé qui engendra l’école du Benin. Elle est connue par des œuvres de terre cuite, de pierre et de bronze. Elle est caractérisée par un réalisme, une sérénité, un équilibre qui défient l’art de l’époque grecque archaïque du VIe siècle. Elle ne connaitra jamais le naturalisme outrancier de l’art de l’époque grecque classique. L’école du Benin est surtout connue par ses figures de bronze : guerriers armés, portraits des rois avec hauts colliers décorés et de membres de la famille royale ; et aussi par ses sculptures d’Ivoire, relatant l’histoire du roi, ou ses masques.
Un réalisme aussi pur que celui du Benin et d’Ifé, caractérise aussi les œuvres de bois de l’école Ourona et Bakuba dans le Congo central. Les styles de ce réalisme sont divers : Gouro, Pongwé, Baoulé (côte d’Ivoire), Ekoi (Cross-river du Cameroun), Bydiagos (iles Bissagos), Sao, Azande et Mang Betu, Kuyu, Bateke, Manyema, Baluba. On pourrait aussi classer sous la rubrique réaliste, mais à tendance expressionniste (forme du nez) l’art des Bagas (de Guinée) et celui des Bamouns (Cameroun).
L’art expressionniste ou géométrique
Il s’oppose à l’art réaliste par une plus grande liberté et une plus grande audace. Le grand mérite de cet art est de parvenir à représenter la figure humaine d’une façon valable en dépit de toute vérité anatomique. Ce courant comprend trois grands groupes de styles que l’on peut classer de la façon suivante
- Groupe à forme creuse, comprenant le style Batoka, M’bete, Bakouelé (Congo), makondé (Est Afrique, Machona (Zambèze).
- Groupe à forme plane. Il comprend le style Dogon (Soudan, falaise de Bandiagara), les Fangs du Gabon, Senoufo (Côté d’Ivoire) et celui de l’Oubangui-Chari.
- Groupe à forme cubiste. Il comprend deux principaux types : le styles Dan (Côte d’Ivoire) et le style Basonge (Congo). C’est l’aspect géométrique de ces œuvres qui a surtout influencé l’art occidental actuel depuis le cubisme en 1907.
Voilà brièvement résumés et d’une façon très incomplète les différents aspects de l’art africain. Il faut avoir présent à l’esprit que l’artiste africain a toujours travaillé d’une manière rebelle, avec des instruments dérisoires. Mais pour mieux apprécier sa valeur inventive, il faudrait comparer le peu que nous en connaissons avec tout l’art occidental depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Pendant 25 siècles de sculpture occidentale, il n’y a pas eu d’invention plastique au sens propre du mot. Il y a eu tout au plus, des nuances sculpturales liées à l’époque et au coefficient individuel de l’artiste.
Est-ce à dire que nous devons en rester là et répéter perpétuellement ces formes ?
Certes non, car l’art doit toujours être l’art de son époque, c’est-à-dire au service des besoins les plus pressants du peuple africain à l’état actuel. La nouvelle orientation de notre art doit être en fonction de notre société actuelle. Pour cela, nous avons besoin d’une société africaine libre et parfaitement organisée, d’ouvrir davantage les yeux sur la nature extérieure, de posséder le réel au même degré que les occidentaux, d’atteindre leur niveau d’efficacité, en un mot de découvrir la nature dans sa totalité. C’est donc à cette double exigence sociale et intellectuelle que notre art devra être soumis, pour être valable à nos yeux. L’artiste qui saura exécuter des œuvres nobles dans le but d’inspirer un idéal de grandeur à son peuple, qu’il soit poète, musicien, sculpteur, peintre ou architecte, est l’homme qui répond, dans la mesure de ses dons, aux nécessités de son époque et aux problèmes qui se posent au sein de son peuple.
Cependant pour que la fonction sociale de l’artiste soit ainsi dégagée, faudrait-il aussi que le milieu soit propice. L’art ne nourrit toujours pas son homme, encore moins en Afrique dans les circonstances actuelles. Il a manqué à l’artiste africain tout le luxe de son collègue occidental. Est-ce à dire qu’il faille nécessairement en passer par ce luxe pour produire des œuvres modernes valables, pour arriver à l’existence d’une tradition artistique consciente et désormais ininterrompue ?
Certes non et s’il fallait attendre de réaliser ces conditions pour produire des œuvres répondant aux nécessités qui nous préoccupent, nous ferions mieux de ne rien attendre des artistes africains comme concours à la cause commune.
Théâtre
Le théâtre folklorique de l’école william Ponty ne saurait, en aucun cas, être considéré comme le théâtre africain authentique, quand on songe aux conditions spéciales qui l’ont engendré (manque de liberté et de formation technique des élèves). Si nous devons traduire nos œuvres authentiques pour communiquer avec les autres et leur apporter quelque chose, pour nous faire connaître d’eux, poser les problèmes qui nous préoccupent à leur conscience, l’inverse doit aussi exister. Nous devons songer à traduire en langue africaine le théâtre occidental et il serait intéressant de voir ce que donneraient de tels essais.
Sculpture
Elle doit être en matières plus dures que le bois ordinaire : bois d’ébène, granit diorite, grès, ivoire, métal, alliage, ou en sycomore qui, bien que léger est un bois imputrescible.
Peinture
La peinture africaine est essentiellement une peinture de mouvement. Le jour où l’Africain disposera d’une technique et d’une palette aussi variée que celle des européens, il ne tardera pas à faire ses preuves dans ce domaine artistique. C’est du reste ce qui commence à se passer au Congo Belge avec les jeunes peintres noirs.
Architecture
Parmi les nombreux styles d’architecture africaine, deux me semblent particulièrement typiques et plus faciles à adapter. Il s’agit du style de Djenné qui a déjà inspiré des constructions religieuses telles que des mosquées, et civiles telles que la polyclinique de Dakar, l’Institut d’Art de Paris, et de nombreuses villas privées.
Musique
L’Afrique est peut-être la terre du rythme. Cependant les conditions sociales n’ont pas encore permis l’existence d’une musique symphonique africaine. L’ignorance n’a pas permis à l’africain d’analyser scientifiquement les sons musicaux, de les disséquer, de saisir leurs rapports harmonieux, pour les rassembler ensuite dans une savante synthèse architecturale à partir de sa sensibilité. Cependant cela ne peut plus tarder. La symphonie de la misère sociale, des souffrances de toutes sortes d’un peuple qui lutte âprement et courageusement pour sa liberté ne peut manquer de tonner à nos oreilles. La musique africaine devra exprimer le chant de la forêt, la puissance des ténèbres et celle de la nature, la noblesse dans la souffrance avec toute la dignité humaine. En attendant, les africains devraient, chaque fois qu’il leur est possible, recueillir et enregistrer tous les chants et rythmes qu’ils trouvent, sans négliger le moindre air.
La poésie
On a souvent ignoré l’existence d’une poésie écrite en langue du pays selon les régies bien définies d’un art poétique. La poésie valaf présente ce que l’on pourrait considérer comme une supériorité de forme sur celle du moyen-âge parce qu’elle a pu s’inspirer de l’art poétique arabe déjà existant.
Chapitre V
Structure sociale et politique
Structure sociale et politique découlant des conditions économiques et matérielles
La période de notre histoire à laquelle il est fait allusion ici est celle qui débute vers le IIIe siècle de l’ère chrétienne : De l’empire du Ghana jusqu’à la destruction du royaume du Cayor, sous Napoléon III, par Faidherbe. Nous prendrons exemple sur le royaume du Cayor.
Dans toute l’Afrique organisée en Etats, la structure politique et sociale de cette époque semble ne présenter que des différences de détails. La société africaine est stratifiée en castes, celles-ci résultent d’une division du travail à l’époque pré-colonialiste. Par suite du morcellement politique, à cette époque, la fonction militaire était celle qui comportait le plus de risques. Elle garantissait la sécurité collective. Aussi, les guerriers sont-ils devenus rapidement une classe de nobles détenant le pouvoir, la force et la considération. Toute autre forme de travail était avilissante pour eux. Ne pouvaient et ne devaient travailler que les hommes de castes, c’est-à-dire ceux qui pratiquaient les différents métiers du temps : cordonnerie, orfèvrerie, métallurgie (forgerons, tissage…) La caste n’est autre chose qu’une profession considérée dans ses rapports dialectiques avec la société.
La stabilité du système de castes était due à différentes raisons dont la principale est le parfait équilibre des avantages et des inconvénients impliqués par l’appartenance à une caste. La profession était héréditaire. On ne saurait guérir une maladie si l’on n’appartient pas à la famille de « prêtres » qui connait de père en fils, les méthodes de guérison. Si on le faisait, c’était une usurpation et aux yeux du peuple, on ne produirait pas de résultats. Avec ce système, on éliminait ainsi toute concurrence interprofessionnelle.
Les objets fabriqués n’étaient pas de luxe, ils étaient indispensables à la vie sociale. Aussi l’homme de métier chômait rarement car la demande était facilement supérieure à l’offre. L’exploitation de l’homme de caste par le noble n’existait pas sur le plan matériel, mais moral à travers les quémandages. Les nobles ne pouvaient refuser ces quémandages sans se rabaisser.
En résumé, c’est la classe laborieuse qui avait le plus de possibilité d’accumuler les richesses. Elle ne pouvait donc pas être mécontente de son sort et le renversement du régime ne pouvait provenir d’elle. La haine de classe de l’ouvrier occidentale lui est étrangère. Avec la colonisation, ce sont les bourgeois (Gier), privés de ressources, qui deviendront des hommes de métier dans les villes, rompant ainsi avec la tradition. La classe des nobles tendra à disparaitre, tandis que celle des travailleurs des castes se développera.
Le peuple trouvait la nécessité du roi et trouvait normal de verser une partie de leur récolte ou de leur production pour lui faire vivre ainsi que les siens et sa cour. Quand un roi disparaissait, ils songeaient à lui trouver un remplaçant plutôt que de se passer du roi. Le roi avait une légitimité religieuse et sociale. Seul un système laïc pouvait provoquer une transformation du régime. Or l’existence d’une tradition religieuse, d’une cosmogonie expliquant l’univers entier et le pourquoi de chaque chose, ne laissait pas beaucoup de chances à l’apparition d’une pensée laïque en tant que telle, il faudra que celle-ci vienne de l’extérieur.
Mais d’autres rois émergèrent en Egypte quand elle perdit son autonomie. Le roi abuse de ses pouvoirs, devient injuste et ne protège plus les faibles. Le peuple est écrasé sous le poids d’une administration corrompue. Il s’ensuit l’apparition d’une conscience de classe et le bouleversement du régime. C’est ce qui arriva en Egypte au temps de la VIe dynastie, lors de la révolution prolétarienne. Avec la domination coloniale, l’Afrique noire entière tombera sous le joug de ce genre de rois, en occurrence au dernier temps de l’indépendance du continent. Ce sont des rois immigrés, ils ne sont pas divins parce qu’on ne les connait pas. Ils viennent de l’extérieur et s’imposent par la force à la faveur d’une anarchie intérieure ou d’un pouvoir faible. Profitant du fait que le respect du roi dans l’esprit du peuple est un devoir sacré, ces rois parviennent à légitimer rapidement leur situation et introduisent souvent des coutumes étrangères. Mais la domination de tels rois sur le peuple n’était pas à comparer avec ceux des rois ou des bourgeois en Europe. Ce qui fait que malgré cela, le peuple ne trouvait pas de raison de changer de régime. Il n’était pas révolutionnaire, mais conservateur. Chaque caste conservait ses avantages.
Le régime constitutionnel s’imposait avec un conseil composé des représentants de chaque caste (cordonniers, tisserands…), du représentant des hommes libres (premier ministre), du représentant des esclaves (général d’armées)… dans les premières dynasties du Cayor. Le pouvoir du chef reposait sur le premier ministre (représentant des hommes libres) et du général d’armées (représentant des esclaves) sans lesquels il n’était rien. Il était donc loin d’être un roi absolu. Le roi devait réunir le conseil avant de prendre une décision importante. S’il agissait à l’encontre d’une recommandation du premier ministre, il n’était plus soutenu par le peuple.
Les sociétés africaines étaient aussi constituées d’Etats dominants et d’Etats dominés. Des rivalités existaient entre Etats. L’impérialisme, en nivelant ces individualités, en introduisant le dénominateur commun du colonialisme a, chose paradoxale, introduit en même temps l’unité politique qui peut permettre maintenant la réalisation d’une fédération africaine à l’échelle du continent. L’harmonie de la société de caste où pratiquement personne n’était lésé, ne pouvait être rompu que par une certaine catégorie d’esclaves, et non pas de tous les esclaves.
On devenait esclave à la suite d’une bataille, quand on était prisonnier de guerre, sans tenir compte de la situation sociale première. L’esclave servait de dot lors du mariage, il ne reçoit pas de compensation pour son travail. Il est le seul de la société africaine qui soit l’objet d’une aliénation sans dédommagement d’aucune sorte. Il est quotidiennement blessé dans sa dignité d’homme, ce qui est extrêmement grave, puisqu’il était jadis un homme libre. Il est par excellence, l’agent mécontent de la société, le premier élément révolutionnaire, car le plus aliéné de tous. Mais la surveillance sous laquelle il était placé, la faible densité de la population repartie en villages dispersés, les multiples préjugés sur lui, l’isolement relatif de chaque esclave au sein d’une famille étrangère et hostile ont fait de l’esclave ancien un être plutôt messianique qui s’aliénera progressivement sans songer concrètement à un soulèvement concerté de tous les esclaves pour bouleverser le régime oppresseur. Tout au plus, il s’enfuyait pour retrouver sa liberté ou se suicidait, en désespoir de cause. Tous les membres de la société pouvaient posséder un esclave. Ils n’étaient pas seulement l’apanage des bourgeois. Si les nobles et les hommes libres ont pu vivre dans le mépris du travail manuel, c’est que, en assurant la sécurité collective par la guerre, ils ont pu, en échange, se procurer une main d’œuvre esclave gratuite qui leur permettait de vivre ainsi.
Les esclaves du roi n’étaient plus esclaves que de nom. Ils étaient sous la dépendance directe du roi dont ils constituaient les troupes de choc encadrées par la noblesse et quelques hommes libres. Au Cayor, le général d’armées était choisi parmi les esclaves les plus fidèles. Seules ces esclaves pouvaient faire une révolution, mais l’occasion ne se produira qu’exceptionnellement, entre Lat Djor (roi du Cayor-baol) et Demba War (son général d’armée), soutenu par Faidherbe, qui a su exploiter cette contradiction de la société africaine. Il a mobilisé les esclaves pour conquérir le pays.
En résumé, puisque personne ne voulait changer de condition, il n’y avait pas de forces révolutionnaires. Seuls les esclaves auraient bien voulu le faire, mais la structure économique de cette société préindustrielle ne le leur permettait pas. Le système de compensation des castes semble donc expliquer la stabilité apparente des sociétés nègres depuis l’origine des temps : Egypte, Afrique, Arabie Sabéenne, Inde dravidienne. Aussi est-il presque inutile d’ajouter que préjugés ethniques et sociaux sont également néfastes pour l’avenir de notre pays. Pour élever notre société au niveau du monde moderne, force-nous est de tourner résolument le dos au système des castes.
D’après cette analyse on voit que le primat de la superstructure dans une société à castes n’est qu’apparent. La société doit sa cohésion, sa stabilité à la sauvegarde des intérêts matériels de la classe laborieuse.
Morale engendrée par ces conditions économiques
La fonction de guerrier provoquant le développement du sentiment de l’honneur militaire à son plus haut degré, la témérité était une des plus hautes valeurs morales, sinon la plus haute, de la société africaine. Au Cayor, un noble qui survivait à une défaite était déchu de son titre de noblesse.
La générosité était aussi considérée comme une valeur morale essentielle, à tel point qu’un citoyen ne pouvait pas croquer seul un morceau de colas. S’il n’avait personne avec qui partager, il jetait une autre partie. La générosité prenait la forme d’adaptation aux conditions de vie de l’époque. Elle permettait à chacun de voyager dans une région ou un pays où l’on est totalement inconnu sans souci de nourriture et de logement (à une époque où il n’existait ni hôtel, ni banque…)
Ce résumé est mis à votre disposition gratuitement par la Ligue Associative Africaine. Lisez et faites lire ce résumé à toutes vos connaissances si possibles. Allez dans notre site web www.ligueaa.org pour télécharger d’autres résumés d’ouvrages et de centaines d’articles sur la renaissance africaine. Les portes de la Ligue Associative Africaine sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent une renaissance africaine et qui veulent mener avec nous la Grande Révolution Panafricaine et proclamer avec nous la République de Fusion Africaine.
Nous vous attendons.
Fraternellement.