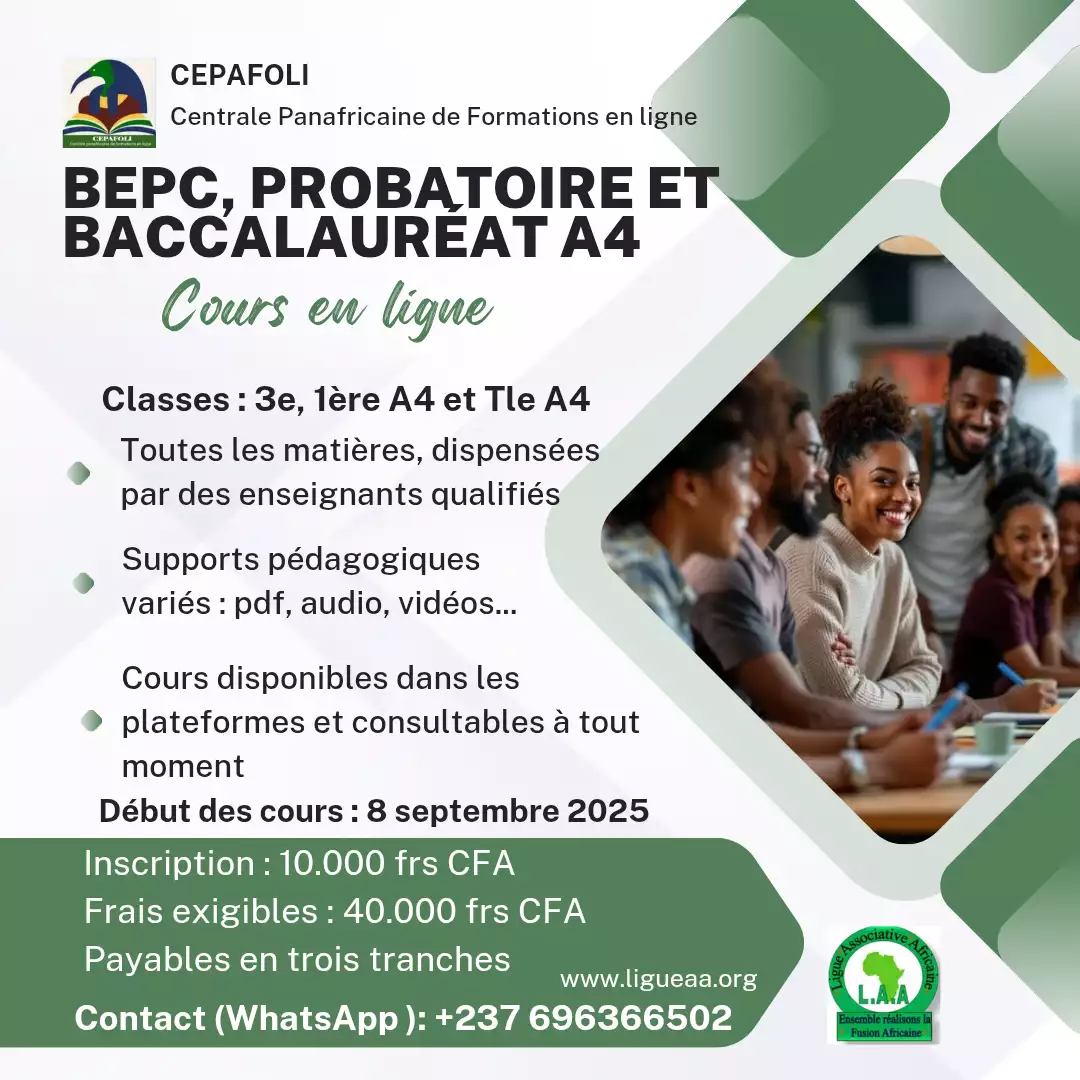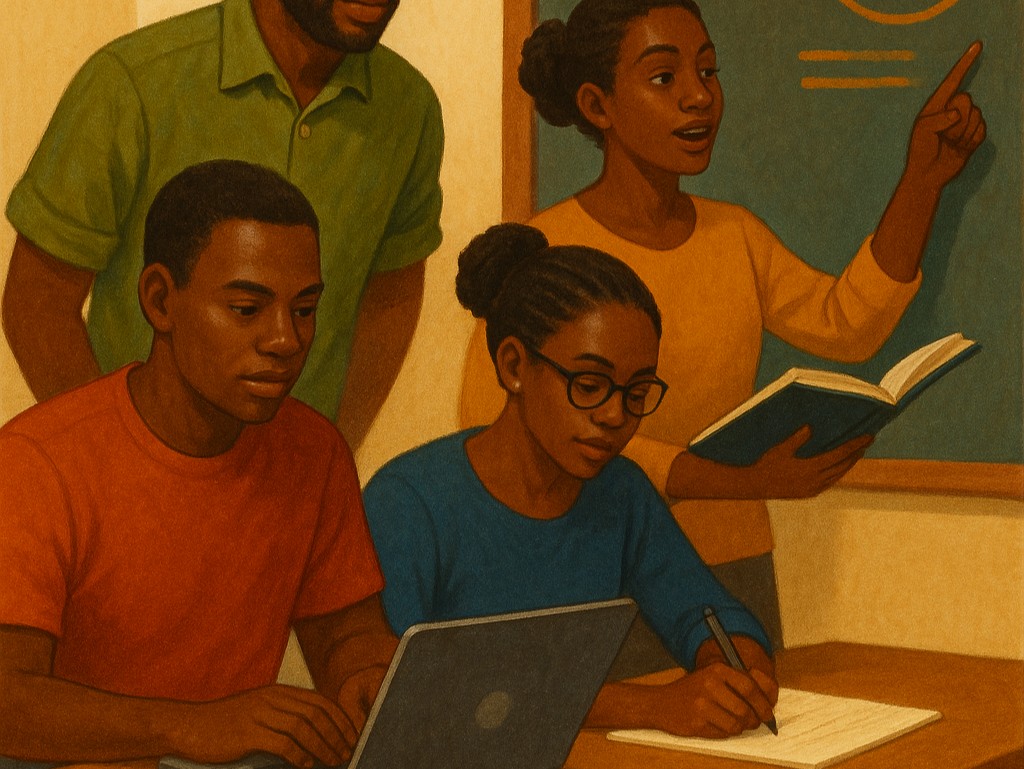Résumé de l’ouvrage : MAIN BASSE SUR LE CAMEROUN Version revue et corrigée
Auteur : Mongo Beti
Edition : Maspero
Année d’édition : première édition en 1972
Par :
La Ligue Associative Africaine
Sous la coordination de : Yemele Fometio
Mai 2019
Cet ouvrage est résumé par le Département Panafricain de l’Education et de la Culture de la Ligue Associative Africaine. Le projet du résumé des grands ouvrages contribue à la Renaissance Africaine. Nous sommes convaincus que cette renaissance ne peut être assise que sur des savoirs solides et inattaquables. Nous avons décidé de résumer des ouvrages capitaux sur l’Afrique pour permettre aux africains d’avoir des connaissances nécessaires à l’émergence du continent, et à la proclamation de la République de Fusion Africaine.
Une renaissance africaine n’est pas possible sans un Etat unificateur solide et puissant, capable de fédérer toutes les aspirations du peuple africain à travers la planète. C’est pour cette raison que la Ligue Associative Africaine fédère les partis politiques, les syndicats et organisations des pays d’Afrique pour mener la Grande Révolution Panafricaine et proclamer la République de Fusion Africaine. Le résumé de cet ouvrage entre dans le cadre de notre programme éducatif « Les études panafricaines » qui vise à former les cadres de la Grande Révolution Panafricaine dans les partis politiques et organisations membres de la Ligue Associative Africaine. Au-delà, ce résumé s’adresse à tout africain et toute personne désireuse d’avoir des connaissances solides et vraies sur l’Afrique.
Cependant seule une lecture de l’ouvrage en entier peut vous permettre de cerner toute sa quintessence. Bonne lecture de ce résumé.
L’odieuse persécution d’un évêque catholique romain
Samir Amin et d’autres théoriciens exposent bien les mécanismes de pillage économique du tiers-monde. En rassemblant les informations méthodiquement recueillies, se découvrait avec une sorte de colère jubilatoire comment cette surexploitation se traduisait concrètement dans le vécu des camerounais. Dans ce pays, les gens meurent comme des mouches faute de médicaments, la mortalité infantile y est très élevée. Les Camerounais sont privés de fabriquer même un grain d’aspirine pour soigner la population. Ils sont contraints d’importer tous leurs médicaments de la France plus d’une décennie après l’indépendance. Le gouvernement camerounais se soucie peu de contrôler l’importation et la commercialisation des médicaments, s’en remettant entièrement à une bande de margoulins européens qui n’hésite pas à réaliser des profits spéculatifs sur la souffrance même des nouveaux nés. Cette population si démunie a tout à créer et la priorité des priorités devrait être pour elle d’accumuler le capital nécessaire aux exigences de l’investissement. Or les établissements français qui détiennent le monopole de fait transfère mécaniquement leurs revenus en Europe sans aucune restrictions ni aucun contrôle de l’Etat camerounais, créant une extraordinaire hémorragie des capitaux qu’on pouvait utiliser pour engager l’industrialisation du pays. L’Etat camerounais lui-même est entre les mains d’assistants techniques français qui, par une étonnante réglementation, mettent le crédit hors d’atteinte des nationaux pour le réserver aux commerçants et aux entrepreneurs européens. L’assistance française au Cameroun ferait croire que le pays manque cruellement de cadres, or on voit couramment des diplômés de l’enseignement supérieur au chômage ou, pour peu qu’ils se sont montrés turbulents, contraints à l’exil au point que le Cameroun est le premier pays d’Afrique noire ayant le plus de diplômés de l’enseignement supérieur à l’extérieur de ses frontières.
Voici l’univers de folie dont n’a pas pu s’accommoder Mgr Albert Ndongmo, cet homme de cœur et de réflexion. C’est en découvrant peu à peu qui avait été Mr Albert Ndongmo, quels étaient ses projets, quel rôle il avait tenté de jouer dans le Cameroun dirigé par Ahmadou Ahidjo que le pays m’apparut pour la première fois comme un véritable bantoustan : Tous les profits sont aux mains des firmes et des entreprises blanches, mais toutes les larmes et toutes les plaies de la misère sont aux nègres. Pour protéger cet ordre, le régime exerce contre les camerounais désarmées des exactions, des saccages. Il entretient au quotidien des humiliations, des brutalités, une censure perverse pour imposer le silence d’un peuple transformé en une sorte de zombies. Les massacres, une crise sociale et culturelle menacent constamment de déraper vers le génocide tout court. En 1966, 500 paysans de Tombel, un village de l’ouest Camerounais furent exterminés une seule nuit par la soldatesque d’Ahmadou Ahidjo, encadrée par les conseillers techniques français.
Après la sortie et la saisie de cet ouvrage, mes adversaires, pourtant puissants n’ont jamais eu le courage de soumettre l’ouvrage à un tribunal en m’intentant un procès. Cette procédure plus simple risquerait d’aboutir à un déballage public de la situation du Cameroun et risque de créer un scandale. S’ils doivent se résoudre un jour à une tentative quelconque, ce serait l’assassinat. Je ne serais qu’un cadavre de plus parmi les centaines de milliers qui jalonnent déjà le pouvoir du triste célèbre Ahmadou Ahidjo.
Saisisez, il en restera toujours quelque chose
Mis en vente le lundi 25 juin 1972, Main basse sur le Cameroun était l’objet d’un arrêté d’interdiction paru au journal officiel du samedi 30 juin. Le livre a été saisi le 02 juillet chez l’éditeur français Maspero. Je m’associais à l’action intenté contre le ministère de l’Intérieur par mon éditeur auprès du tribunal d’administration de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire est enfin jugée le 15 février 1975 et le lobby qui avait demandé l’interdiction de Main basse sur le Cameroun est battu. Au mois de mai, le ministre de l’intérieur signait un arrêté annulant celui de juin 1972 qui interdisait Main basse sur le Cameroun.
« Main basse sur le Cameroun », un livre dépassé ?
Le Cameroun, perdu dans l’immensité du continent noir, naufragé dans la tempête quotidienne de l’actualité internationale, n’a pas renoncé à résister à la sanglante dictature d’Ahmadou Ahidjo dont le régime se caractérise par une extrême faiblesse, nécessitant la protection de Paris. Les nombreuses arrestations de juillet 1976 consécutives à de simple distributions de tracts et atteignant jusqu’à de très hauts fonctionnaires du régime, sans épargner les très jeunes lycéens, les travailleurs, les chômeurs et même les femmes enceintes, tous citoyens suspects de sympathie pour l’U.P.C (Union des Populations du Cameroun), révèlent cette extrême faiblesse du dictateur. La rage avec laquelle le ministre français de l’intérieur s’acharne à nous empêcher d’informer l’opinion publique sur les victimes de la violence politique au Cameroun témoigne aussi de cette faiblesse. Le démantèlement de l’embryonnaire système éducatif laissé par la colonisation est encore plus scandaleux et plus révoltant. La privatisation méthodique des livres aux niveaux du primaire et du secondaire, les effectifs avoisinant 100 enfants par classe servent à ôter du camerounais une conscience à toute épreuve, alors que les enfants des serviteurs de la dictature sont élevés avec soin dans les écoles réservées où enseignent les européens. La misère ronge les masses, alors qu’une petite caste accumule tous les privilèges, formant la façade africaine de l’édifice néocolonial et formant l’épine dorsale du parti unique, qui est aussi le parti profrançais. C’est, d’autre part, le complexe impérialo-culturel français, violentant les authentiques et les aspirations profondes des Africains, n’épargnant aucune catégorie, aucune institution.
L’église Catholique camerounaise est partagée dans des conflits d’intérêts mis à nu par Mr Albert Ndongmo. Il y a une faction conservatrice, bénéficiant des subsides de l’occident et résignée à laisser la pénitence aux missionnaires, si discrédités soient-ils aux yeux des populations, et une aile de jeunes désireux de prendre fermement en main le destin des communautés africaines. Seuls les sourds et les aveugles peuvent se figurer aujourd’hui qu’après tant de sang versé pour leur dignité, après tant de rêves avortés de prospérité et de bonheur, les Camerounais acceptent encore pendant longtemps de s’accommoder d’un protectorat ou d’un détournement de leur labeur et de leurs ressources.
Le rôle de « l’humanité » pendant le procès anarchique de Mgr Ndongmo
En dix années d’indépendance, le pays n’avait pas pourvu les camerounais d’une modeste tribune pour y entendre leurs aspirations au cours du drame qui les concernait tant. Les médias nationaux relayaient le discours banal de la domination occidentale. Au moment où les marionnettes noires choisies par les agents de Foccart prononcent la condamnation à mort d’Ernest Ouandié, de Mgr Albert Ndongmo et de leurs compagnons, tous les Camerounais avertis ont la bouche gonflée de colère et de mépris. Les seuls comptes rendus de la mascarade du palais de justice de Yaoundé leur sont apportés par des journaux français qui s’efforcent à justifier cette ignominie. Les centaines de journaux qui existaient au Cameroun au début de l’indépendance ont été exposés à la dictature et à la répression. Les organisations populaires liées à L’U P C, autant dire la grande majorité des militants politiques et syndicalistes ont été écrasés sans pitié. Au moment du drame, la presse nationale camerounaise se réduisait à quelques journaux gouvernementaux au service de la répression, ainsi que deux ou trois journaux religieux contraints à la complaisance, parce que perpétuellement menacés de représailles. Cette situation laissait le champ libre aux journaux français, qui détiennent le véritable monopole de l’information. Ces journaux sont d’extrême-droite et de droite et présentent souvent l’homme noir en esclave. « L’Humanité », l’organe du PCF (Parti Communiste Français) tout au long de l’affaire Ouandié-Ndongmo a mis en pratique les principes de solidarité internationale dont il s’est toujours réclamé. Le 24 Décembre 1970, « l’Humanité » publie un article y dévoilant les véritables raisons de l’arrestation d’Ernest Ouandié et Mg Ndongmo. Le 7 Janvier 1971, le Journal annonce les condamnations à mort prononcées par le tribunal militaire à l’encontre d’Ernest Ouandié, d’Albert Ndongmo et de leur caractère arbitraire. Le numéro du 8 Janvier reprend ces informations et y ajoute les interventions faites par les organisations démocratiques françaises auprès de diverses autorités concernées. Le 9 Janvier, « L’Humanité » engagé à sauver de la mort les six détenus de Yaoundé, donne une large place à la conférence de Me Fadilou Diop, avocat sénégalais régulièrement constitué comme défenseur par la femme d’Ernest Ouandié, qui, à peine débarqué au Cameroun en avril, a été aussitôt chassé par la police d’Ahmadou Ahidjo. Me Fadilou certifie que ces dossiers n’étaient pas clairs. Le 16 Janvier, le Journal « L’Humanité » annonce que le président de l’UPC et ses Camarades révolutionnaires ont été exécutés sur la grande place de Bafoussam.
Bref rappel historique du Cameroun
27 Août 1940
En Août 1940, les Camerounais autochtones ignoraient encore que leurs maitres français avaient perdu la guerre. Ils apprendront avec stupéfaction que leur pays se ralliait à De Gaulle. Le 27 Août, Leclerc et quelques gaullistes débarquent à Douala dans la nuit sur trois canots indigènes et lancent l’offensive. Ils rallient les forces militaires et arrêtent les dissidents. Leclerc prend le titre de colonel et de gouverneur.
18 Décembre 1944
Création à Douala, sous l’impulsion d’un Français Donnat, de l’USCC (Union des Syndicats Confédérés du Cameroun), centrale syndicale unique, proche de la C.G.T française. Ce syndicat va se trouver tout de suite en butte à une très violente campagne du clergé catholique, en attendant les persécutions de l’administration coloniale.
En 1946, des élections sont organisées au Cameroun pour donner trois représentants au palais-Bourbon : Appuyé par le chef de l’église locale Mgr Graffin, Louis Paul Aujoulat se présente à la circonscription du centre très catholique. Pour être élu, Aujoulat a besoin des voix des africains. Il promet aux notables catholiques africains des avantages matériels et une considération que, selon lui, l’administration leur refuse. Il est élu malgré l’opposition de la gauche camerounaise. Député des populations noires dont il refuse de comprendre les aspirations profondes et surtout la revendication d’indépendance, il se persuade que, noyés dans un effet de promotion sociale sans précédent, les voix de la gauche s’assourdiront. Mais il n’a pas les moyens de sa politique et seuls quelques notables ou élites bénéficient de sa politique. Aujoulat, comme tous les Européens, attribuent aux notables une emprise exagérée sur la masse de petits gens, ce qui fortifie la gauche, et notamment l’UPC de Ruben Um Nyobé. En 1953, Louis Paul Aujoulat se heurte à la gauche. Ministre à Paris, il est aussi, sur le plan local, tout puissant. Il s’entoure de nombreux notables profiteurs. Conscient de la limite de ces individus, il élargit son assise camerounaise en réunissant autour de lui, non plus seulement les Catholiques, mais tous ceux qui sont résolus à barrer la voix aux nationalistes. Parmi ces personnalités dont s’entoure Louis Paul Aujoulat se trouve Ahmadou Ahidjo. Le nouveau parti que crée Louis Paul Aujoulat est le Bloc Démocratique Camerounais (B.D.C). Ce parti s’inscrit dans la guerre froide comme défenseur des intérêts de l’occident et partisan de l’Alliance Atlantique, ce qui l’amène tout naturellement à des positions colonialistes. Or l’UPC a créé une croisade anticolonialiste pour la réunification et l’indépendance du Cameroun. En 1954, le BDC et son leader Louis Paul Aujoulat deviennent synonymes de cynisme politique. Certains collaborateurs quittent le mouvement et entreprennent même de le combattre. André Marie Mbida quitte le BDC et se lance dans une entreprise personnelle. Ahmadou Ahidjo fait partir du dernier carré des fidèles de Louis Paul Aujoulat. Battu aux élections de 1956 par André Marie Mbida, évincé de tous les postes qu’il occupait, Aujoulat abandonne définitivement la politique camerounaise, mais reste une éminence grise du régime Ahidjo. Le gouvernement institué au Cameroun n’empêche pas la France d’exercer sa pleine autorité sur le pays. Georges Chaffard raconte cet épisode dans ses carnets secrets de la décolonisation: « Abandonné à lui-même, Ahmadou Ahidjo est incapable de la moindre initiative. »
En 1958, tout le monde veut le départ d’André Marie Mbida : L’administration coloniale ne supporte plus un homme qu’elle ne contrôle plus vraiment à cause de sa désinvolture et ses brusqueries gratuites. L’Assemblée non plus ne supporte plus son esprit autoritaire et ses éclats de voix. Il injure et terrorise les membres de l’Assemblée. La population le rejette pour son attitude dure contre l’UPC. Tout le monde attend un acte, un geste de son adjoint Ahmadou Ahidjo. Mais Ahidjo n’initie rien pour évincer André Marie Mbida. Ce qu’il laisse apparaitre c’est la passivité, la pleutrerie. Après avoir fait confiance en Paul Soppo Priso qui l’a trahi en devenant nationaliste, la France avait placé sa confiance en André Marie Mbida qui est à son tour devenu incontrôlable, elle trouvera enfin en Ahmadou Ahidjo celui qui défendra ses intérêts. Elle délègue de Paris le haut-commissaire Jean Ramadier chargé d’éliminer tous les obstacles sur le chemin conduisant Ahmadou Ahidjo à son Bureau de premier ministre. C’est un haut-commissaire bulldozer chargé de déraciner André Marie Mbida. Ramadier contraint André Marie Mbida à la démission en 1958 et le remplace par Ahmadou Ahidjo. Il faut à ce dernier, non plus sa docilité habituelle, mais une image de marque internationale.
Pour le Brain-trust qui l’entoure, il faut surtout le transformer en un chef imposant, prestigieux. Dans ce Brain-trust se trouvent des vétérans de la guerre d’Indochine et d’Algérie, experts du viol des foules, de la manipulation psychologique la plus déshonorante. Ahmadou Ahidjo doit incarner les vertus de violence et de sagesse. La France Gaulliste a décidé de mettre au pouvoir dans les pays africains des hommes servant les intérêts de la France : maintien des formes coloniales et accroissement des bénéfices français grâce à une exploitation effrénée et incontrôlée des hommes et des ressources de l’Afrique. Le gaullisme recherche surtout des vassaux sur lequel s’appuyer pour mieux défendre les intérêts de la France en Afrique.
« Tous les parfums d’Arabie… »
Ahmadou Ahidjo ne peut empêcher que sur son passage jaillisse le sang des camerounais. Pendant deux ans, il se cache derrière le statut d’autonomie interne pour se tenir à l’écart de la répression frénétique où périt Ruben Um Nyobé. Mais ce temps ne suffit pas pour écraser les progressistes qui luttent avec acharnement. A partir de l’indépendance, il ne pourra plus s’esquiver. Il doit donner son aval au redoublement d’opérations militaires pour pourchasser impitoyablement les maquisards (nationalistes), raser les villages, bombarder les populations au Napalm. Le Cameroun devient le théâtre d’une guerre sanglante dont la comparaison en termes de violence ne peut être donnée que dans la guerre du Biafra. Pour Georges Chaffard, « Entre Douala et Bafoussam, près de 400 000 Bamilékés sont en dissidence. Pour rétablir l’ordre à la demande expresse du gouvernement camerounais, le général Briand dispose de cinq bataillons, un escadron blindé et un escadron de chasseurs-bombardiers T.26 pour des missions d’intimidation ». Mais le général et ses hommes doivent s’arrêter sans cesse pour dégager la route et chasser des populations sans armes qui s’agrippent aux voitures. Pour Briand lui-même, rarement une insurrection n’a eu un caractère si populaire. Le général Briand n’a rien d’un pacifique. Il a servi dans l’armée française en Indochine et en Algérie, adjoint du général Massu.
Le pays bamiléké a besoin de réformes profondes de caractère social et agraire et les populations n’ont aucune garantie que ces réformes seront menées par le gouvernement camerounais. Ce qu’on attend d’eux, c’est d’isoler la rébellion manu-militari. Il est difficile de définir l’aide militaire sous une forme ou une autre, que la France consent aujourd’hui à Ahmadou Ahidjo. La mission de Briand n’était pas seulement d’intimider puisqu’on a eu des blessés qui avaient été brulés au Napalm. La présidence d’Ahmadou Ahidjo est aussi marquée par une succession de meurtres. En fin 1960, Felix Roland Moumié, chef de l’UPC depuis la mort de Ruben Um Nyobé et principal adversaire d’Ahmadou Ahidjo est empoisonné à Genève où il était de passage. Il est tué par un faux journaliste appartenant aux services secrets français. Le complot entre Ahmadou Ahidjo et la France pour éliminer Moumié a réussi.
Ahmadou Ahidjo et son régime s’acharnent à présenter Ahidjo comme un chef charismatique. On ne parle pas de lui sans ajouter un « Son excellence ». Depuis son pèlerinage à la Mecque, il est aussi devenu El Hadj. Désormais pour parler de lui les journalistes alignent une série de qualificatifs : « Son Excellence El Hadj Ahmadou Ahidjo, président de la République Fédérale du Cameroun, père de la Patrie ». On ajoute aussi souvent les attributs suivants : « pionnier de le négritude, prophète du panafricanisme, défenseur de la dignité africaine ».
La naissance de l’Union des Populations du Cameroun.
Le mouvement est apparu comme seul instrument de conquête vitale à une société qui subissait les arbitraires d’un système colonial devenu intolérable. Constamment menacé de destruction physique et morale, la population a vu aux tourments du mouvement le signe de la nécessité de sa mission. Parmi ceux qui participent à la mise sur pied du parti au début se trouve un jeune et modeste enseignant répondant au nom d’Ernest Ouandié. Ce dernier et ses camarades sentent confusément que leur dessein déborde le cadre du Cameroun et embrasse la cause du peuple noir tout entier, quel que soit le continent. En Afrique française, la ségrégation sévit, les sectateurs du général Lynch tiennent le haut du pavé en Amérique, l’apartheid a débuté en Afrique du Sud. Les africains ne voient d’issue que dans la libre disposition de leur destin politique. Le succès du R.D.A (Rassemblement Démocratique Africain) dans toute l’Afrique française témoigne de l’authenticité de cette inquiétude, et l’UPC n'est que la section Cameroun du R.D.A. Mais l’UPC désavoue seul le tournant de 1950, qui dévie le RDA vers la collaboration loyale avec l’administration coloniale.
L’UPC a une faiblesse qui lui sera fatale. Contrairement à l’Algérie et l’Indochine, elle n’est pas adossée à une nation amie aux ressources incalculables qui la protège et où elle peut se replier pour se réorganiser dans les moments difficiles. Elle souffre au contraire, du fait de la situation géographique du Cameroun, d’une excentricité dangereuse qui donnera la tentation aux autorités successives de Yaoundé d’asphyxier purement et simplement le mouvement. Pendant la guerre, le mouvement manquera cruellement une arrière base lui donnant un espace de manœuvre et lui permettant d’étoffer ses organisations. Les théoriciens du système colonial qui croyaient que l’UPC n’a pas les moyens de défaire la colonisation, vont découvrir au fil des semaines, des mois, des années, des lustres qu’ils ne peuvent pas anéantir, comme ils le souhaitaient, le mouvement progressiste. Tout l’acharnement de la colonisation ne sert qu’à faire émerger de nouveaux héros et à susciter l’adhésion d’un peuple longtemps humilié. Vers 1954, la colonisation a atteint les paroxysmes dans son irritation, et il est question dans les hautes sphères d’en finir avec l’UPC. C’est dans ce sens que Roland pré est nommé haut-commissaire au Cameroun.
Roland pré ou les débuts de la terreur
Quand Roland pré est nommé au Cameroun, le député s’appelle Louis Paul Aujoulat, en plus d’être ministre de la santé à Paris. Il est donc un personnage puissant en métropole. Par le nombre et l’importance des postes qu’il occupe à Yaoundé et à Paris, Louis Paul Aujoulat s’est fait à la fois le stratège et le tacticien de ce qu’il appelle « lutte contre le communiste au Cameroun et en Afrique ». C’est bien l’esprit de coercition dont témoigne Roland pré envers l’UPC qui provoque les émeutes de mai 1955, réprimés avec une rare férocité, à la suite desquelles Ruben Um Nyobé, se sentant menacé, entre en clandestinité et le Cameroun entre dans le tunnel d’une interminable guerre. Mais ni l’avènement d’un gouvernement autonome en 1957, ni la mort d’Um Nyobé en 1958, ni celle de son successeur Felix Roland Moumié en 1960, ni la proclamation de l’indépendance ne vont modifier la nature de l’affrontement. L’état d’urgence, sans cesse reproduit tous les six mois, est un démenti sans appel à toutes les déclarations de victoire d’Ahmadou Ahidjo et de ses amis, en même temps un aveu d’échec. M. Charles von de Lanoite qui a résidé 43 ans à Douala, et dont la fille vivait à 150 mètres du sinistre camp de torture de Manengouba, explique qu’ils entendaient « des hurlements des condamnés certaines nuits. Le jour, des camions montaient la route chargés d’hommes enchainés, la nuit, vers 3 heures du matin, c’étaient les pétarades et les grincements de camions militaires qui allaient au cimetière, où une équipe de prisonniers enterraient les corps des malheureux qui avaient été torturés à mort, et parfois respiraient encore ».
Le garrot
En 1962, Ernest Ouandié prend la direction des maquis. Considérablement affaiblie, l’UPC va connaitre des victoires durables qu’Ahmadou Ahidjo tente sans répit de transformer en défaites. Les troupes gouvernementales et ses conseillers techniques français ne cessent de frapper sévèrement les révolutionnaires et rendre insurmontables, en partie les problèmes d’approvisionnement en armes, de ravitaillement, de logistique, de communication et de recrutements des maquis. Mais le succès d’Ahmadou Ahidjo apparait plus éclatant dans l’action psychologique. Ses démonstrations de force fréquentes font impression sur des populations vulnérables. L’horreur des exécutions publiques qui sont monnaie courante à Douala, les disparitions inexpliquées, la rumeur des tortures, les menaces, la sauvagerie d’une police fanatisée, les voyages d’Ahidjo à l’étranger contribuent de cette action psychologique. Vers le milieu des années 1960, à l’image d’Houphouët Boigny, Ahidjo est érigé en fondateur de la propriété économique du Cameroun. Mais la misère ne cesse de croitre au pays. Le régime ne réalise rien du tout en vérité. Le régime fait un tapage médiatique sur cent kilomètres de route dans la région de Mbalmayo, pourtant cette route a été offerte gracieusement par la République Fédérale d’Allemagne. Le régime se vante du prolongement du tronçon de chemin de fer trans-camerounais, alors que ce tronçon a été offert gracieusement par les Etats-Unis. Il se vante de l’Université qui a été offerte gracieusement par le Canada. A la longue, et en l’absence d’informations contradictoires, les populations finissent par croire à une volonté de progrès. Le régime Ahidjo a surtout réussi à créer un silence autour du Cameroun. Le citoyen Camerounais ignore même un événement important qui s’est passé au quartier voisin du sien. Cette privatisation d’information a été notoire pendant la colonisation, cachant des informations qui avaient mis l’accent sur la détermination du combat national. On annonçait l’incarcération d’un Martin Luther King sans annoncer sa race, ni les raisons de son combat. Le silence imposé par Ahmadou Ahidjo par la saisie et l’interdiction des journaux, l’exil, l’arrestation ou l’assassinat des intellectuels progressistes, aidé du régime gaulliste, a réussi à faire oublier peu à peu la lutte de libération de l’UPC contre un tyran imposé de l’extérieur. On a vu la gauche française se désintéresser d’un procès où l’un des plus grands révolutionnaires d’Afrique et du tiers-monde jouait sa tête. L’UPC lui-même a abdiqué dans le domaine de la guerre psychologique. Ceci peut être justifié par le fait qu’à la prise de la tête de l’UPC en 1962, le parti souffre d’un isolement presque complet.
La Baleine échouée sur la plage ?
Particularismes ethniques et sociaux, archaïsme des mentalités, extrême dispersion géographique, ignorance et dénuement contribuent à retenir les masses rurales (80 % de la population) en marge de la vie politique. C’est seulement en pays bamiléké que la structure semi-féodale de la propriété foncière, le surpeuplement et le fort pourcentage des moins de 30 trente ans crée d’une manière durable une tension véritablement prérévolutionnaire. Sous la colonisation, l’UPC a recruté la plus grande partie de ses militants en zones urbaines. A partir de l’indépendance, ces villes deviennent l’enjeu d’une âpre lutte entre le gouvernement réactionnaire d’Ahmadou Ahidjo et les organisations clandestines de l’Union des Populations du Cameroun. Les fonctionnaires dont la promotion était limitée au temps de la colonisation croyaient voir s’ouvrir devant eux des horizons illimités et se rangeaient derrière le gouvernement d’Ahmadou Ahidjo. C’est le début de l’âge d’or pour la petite bourgeoise bureaucratique vaguement lettrée, mais encore profondément docile aux maitres blancs. La petite-bourgeoise du commerce et des affaires fait pareil. L’UPC est surtout soutenue par le sous-prolétariat et de nombreux chômeurs des bidonvilles, dans une moindre mesure des adolescents de certaines écoles. Pour les conseillers d’Ahmadou Ahidjo, le problème est résolu et la bataille gagnée vers 1962 avec l’élimination de quelques politiciens progressistes encore tolérés. La répression et la terreur doivent sans peine tuer dans l’œuf toute velléité d’organiser les jeunes et les pauvres. Isolé du peuple qui assure sa protection, le régime d’Ahidjo compare l’UPC à une baleine échouée sur la plage, faute d’eau pour se mouvoir et se dérober ou attaquer.
Aux premières années d’indépendance, Ahmadou Ahidjo bénéficie d’une sorte de scepticisme auprès de l’opinion Publique. Il ne s’est jamais expliqué au sujet de la mort de Ruben Um Nyobé, pourtant des questions se posaient. L’indépendance est venue très vite et la domination française demeure. Pour répondre à toutes ces questions, le gouvernement Ahidjo engage une série ininterrompue des nominations, d’avancements, de promotions, de parachutages. Prévarication et courses au plaisir, vices et jalousies, l’accélération éperdue de l’exode rural suivent ce feu d’artifice. Le combat devient encore plus difficile pour la gauche progressiste et révolutionnaire en combat, d’autant plus que de graves dissensions sont apparues dans ses rangs depuis la mort de Ruben Um Nyobé. La division entre la Chine et la Russie crée dans le mouvement des accusations de tendance à un camp. Si tôt publiée l’intention d’octroi de l’indépendance politique au Cameroun par la France, l’UPC devait choisir entre deux stratégies : Soit entamer une course de vitesse contre Ahmadou Ahidjo ayant pour but de l’empêcher d’assoir son régime, le paralyser, l’enfoncer dans le chaos, le forcer à abandonner le terrain ; soit attendre une nouvelle génération moins corrompue par la bamboula de l’indépendance, réorganiser le mouvement de fond en comble, tout en entretenant une résistance larvée, pour déclencher enfin l’insurrection au jour choisi. Tiraillé entre les deux ailes du mouvement, Ernest Ouandié ne parait pas avoir opté définitivement pour l’une ou l’autre de ces deux stratégies.
Au moment de la colonisation, le mot indépendance était perçu comme la revendication suprême, entrainant naturellement une mobilisation massive. Le général De Gaulle a su jouer sur cet aspect pour installer des présidents dociles à la tête des pays africains. Par ce jeu, il a pu exclure les progressistes africains du pouvoir politique. Il les a non seulement isolés, mais a pu les désigner comme des boucs émissaires des difficultés que traversaient les Etats africains dirigés par ses hommes de main. Il a pu créer et maintenir le mythe de l’Afrique menacée par la subversion chinoise que seuls des gouvernements militaires étaient capables de contenir.
L’UPC, espoir des pauvres et des jeunes
Devant les difficultés que le parti affrontait depuis sa naissance et surtout devant la guerre qu’il menait, l’UPC devait forger un langage nouveau, une perspective inédite de mutation globale. Il était clair que le régime courait à l’impasse. L’aggravation des pillages des firmes coloniales, l’explosion démographique et une scolarisation accélérée sans aucune prévision de création d’emplois promettait à Ahmadou Ahidjo un avenir incertain et à ses adversaires une nouvelle bataille dans leur longue guerre. Le fossé entre les classes privilégiées essentiellement de la bureaucratie et l’extrême misère du petit peuple de paysans, de citadins, de chômeurs et ouvriers, et même de petits fonctionnaires et petits employés est tel que les divisions ethniques que le régime utilise pour se maintenir n’apportent plus aucune atténuation. Les Citadins pauvres se replient sur le village et la tribu, il se crée entre eux un lien d’entraide. L’aristocratie bureautique, qu’on appelle à tort bourgeoise africaine, tant cette classe manque d’assise économique, d’idéal collectif et d’esprit d’initiative qui sont caractéristiques de la bourgeoise européenne, s’est enfermée dans le ghetto de la consommation. Elle s’est révélée une classe aussi inutile que vorace, décevant tout le monde. Le peuple comptait sur elle pour être guidé. Le régime d’Ahidjo et ses conseillers comptaient sur elle pour gagner la confiance du peuple. Cet échec laisse le régime et ses conseillers dans l’obligation d’interposer la police et l’armée, à défaut d’une courroie de transmission, avec toutes les conséquences qu’entraine nécessairement ce genre de dialogue.
La forte scolarisation des jeunes inquiète le régime qui tente de freiner ce processus. Sa volonté de freiner la scolarisation se heurte à la création des établissements d’enseignement privés. Le gouvernement distribue le Baccalauréat au compte-gouttes pour ne pas créer plus de titulaires qu’il ne peut accorder de bourses d’enseignement supérieur. De la sorte, le régime n’a pas encore sous le bras des bacheliers en chômage. Ce blocage donne lieu à une émigration officielle et Clandestine des jeunes Camerounais vers les établissements scolaires d’Europe et d’autres pays d’Afrique, créant une véritable diaspora dont le poids se fera sentir à l’avenir.
Des processus aussi déterminants étaient en faveur de la gauche camerounaise. Au lieu de ressasser les mots d’ordre nationalistes désormais désuets, elle devait proposer une mobilisation pour lutter contre le sous-développement et les injustices en cours. Les conseillers d’Ahmadou Ahidjo de leur côté sentent que le moment est propice pour la relance de l’action révolutionnaire, d’autant plus que de nombreux incidents ont eu lieu : Attentat d’un jeune officier contre le président de la République, affaire Victor Kanga, un ancien ministre des finances qui a révélé les scandales et a été condamné, opposition chaque jour plus dévastatrice de l’évêque catholique Mgr Albert Ndongmo. Plusieurs fois, des révolutionnaires d’une tendance dissidente de l’UPC ont tenté du créer un front de guérilla dans l’extrême-sud du pays. Au moment de la retraite du général De Gaulle en 1969, le grand gaulliste M. Tomballaye ne se maintient au pouvoir au Tchad que grâce à un véritable corps expéditionnaire de Paris, des Cubains et des Chinois se trouvent au Congo-Brazzaville. Dans l’entourage d’Ahmadou Ahidjo, la crainte est à son comble. On se demande si le départ de Charles De Gaulle du pouvoir ne va pas faire écrouler l’échafaudage qu’il a bâti en Afrique. C’est à ce moment que les révolutionnaires devaient frapper à grand coups pour précipiter le régime d’Ahmadou Ahidjo, mais on s’étonne que les troupes gouvernementales aient surpris Ernest Ouandié à ce moment précis et crucial pour la Révolution.
Paradoxes de la condition bureaucratique Camerounaise
Par leur manière de vie occidentale, la bureaucratie camerounaise séduisait les camerounais aliénés par la colonisation. Au contraire du commerçant, de l’entrepreneur, du citoyen qui exerce une profession libérale, le bureaucrate, confortablement abrité derrière les murs d’un édifice public, éloigné des combats pour la vie, insoucieux des lendemains proches ou éloignés, n’est point contraint par ses activités quotidiennes de remettre en question sa place dans sa société, ni la nature de celle-ci, ni la tutelle étrangère. Son salaire si maigre soit-il est une fortune au milieu de la misère qui caractérise le pays. Les modestes lumières de son instruction éblouissent ses familiers. Jamais de mémoire d’Hommes, on a cumulé tant de privilèges pour si peu de mérites. Avec l’avènement d’Ahmadou Ahidjo, les camerounais comprennent que ces fonctionnaires tiennent leurs privilèges de leur renoncement politique, d’autant plus que les avantages sont attribués en dehors de tout critères. Dispensateur omnipotent des salariées, des pensions, des promotions et de tous les avantages liés à la fonction publique devenue l’unique industrie des Camerounais, le président ne doute pas d’obtenir la sujétion de ses concitoyens. La classe supérieure, la plus instruite est subjuguée. C’est une classe de troupeau sans âmes. Pour détruire l’opposition, le régime engage la fonctionnarisation. Les intellectuels s’opposant à sa politique sont appelés pour occuper des bonnes places qui ne vont pas rester éternellement. Les commerçants, planteurs, de modestes hommes d’affaires sont appelés à renoncer à leurs activités pour servir le régime comme députés, sous-préfets, ambassadeurs ou à d’autres postes honorifiques, vivant dans le budget de l’Etat. Par ce fait, la part de la société qui pouvait porter la croissance du pays est devenue un fardeau pour l’Etat.
Un système socio-politique aberrant
Par cette politique d’étatisation, les principales activités économiques demeurant en dehors de l’Etat sont réservées aux étrangers occidentaux, libanais et syriens. La colonisation avait cru pouvoir édifier un ordre durable dans lequel, tandis que le Camerounais bornerait son ambition aux satisfactions bureaucratiques, l’Européen aurait l’apanage de bâtir, de créer des entreprises et des richesses, en un mot d’exercer la véritable puissance. Mais tôt ou tard les Camerounais allaient être séduits eux aussi par les avantages et le prestige attachés aux activités créatrices d’argent. Une fraction bamiléké du peuple Camerounais fit preuve très tôt d’un sens universellement reconnu du commerce et de l’initiative. Le transporteur bamiléké, par son génie, maitrise sa société, passe à travers les quartiers pour chercher les voyageurs, fixe son prix en fonction du pouvoir d’achat de ses compatriotes, sait respecter ses clients, roule dans de vieilles voitures toujours pleines de passagers, contrairement au transporteur européen qui stationne à un seul endroit, voyage rarement et à des heures incomprises par les paysans, dans des autocars qui sont souvent vides. Le transporteur bamiléké a compris quelque chose que les professeurs d’économie de l’Université Fédérale et les experts de l’ONU n’ont pas compris. Aussi longtemps que les prix des denrées et des services courants seront les même à Yaoundé et à New York, tout ce qui se fait ou se dit au Cameroun en matière d’économie n’est que futilité. Le système de libre concurrence a permis aux transporteurs bamilékés d’éliminer leurs concurrents européens. Mais aux émeutes de mai 1955 provoquées par Roland pré, beaucoup de transporteurs bamilékés sont arrêtés comme militants ou sympathisants de l’UPC et disparaissent : Par cette élimination physique de leurs principaux concurrents, les européens que les bamiléké avaient évincés par la concurrence reviennent sur le transport. Ce ne fut pas seulement le cas des transporteurs bamilékés. Tous les africains dont les affaires rivalisaient avec ceux des européens ont été inquiétés, incarcérés ou éliminés. La décolonisation véritable dont clamait l’U.P.C devait prendre en charge les activités moyennes de l’économie, l’Etat se réservant d’animer les secteurs complexes et vitaux. L’économie devait alors être vraiment nationale. Les entrepreneurs camerounais ayant échappé à cette répression de 1955 furent cooptés dès l’indépendance par le régime d’Ahmadou Ahidjo vers la voie de la bureaucratie.
Un pillage frénétique
La décolonisation gaulliste du Cameroun a surtout permis le retour à l’âge d’or de l’exploitation coloniale, en la sous-traitant et en la soustrayant cette fois à toute possibilité de contrôle de l’opinion publique française et mondiale. C’est à cela que Mgr Ndongmo va s’opposer, il entreprit les affaires et mit sur pied la société « Mungo plastique » chargée de fabriquer des objets en matière plastique, et dirigée par M. Verbeck. La prospérité foudroyante de la société révélait tout à coup chez les africains la volonté de se substituer au capital néocolonial pour créer une économie au service des Camerounais. Les foudres du régime et du lobby de Paris allaient tomber sur le prélat. Le 17 avril 1970, le gérant de la société est arrêté et les deux collaborateurs européens de Mgr Ndongmo sont expulsés sans préavis. Le 12 Juin, la banque coupe les crédits à la société. Et finalement en mi-juillet, la société ferme ses portes. Les banques en question sont des établissements français, et plus précisément des filiales d’établissements parisiens où le lobby colonial exerce une influence déterminante.
Sous la décolonisation gaulliste, le pouvoir d’achat de l’écrasante majorité des camerounais est un des plus bas au monde, tandis que les prix rivalisent avec ceux de New York. L’étreinte asphyxiante de la zone Franc, telle qu’elle fonctionne au Sud du Sahara, permet également aux économistes officiels de briller par leur somnambulisme. Les anciennes colonies sont obligées de faire bourse commune avec leur tuteur. Les capitaux voyagent surtout du Cameroun vers la France. Cette politique aboutit à la spoliation accélérée d’un des pays les plus pauvres de la planète. Ficelé dans ce carcan des transferts, le Cameroun est abandonné à la sauvagerie des firmes néocoloniales et à des grandes banques parisiennes qui commanditent le pillage colonial depuis plus d’un siècle. Le pays se vide toujours de sa substance. Loin de l’arrêter, l’indépendance a plutôt accéléré le pillage du pays.
Dictature flibuste et compagnie
La stabilité du régime camerounais ne trompe que les idiots, et la dictature d’Ahmadou Ahidjo n’attire que des aventuriers. Jamais le régime n’a séduit le véritable capitalisme européen, des créateurs d’entreprises qui acceptant de lier définitivement leur avenir au destin du pays. Dans les pays francophones, tous les commerçants les plus prospères et les plus puissants sont des étrangers. Ces derniers ne rêvent que de regagner leurs pays fortune faite, jouissant des marges bénéficiaires exorbitantes extorquées à de gouvernements extraordinairement dociles. Les bénéfices sont chaque année transférés dans leurs pays dans les proportions de 90% et d’avantage. Si l’entrepreneur Camerounais avait les mêmes facilités auprès du régime en place, les résultats seraient les mêmes, mais il aurait pu réinvestir ses bénéfices au pays et assurer alors la prospérité nationale. A ceci vient s’ajouter le pillage des matières premières et la détérioration des termes de l’échange. Depuis l’indépendance, à l’exception des quartiers administratifs, les villes camerounaises n’ont pas changées, contrairement à l’Europe où l’argent créé dans un pays y demeure pour l’essentiel, afin de financer les diverses activités du pays. Au Cameroun par contre, le régime s’oppose à la naissance d’autres entreprises, en privant le pays de l’argent qui devait faire avancer le pays. Le Cameroun est ainsi voué à l’aide extérieure qui préserve une façade de la vie et empêche au pays de s’asphyxier tout simplement.
Dans les affaires africaines, il ne faut pas se fier aux discours officiels et aux intentions qu’ils proclament. Bien que l’appauvrissement et l’avilissement du Cameroun désespère tout le monde, l’affaire Ndongmo va révéler qu’au contraire bien des gens y trouvent intérêt : Le lobby d’outre-mer de Paris, le gouvernement Camerounais dont la survie politique est liée à ce mode d’exploitation de leurs frères et de leur pays, le régime gaulliste qui a réussi à tourner le drame à son profit politique, présentant la situation comme une fatalité qui requiert la présence et l’aide de France.
Albert Ndongmo, prince de l’église ou prophète ?
Beaucoup de Camerounais sont convaincus que le sous-développement du Cameroun est artificiellement entretenu pour légitimer l’immixtion de la France dans ses affaires. Albert Ndongmo en fait partir. En tant que bamiléké, il est nourri du combat séculaire de son peuple contre l’oppression économique du pays depuis la colonisation. En 1963, il déclarait que : « l’Etat croit que nous devons prêcher un christianisme désincarné, parler du ciel, des anges, sans toucher les réalités vitales de tous les jours. Or, l’évangile du christ n’est pas une théorie, mais une vie. Il s’insère dans toute la vie de l’homme engagé dans la famille, la politique, la profession et le syndicat ». Albert Ndongmo est aussi un intellectuel, un homme qui a beaucoup étudié, beaucoup médité, beaucoup appris. Un homme qui a séjourné à l’étranger où son esprit s’est ouvert aux nombreux problèmes de notre temps, et surtout la nécessité pour tous les peuples de progresser, s’ils veulent survivre. L’église couvre la moitié Sud du Cameroun. Avant l’indépendance, cette église était une église coloniale et colonialiste qui avait épousé les préjugés, les idéaux de la colonisation. Les missionnaires s’étaient alliés aux autorités pour ruiner la civilisation de ce qu’ils appelaient « les peuples indigènes ».
Avec l’avènement d’Ahidjo, s’est produit un changement qualitatif : L’église avait aidé un musulman à triompher sur les « marxistes » de l’UPC. Cette église continue de le soutenir en revendiquant des privilèges liés à ce soutien. Au moment des élections, elle fait envahir les bureaux de vote par les fidèles au sortir de la messe. Or ceux qui entrent dans l’isoloir sont sensés voter pour le gouvernement. Lentement, naturellement, inéluctablement se tissent des liens qui, au milieu des années soixante, se cristallisent en une véritable sainte Alliance des croyants et du régime, bientôt scellée par une visite du président camerounais au Vatican, en Septembre 1967. Sur le timbre-poste qui célèbre l’événement, on peut voir le pape serrant chaleureusement la main d’Ahmadou Ahidjo. Voilà le clergé camerounais, africanisé maintenant pour la plupart, devenu une des catégories qui tiennent le haut du pavé de l’Etat. Le prêtre qui prêche est une figure symbolique du régime. Cette allégeance explique le fait que cette église, loin de s’émanciper, demeure d’inspiration strictement colonial. Le clergé africain, domestiqué par une collaboration intéressée avec la dictature, se range plutôt dans la classe bureaucratique. L’église en retour reçoit les privilèges de la bureaucratie, les aides pour la construction de ses écoles, l’édification des lieux de culte ou le pèlerinage des fidèles sur la terre Sainte. Comme la bureaucratie, le clergé n’a aucune autonomie morale ni spirituelle. Contrairement au clergé engagé d’Amérique Latine, le clergé camerounais n’a aucune sensibilité à la détresse des foules ignorantes et démunies.
Albert Ndongmo, évêque de Nkongsamba depuis 1964, ne résiste pas à la tentation de sortir de ce réseau serré de tabous et d’interdits. Il se sent frustré dans ses aspirations d’Homme, de Bamiléké et de guide d’une communauté. Il est impatient de plonger dans l’action. Tant d’écoles, d’hôpitaux, de maisons de jeunes manquent dans ce diocèse. Tant de discours se font sur la pauvreté du tiers-monde, tant d’invites à l’effort sont adressées à leurs habitants, et surtout à leurs à leurs élites, sommées de se sacrifier, de se crucifier pour leurs peuples. L’enthousiasme de Mgr Ndongmo semble traduire le sentiment d’une mission collective du peuple bamiléké, choisi pour frayer la voie de libération économique, la vraie, la seule. La réussite éclatante de son action est une revanche sur l’histoire récente du Cameroun, qui a si souvent frustré le peuple Bamiléké de victoires amplement méritées. La production de sa société « Mungo Plastique » commença en mars 1970 et en Juin, le montant des contrats de vente avait atteint 9 millions de Francs CFA. Le chiffre d’affaire de Mungo-plastique, révélant un besoin aigu et une attente du public, promettait déjà un développement véritablement fantastique de l’entreprise. Mgr Ndongmo voulait aider à la promotion de la petite et moyenne industrie camerounaise et assurer à son diocèse des rentrées d’argents autonomes destinées à alimenter les caisses des écoles, des hôpitaux et la création d’une caisse de retraite pour les prêtres âgés et autres personnes relevant de l’administration diocésaine. Devenu très populaire et ayant beaucoup d’argent avec un esprit indépendant, Mgr Albert Ndongmo ne se doute pas un seul instant que le gouvernement dresserait contre lui ses propres pairs, qui le jalousent de longue main. Mais il est confiant de sa loyauté et de sa droiture vis-à-vis du Pape.
L’UPC, un mort qu’il faut qu’on tue
Depuis la mort de Ruben Um Nyobé, le journal « Le monde » ne cesse de présenter L’U.P.C comme un mouvement moribond. Phillippe Decraene et André Blanchet, Pierre Biarnes prennent en main cette tâche représentant le mouvement comme un mouvement divisé en petits groupes avec des chefs inexistants ou en exil. De telles affirmations impressionnent le lecteur en profondeur, se gravent bien dans son subconscient et, à la longue, associées à ses préjugés habituels, finissent par gouverner son jugement. Selon Pierre Biarnes, journaliste de la rubrique africaine de « Le monde », et donc spécialiste attitré des questions africaines, Ernest Ouandié, le 6 Juillet 1966, soit quatre ans avant son arrestation, n’existe pas. Puisque pour lui l’U.P.C s’est désagrégée en petits groupes d’intellectuels en exil et à quelques bandes sans doctrines et mal encadrés.
Action psychologique
D’habitude, les chefs révolutionnaires sont exécutés discrètement pour n’annoncer leur mort que quelques jours, parfois des semaines plus tard, selon une version entièrement forgée. Mais Ouandié a été arrêté et conservé vivant. Pour Ruben Um Nyobé, la raison avancée pour le tuer est qu’il tentait de s’enfuir avec une serviette en main, pourtant la serviette n’a pas été retrouvée. Son cadavre fut exposé pour que des populations voient celui qui constituait leur mythe. Pour Castor Ossende Afana tué en 1966 sur le front Sud, la tête avait été tranchée et avait roulé à quelques mètres du tronc, attestant les circonstances d’une exécution sommaire. Quant à Félix Roland Moumié, les circonstances de son assassinat n’ont pas permis au régime d’Ahmadou Ahidjo de mener l’action psychologique puisqu’il a été empoisonné à Génève par un agent des services secrets français qui s’est fait passer pour un journaliste.
Et voilà que tout à coup Ahmadou Ahidjo change de méthode et fait arrêter Ernest Ouandié, attirant sur lui les projecteurs de l’actualité. Dans un but de préparation psychologique, il fait annoncer à l’Agence France Presse que des armes ont été trouvées au bureau de Mungo-Plastique. Il s’agit de lier le cas d’Ernest Ouandié à celui de Mgr Ndongmo afin de les éliminer une fois. A la même agence de presse, il fait faire une biographie d’Ernest Ouandié lui couvrant d’éloges. Par cette attitude, le régime veut établir l’importance du personnage qu’il vient d’arrêter. Nouveauté des nouveautés, le régime s’engage même à juger Ernest Ouandié, et publiquement, alors que les autres nationalistes sont tout simplement torturés et tués. Des assassinats successifs des leaders de l’UPC par le régime n’avaient pas fait progresser la pacification. Chaque fois qu’un leader était torturé et tué, un autre prenait directement sa place et la guerre continuait. Le régime d’Ahidjo, en arrêtant Ernest Ouandié au lieu de le tuer croit pouvoir tirer du révolutionnaire un service inestimable. Le régime voulait recourir à la destruction morale en noyant la gauche dans le doute, le mépris et la dérision. Pour le faire, il fallait le ralliement d’Ernest Ouandié, compagnon de Ruben Um Nyobé et dernier chef historique de l’U.P.C comme le régime aimait l’appeler depuis sa capture. Dans un régime dictatorial, le ralliement d’un opposant, fut-ce obtenu par la torture est toujours un triomphe. Quand un membre de la diaspora revient au pays, le régime présente ce retour comme un acte de ralliement. A la longue, le partisan d’Ahmadou Ahidjo est celui qui est au pays, l’opposant brille par son absence au pays. Le prisonnier politique lui-même, dans son camp de concertation, ne survit qu’avec le consentement du gouvernement, auquel, à n’en pas douter, il a dû donner quelques raisons de satisfaction. Et maintenant Ernest Ouandié en vie, le régime peut à tout moment diffuser un aveu de l’homme pour jeter le doute sur l’héroïsme du chef rebelle et la réputation d’intégrité de la Révolution. Au lendemain de son arrestation, le gouvernement fait circuler un apocryphe, soit disant déclaration d’Ernest Ouandié, demandant aux combattants de l’Armée de Libération Nationale du Kamerun (ALNK) de réintégrer la légalité. Les conseillers d’Ahmadou Ahidjo avaient sous-estimé l’emprise des mots d’ordre de l’U P C sur les populations. Pour eux, à quoi bon faire disparaitre un chef de la Révolution si demain un autre mieux aguerri peut-être, plus résolu vient à son tour narguer le régime pro-occidental.
Ernest Ouandié, plus écouté, devait aller exhorter les mille intellectuels en exil, les résistants des divers fronts, les jeunes chômeurs des bidonvilles en passe de rallier la Révolution, et les expliquer que ce combat n’a pas d’issue, qu’il faut y renoncer. Bien entendu, Ernest Ouandié ne fit rien dans ce sens après quatre mois de torture et de traitement inhumain. Pis encore, Abel Eyinga, un intellectuel vivant à Paris avait fait acte de candidature aux élections présidentielles du mois de mars 1970 comme adversaire d’Ahmadou Ahidjo, créant une panique au sein du régime. Ce régime l’avait condamné à cinq ans de prison par contumace. Contrairement à ce que les journaux ont écrit, le voyage du président français Georges pompidou en Afrique n’était pas pour voir si la coopération franco-africaine valait encore la peine. Au contraire, il adhérait à ce système sans réserves, réalisé et géré par lui-même quand il était premier ministre. D’ailleurs ses propres liens avec le lobby nous en dit long. Son voyage était en fait une opération d’action psychologique, destinée à redonner du prestige à la coopération qui rencontrait de plus en plus du scepticisme.
Comme le régime d’Ahmadou Ahidjo, la Révolution camerounaise manque cruellement d’hommes. La révolution ressent plus ce manque, pressée d’aller de l’avant, d’effectuer des bonds pour franchir les obstacles. Trop sollicité, Ernest Ouandié se dépense avec une générosité excessive, il va et vient sans répit, apaisant une crise d’autorité, investissant solennellement un nouveau responsable, décidant d’honorer une nouvelle recrue qui ferait basculer un village ou un bourg. Partagé entre des tâches qui le dispersent, le chef relâche nécessairement une vigilance qui doit pourtant être fatale pour la Révolution.
L’arrestation de Mrg Ndongmo ou l’odieuse machination
Les liens de l’évêque et du maquisard ne faisaient de mystères pour personne parmi les dirigeants camerounais et dans les sphères de l’assistance technique sur place. Le président camerounais a démenti les affirmations répétées de l’évêque pendant le procès, selon lesquelles ce sont les autorités camerounaises elles-mêmes qui lui ont demandé de nouer des contacts avec le chef révolutionnaire dans l’objectif de ramener ce dernier dans la légalité. Plusieurs témoignages venus de tous les horizons confirment cette thèse. Bien des années s’étaient écoulées depuis 1968, début de la mission confiée à l’évêque, sans apporter au gouvernement aucune satisfaction. Peu à peu, comme il était prévisible pour un homme de bon sens, les contacts de l’évêque et du révolutionnaire avaient pris une autre tournure, un autre sens. Au lieu d’amener Ernest Ouandié à joindre le régime d’Ahmadou Ahidjo, c’est l’évêque qui se laissait influencer par les idées progressistes de l’UPC, secouant résolument la subordination de l’église à l’Etat néocolonial. Mais contrairement à l’accusation du gouvernement, ce rapprochement n’ira pas jusqu’à une alliance formelle, à l’action commune avec les révolutionnaires. Mgr Ndongmo avait des points communs avec son misérable peuple. Il comprenait ce peuple, compatissait à son dénuement. L’UPC avait opté pour la lutte armée afin de renverser la tendance. Mgr Albert Ndongmo lui, tentait de donner aux Camerounais la maitrise de leur économie, favoriser la petite et moyenne entreprise nationale, éduquer intensément la jeunesse Camerounaise et stimuler son esprit d’invention, créer des emplois pour remédier à un chômage galopant, rendre aux populations le sentiment de leur dignité, les détourner de la facilité illusoire de l’aide étrangère. Tout ceci c’est, quoi qu’on dise, combattre le capitalisme. Au milieu d’un peuple que les persécutions du gouvernement contraignent à se serrer les coudes, une sorte de connivence nait entre les deux hommes, qui de fait en sont les deux véritables guides. En pays sous développé, un évêque vraiment pénétré de sa mission, doit baigner dans la population comme un poisson dans l’eau.
Si Mgr Albert Ndongmo était depuis plusieurs années l’homme à abattre dans des cercles puissants du Cameroun, c’est parce que sa philanthropie révoltait. Aux yeux du margouillat colonial local et par conséquent du lobby colonial de Paris, son cas ne requiert vraiment une thérapie urgente et radicale qu’à partir de mars 1970 avec le début de la production de l’usine Mungo-plastique. Le crime qu’on ne pardonnera jamais à Albert Ndongmo, c’est, en tant qu’africain, d’avoir dépassé le stade que le système avait prévu pour les entreprises africaines et d’avoir atteint la réalisation de ses desseins tout en ne laissant aucune marge d’échec si l’expérience se poursuivait. Son forfait c’est d’avoir ruiné les fondements d’un ordre psychologique et socio-économique hypocrite et injuste qui ne repose que sur le mensonge et l’oppression et que l’indépendance à la mode Ahidjo avait renforcé, loin de mettre fin. Grâce à Mgr Albert Ndongmo, l’évêché de Nkongsamba s’était associé au centre climatique et touristique de Dschang, aux librairies catholique de Nkongsamba et Douala, à la boucherie de Nkongsamba et Douala, à quelques plantations et hôtels divers. Avec ces partenaires, Albert Ndongmo avait également pour projet de fabriquer des cahiers scolaires, des chaussettes, d’ouvrir une caisse mutuelle (maladie, retraite) regroupant tous les évêchés du Cameroun. De tels projets s’opposaient radicalement à la logique néocoloniale.
L’hallali
Quand s’opère l’arrestation de l’évêque le 28 Août 1970, Ahmadou Ahidjo est absent du pays. Mais de nombreuses manœuvres d’intimidations ont été adressées à l’évêque avant ce jour. Les responsables de son entreprise Mungo-plastique ont été soit arrêtés, soit expulsés. L’Agence France Presse a diffusé une information selon laquelle des stocks d’armes ont été découverts dans l’industrie. Certains ont accusé une faction du régime Ahidjo, ayant à sa tête le terrible Fochivé, maitre de la police parallèle, de n’avoir pas respecté les conversations qui se poursuivaient en vue de signaler tout compromis entre le gouvernement et l’opposition clandestine et d’avoir arrêté Ouandié et Ndongmo sans l’accord du gouvernement camerounais. Il n y a pas de faction dans le régime Ahidjo. La nature même du régime lui interdit un tel luxe qui lui serait fatal. Tous les pouvoirs ont été concentrés dans les mains d’Ahidjo, même s’il n’est qu’une façade. Tous ceux qui lui opposent la moindre résistance sont sévèrement châtiés. C’est ce qui s’est passé en 1966 avec l’ancien ministre des finances Victor Kanga, disgracié et condamné à de lourdes peines sans vraiment savoir ce qui lui était reproché. En fait, Victor Kanga avait eu le malheur de s’opposer à Ahmadou Ahidjo à propos des dépenses qu’il jugeait désastreuses et sans utilités pour le pays. Fochivé est conscient que s’il prend une initiative aussi mineure soit-elle, qui défierait l’omnipotente autorité du président, il la payerait aussitôt de sa révocation immédiate, de sa liberté, voire de sa vie. En vérité, toute l’organisation de l’affaire Ndongmo a été agrée par le président de la république jusqu’aux moindre détails. Lui seul savait que le pape accepterait l’avanie infligée à Albert Ndongmo. En fait, une sorte de pacte dont seulement une infirme partie avait été rendu publique, avait été signée entre le pape et Ahmadou Ahidjo en 1967, pendant la visite d’Ahidjo au Vatican. Le Vatican laissait carte blanche à Ahmadou Ahidjo et acceptait de subordonner les intérêts de l’église locale à la lutte d’Ahidjo contre le « Marxisme ». En le déchargeant quelques jours plus tôt de son diocèse, la Vatican livrait Albert Ndongmo à la dictature d’Ahmadou Ahidjo. Si le Vatican a accepté un tel pacte, alors Ahmadou Ahidjo aurait payé le prix fort en termes de ressources du pays.
Le procès
Contrairement à l’information que voulait véhiculer la grande presse, les moments cruciaux du drame ne furent pas la condamnation à mort des principaux accusés, la grâce de l’évêque et l’exécution par fusillade sur la place publique des accusés révolutionnaires. En fait l’assassinat des révolutionnaires ne faisait de doute pour personne, à moins qu’ils acceptent de joindre le régime d’Ahmadou Ahidjo. Leur procès n’était qu’une mascarade. Le moment crucial de l’affaire fut le refus du ministre français des affaires étrangères d’imposer le respect de la convention judiciaire franco-camerounaise en exigeant de l’ambassadeur du Cameroun à Paris qu’il délivre un visa d’entrée dans le pays à Me De-Felice, avocat constitué par la famille d’Ernest Ouandié et de pierre Biarnès. Le régime d’Ahmadou Ahidjo a tenté de contrecarrer, avec le soutien de Jean Zoa, archévêque de Yaoundé et ennemi juré de Ndongmo, le courant de sympathie qui se dessinait en faveur du prisonnier grâce ou journal catholique « La croix ».
Un autre fait assez surprenant et troublant est qu’Ahmed Sékou Touré, d’habitude si solidaire des Révolutionnaires africains n’a délégué aucun envoyé spécial à Yaoundé pour informer le monde du déroulement du procès. Le monde n’attendait donc que la version du régime Ahmadou Ahidjo, ignorant tout sur le pays, ses habitants, la situation des accusés et des juges, leurs gestes, leurs voix. Seul « Politique Hebdo », jeune journal sans moyens financiers et « La croix » offrirent aux lecteurs quelques croquis pris au vif.
Sinistre prélude
Toutes les relations des deux procès ont été faites dans les quotidiens français à partir des dépêches de l’Agence France-Presse dont l’objectivité n’est point garantie. L’Agence France-Presse ayant publié le 15 Juillet 1970 une dépêche mettant très gravement en cause Mgr Albert Ndongmo, ce dernier écrit dans le journal « Le monde » une lettre de démenti, s’expliquant sur les événements et demandant à l’agence de fournir les sources de ses accusations. L’agence va répondre par le silence. L’affaire du stock d’armes trouvé à Mungo-Plastique ne sera jamais question à l’audience du procès, faute de preuves pour l’Agence France-Presse qui a diffusé l’information. Cette information de stock d’armes s’inscrit dans la campagne d’intimidation déclenchée contre Mungo-plastique dès que ses premiers succès ont été éclatants. Le 30/31 août 1970, l’Agence France-Presse cite les déclarations de M Sabal Lecco, ministre Camerounais de la justice selon lequel Mgr Ndongmo faisait partir d’un complot visant à assassiner le président. Le stock d’arme est passé, il s’agit actuellement d’un complot. Les dépêches de l’agence ne sont accompagnées d’aucun commentaire du Journal, comme les précédents d’ailleurs. Au procès, Ouandié affirmera d’ailleurs n’avoir jamais entendu parler de cette conjuration. Depuis dix jours que l’affaire a éclatée, on a l’impression que tout s’embrouille d’avantage avec le temps qui passe. Les seuls journalistes étrangers installés dans la capitale camerounaise sont ceux de l’Agence France-Presse et celui de l’agence Ton. L’envoi de chacune de leurs dépêches nécessite de véritables prodiges de diplomatie dans ce pays où l’intérim du ministre de l’information est assuré par son collègue de la défense nationale.
Les lumières viennent de « La croix »
L’attitude du quotidien du soir parisien « La croix » sera celle du bon sens, qui n’est pas éloigné de l’objectivité. Le 29 août 1970, contrairement à son confrère « Le monde » qui se bornait à reproduire une dépêche du bureau Agence France Presse de Yaoundé annonçant l’arrestation du prélat camerounais, le quotidien catholique analysait le fond politico-social de l’affaire. Il met en lumière l’existence d’une guerre civile et de fréquentes campagnes de liquidation de la rébellion, c'est-à-dire de l’opposition forcée au combat parce qu’elle ne peut faire entendre sa voix au Cameroun d’Ahidjo. Le 1er Septembre, le journal, tout comme son confère « Le monde », reproduit la bande sonore de l’Agence France-Presse où Mgr Albert Ndongmo fait des aveux d’avoir participé à la tentative de coup d’Etat et commente le caractère étonnant des révélations, surtout quand on connait l’homme qui les a prononcé. Il s’agit ici de voir la valeur accordée à une bande magnétique, si facile à tripatouiller et la manière dont les aveux ont été recueillis. Le journal « Africasia » suggèrera que le prélat a été drogué, et « Politique Hebdo » dira qu’il a été torturé comme tous les accusés révolutionnaires. Pour savoir la vérité, il faudra présenter l’évêque devant les journalistes pour qu’il réitère ses aveux devant les témoins, chose que le régime ne peut tolérer. Le 11 Septembre, alors que « Le monde » se désintéresse de l’affaire, « La croix » réussi à avoir un entretien M. Verbeek, collaborateur de Mgr Albert Ndongmo. M. Verbeek réaffirme qu’il n’y avait pas d’armes dans la société et qu’il ne pourrait y avoir. Le journal coiffe l’article d’un chapeau : « Il est intolérable que, sous prétexte de prudence ou de différence tribale, les hommes de bonne volonté du Cameroun, l’Eglise Camerounaise, les autorités civiles et nous-mêmes soyons complices d’arrestations et d’interrogatoires injustifiées, toujours condamnables, qu’ils frappent un simple citoyen ou un évêque… »
Mgr Jean Zoa n’a pas entendu ces paroles. L’hostilité de l’archevêque de Yaoundé et chef de l’église camerounaise tenait sans doute à la rivalité traditionnelle des bamiléké et des Ewondos. Mais l’hostilité est aussi née de l’opposition des tempéraments des deux hommes : Albert Ndongmo est téméraire, conquérant, actif et enthousiaste. L’archevêque est frileux à force de timidité, recroquevillé, très nonchalant. C’est un vrai monument du conformisme. Sa nomination peu après l’indépendance faillit créer une révolte parmi le clergé noir du diocèse, mais le vieil archevêque colonial René Graffin n’avait consenti laisser sa place que si Jean Zoa lui succédait. Mgr Graffin méprisait pourtant les prêtres africains. En laissant sa place à Jean Zoa, il était conscient que ce dernier ne prendrait pas d’initiatives pour rendre le clergé camerounais progressiste.
Manœuvre diabolique ou maladresse funeste
La campagne du journal « La croix » commence à déranger à Paris, son aire de diffusion. Les experts sur l’Afrique du journal « Le monde », après s’être confinés dans un silence, se réveillent le 28 septembre, un mois après l’éclatement de l’affaire pour faire monter en première ligne un journaliste inconnu de la rubrique africaine, J.G (sans doute Jean de la Guérière). Il signale l’opposition de l’évêque au régime d’Ahmadou Ahidjo, allant jusqu'à suggérer qu’il ne s’agit sans doute après tout que d’un règlement de comptes politique. Il fait néanmoins confiance, dans sa conclusion, à la justice du président de la République. Comme tous les camerounais, la grande majorité des évêques et des prêtres camerounais est engourdie par le lavage de cerveau et le matraque obsédant de l’information monocorde dispensée par les organes de l’Etat. Mais certains sont même capables de critiquer le régime dont-ils observent chaque jour les tares, surtout en pays bamiléké. Le 11 septembre 1970, les prêtres de la base, dans le diocèse de Bafoussam esquissent une réplique collective, mais bien hésitante encore, à l’arrestation de Mgr Albert Ndongmo, s’inquiétant de la tournure que les événements sont en train de prendre. C’est le moment que choisit M. Biarnes pour faire son incursion, au terme duquel il publie un article dans « Le monde » du 22/23 novembre, alors que le procès se prépare fébrilement. Son article reprend les versions du gouvernement. Cet article est particulièrement dur envers Ernest Ouandié et Mgr Albert Ndongmo. L’interview que lui a donnée Jean Zoa n’est pas en reste. Fabriqué selon les recettes du stalinisme, ce texte en étale les procédés de destruction morale : le ragot sordide, l’insinuation, la calomnie délibérée, la contre vérité et même le chantage. A court termes, l’effet escompté est largement obtenu. L’intimidation étrangle les quelques rares voix qui tentaient de s’élever, craintivement, contre la dictature. Aux yeux des camerounais, à quoi bon tenter quoi que ce soit contre Ahmadou Ahidjo si l’appui de l’occident lui est assuré coûte que coûte ? Les Camerounais, gens fort réalistes, n’entreprennent généralement qu’avec un espoir de succès.
Chaque jour, à la même heure que dans une ville de la province française, une livraison spéciale du journal « Le monde », arrivé la nuit par l’avion régulier de la ligne Paris-Yaoundé est distribuée dans les ministères et les services importants, à l’intention des dirigeants. La livraison destinée aux lecteurs anonymes n’arrive qu’avec plusieurs jours de décalage sur l’édition de Paris. Il ne fait aucun doute qu’en même temps qu’il démoralisait un grand nombre de citoyens Camerounais, les papiers de Pierre Biarniés confirmaient Ahmadou Ahidjo dans ses dispositions de rigueur implacable. Pour contrecarrer dans l’esprit des camerounais les ravages exercés par ces textes, il eut fallu lui donner la réplique immédiatement, dans le même Journal. Abel Eyinga réagit. Ce dernier est un intellectuel Camerounais résidant à Alger, et candidat des élections de mai 1970 qui avait fait paniquer le régime d’Ahmadou Ahidjo. Après d’interminables tractations, le « Le monde » consentit à publier quelques paragraphes assez anodins de la réponse d’Abel Eyinga le 7 Janvier 1971, soit un mois et demi après la rédaction de l’article de Biarnes. Ce texte aurait pu mobiliser l’opinion internationale et sauver Ernest Ouandié s’il était publié tel quel au moment où il fut envoyé. Mais qui se souciait vraiment de sauver Ernest Ouandié parmi tous ceux dont son sort en dépendait. Les efforts des Camerounais résidant en France pour publier les informations terrifiantes ont été vains. Ernest Ouandié était voué au poteau d’exécution.
La responsabilité du gouvernement français dans cette affaire est grande. Il ne se prend pas de décision importante à Yaoundé qui n’ait l’agrément de Paris. Au moment de l’affaire Ndongmo-Ouandié, plusieurs groupes d’intellectuels camerounais, opérant chacun de son côté, se sont heurtés exactement et de la même façon au même mur du refus. L’intellectuel d’Afrique francophone, s’il n’est pas un nouvel exemplaire de Léopold Sédar Senghor qui se soumet à l’occident, travaille pour les intérêts de l’occident, est la bête noire, l’individu détestable, le fâcheux, celui qu’il faut nier à tout prix.
A quoi servent les conventions internationales
Le combat de Maitre de Felice et du Comité International de Défense d’Ernest Ouandié aurait sans doute suffit pour sauver Ernest Ouandié. La presse devait exiger le respect d’engagements solennels contractés par la France au moment de l’accession du Cameroun à l’indépendance. Le texte de la convention judiciaire Franco-Camerounaise ne permet pourtant aucune échappatoire. L’article 31 stipule que « Les citoyens français ont accès, au Cameroun, aux professions libérales, judiciaires dans les mêmes conditions que les nationaux camerounais sans qu’aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard » et vice-versa. L’article poursuit en stipulant que « Les avocats inscrits au barreau camerounais peuvent assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises […] dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français » et vice-versa. Ces textes ont toujours été tenus secrets. Mais Me de Felice et le Comité de Défense d’Ernest Ouandié ont alerté l’opinion sur ces textes, et en premier lieu les journaux. Malgré les efforts de Jean-Jacques De Felice pour entrer au Cameroun et défendre son client, il ne put venir à bout. Les accusés ont alors été défendus par les avocats choisis par le régime d’Ahmadou Ahidjo lui-même. Connaissant le côté tyrannique du régime, les avocats choisis pour défendre Ernest Ouandié et les autres accusés devaient donc se soumettre entièrement au régime par craintes de représailles.
Feu vert !
L’inertie de l’opinion, et en premier lieu la presse, avait donc enlevé sur la route tout obstacle conduisant Ahmadou Ahidjo au crime l’ultime. Les dirigeants camerounais, en proie à la hantise de la subversion marxiste voient un ennemi en quiconque affiche les idées de progrès. Laisser entrer Me Jean-Jacques de Felice au Cameroun était pour eux comme introduire un loup dans la bergerie. Il allait transformer un procès très folklorique en une joute politique pleine de bruit et de fureur. Ahmadou Ahidjo déteste les procès politiques depuis les expériences de 1962. Rien ne l’épouvante comme lui rappeler la manière dont il est arrivé au pouvoir et la manière dont il a éliminé l’un après l’autre les véritables fils du pays et érigé son despotisme sur un pays désespéré et réduit peu à peu en un désert d’hommes de cœur et de talent.
Les Observateurs internationaux ou la stratégie de la normalisation
Aux procès de Yaoundé, on a vu entrer en scène les trois observateurs internationaux, arrivés avec deux jours de retard après l’ouverture du procès de la rébellion. Parmi eux Me Louis Pettiti, avocat à la cour d’appel de Paris, représentant le Mouvement International des Juristes Catholiques et le Centre de la Paix Mondiale, Me Giuseppe Cassano représentant la Pax Romana et Me Martin Achard représentant la Commission Internationale des Juristes. Me Pettiti est arrivé à Yaoundé le 3 janvier, soit trois jours avant la fin du second procès, et avant que le verdict ait été prononcé, il n’y était plus. Cela ne lui empêche pas de prendre parole pour déclarer la régularité des procès qui ne sont pas encore finis et qu’il a pris en cours, et de confirmer la culpabilité de l’évêque de Nkongsamba. Son article paru dans le journal « Le monde » du 6 Janvier 1971 ressemble à celui de pierre Biarnés du 22/23 novembre 1970 par le fait qu’il est une défense et une illustration de la justice d’Amadou Ahidjo.
Myopie ou aveuglement
Dans son article, Pettiti omet de mentionner que deux avocats européens, un anglais et le français se sont vu refuser le visa d’entrer au Cameroun par le gouvernement d’Ahmadou Ahidjo. Pettiti souligne que les procès se sont déroulés dans des conditions régulières, oubliant que les accusés ont été arrêtés par une police parallèle qui n’est soumise à aucune réglementation connue, de telle sorte qu’on ne voit pas par quel miracle ceux qui ont été arrêtés échapperaient au caprice du pouvoir et à l’arbitraire de ses chefs. Cette police parallèle a interrogé les accusés dans ses propres locaux où elle les a détenus jusqu’à leurs jugements, c'est-à-dire pendant quatre mois presque jour pour jour, pendant lesquels ils n’ont bénéficié de l’assistance d’aucun avocat, ni même de la visite d’aucune personne, s’agissant des accusés révolutionnaires. Seul Mgr Albert Ndongmo a eu ce luxe. De plus, un climat d’excitation politique et de haine tribale a été créé et délibérément entretenu dans le pays, par le régime lui-même. Me Pettiti qualifie toutes ces anomalies de régulier. Il tente de comparer la police politique du Cameroun à la Cour De Sûreté de la France. Or jamais en France les accusés comparaissent devant la Cour De Sûrété, n’ont été arrêtés par une police politique ou parallèle. Sauf peut-être le colonel Argoud, encore pour ainsi dire, clandestinement. Jamais leur interrogatoire ne s’est fait en dehors de la présence d’un avocat. Me Pettiti n’est nullement troublé des accusations de tortures clamées par Ernest Ouandié dès le début du procès. Au deuxième procès, tous les accusés ont affirmé que leurs aveux leur avaient été arrachés par la violence. Me Pettiti trouve tout cela régulièr. Il n’a pas cherché à savoir ce qui advenait de ces accusés après l’audience quand ils retrouvaient leurs cachots. Il dit les avoir parlé « librement », les gardes se tenant à l’écart. Aurait-il fallu aux accusés de rire avec lui pour qu’il s’assure qu’ils sont bien traités et bien nourris. Me Pettiti et ses collègues sont le genre d’observateurs internationaux taillés sur mesure, qu’on a envoyé à Ahmadou Ahidjo ou bien qu’il a commandé.
Mgr Ndongmo a été accusé d’avoir comploté avec Ernest Ouandié pour assassiner le président de la République par une alliance appelée « La sainte croix ». Or comme le confirme le journal « La croix » du 1er septembre 1970, dès les premiers interrogatoires de la police, Ernest Ouandié déclarait qu’il ignorait tout du complot. Il acceptait avoir collaboré avec Mgr Albert Ndongmo dans le cadre de la rébellion. Dans ce cas, pourquoi le faire comparaitre au nom du complot ? Pourquoi le régime s’acharne-t-il à créer artificiellement les liens entre ces deux affaires. Parce que l’une, la Sainte croix qui n’existe pas, ne prendra quelque consistance que si elle est contaminée par l’autre, qui existe tellement qu’elle n’a jamais été un mystère pour les dirigeants Camerounais. En fait, le complot pour lequel Mgr Albert Ndongmo a été jugé et condamné à mort, puis gracié, n’a jamais existé. Il était tellement imaginaire lors des débats d’audiences que l’un des avocat s’est permis cette remarque énergique et désabusé qui a tant frappé l’audience : « Où sont les plans des conjurés ? Qui devait arrêter qui ? Quand et où devait être assassiné le chef de l’Etat ? Nous n’en savons rien, et nous n’en saurons jamais rien ».
Me Pettiti sait très bien que faute de pouvoir se débarrasser de Mgr Albert Ndongmo qui était une gêne et même une menace pour son régime, Ahidjo a décidé de le faire comparaitre aux côtés d’un Chef révolutionnaire dont la présence sur le banc d’infamie ne s’étonnait point. Cela s’appelle l’amalgame. M. Pettiti, comme va nous confirmer « La croix » du jeudi 14 janvier 1971, était un partisan international et même « inconditionnel » de M. Ahmadou Ahidjo, et un grand admirateur du type de « décolonisation » que symbolise le petit Président.
Mgr Ndongmo à Canossa
Outre la thèse que la rencontre entre Mgr Albert Ndongmo et la rébellion s’est faite sous l’instigation du gouvernement lui-même, l’évêque ajoute avoir rendu des services à l’UPC, et notamment aux maquis de son diocèse, pour être en position d’influencer le mouvement révolutionnaire et le détourner de la pratique de la violence. Dans tous les pays, des hommes et femmes ont apporté des soutiens à des combattants de la liberté de leurs pays. La seule vraie question que les juristes n’ont pas posée est celle-ci : Pourquoi Albert Ndongmo, dont chacun convient qu’il est un opposant, a si peu insisté sur ses motivations politiques ?
L’Amen
De son arrestation au prononcé du verdict, jamais Abert Ndongmo n’a réagi comme s’y seraient attendus tous ceux qui le connaissaient. Il devait se murer dans le silence que les forts opposent comme ultime recours à l’oppression et à la persécution triomphante. Les modifications d’attitudes et de sentiments naissent des faits, d’événements. En premier lieu, nous avons l’accusation du stockage d’armes lancée à plusieurs reprises par l’Agence France-Presse et reprise par les journaux français. Le prélat a été détenu pendant quatre mois dans les locaux de la police parallèle, à la discrétion de ses ennemis. Quatre mois de la vie d’un homme, cela compte. Plusieurs Camerounais, en qui j’ai toute confiance, m’ont affirmé que l’évêque restait de longs jours enchainé à un pilier de ciment, les mains liées derrière le dos, dans une posture fort douloureuse, mais surtout humiliante. Dans la fameuse bande magnétique qui défraya tant la chronique, la voix du prélat était comme brisée, le débit mal contrôlé. Les Journalistes d’Africasia, en écoutant cette bande, ont afformé que Mgr Ndongmo était drogué. Il est aisé d’imaginer que, par la suite, il devra plonger dans le désespoir. Il ne dût pas ignorer, aidé par la solitude, que les plus hautes autorités ecclésiastiques l’avaient livré au président de la République qui pouvait faire de lui ce qu’il voulait. Il s’imaginait sûrement la vengeance enfin assouvie de l’archevêque de Yaoundé Jean Zoa. On peut s’imaginer dans quelles circonstances exactes ont eu lieu la scène évoquée par Pierre Biarnés, au cours de laquelle le prélat, vaincu, sanglant, connaissant son innocence, impuissant, articule péniblement ces mots que lui attribue le journaliste : « J’ai trompé tout le monde, le gouvernement, l’église et l’U .P.C ». Se sachant désormais pieds et poings liés à la discrétion d’un ennemi implacable, Albert Ndongmo se résigna donc à se souscrire au marché de dupes qui lui était proposé. Il aurait la vie et l’honneur saufs à condition qu’il demande le pardon.
Le pardon est la plus grande souffrance qui se présentait devant l’évêque. Mais la crainte de la mort et les supplications de ses supérieurs romains, lui persuadant que son sacrifice servait l’église l’y poussaient. On entendra plusieurs fois Mgr Albert Ndongmo demander la clémence des autorités, déclarer qu’il n’avait jamais médité renverser les institutions étatiques, et que son seul et unique soucis avait toujours été le respect de la légalité. Il demandait pardon à tous, à ses concitoyens, à l’église, au gouvernement pour les erreurs qu’il avait pu connaitre, aux nationalistes. Quelle consternation pour ceux qui avaient connu ce très grand homme, de le retrouver en guignol ? A côté de ce bourgeois en Soutane, Ernest Ouandié de son coté, depuis toujours préparé au sacrifice suprême et à la torture, souriait, stoïque, attendant la mort avec sérénité.
L’intelligence française malade de l’Afrique gaullienne ?
Le 13 avril 1960, Ahidjo est toujours premier ministre. Tandis que le corps expéditionnaire français combat l’U.P.C à l’Ouest, il entreprend d’organiser des élections qui vont lui permettre de compléter les institutions du jeune Etat et en même temps d’entamer sa propre ascension. Mais la plupart de ses ministres sont battus lors de ces élections par le Dr Bebey Eyidi, Mayi Matip, André Marie Mbida et Victor Kanga qui furent élus. Ahmadou Ahidjo sent sa place menacé et entreprend l’élimination des plus importantes personnalités du Sud du pays, creusant d’avantage le fossé entre le Nord et le Sud du Cameroun. Il fabrique un complot pour se débarrasser d’André Marie Mbida, Bebey Eyidi et Mayi Matip, leaders jouissants de la confiance des populations qui les avaient élus. Plus tard, il se débarassera aussi de Victor Kanga qui avait aussi été élu par la population. Ahmadou Ahidjo déteste les élections parce qu’il y est toujours perdant.
L’aube de la gaullocratie
Quelques mois après les élections présidentielles très contestées, Ahmadou Ahidjo se déclaré élu. Si Majorité il a eu, Ahmadou Ahidjo le doit surtout à sa province du Nord natale, où les élections sont purement théoriques, la structure féodale et esclavagiste de la société peuhle déjouant d’avance tout effort pour organiser l’expression individuelle et secrète de choix politiques libres.
En juillet 1962, Ahmadou Ahidjo est élu président depuis un peu plus d’un an. Dans l’ouest bamiléké, la guerre de pacification se poursuit toujours avec acharnement. Le président vient de remporter une incontestable victoire diplomatique plutôt que politique : l’ancien Cameroun anglais vient de joindre le Cameroun français avec qui ils forment désormais une seule Nation. Cette réunification qui avait toujours été exigée par l’U.P.C, Ahmadou Ahidjo la présente triomphalement comme la victoire de la modération et de ce qu’il appelle la sagesse africaine, qui est en fait sa docilité. Le président entreprend une manœuvre d’une audace et d’une brutalité folles qui va, cette fois, plonger toute la moitié Sud du Cameroun dans les larmes, le sang, le chaos pour une période dont personne ne pouvait prévoir la durée et dont les conséquences demeurent incalculables même aujourd’hui. Ayant décidé que la présence d’une opposition est un luxe inutile pour le Cameroun et une gêne intolérable pour sa liberté personnelle, il ordonne à toutes les formations politiques de se fondre dans l’Union Camerounaise, son propre parti. Mais comme les leaders du Sud du pays montrent peu d’empressement à obtempérer, le président les faits arrêter et mettre en jugements, avançant l’argument d’un complot. A ceux déjà cités se joint Charles Okala, détenteur d’un mandat de sénateur sous la colonisation. Tous ces hommes ne sont pas seulement investis de la mission de représenter les populations qui les ont librement désignés, ils sont aussi véritablement les guides de l’opinion locale.
En plus du bannissement des leaders de l’U.P.C, Ahmadou Ahidjo vient de décapiter une seconde fois la société du Sud du pays. Il veut désormais avoir en face de lui des foules « sudistes » inorganisées, faciles à manipuler et sur qui il peut trôner. En fait, la longue tradition de lutte dans le Sud du pays l’empêche d’installer sa dictature, contrairement au Nord du pays où la domination peule sur les autres peuples facilite sa dictature. Avec les assassinats de Félix Roland Moumié, Martin Singap, Ossende Afana, l’emprisonnement de Victor Kanga et l’élimination de Mgr Albert Ndongmo en 1970, Ahmadou Ahidjo s’en prenait à la troisième génération des grands leaders « sudistes ». La colonisation camerounaise par Ahmadou Ahidjo interposé, tire ainsi vengeance des années 1950. Mais comme le Cameroun se situe dans une zone française, aucun commentateur en France n’a le courage de mettre en lumière cet aspect effroyable du problème camerounais. Aux élections de 1962, Ahmadou Ahidjo sort avec 51 sièges sur 100, soit une seule voix de majorité. Il aurait pu faire appeler un membre de l’opposition pour former un gouvernement de coalition ou bien provoquer de nouvelles élections et demander au pays de lui donner les moyens de gouverner. Mais Ahmadou Ahidjo et ses conseillers choisirent une troisième voix : De 51 sièges en avril, l’Union Camerounaise se retrouvait en juillet de la même année avec 85 députés, sans aucune autre élection organisée. Tout simplement Ahmadou Ahidjo venait de renouer avec les délices du système colonial, en occurrence la corruption. A des élus dont la plupart étaient de modestes citoyens sans fortunes, il avait fait miroiter des avantages devant lesquels il est bien difficile de refuser dans un pays sous-développé et dont la misère est chaque jour plus menaçante. Avec ce jeu, Ahidjo se retrouvait avec la majorité écrasante.
Bebey Eyidi, Mayi Matip, André Marie Mbida est Charles Okala publièrent un manifeste témoignant leur opposition au parti unique. Accusé de complot contre le régime, ils furent arrêtés, jugés et enfermés dans des camps de concentration, dont ils sortirent tellement diminués que le Dr. Bebey Eyidi mourut quelques temps après des séquelles de sa détention. André-Marie Mbida était presque aveugle à sa sortie. Tous ces chefs politiques sont sortis avec des séquelles. Depuis 1962, on ne trouve plus de véritables analyses de la réalité Camerounaise : Il n’y a plus que des éloges au régime Ahidjo. Sa politique résolument tribaliste à l’égard des bamiléké jugés trop entreprenants et que le président tente de soumettre à tout prix est vantée. Mais les faits sont demeurés les mêmes, avec un entêtement désespérant. Les maquis sont toujours là. L’arbitraire d’Ahmadou Ahidjo a franchi les frontières du fascisme, comme les événements viennent de le démontrer. Une telle dictature en Europe devait faire parler des journaux et mobilisé des organisations internationales. Mais Ahmadou Ahidjo sert les intérêts des puissants du monde. Ces puissants contrôlent les journaux. Une telle dictature sous le régime d’Ahmed Sekou Toure trop nationaliste et refusant de vendre son pays au pillage des puissants aurait occasionné immédiatement un déchainement médiatique et la mobilisation des organismes internationaux.
Pour expliquer la puissance de la malédiction coloniale en Afrique francophone, on a souvent invoqué la fragilité ou l’absence de structures politiques modernes dans ces pays. La résistance camerounaise infirme catégoriquement cette thèse. Voici des organisations forgées par des Camerounais eux-mêmes qui tiennent tête depuis près de vingt ans à bien des efforts d’anéantissement, dans des conditions de dénuements offreuses.