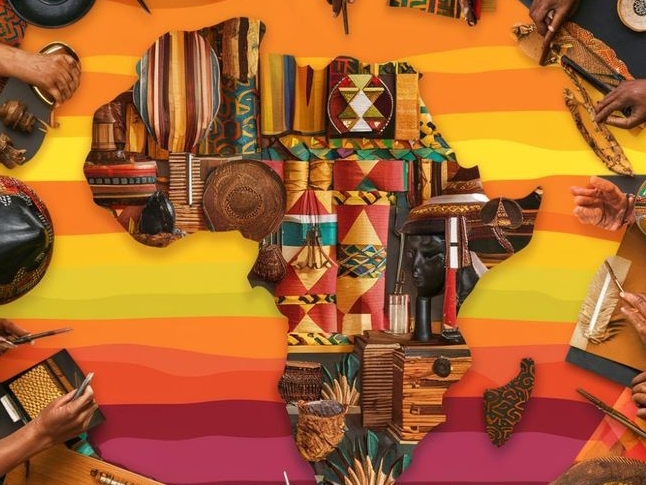Résumé de l’ouvrage : LES DAMNES DE LA TERRE
Auteur : Frantz Fanon
Edition : Réédition des éditions La découverte
Année d’édition : Edition de 2002
Par :
La Ligue Associative Africaine
Sous la coordination de : Yemele Fometio
Septembre 2018
Cet ouvrage est résumé par le Département Panafricain de l’Education et de la Culture de la Ligue Associative Africaine. Le projet du résumé des grands ouvrages contribue à la Renaissance Africaine. Nous sommes convaincus que cette renaissance ne peut être assise que sur des savoirs solides et inattaquables. Nous avons décidé de résumer des ouvrages capitaux sur l’Afrique pour permettre aux africains d’avoir des connaissances nécessaires à l’émergence du continent, et à la proclamation de la République de Fusion Africaine.
Une renaissance africaine n’est pas possible sans un Etat unificateur solide et puissant, capable de fédérer toutes les aspirations du peuple africain à travers la planète. C’est pour cette raison que la Ligue Associative Africaine fédère les partis politiques, les syndicats et organisations des pays d’Afrique pour mener la Grande Révolution Panafricaine et proclamer la République de Fusion Africaine. Le résumé de cet ouvrage entre dans le cadre de notre programme éducatif « Les études panafricaines » qui vise à former les cadres de la Grande Révolution Panafricaine dans les partis politiques et organisations membres de la Ligue Associative Africaine. Au-delà, ce résumé s’adresse à tout africain et toute personne désireuse d’avoir des connaissances solides et vraies sur l’Afrique.
Cependant seule une lecture de l’ouvrage en entier peut vous permettre de cerner toute sa quintessence. Bonne lecture de ce résumé.
I
De la violence
Libération nationale, renaissance nationale, restitution de la nation au peuple, Commonwealth, quelles que soient les rubriques utilisées ou les formules nouvelles introduites, la décolonisation est toujours un phénomène violent. Elle est le remplacement d'une « espèce » d'hommes par une autre « espèce » d'hommes. L'importance de ce changement est qu'il est voulu, réclamé, exigé. La décolonisation, qui se propose de changer l'ordre du monde est un programme de désordre absolu. Elle ne peut être le résultat d'une opération magique ou d'une entente à l'amiable. Elle est la rencontre de deux forces congénitalement antagonistes. Leur première confrontation s'est déroulée sous le signe de la violence et leur cohabitation s’est faite à grand renfort de baïonnettes et de canons.
La décolonisation modifie fondamentalement l'être, elle transforme des spectateurs écrasés en acteurs privilégiés. Elle est véritablement création d'hommes nouveaux. Mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle : le colonisé devient homme dans le processus même par lequel il se libère. Dans décolonisation, il y a donc exigence d'une remise en question intégrale de la situation coloniale. Sa définition peut tenir dans la phrase bien connue : « Les derniers seront les premiers. » Si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Cette volonté affirmée de faire remonter les derniers en tête de file ne peut triompher que si on utilise tous les moyens, y compris la violence. On ne désorganise pas une société, aussi primitive soit-elle, si l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-dire dès la formulation même de ce programme de décolonisation, à briser tous les obstacles qu'on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce programme, de s'en faire le moteur, est préparé de tout temps à la violence.
Le monde colonisé est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière est indiquée par les casernes et les postes de police. Aux colonies, l'interlocuteur valable et institutionnel du colonisé, le porte-parole du colon et du régime d'oppression est le gendarme ou le soldat. Par leur présence immédiate, leurs interventions directes et fréquentes, le gendarme et le soldat maintiennent le contact avec le colonisé et lui conseillent, à coups de crosse ou de napalm, de ne pas bouger. L'intermédiaire du pouvoir utilise donc un langage de pure violence. Les zones habitées par les colons et les colonisés s'opposent selon un principe d'exclusion réciproque. La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C'est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés par le colonisé. Les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux. La ville du colon est une ville de blancs, d'étrangers. La ville du colonisé est un lieu mal famé, peuplé d'hommes mal famés. On y naît n'importe où, n'importe comment. On y meurt n'importe où, de n'importe quoi. C'est un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. C’est une ville affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. C’est une ville accroupie, une ville à genoux. C'est une ville de nègres, une ville de bicots. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d'envie (envie de s'asseoir à la table du colon, coucher dans son lit, avec sa femme si possible). Il n'y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s'installer à la place du colon. Ce monde coupé en deux est habité par des espèces différentes. Malgré toutes les mesures mises sur pied, le colon reste un étranger. Disloquer le monde colonial ne signifie pas qu'après l'abolition des frontières on aménagera des voies de passage entre les deux zones. Détruire le monde colonial c'est abolir une zone ou l'expulser du territoire.
Il ne suffit pas au colon de limiter physiquement, c'est-à-dire à l'aide de sa police et de sa gendarmerie, l'espace du colonisé. Pour le colon, le colonisé est l'ennemi des valeurs. En ce sens, il est le mal absolu. Il est l’élément corrosif, détruisant tout ce qui l'approche, défigurant tout ce qui a trait à l'esthétique ou à la morale, dépositaire de forces maléfiques. Les coutumes du colonisé, ses traditions, ses mythes sont la marque de la barbarie et de l’obscurantisme qu’il faut bannir. L’église est là pour remplacer les croyances des colonisés jugés barbares. L'église aux colonies est une église de Blancs, une église d'étrangers. Elle n'appelle pas l'homme colonisé dans la voie de Dieu mais bien dans la voie du Blanc, dans la voie du maître, dans la voie de l'oppresseur. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de reptation du jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Dans la période de décolonisation, il est fait appel à la raison des colonisés. On leur explique que la décolonisation ne doit pas signifier régression, qu'il faut s'appuyer sur des valeurs expérimentées, solides, cotées. La violence avec laquelle s'est affirmée la suprématie des valeurs blanches, l'agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ces valeurs avec les modes de vie ou de pensée des colonisés font que le colonisé ricane quand on lui évoque ces valeurs. Pour le peuple colonisé la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, c'est d'abord la terre : la terre qui doit assurer le pain et, bien sûr, la dignité. Etre moraliste c'est faire taire la morgue du colon, briser sa violence étalée, en un mot l'expulser carrément.
L'intellectuel qui a suivi le colonialiste sur le plan de l'universel abstrait va se battre pour que colon et colonisé puissent vivre en paix dans un monde nouveau. Mais ce qu'il ne voit pas, parce que précisément le colonialisme s'est infiltré en lui avec tous ses modes de pensée, c'est que le colon, dès lors que le contexte colonial disparaît, n'a plus d'intérêt à rester, à coexister. Pendant la lutte de libération, au moment où le colonisé reprend contact avec son peuple, toutes les valeurs méditerranéennes, triomphe de la personne humaine, de la clarté et du Beau, deviennent vides de sens. Ces valeurs qui semblaient ennoblir l'âme se révèlent inutilisables parce qu'elles ne concernent pas le combat concret dans lequel le peuple s'est engagé. L’intellectuel colonisé avait appris de ses maîtres que l'individu doit s'affirmer, une société où la richesse est celle de la pensée. Or le colonisé qui aura la chance de s'enfouir dans le peuple pendant la lutte de libération va découvrir la fausseté de cette théorie. Les formes d'organisation de la lutte vont lui proposer un vocabulaire inhabituel. L’intellectuel colonisé assiste à la destruction de toutes ses idoles : l'égoïsme, la récrimination orgueilleuse, l'imbécillité infantile de celui qui veut toujours avoir le dernier mot. Il découvre la consistance des assemblées de villages, la densité des commissions du peuple, l'extraordinaire fécondité des réunions de quartier et de cellule. Le calcul, les silences insolites, les arrière-pensées, l'esprit souterrain, le secret, tout cela l'intellectuel l'abandonne au fur et à mesure de sa plongée dans le peuple. Mais il arrive que la décolonisation ait lieu dans des régions qui n'ont pas été suffisamment secouées par la lutte de libération et l'on retrouve ces mêmes intellectuels débrouillards, malins, astucieux. On retrouve chez eux, intactes, les conduites et les formes de pensée ramassées au cours de leur fréquentation de la bourgeoisie colonialiste. Enfants gâtés hier du colonialisme, aujourd'hui de l'autorité nationale, ils organisent le pillage des quelques ressources nationales. Impitoyables, ils se hissent par les combines ou les vols légaux : import-export, sociétés anonymes, jeux de bourse, passe-droits, sur cette misère aujourd'hui nationale.
Le colon fait l'histoire et sait qu'il la fait. Et parce qu'il se réfère constamment à l'histoire de sa métropole, il indique en clair qu'il est ici le prolongement de cette métropole. L'histoire qu'il écrit n’est donc pas l'histoire du pays qu'il dépouille mais l'histoire de sa nation en ce qu'elle écume, viole et affame. La statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont ou écrasé les révoltes des colonisés. Voilà le monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi ses rêves sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Il rêve qu’il saute, nage, cours, grimpe, éclate de rire, est poursuivi par des meutes de voitures qui ne le rattrapent jamais… Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va la manifester d'abord contre les siens. C'est la période où les nègres s’affrontent entre eux et où les policiers, les juges d'instruction ne savent plus où donner de la tête devant l'étonnante criminalité. La tension musculaire du colonisé se libère périodiquement dans des explosions sanguinaires : luttes tribales, luttes entre individus. Alors que le colon ou le policier peuvent, à longueur de journée, frapper le colonisé, l'insulter, le faire mettre à genoux, on verra le colonisé sortir son couteau au moindre regard hostile ou agressif d'un autre colonisé. Car la dernière ressource du colonisé est de défendre sa personnalité face à son congénère. En se lançant à muscles perdus dans ses vengeances, le colonisé tente de se persuader que le colonialisme n'existe pas, que tout se passe comme avant, que l'histoire continue.
Le colonisé réussit également, par l'intermédiaire de la religion, à ne pas tenir compte du colon. Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l'oppresseur, la cause des maux, de la misère, du destin revenant à Dieu. L’individu accepte ainsi la dissolution décidée par Dieu, s'aplatit devant le colon et devant le sort et, par une sorte de rééquilibration intérieure, accède à une sérénité de pierre. Entre-temps, la vie continue, et c'est à travers les mythes terrifiants que le colonisé va puiser des inhibitions à son agressivité : génies malfaisants qui interviennent chaque fois que l'on bouge de travers, hommes-léopards, hommes-serpents, chiens à six pattes, zombies, toute une gamme inépuisable d'animalcules ou de géants dispose autour du colonisé un monde de prohibitions, de barrages, d'inhibitions beaucoup plus terrifiant que le monde colonialiste. Il faut réfléchir à trois fois avant d'uriner, de cracher ou de sortir dans la nuit. Dans la lutte de libération, le colonisé coincé dans ces deux aspects (colonisation et métaphysique) se perd, se disloque, se réorganise et enfante dans le sang et les larmes des confrontations très réelles et très immédiates. Les hommes et les femmes colonisés se plongent dans les rites magiques qui leur donne une certaine tranquillité. Mais au cours de la lutte de libération, le dos au mur, le couteau sur la gorge ou, pour être plus précis, l'électrode sur les parties génitales, le colonisé va réaliser les limites de ces rites. Après des années d'irréalisme, après tous ces rites religieux, sa mitraillette au poing, il affronte enfin les seules forces qui lui contestaient son être : celles du colonialisme. Le jeune colonisé qui grandit dans une atmosphère de fer et de feu se moque des ancêtres zombies, des chevaux à deux têtes, des morts qui se réveillent.
Les partis politiques nationalistes n'insistent jamais sur la nécessité de l'épreuve de force, parce que leur objectif n'est pas précisément le renversement radical du système. Pacifistes, légalistes, en fait partisans de l'ordre nouveau, ces formations politiques posent crûment à la bourgeoisie colonialiste la question qui leur est essentielle : « Donnez-nous plus de pouvoir. » Sur le problème spécifique de la violence, les élites sont ambiguës. Elles sont violentes dans les paroles et réformistes dans les attitudes. La clientèle des partis nationalistes est une clientèle urbaine. Ces ouvriers, ces instituteurs, ces petits artisans et commerçants qui ont commencé à profiter de la situation coloniale ont des intérêts particuliers. Ce que cette clientèle réclame, c'est l'amélioration de son sort, l'augmentation de ses salaires. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir un grand nombre d'indigènes militer dans les succursales des formations politiques de la métropole. Ces indigènes se battent sur un mot d'ordre abstrait : « Le pouvoir au prolétariat », oubliant que, dans leur région, c'est d'abord sur des mots d'ordre nationalistes qu'il faut mener le combat. Les masses, par contre, n'entendent pas voir augmenter les chances de succès des individus. Il ne s'agit pas pour eux d'entrer en compétition avec le colon. Ils veulent sa place. La paysannerie est laissée systématiquement de côté par la propagande de la plupart des partis nationalistes. Or il est clair que, dans les pays coloniaux, seule la paysannerie est révolutionnaire. Elle n'a rien à perdre et tout à gagner. Le paysan, le déclassé, l'affamé est l'exploité qui découvre le plus vite que la violence, seule, paie. Pour lui, il n'y a pas de compromis, pas de possibilité d'arrangement. La colonisation ou la décolonisation, c'est simplement un rapport de forces.
Au moment de l'explication décisive, la bourgeoisie colonialiste, qui était jusque-là restée calme, entre en action. Elle introduit cette nouvelle notion de la non-violence. Mais si les masses n'écoutent que leur propre voix et commencent les incendies et les attentats, on voit alors les « élites » et les dirigeants des partis bourgeois nationalistes se précipiter vers les colonialistes et leur dire : « C'est très grave ! On ne sait pas comment tout cela va finir, il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis. » Les tenants du système colonial découvrent que les masses risquent de tout détruire (sabotage des ponts, destruction des fermes…) La bourgeoisie nationale de son côté craint d'être balayée par cette formidable bourrasque. Elle ne cesse de dire aux colons : « Nous sommes encore capables d'arrêter le carnage, les masses ont encore confiance en nous, faites vite si vous ne voulez pas tout compromettre. » Un degré de plus, et le dirigeant du parti nationaliste prend ses distances vis-à-vis de cette violence. Il affirme hautement qu'il n'a rien à faire avec ces Mau-Mau, avec ces terroristes, avec ces égorgeurs. Dans le meilleur des cas, il se cantonne dans une position d’intermédiaire. Comme les colons ne veulent pas engager les négociations, lui, il veut bien le faire.
L’attitude classique de l'intellectuel colonisé et des dirigeants des parties nationalistes n'est pas objective. En fait, ils ne sont pas sûrs que cette violence impatiente des masses soit le moyen le plus efficace de défendre leurs propres intérêts. Il y a aussi qu'ils sont convaincus de l'inefficacité des méthodes violentes. Pour eux, aucun doute n'est permis, toute tentative de briser l'oppression coloniale par la force est une conduite de désespoir, une conduite-suicide. C'est que, dans leur cerveau, les tanks des colons et les avions de chasse occupent une place énorme. Quand on leur dit : il faut agir, ils voient des bombes se déverser sur leur tête, des blindés s'avancer le long des chemins, la mitraille, la police... et ils restent assis. Ils partent perdants. Il est vrai que les instruments sont importants dans le domaine de la violence, puisque tout repose en définitive sur la répartition de ces instruments. Mais il se trouve que, dans ce domaine, la libération des territoires coloniaux apporte un éclairage nouveau. Au début de la colonisation, une colonne pouvait occuper des territoires immenses : le Congo, le Nigéria, la Côte-d'Ivoire, etc. Mais aujourd'hui la lutte nationale du colonisé s'insère dans une situation absolument nouvelle. Le capitalisme, dans sa période d'essor, voyait dans les colonies une source de matières premières qui, manufacturées, pouvaient être déversées sur le marché européen. Les colonies sont devenues un marché. La population coloniale est une clientèle qui achète. Dès lors, si la garnison doit être éternellement renforcée, si le commerce se ralentit, c'est la preuve que la solution militaire doit être écartée. La fraction monopoliste de la bourgeoisie métropolitaine ne soutient pas un gouvernement dont la politique est uniquement celle de l'épée. Ce que les industriels et les financiers de la métropole attendent de leur gouvernement, ce n'est pas qu'il décime les peuplades mais qu'il sauvegarde, à l'aide de conventions économiques, leurs « intérêts légitimes ». De plus, le colonisé n'est pas seul face à l'oppresseur. Il y a, bien sûr, l'aide politique et diplomatique des pays et des peuples progressistes. Mais il y a surtout la compétition, la guerre impitoyable que se livrent les groupes financiers. Aujourd'hui on ne mène plus de guerre de répression contre tel sultan rebelle. On est plus élégant, moins sanguinaire, et on décide la liquidation pacifique du régime castriste. On essaie d'étrangler la Guinée, on supprime Mossadegh. Le dirigeant national qui a peur de la violence a donc tort s'il s'imagine que le colonialisme va « tous nous massacrer ».
La bourgeoisie colonialiste est aidée dans son travail de tranquillisation des colonisés par l'inévitable religion. Tous les saints qui ont tendu la deuxième joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu sans tressaillir les crachats et les insultes sont expliqués, donnés en exemple. Les élites des pays colonisés, ces esclaves affranchis, quand ils sont à la tête du mouvement, utilisent l'esclavage de leurs frères pour faire pression sur les colonialistes et les groupes financiers. Ils brandissent la menace d'une mobilisation des masses. Il se trouve évidemment au sein de ces partis politiques, parmi les cadres, des révolutionnaires qui tournent délibérément le dos à la farce de l'indépendance nationale. Mais rapidement leurs interventions, leurs initiatives, leurs mouvements de colère indisposent la machine du parti. Progressivement, ces éléments sont isolés, puis carrément écartés. Dans le même temps, comme s'il y avait concomitance dialectique, la police colonialiste va leur tomber dessus. Sans sécurité dans les villes, évités par les militants, rejetés par les autorités du parti, ces indésirables au regard incendiaire vont échouer dans les campagnes. Les masses paysannes leur posent la question dont ils n'ont pas préparé la réponse : « On entre en action quand ? »
Néanmoins, les actions des élites politiques bourgeoises portent quelques résultats. Dans leurs discours, ils « nomment » la nation. Les revendications du colonisé reçoivent ainsi une forme. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de programme politique et social. Il y a une forme vague mais néanmoins nationale, un cadre, ce que nous appelons l'exigence minimum. Les hommes politiques qui prennent la parole, qui écrivent dans les journaux nationalistes, font rêver le peuple. Quelquefois encore ces hommes politiques disent : « Nous les Nègres, nous les Arabes », et cette appellation reçoit une sorte de sacralisation. Lors des meetings, entendre des discours, voir le peuple réuni, les policiers autour, les démonstrations militaires, les arrestations, les déportations de leaders, tout ce remue-ménage donne au peuple l’impression que le moment est venu, pour lui, de faire quelque chose. Le peuple utilise pour se maintenir en forme, pour entretenir sa capacité révolutionnaire, certains épisodes de la vie de la collectivité. Le bandit, par exemple, qui tient la campagne pendant des journées face aux gendarmes lancés à ses trousses, celui qui, dans un combat singulier, succombe après avoir abattu quatre ou cinq policiers, celui qui se suicide pour ne pas « donner » ses complices constituent pour le peuple des phares, des schèmes d’actions, des « héros ». Les grandes figures du peuple colonisé sont toujours celles qui ont dirigé la résistance nationale à l'invasion. Béhanzin, Samory, Abdel Kader revivent avec une particulière intensité dans la période qui précède l'action. C’est la preuve que le peuple s’apprête à se remettre en marche, à interrompre le temps mort introduit par le colonialisme, à faire l’Histoire. Le peuple s’informe et apprends des violences qui ont réussies. La grande victoire du peuple vietnamien à Dien-Bien-Phu n’est plus, à strictement parler, une victoire vietnamienne. Tous les peuples colonisés se reconnaissent dans cette victoire et veulent reproduire Dien-Bien-Phu chez eux. Les colonialistes aussi prennent conscience de Dien-Bien-Phu. C’est pourquoi une véritable panique s’empare des gouvernements colonialistes. Leur propos est de prendre les devants, de tourner à droite le mouvement de libération, de désarmer le peuple : vite, décolonisons. Décolonisons le Congo avant qu’il ne se transforme en Algérie. Votons la loi-cadre pour l’Afrique, créons la Communauté, rénovons cette communauté mais, décolonisons, décolonisons... On décolonise à une telle allure qu’on impose l’indépendance à Houphouët Boigny. À la stratégie du Dien-Bien-Phu, définie et mené par le colonisé, le colonialiste répond par la stratégie de l’encadrement des leaders à qui elle veut céder cette l’indépendance.
En dépit des métamorphoses que le régime colonial lui impose dans les luttes tribales ou régionalistes, la violence s’achemine, le colonisé identifie son ennemi, met un nom sur tous ses malheurs et jette dans cette nouvelle voie toute la force exacerbée de sa haine et de sa colère. Mais tout ceci n’est qu’une atmosphère de violence. Pour passer à la violence en action, plusieurs faits se multiplient. Le colon qui connaît les indigènes s’aperçoit à plusieurs indices que quelque chose est en train de changer. Les bons indigènes se font rares, les silences s’étendent à l’approche de l’oppresseur. Quelquefois les regards se font durs, les attitudes et les propos carrément agressifs. Les partis nationalistes s’agitent, multiplient les meetings et, dans le même temps, les forces de police sont augmentées, des renforts de troupe arrivent. Les autorités prennent des mesures spectaculaires, arrêtent un ou deux leaders, organisent des défilés militaires, des manœuvres, des vols aériens. Mais toutes ses manœuvres ne font pas reculer le peuple. Une atmosphère de drame s’installe, où chacun veut prouver qu’il est prêt à tout. La peur s’est installée. Un moindre incident peut dégénérer. Les premiers heurts éclatent. Les répressions, loin de briser l’élan, scandent les progrès de la conscience nationale. Aux colonies, les hécatombes, à partir d’un certain stade de développement embryonnaire de la conscience, renforcent cette conscience, car elles indiquent qu’entre oppresseurs et opprimés tout se résout par la force. Il faut signaler ici que les partis politiques n’ont pas lancé le mot d'ordre de l’insurrection armée, n’ont pas préparé cette insurrection. Les événements les prennent de court. C’est alors que le colonialisme peut décider d’arrêter les leaders nationalistes. Les masses donnent libre cours à leurs « instincts sanguinaires» et imposent au colonialisme la libération des leaders, auxquels reviendra la tâche difficile de ramener le calme. Alors le colonialisme libérera ces hommes et discutera avec eux. Mais les masses n’écoutent pas leurs appels au calme. La situation se détériore et pourrit. Les dirigeants en liberté restent alors sur la touche. Malgré cela, ils tentent de parler au nom de la nation. Le colonialisme se jette avec avidité sur cette aubaine, transforme ces inutiles en interlocuteurs et peut arriver à faire d’eux l'expression authentique des masses colonisées. Dans un autre cas, le colonialisme va profiter de la détention des leaders pour lancer de nouveaux leaders. Pour arriver à surpasser leurs craintes et prendre des armes contre un oppresseur qu’ils savent supérieur à eux, il faut plusieurs raisons aux colonisés. Ils savent que seule cette folie peut les soustraire à l’oppression coloniale. Un nouveau type de rapports s’est établi dans le monde. Aucun pays colonialiste n’est aujourd’hui capable d’adopter la seule forme de lutte qui aurait une chance de réussir: l’implantation prolongée de forces d’occupation importantes. Sur le plan intérieur, les pays colonialistes se trouvent confrontés à des contradictions, à des revendications ouvrières qui exigent l’emploi de leurs forces policières. De plus, dans la conjoncture internationale actuelle, ces pays ont besoin de leurs troupes pour protéger leur régime. Enfin l’on connaît le mythe des mouvements de libération dirigés de Moscou.
Dans l’impatience du colonisé, le fait qu’il brandisse à bout de bras la menace de la violence prouve qu’il est conscient du caractère exceptionnel de la situation contemporaine et qu'il entend en profiter. Chaque meeting, chaque acte de répression retentit dans l’arène internationale. Les peuples colonisés se rendent compte qu’aucun clan ne se désintéresse des incidents locaux. Ils cessent de se limiter à leurs horizons régionaux, comprennent qu’ils sont dans cette atmosphère de secousse universelle. Lorsque Khrouchtchev menace de sauver Castro à coups de fusées, lorsque Kennedy, à propos du Laos, décide d’envisager les solutions extrêmes, le colonisé ou le nouvel indépendant a l’impression que, bon gré, mal gré, il est entraîné dans une sorte de marche effrénée. En fait, il marche déjà. Les hommes au pouvoir dans les pays nouvellement libérés passent les deux tiers de leur temps à surveiller les alentours, à prévenir le danger qui les menaces. En même temps, ils se cherchent des appuis. Les oppositions nationales à leur tour cherchent des alliés qui acceptent de les soutenir dans leur entreprise brutale de sédition. L’atmosphère de violence, après avoir imprégné la phase coloniale, continue dans la vie nationale. Le tiers monde n’est pas exclu. Bien au contraire, il est au centre de la tourmente. C'est pourquoi, dans leurs discours, les hommes d’État des pays sous-développés maintiennent indéfiniment le ton d’agressivité et d’exaspération qui aurait dû normalement disparaître. C’est que ces porte-parole sont chargés par leurs peuples de défendre à la fois l’unité de la nation, le progrès des masses vers le bien-être et le droit des peuples à la liberté et au pain. C’est donc une diplomatie en mouvement, en furie, qui contraste étrangement avec le monde immobile, pétrifié, de la colonisation. Quand M. Khrouchtchev brandit son soulier à l’ONU et en martèle la table, aucun colonisé, aucun représentant des pays sous-développés ne rit. Car ce que M. Khrouchtchev montre aux pays colonisés qui le regardent c’est que lui, qui possède des fusées, traite ces misérables capitalistes comme ils le méritent. De même, Castro siégeant en tenue militaire à l'ONU ne scandalise pas les pays sous-développés. Ce que montre Castro, c'est la conscience que la violence n’a pas pris fin. Et tous les dirigeants du tiers monde le savent. En 1945, les 45 000 morts de Sétif pouvaient passer inaperçus ; en 1947, les 90 000 morts de Madagascar pouvaient faire l’objet d’un simple entrefilet dans les journaux ; en 1952, les 200 000 victimes de la répression au Kenya pouvaient rencontrer une indifférence relative. C’est que les contradictions internationales n’étaient pas suffisamment tranchées. Déjà la guerre de Corée et la guerre d’Indochine avaient inauguré une nouvelle phase. Mais c’est surtout Budapest et Suez qui constituent les moments décisifs de cette confrontation. Forts du soutien inconditionnel des pays socialistes, les colonisés se lancent avec les armes qu’ils ont contre la citadelle du colonialisme. Si cette citadelle est invulnérable aux couteaux et aux poings nus, elle ne l’est plus quand on décide de tenir compte du contexte de la guerre froide. Dans cette conjoncture nouvelle, les Américains prennent très au sérieux leur rôle de patron du capitalisme international. Dans un premier temps, ils conseillent aux pays européens de décoloniser à l’amiable. Dans un deuxième temps, ils n’hésitent pas à proclamer d’abord le respect puis le soutien du principe : l’Afrique aux Africains. En fait, la violence du colonisé n’est désespérée que si on la compare à la machine militaire des oppresseurs. Par contre, si on la situe dans la dynamique internationale, on s’aperçoit qu’elle constitue une terrible menace pour l’oppresseur. Pour lui, ce qu’il faut éviter avant tout, c’est l’insécurité stratégique, l’ouverture des masses sur une doctrine ennemie, la haine radicale de dizaines de millions d’hommes. Les peuples colonisés sont parfaitement conscients de ces impératifs qui dominent la vie politique internationale. C’est pourquoi même ceux qui tonnent contre la violence décident et agissent toujours en fonction de cette violence planétaire.
L’indépendance a certes apporté aux hommes colonisés la réparation morale et consacré leur dignité. Mais ils n’ont pas encore eu le temps d’élaborer une société, de construire et d’affirmer des valeurs. Quant aux dirigeants, face à cette conjoncture, ils hésitent et choisissent le neutralisme. Or, le neutralisme, cette création de la guerre froide s’il permet aux pays sous-développés de recevoir l’aide économique des deux parties, ne permet pas, en fait, à chacune de ces deux parties de venir en aide comme il le faudrait aux régions sous-développées. Ces leaders de pays vides, qui parlent fort, irritent. On a envie de les faire taire. Mais, on les courtise. On leur offre des fleurs. On les invite. Disons-le, on se les arrache. Cela, c’est du neutralisme. Illettrés à 98%, il existe cependant à leur propos une littérature colossale. Ils voyagent énormément. Les responsables africains et asiens ont la possibilité, dans le même mois, de suivre un enseignement sur la planification socialiste à Moscou et sur les bienfaits de l'économie libérale à Londres ou à Columbia University. Les syndicalistes africains, pour leur part, progressent à une cadence accélérée. À peine leur confie-t-on des postes dans les organismes de direction qu’ils décident de se constituer en centrales autonomes. Ils n’ont pas ces cinquante ans de pratique syndicale passés dans le cadre d’un pays industrialisé, mais ils savent déjà que le syndicalisme apolitique est un non-sens. Ils n’ont pas affronté la machine bourgeoise, ils n’ont pas développé leur conscience dans la lutte des classes, mais peut-être n’est-ce pas nécessaire. Peut-être.
L’existence de la lutte armée indique que le peuple décide de ne faire confiance qu’aux moyens violents. Le régime colonial tire sa légitimité de la force et à aucun moment n’essaie de ruser avec cette nature des choses. Chaque statue, celle de Faidherbe ou de Lyautey, de Bugeaud ou du sergent Blandan, tous ces conquistadors juchés sur le sol colonial n’arrêtent pas de signifier une seule et même chose : «Nous sommes ici par la force des baïonnettes... » Pour le colonisé, la violence représente la praxis absolue. Dans la guerre, le militant est donc celui qui est violent, celui qui doit poser un acte irréversible. Travailler en régime colonial, c’est travailler à la mort du colon.
Dès lors que le colonisé choisit la contre-violence, les représailles policières et des forces de défenses nationales ne tardent pas. Les mitraillages par avion ou les canonnades se font régulières. Cette violence dépasse celle du colonisé et démystifie définitivement les plus aliénés des colonisés. Le colonisé, quand on le torture, qu’on lui tue sa femme ou qu’on la viole, ne va se plaindre à personne. Le gouvernement colonial qui opprime pourra bien nommer chaque jour des commissions d’enquête et d’information. Aux yeux du colonisé, ces commissions n’existent pas. Le travail du colon est de rendre impossible jusqu’aux rêves la liberté du colonisé. Le peuple colonisé, après chacun des assassinats orchestrés par le colon, structure davantage sa prise de conscience et solidifie sa résistance. C’est pourquoi, au début des hostilités, il n’y a pas de prisonniers. C’est seulement par la politisation des cadres que les dirigeants arrivent à faire admettre aux masses : 1) que les gens qui viennent de la métropole ne sont pas toujours des ennemis et que certains sont écœurés par la guerre que livre leur pays; 2) que la lutte doit se dérouler dans le respect de certaines conventions internationales ; 3) qu’une armée qui fait des prisonniers est une armée, et cesse d’être considérée comme un groupe d’écumeurs de routes; 4) que la possession des prisonniers constitue un moyen de pression non négligeable pour protéger les militants détenus par l’ennemi.
Pour le colonisé, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. La lutte armée mobilise le peuple, c’est-à-dire qu’elle le jette dans une seule direction, à sens unique. La mobilisation des masses, quand elle se réalise à l’occasion de la guerre de libération, introduit dans chaque conscience la notion de cause commune, de destin national, d’histoire collective. Aussi la construction de la nation se trouve facilitée par l’existence de ce mortier travaillé dans le sang et la colère. La violence du colonisé unifie le peuple. Le colonialisme est séparatiste et régionaliste. Avec l’avancée de la lutte, le colonialisme renforce les tribus et les différencie. Il alimente les chefferies et réactive les vieilles confréries maraboutiques. La lutte du colonisé de son côté vise la liquidation du régionalisme et du tribalisme. C’est pourquoi les partis nationalistes se montrent particulièrement impitoyables avec les caïds et les chefs coutumiers. Leur liquidation est un préalable à l’unification du peuple.
Au niveau des individus, la violence désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe d’infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. Il a le temps de se convaincre que la libération est l’affaire de tous et de chacun, que le leader n’a pas de mérite spécial. La violence hisse le peuple à la hauteur du leader. Quand elles ont participé, dans la violence, à la libération nationale, les masses ne permettent à personne de se présenter en « libérateur ». Elles se montrent jalouses du résultat de leur action et se gardent de remettre à un dieu vivant leur avenir, leur destin, le sort de la patrie. Totalement irresponsables hier, elles entendent aujourd’hui tout comprendre et décider de tout. Illuminée par la violence, la conscience du peuple se rebelle contre toute pacification. Les démagogues, les opportunistes et les magiciens ont désormais la tâche difficile.
La jeune nation indépendante évolue pendant les premières années dans une atmosphère de champ de bataille. Le dirigeant politique mesure avec effroi le chemin immense que doit franchir son pays. Il en appelle au peuple et lui dit : « Ceignons-nous les reins et travaillons. » Le pays, tenacement saisi par une sorte de folie créatrice, se jette dans un effort gigantesque et disproportionné. Le programme est non seulement de s’en sortir, mais de rattraper les autres nations avec les moyens de bord. Si les peuples européens, pense-t-on, sont parvenus à ce stade de développement, c’est à la suite de leurs efforts. Prouvons donc au monde et à nous-mêmes que nous sommes capables des mêmes réalisations. En réalité le bien-être et le progrès de l’Europe ont été bâtis avec la sueur et les cadavres des nègres, des Arabes, des Indiens et des Jaunes. La situation est encore plus difficile pour les pays indépendants dirigés par les nationalistes. Le colonialisme retire ses capitaux et ses techniciens et met autour du jeune État un dispositif de pression économique. L'apothéose de l'indépendance se transforme en malédiction de l’indépendance. La puissance coloniale multiplie des actions pour empêcher tout progrès de la jeune nation et la condamne à la régression. Les dirigeants nationalistes n’ont alors d’autre ressource que de se tourner vers leur peuple et leur demander de travailler. Après la prise de pouvoir de Fidel Castro à Cuba, les États-Unis organisent des brigades contre-révolutionnaires, fabriquent un gouvernement provisoire, incendient les récoltes de canne, décident enfin d’étrangler impitoyablement le peuple cubain. Le peuple cubain souffrira mais il vaincra. D’autres pays du tiers monde refusent cette épreuve difficile et acceptent les conditions dictées par l’ancienne puissance colonisatrice. L’ancien pays dominé se transforme en pays économiquement dépendant. L’ex puissance coloniale qui a maintenu intacts, et quelquefois renforcés, des circuits commerciaux de type colonialiste accepte par petites injections d’alimenter le budget de la nation indépendante.
Les pays sous-développés doivent s’efforcer de mettre au jour des valeurs qui leur soient propres, des méthodes et un style qui leur soient spécifiques. Le problème concret devant lequel nous nous trouvons n’est pas celui du choix coûte que coûte entre le socialisme et le capitalisme tels qu’ils ont été définis par des hommes de continents et d’époques différents. Nous savons, certes, que le régime capitaliste ne peut pas en tant que mode de vie nous permettre de réaliser notre tâche nationale et universelle. L’exploitation capitaliste, les trusts et les monopoles sont les ennemis des pays sous-développés. Par contre le choix d’un régime socialiste, d’un régime tout entier tourné vers l’ensemble du peuple, basé sur le principe que l’homme est le bien le plus précieux, nous permettra d’aller plus vite, plus harmonieusement, rendant de ce fait impossible cette caricature de société où quelques-uns détiennent l’ensemble des pouvoirs économiques et politiques au mépris de la totalité nationale. Mais pour que ce régime puisse valablement fonctionner, que nous puissions à tout instant respecter les principes dont nous nous inspirons, il nous faut autre chose que l’investissement humain. Certains pays sous-développés déploient dans cette direction un effort colossal. Hommes et femmes, jeunes et vieux, dans l’enthousiasme, s’engagent dans un véritable travail forcé et se proclament esclaves de la nation. Le don de soi, le mépris de toute préoccupation qui ne soit pas collective font exister une morale nationale qui réconforte l’homme, lui redonne confiance dans le destin du monde et désarme les observateurs les plus réticents. Nous croyons cependant qu’un tel effort ne pourra se poursuivre longtemps à ce rythme infernal. Après le départ du colon, le pays se retrouve entre les mains d’une nouvelle équipe. Il faut tout reprendre, tout repenser. Le système colonial s’intéressait à certaines richesses, à certaines ressources, précisément celles qui alimentaient ses industries. Aucun bilan sérieux n’avait été fait jusqu'à présent du sol ou du sous-sol. Il faudrait tout recommencer, changer la nature des exportations et non pas seulement leur destination, réinterroger le sol, le sous-sol, les rivières et pourquoi pas le soleil. Or, pour ce faire il faut autre chose que l’investissement humain. Il faut des capitaux, des techniciens, des ingénieurs, des mécaniciens, etc.
Les impérialistes et les colonialistes ont volé de nombreuses richesses aux colonies. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. Cela ne veut absolument pas signifier que nous nous sentons concernés par les créations de la technique ou des arts occidentaux. Très concrètement l’Europe s’est enflée de façon démesurée de l’or et des matières premières des pays coloniaux : Amérique latine, Chine, Afrique. De tous ces continents, en face desquels l’Europe aujourd’hui dresse sa tour opulente, partent depuis des siècles en direction de cette même Europe les diamants et le pétrole, la soie et le coton, les bois et les produits exotiques. L’Europe est littéralement la création du tiers monde. Les richesses qui l’étouffent sont celles qui ont été volées aux peuples sous-développés. Les ports de la Hollande, Liverpool, les docks de Bordeaux et de Liverpool spécialisés dans la traite des nègres doivent leur renommée aux millions d’esclaves déportés. Quand un chef d’État européen déclare venir en aide aux peuples sous-développés, il s’agit juste de réparation qui va nous être faite. Si les pays capitalistes refusent de payer, alors la dialectique implacable de leur propre système se chargerait de les asphyxier.
Les compagnies privées, pour investir dans les pays indépendants, exigent des conditions qui se révèlent inacceptables ou irréalisables. Fidèles au principe de rentabilité immédiate qui est le leur dès qu’ils vont « outre-mer », les capitalistes se montrent réticents à l’égard de tout investissement à long terme. Ils sont rebelles et souvent ouvertement hostiles aux prétendus programmes de planification des jeunes équipes au pouvoir. À la rigueur ils accepteraient volontiers de prêter de l’argent aux jeunes États mais à la condition que cet argent serve à acheter des produits manufacturés, des machines, donc à faire tourner les usines de la métropole. Ils exigent une stabilité politique qu’il est impossible d’obtenir si l’on tient compte de la situation lamentable de la population globale au lendemain de l’indépendance.
II
GRANDEUR ET FAIBLESSES DE LA SPONTANÉITÉ
Dans toute organisation politique ou syndicale il existe un fossé entre les masses qui exigent l’amélioration immédiate et totale de leur situation et les cadres qui, mesurant les difficultés susceptibles d’être créées par le patronat, limitent et restreignent leurs revendications. C’est pourquoi on constate souvent un mécontentement tenace des masses vis-à-vis des cadres. Après chaque journée de revendication, alors que les cadres célèbrent la victoire, les masses ont bel et bien l’impression d’avoir été trahies. La grande erreur de la majorité des partis politiques dans les régions sous-développées a été de s’adresser en priorité aux éléments les plus conscients : le prolétariat des villes, les artisans et les fonctionnaires, c’est-à-dire une infime partie de la population qui ne représente guère plus d’un pour cent. Or si ce prolétariat comprend la propagande du parti et lit sa littérature il est beaucoup moins préparé à répondre aux éventuels mots d’ordre de lutte implacable pour la libération nationale. Dans les territoires coloniaux, le prolétariat est le noyau du peuple colonisé le plus choyé par le régime colonial. Contrairement au prolétariat des pays industrialisés, le prolétariat des colonies a tout à perdre dans la lutte. Il représente la fraction du peuple colonisé nécessaire et irremplaçable pour la bonne marche de la machine coloniale : conducteurs de tramways, de taxis, mineurs, dockers, interprètes, infirmiers, etc. Ce sont ces éléments qui constituent la clientèle la plus fidèle des partis nationalistes et qui par la place privilégiée qu’ils occupent dans le système colonial constituent la fraction « bourgeoise » du peuple colonisé.
Les partis nationalistes, dans leur immense majorité, éprouvent une grande méfiance à l’égard des masses rurales. Assez rapidement les membres des partis nationalistes (ouvriers des villes et intellectuels) en arrivent à porter sur les campagnes le même jugement péjoratif que les colons. Encadrées par les marabouts, les sorciers et les chefs coutumiers, les masses rurales vivent encore au stade féodal. La jeune bourgeoisie nationale, commerçante surtout, va entrer en compétition avec ces seigneurs féodaux dans des secteurs multiples : marabouts et sorciers qui barrent la route aux malades qui pourraient consulter le médecin, djemaas qui jugent, rendant inutiles les avocats, caïds qui utilisent leur puissance politique et administrative pour lancer un commerce ou une ligne de transports, chefs coutumiers s’opposant au nom de la religion et de la tradition à l’introduction de négoces et de produits nouveaux. La jeune classe de commerçants et de négociants colonisés a besoin de la disparition de ces prohibitions et de ces barrières pour se développer. La clientèle indigène qui représente la chasse gardée des féodaux et qui se voit plus ou moins interdire l’achat de produits nouveaux constitue donc un marché que l’on se dispute. Chaque fois que les élites politiques font un effort en direction des masses rurales, les chefs de tribus, les chefs de confréries, les autorités traditionnelles multiplient les mises en garde, les menaces, les excommunications. Ces autorités traditionnelles qui ont été confirmées par la puissance occupante voient sans plaisir se développer les tentatives d’infiltration des élites dans les campagnes. Elles savent que les idées susceptibles d’être introduites par ces éléments venus des villes contestent le principe même de la pérennité des féodalités. Leur ennemi n’est donc pas la puissance occupante avec qui elles font bon ménage, mais les leaders nationalistes qui entendent désarticuler la société autochtone et par là même leur enlever le pain de la bouche. Le paysan qui reste en campagne défend avec ténacité ses traditions. Les masses rurales demeurent généralement disciplinées, altruistes. L’individu s’efface devant la communauté. Les paysans de leur côté ont une méfiance à l’égard de l’homme de la ville. Habillé comme l’Européen, parlant sa langue, travaillant avec lui, habitant parfois dans son quartier, il est considéré par les paysans comme un transfuge qui a abandonné tout ce qui constitue le patrimoine national. Les colonialistes utilisent cette opposition dans leur lutte contre les partis nationalistes. Ils mobilisent les montagnards contre les gens de la ville.
Les partis politiques n’arrivent pas à implanter leur organisation dans les campagnes. Au lieu d’utiliser les structures existantes pour leur donner un contenu nationaliste ou progressiste ils entendent, dans le cadre du système colonial, bouleverser la réalité traditionnelle. Ils s’imaginent pouvoir faire démarrer la nation alors que les mailles du système colonial sont encore pesantes. Ils ne vont pas à la rencontre des masses. Ils ne mettent pas leurs connaissances théoriques au service du peuple mais ils tentent d’encadrer les masses selon un schéma a priori. De la capitale, ils parachutent dans les villages des dirigeants inconnus ou trop jeunes. Les chefs traditionnels sont ignorés, quelquefois brimés. Les vieux, entourés de respect dans les sociétés traditionnelles et généralement revêtus d’une autorité morale indiscutable, sont publiquement ridiculisés. Après le triomphe de la lutte de libération nationale, les mêmes erreurs se renouvellent, alimentant les tendances décentralisatrices et autonomistes. Mais il se trouve que les masses rurales, malgré le peu d’emprise que les partis nationalistes ont sur elles, interviennent de manière décisive soit dans le processus de maturation de la conscience nationale, soit pour relayer l’action des partis nationalistes, soit plus rarement pour se substituer purement et simplement à la stérilité de ces partis. La propagande des partis nationalistes trouve toujours un écho au sein des masses paysannes. Le souvenir de la période anticoloniale demeure vivace dans les villages. Les femmes murmurent encore à l’oreille des enfants les chants qui ont accompagné les guerriers résistant à la conquête. À 12, 13 ans les petits villageois connaissent le nom des vieillards qui ont assisté à la dernière insurrection. Quelquefois les paysans prennent le relais de l’agitation urbaine, le parti nationaliste dans les villes étant l’objet de la répression policière. Les nouvelles parviennent aux campagnes démesurément amplifiées : leaders arrêtés, mitraillages multiples, le sang nègre inonde la ville, les petits colons se baignent dans le sang arabe. Alors la haine accumulée, la haine exacerbée éclate. Le poste de police avoisinant est investi, les gendarmes sont déchiquetés, l’instituteur est massacré, le médecin n’a la vie sauve que parce qu’il était absent, etc. Des colonnes de pacification sont dépêchées sur les lieux, l’aviation bombarde. L’étendard de la révolte est alors déployé, les vieilles traditions guerrières resurgissent, les femmes applaudissent, les hommes s’organisent et prennent position dans les montagnes, la guérilla commence. Spontanément les paysans créent l’insécurité généralisée, le colonialisme prend peur, s’installe dans la guerre ou négocie.
Les partis nationalistes ne s’opposent pas à la persistance de l’insurrection, mais ils se contentent de faire confiance à la spontanéité des ruraux. Ils se comportent à l’égard de cet élément nouveau comme s'il s’agissait d’une manne tombée du ciel, priant le sort que ça continue. Ils exploitent cette manne mais ne tentent pas d’organiser l’insurrection. Ils n’envoient pas dans les campagnes des cadres pour politiser les masses, pour éclairer les consciences, pour élever le niveau du combat. Ils espèrent que l’action de ces masses ne se ralentira pas. Il n’y a pas contamination du mouvement rural par le mouvement urbain. Chacun évolue selon sa dialectique propre. Les partis nationalistes ne tentent pas d’introduire dans les masses rurales, qui sont à ce moment entièrement disponibles, des mots d’ordre. Ils ne leur proposent pas d’objectif, ils espèrent simplement que ce mouvement se perpétuera indéfiniment et que les bombardements n’en viendront pas à bout. Ils n’exploitent pas la possibilité qui leur est offerte d’intégrer les masses rurales, de les politiser, d’élever le niveau de leur lutte. Ils maintiennent la position criminelle de méfiance vis-à-vis des campagnes. Les cadres politiques se terrent dans les villes, font comprendre au colonialisme qu’ils n’ont pas de rapport avec les insurgés ou partent à l’étranger.
En régime colonial, le colonialisme tente quelquefois de diversifier, de disloquer la poussée nationaliste. Au lieu de dresser les cheiks et les chefs contre les « révolutionnaires » des villes, les bureaux indigènes organisent les tribus et les confréries en partis. Face au parti urbain qui commençait à « incarner la volonté nationale » et à constituer un danger pour le régime colonial, des groupuscules prennent naissance, des tendances, des partis à base ethnique ou régionaliste surgissent. C’est la tribu dans son intégralité qui se mue en parti politique conseillé de près par les colonialistes. Le parti unitaire sera noyé dans l’arithmétique des tendances. A l’indépendance, parmi les deux ou trois partis nationalistes qui ont mené la lutte de libération, l’occupant fait son choix. Les modalités de ce choix sont classiques : lorsqu’un parti a fait l’unanimité nationale et s’est imposé à l’occupant comme seul interlocuteur, l’occupant multiplie les manœuvres et retarde au maximum l’heure des négociations. Ce retard sera utilisé pour émietter les exigences de ce parti ou à obtenir de la direction la mise à l’écart de certains éléments « extrémistes ». Si, par contre, aucun parti ne s’est véritablement imposé, l’occupant se contente de privilégier celui qui lui paraît le plus « raisonnable ». Les partis nationalistes qui n’ont pas participé aux négociations se lancent alors dans une dénonciation de l’accord intervenu entre l’autre parti et l’occupant. Le parti qui reçoit le pouvoir de l’occupant, conscient du danger que représente son parti rival, tente de le démanteler et le condamne à l’illégalité. Le parti persécuté n’a d’autre ressource que de se réfugier à la périphérie des villes et dans les campagnes. Il essaie de soulever les masses rurales contre les « vendus de la côte et les corrompus de la capitale ». Tous les prétextes sont alors utilisés. On exploite la tendance obscurantiste des masses rurales. On murmure çà et là que la montagne bouge, que les campagnes sont mécontentes. On affirme que dans tel coin la gendarmerie a ouvert le feu sur des paysans, que des renforts ont été envoyés, que le régime est près de s’écrouler. Les partis d’opposition, sans programme clair, n’ayant d’autre but que de se substituer à l’équipe dirigeante, remettent leur destin entre les mains spontanées et obscures des masses paysannes. Inversement, il arrive que l’opposition ne s’appuie plus sur les masses rurales mais sur les éléments progressistes, les syndicats de la jeune nation. Dans ce cas, le gouvernement fait appel aux masses rurales pour résister aux revendications des travailleurs, dénoncées alors comme manœuvres d’aventuriers anti traditionalistes.
Les syndicats s’aperçoivent au lendemain de l’indépendance que les revendications sociales si elles étaient exprimées scandaliseraient le reste de la nation. Les ouvriers sont en effet les favorisés du régime. Ils représentent la fraction la plus aisée du peuple. Une agitation qui se proposerait d’arracher l’amélioration des conditions de vie pour les ouvriers serait non seulement impopulaire, mais risquerait encore de provoquer l’hostilité des masses déshéritées des campagnes. Les syndicats, à qui tout syndicalisme est interdit, piétinent sur place. Ce malaise traduit la nécessité objective d’un programme social intéressant à l’ensemble de la nation. Les syndicats découvrent que l’arrière-pays doit être également éclairé et organisé. Mais, parce qu’à aucun moment ils ne se sont préoccupés de mettre en place des courroies de transmission entre eux et les masses paysannes, et comme précisément ces masses constituent les seules forces spontanément révolutionnaires du pays, les syndicats vont faire la preuve de leur inefficacité et découvrir le caractère anachronique de leur programme. Les dirigeants syndicaux, plongés dans l’agitation politico-ouvriériste, en arrivent mécaniquement à la préparation d’un coup d’État. La bourgeoisie nationale, reprenant les vieilles traditions du colonialisme, montre ses forces militaires et policières, tandis que les syndicats organisent des meetings, mobilisent des dizaines de milliers d’adhérents. Les paysans, face à cette bourgeoisie nationale et à ces ouvriers qui, somme toute, mangent à leur faim, regardent en haussant les épaules car ils se rendent compte que les uns et les autres les considèrent comme une force d’appoint. Les syndicats, les partis ou le gouvernement, dans une sorte de machiavélisme immoral, utilisent les masses paysannes comme force de manœuvre inerte, aveugle.
Au sein des partis nationalistes, deux processus vont quelquefois se produire. D’abord, des éléments intellectuels ayant procédé à une analyse soutenue de la réalité coloniale et de la situation internationale commenceront à critiquer le vide idéologique du parti national et son indigence tactique et stratégique. Ils exigent que les problèmes méthodologiques soient abordés avec vigueur. Aux premières divergences, ces éléments révolutionnaires vont être rapidement isolés. La machine du parti se montre rebelle à toute innovation. La minorité révolutionnaire se retrouve seule, face à une direction apeurée et angoissée à l’idée qu’elle pourrait être emportée dans une tourmente dont elle n’imagine même pas les aspects, la force ou l’orientation. Le deuxième processus a trait aux cadres dirigeants ou subalternes qui, du fait de leurs activités, ont été en butte aux persécutions policières colonialistes. Ces hommes sont arrivés aux sphères dirigeantes du parti par leur travail obstiné, l’esprit de sacrifice et un patriotisme exemplaire. Venus de la base, ils sont souvent de petits manœuvres, des travailleurs saisonniers et même quelquefois d’authentiques chômeurs. Pour eux, militer dans un parti national, ce n’est pas faire de la politique, c’est choisir le seul moyen de passer de l’état animal à l’état humain. Ces hommes vont révéler dans les limites des activités qui leur sont confiées un esprit d’initiative, un courage et un sens de la lutte qui les désignent aux forces de répression du colonialisme. Arrêtés, condamnés, torturés, amnistiés, ils utilisent la période de détention pour confronter leurs idées et à durcir leur détermination. Dans les grèves de la faim, dans la solidarité violente des fosses communes des prisons, ils vivent leur libération comme une occasion qui leur sera donnée de déclencher la lutte armée. Mais une fois dehors, le colonialisme fait des avances aux modérés nationalistes. Ces modérés s’opposent aux leaders libérés, et le parti se scinde en deux tendances. Les nationalistes libérés qui expriment les idées mûries en prison et la nécessité de la lutte armée deviennent des indésirables. On les fuit. Un parti clandestin, latéral au parti légal, se crée au sein même du parti. La répression contre ces éléments irrécupérables s’intensifie à mesure que le parti légal se rapproche du colonialisme.
Rejetés des villes, ces hommes se groupent, dans un premier temps, dans les banlieues périphériques. Mais le filet policier les y déniche et les contraint à quitter définitivement les villes, à fuir les lieux de la lutte politique. Ils se rejettent vers les campagnes, vers les montagnes, vers les masses paysannes. Dans un premier temps, les masses se referment sur eux en les soustrayant à la recherche policière. Le militant nationaliste qui décide, au lieu de jouer à cachecache avec les policiers dans les cités urbaines, de remettre son destin entre les mains des masses paysannes ne perd jamais. Le manteau paysan se referme sur lui avec une tendresse et une vigueur insoupçonnées. Véritables exilés de l'intérieur, coupés du milieu urbain au sein duquel ils avaient précisé les notions de nation et de lutte politique, ces hommes sont devenus en fait des maquisards. Obligés tout le temps de se déplacer pour échapper aux policiers, marchant la nuit pour ne pas attirer l’attention, ils vont avoir l’occasion de parcourir, de connaître leur pays. Oubliés les cafés, les discussions sur les prochaines élections, la méchanceté de tel policier. Leurs oreilles entendent la vraie voix du pays et leurs yeux voient la grande, l’infinie misère du peuple. Ils se rendent compte du temps précieux qui a été perdu en vains commentaires sur le régime colonial. Ils comprennent enfin que le changement ne sera pas une réforme, ne sera pas une amélioration. Ils comprennent, dans une sorte de vertige qui ne cessera plus de les habiter, que l’agitation politique dans les villes sera toujours impuissante à modifier, à bouleverser le régime colonial. Ces hommes prennent l’habitude de parler aux paysans. Ils découvrent que les masses rurales n’ont jamais cessé de poser le problème de leur libération en termes de violence, de terre à reprendre aux étrangers, de lutte nationale, d’insurrection armée. Tout est simple. Ces hommes découvrent un peuple cohérent qui se perpétue dans une sorte d’immobilité mais qui garde intacts ses valeurs morales, son attachement à la nation. Ils découvrent un peuple généreux, prêt au sacrifice, désireux de se donner, impatient et d’une fierté de pierre. Ils se mettent à l’école du peuple et dans le même temps ouvrent, à l’intention du peuple, des cours de formation politique et militaire. Le peuple forge ses armes. En fait, les cours ne durent pas longtemps car les masses, reprenant contact avec l’intimité même de leurs muscles, amènent les dirigeants à brusquer les choses. La lutte armée est déclenchée. L’insurrection désoriente les partis politiques. Secrètement, certains partis politiques partagent l’optimisme des colons et se félicitent d’être en dehors de cette folie dont on dit qu’elle sera réprimée dans le sang. Mais le feu allumé, comme une épidémie galopante, se propage à l’ensemble du pays. Les blindés et les avions ne remportent pas les succès escomptés. Devant l’étendue du mal, le colonialisme commence à réfléchir.
Le peuple colonisé quant à lui, dans ses huttes et dans ses rêves, se met en communication avec le nouveau rythme national. À voix basse, au milieu de son cœur, il chante aux glorieux combattants des hymnes interminables. L’insurrection a déjà envahi la nation. C’est au tour des partis d’être maintenant isolés. Quoique les groupes armés fassent régner l’insécurité dans les campagnes, le colonialisme ne se sent pas fondamentalement en danger. Les dirigeants de l’insurrection décident donc de porter la guerre en ville chez l’ennemi, c’est-à-dire dans les cités tranquilles et grandiloquentes. L’installation de l’insurrection dans les cités pose à la direction des problèmes difficiles. Etant des anciens membres du parti politique en ville avant d’être devenu des maquisards suite à leur traque par la police, les dirigeants de l’insurrection se dirigent d’abord vers leurs anciens camarades du parti en ville pour y porter le combat. Mais ils sont déçus. Ils vont trouver autre solution. L’insurrection va pénétrer dans les villes par la fraction de la paysannerie bloquée à la périphérie urbaine, celle qui n’a pu trouver un os à ronger dans le système colonial. C’est dans cette masse, c’est dans ce peuple des bidonvilles, ce lumpen-prolétariat que l’insurrection va trouver son fer de lance urbain. Elle constitue l’une des forces les plus spontanément et les plus radicalement révolutionnaires d’un peuple colonisé. Elle force la citadelle urbaine où elle a été exclue. Les souteneurs, les voyous, les chômeurs, les droit commun, sollicités, se jettent dans la lutte de libération comme de robustes travailleurs. Ces désœuvrés, ces déclassés vont, par le canal de l’action militante et décisive retrouver le chemin de la nation. Les prostituées elles aussi, les désespérées, tous ceux et toutes celles qui évoluent entre la folie et le suicide vont se rééquilibrer, se mettre en marche et participer de façon décisive à la grande procession de la nation réveillée.
Les partis nationalistes ne comprennent pas ce phénomène nouveau qui précipite leur désagrégation. L’irruption de l’insurrection dans les villes modifie la physionomie de la lutte. Alors que les troupes colonialistes étaient toutes entières tournées vers les campagnes, les voici qui refluent précipitamment vers les villes pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La répression disperse ses forces, le danger est partout présent. C’est le sol national, c’est l’ensemble de la colonie qui entre en transe. Les groupes armés paysans assistent au desserrement de l’étreinte militaire. L’insurrection dans les villes est un ballon d’oxygène inespéré. Les dirigeants de l’insurrection, qui voient le peuple enthousiaste et ardent de porter des coups décisifs à la machine colonialiste, renforcent leur méfiance à l’égard de la politique traditionnelle. Chaque succès remporté légitime leur hostilité à l’égard de ce que désormais ils appellent le gargarisme, le verbalisme, la « blagologie », l’agitation stérile. Ils ressentent une haine de la « politique », de la démagogie. C’est pourquoi au début de la lutte nous assistons à un véritable triomphe du culte de la spontanéité. Chaque colonisé en arme est un morceau de la nation désormais vivante. Les jacqueries des colonisés obéissent à une doctrine simple : faites que la nation existe. Il n’y a pas de programme, il n’y a pas de discours, il n’y a pas de résolutions, il n’y a pas de tendances. Le problème est clair : il faut que les étrangers partent. Constituons un front commun contre l’oppresseur et renforçons ce front par la lutte armée. Dans cette période, le spontané est roi. L’initiative est localisée. A chaque secteur du pays, un gouvernement en miniature se constitue et assume le pouvoir. Dans les vallées et dans les forêts, dans la jungle et dans les villages, partout, on rencontre une autorité nationale. Chacun par son action fait exister la nation et s’engage à la faire localement triompher. Le but, le programme de chaque groupe spontanément constitué est la libération locale. L’art politique se transforme tout simplement en art militaire. Le militant politique, c’est le combattant. Faire la guerre et faire de la politique, c’est une seule et même chose. Ce peuple déshérité, habitué à vivre dans le cercle étroit des luttes et des rivalités, va procéder dans une atmosphère solennelle à la toilette et à la purification du visage local de la nation. Dans une véritable extase collective, des familles ennemies décident de tout effacer, de tout oublier. Les réconciliations se multiplient. Les haines tenaces et enfouies sont réveillées pour être plus sûrement extirpées. Les traîtres et les vendus sont jugés et châtiés. Une générosité spectaculaire, une bonté désarmante, une volonté de mourir pour la « cause » règne. Des émissaires sont dépêchés aux tribus avoisinantes. Ils constituent le premier système de liaison de l’insurrection et apportent cadence et mouvement aux régions encore immobiles. Chaque village se découvre agent absolu et relais. C’est la première phase de la lutte.
Dans la seconde phase de la lutte, l’ennemi déclenche l’offensive. Les forces coloniales, après l’explosion, se regroupent, se réorganisent et inaugurent des méthodes de combat correspondant à la nature de l’insurrection. Cette offensive va remettre en question l’atmosphère euphorique et paradisiaque de la première période. L’ennemi déclenche l’attaque et concentre sur des points précis des forces importantes. Le groupe armé local est très rapidement débordé. Au début, il a tendance à accepter de front le combat, et perd beaucoup d’hommes. Il refuse de battre en retraite, se comporte comme si le sort du pays se jouait ici et maintenant. On est encore dans l’instantanéité. Le doute s’installe chez les combattants. Des corps fauchés par la mitraille provoquent une réinterprétation globale des événements.
Après ces massacres, les chefs de l’insurrection éprouvent la nécessité d’engager la guérilla. Dans la guérilla en effet, la lutte n’est plus où l’on est mais où l’on va. Chaque combattant emporte la patrie en guerre entre ses orteils nus. L’armée de libération nationale n’est plus sur place dans un village pour y faire la guerre ou attendre qu’on l’y attaque, mais elle va de village en village, se replie dans les forêts. Les tribus se mettent en branle, les groupes se déplacent, changeant de terrain. Les gens du nord font mouvement vers l’ouest, ceux de la plaine se hissent dans les montagnes. Aucune position stratégique n’est privilégiée. L’ennemi s’imagine poursuivre tous les groupes armés, mais ces groupes s’arrangent toujours pour être sur ses arrières, le frappant au moment même où il les croit anéanties. Avec toute sa technique et sa puissance de feu, l’ennemi se perd et subit des coups. Les dirigeants de l’insurrection comprennent qu’il faut éclairer les groupes, les instruire, les endoctriner, créer une armée, centraliser l’autorité. Les dirigeants qui avaient fui l’atmosphère de vaine politique des villes redécouvrent la politique, non plus comme technique d’endormissement ou de mystification mais comme moyen unique d’intensifier la lutte et de préparer le peuple à la direction lucide du pays. Les dirigeants de l’insurrection s’aperçoivent que les jacqueries, même grandioses, demandent à être contrôlées et orientées. Les dirigeants sont amenés à nier le mouvement en tant que jacquerie, le transformant ainsi en guerre révolutionnaire. Ils découvrent que le succès de la lutte suppose la clarté des objectifs, la netteté de la méthodologie et surtout la connaissance par les masses de la dynamique temporelle de leurs efforts. Ce qui lui assure une certaine primauté dans la lutte.
L’ennemi modifie aussi sa tactique. À la politique brutale de répression il allie opportunément les gestes spectaculaires de détente, les manœuvres de division, « l’action psychologique ». Il tente çà et là et avec succès de redonner vie aux luttes tribales résolues à la première période de lutte, utilisant les provocateurs, les chefs traditionnels et ceux restés trop attachés aux traditions pour faire renaitre le tribalisme. Il utilise aussi certains éléments du lumpen-prolétariat. Tout mouvement de libération nationale doit accorder le maximum d’attention à ce lumpen-prolétariat. Celui-ci répond toujours à l’appel de l’insurrection, mais si l’insurrection croit pouvoir se développer en l’ignorant, le lumpen-prolétariat, cette masse d’affamés et de déclassés participera au conflit aux côtés, cette fois, de l’oppresseur. L’oppresseur utilisera l’inconscience et l’ignorance qui sont les tares du lumpen-prolétariat. Le colon prend des mesures visant à respecter les colonisés et à les traiter humainement. Le colonisé qui a pris les armes parce que le colon le traitait comme une bête, se montre très sensible à ces mesures. D’abord désorientés, les dirigeants de l’insurrection comprennent la nécessité d’expliquer et de faire un grand travail de conscience. Il faut expliquer les raisons réelles de la lutte. Il faut que le peuple voie où il va, comment y aller. Il faut leur expliquer pourquoi les concessions faites par l’ennemi ne mettent pas un terme à la guerre. Il faut leur faire comprendre que ces concessions ne portent pas sur l’essentiel. Les dirigeants de l’insurrection doivent prendre les exemples des autres peuples pour montrer que ces concessions du colon se sont soldées par un asservissement plus discret mais plus total. Le colonisé doit se persuader que le colonialisme ne lui fait aucun don. Ce que le colonisé obtient par la lutte politique ou armée n’est pas le résultat de la bonne volonté ou du bon cœur du colon mais traduit son impossibilité à différer les concessions. Davantage, le colonisé doit savoir que ces concessions, ce n’est pas le colonialisme qui les fait, mais lui-même qui les impose aux colonialistes. À la rigueur le colonisé peut accepter un compromis avec le colonialisme mais jamais une compromission. Toutes ces explications ne sont possibles que dans le cadre d’une organisation, d’un encadrement du peuple. Cette organisation est mise sur pied par l’utilisation des éléments révolutionnaires venus des villes au début de l’insurrection et de ceux qui rejoignent les campagnes au fur et à mesure du développement de la lutte. Mais, de leur côté, les paysans qui élaborent leurs connaissances au contact de l’expérience se révéleront aptes à diriger la lutte populaire. Les institutions traditionnelles sont renforcées, approfondies et quelquefois littéralement transformées. Le tribunal des conflits, les djemaas, les assemblées de village se transforment en tribunal révolutionnaire, en comité politico-militaire. Dans chaque groupe de combat, dans chaque village, surgissent des légions de commissaires politiques. Le peuple qui commence à buter sur des îlots d’incompréhension sera éclairé par ces commissaires politiques. C’est ainsi que ces derniers ne craindront pas d’aborder les problèmes qui, s’ils n’étaient pas explicités, contribueraient à désorienter le peuple. En ville, tout se déroule normalement, comme si rien ne se déroulait dans les campagnes. Ce qui révolte les paysans et renforce leur tendance à mépriser et à condamner globalement les urbains. Le commissaire politique devra les amener à nuancer cette position par la prise de conscience que certaines fractions de la population possèdent des intérêts particuliers qui ne recouvrent pas toujours l’intérêt national. Le peuple comprend alors que l’indépendance nationale met au jour des réalités multiples qui, quelquefois, sont divergentes et antagonistes. L’explication, à ce moment précis de la lutte, est décisive car elle fait passer le peuple du nationalisme global et indifférencié à une conscience sociale et économique. Le peuple, qui au début de la lutte avait adopté la logique du colon : les Blancs et les Noirs, les Arabes et les Roumis, s’aperçoit en cours de route qu’il arrive à des Noirs d’être plus blancs que les Blancs et que l’éventualité d’un drapeau national, la possibilité d’une nation indépendante n’entraînent pas automatiquement certaines couches de la population à renoncer à leurs privilèges ou à leurs intérêts. Le peuple s’aperçoit que des indigènes comme lui semblent profiter de la guerre pour renforcer leur situation matérielle et leur puissance naissante. Le militant qui fait face, avec des moyens rudimentaires, à la machine de guerre colonialiste se rend compte que dans le même temps où il démolit l’oppression coloniale il contribue à construire un autre appareil d’exploitation. Cette découverte est désagréable, pénible et révoltante. Le peuple découvre que l’exploitation peut présenter une apparence noire ou arabe. Il constate que certains colons ne participent pas aux crimes contre lui. Par contre, ces colons condamnent la guerre. Certains veulent se battre avec lui. Le scandale éclate vraiment quand ces colons se joignent à lui, lutte avec lui, acceptent les souffrances, la torture et la mort. La haine globale que le colonisé ressentait à l’égard du peuplement étranger est désamorcée.
III
MÉSAVENTURES DE LA CONSCIENCE NATIONALE
Pendant longtemps le colonisé dirige ses efforts vers la suppression de certaines iniquités : travail forcé, sanctions corporelles, inégalité des salaires, limitations des droits politiques, etc. Ce combat pour la démocratie contre l’oppression de l’homme va progressivement sortir de la confusion néolibérale universaliste pour déboucher, parfois laborieusement, sur la revendication nationale. Or l’impréparation des élites, l’absence de liaison organique entre elles et les masses, leur paresse et, disons-le, la lâcheté au moment décisif de la lutte vont être à l’origine de mésaventures tragiques.
La bourgeoisie nationale qui prend le pouvoir à la fin du régime colonial est une bourgeoisie sous-développée. Sa puissance économique est presque nulle. Elle s’est convaincue qu’elle pouvait avantageusement remplacer la bourgeoisie métropolitaine. Mais l’indépendance qui la met littéralement au pied du mur va déclencher chez elle des réactions catastrophiques et l’obliger à lancer des appels angoissés en direction de l’ancienne métropole. Cette bourgeoisie est constituée de cadres universitaires et commerçants qui constituent la fraction la plus éclairée du nouvel État. Elle se caractérise par son petit nombre, sa concentration dans la capitale, le type de ses activités : négoce, exploitations agricoles, professions libérales. Au sein de cette bourgeoisie nationale on ne trouve ni industriels, ni financiers. Elle n’est pas orientée vers la production, l’invention, la construction, le travail. Elle a une psychologie d’hommes d’affaires et non de capitaines d’industrie. Elle va plonger le peuple dans l’abime.
L’objectif des partis nationalistes à partir d’une certaine époque est strictement national. Ils mobilisent le peuple sur le mot d’ordre d’indépendance et pour le reste s’en remettent à l’avenir. Quand on interroge ces partis sur le programme économique de l’État qu’ils revendiquent, sur le régime qu’ils se proposent d’instaurer, ils se montrent incapables de répondre parce que précisément ils sont totalement ignorants à l’égard de l’économie de leur propre pays. Cette économie s’est toujours développée en dehors d’eux. Des ressources actuelles et potentielles du sol et du sous-sol de leur pays, ils n’ont qu’une connaissance livresque, approximative.
Après l’indépendance la bourgeoisie nationale sous-développée, numériquement réduite, sans capitaux, qui refuse la voie révolutionnaire, va lamentablement stagner. Dans l’impossibilité où elle se trouve de mettre en place des usines plus rentables pour le pays et pour elle, elle va entourer l’artisanat d’une tendresse chauvine qui va dans le sens de la nouvelle dignité nationale et qui par ailleurs lui procurera de substantiels profits. L’économie nationale de la période d’indépendance n’est pas réorientée. Il s’agit toujours de récolte d’arachide, de récolte de cacao, de récolte d’olives. On continue à expédier les matières premières, on continue à se faire les petits agriculteurs de l’Europe, les spécialistes de produits bruts. Pourtant, la bourgeoisie nationale ne cesse d’exiger la nationalisation de l’économie et des secteurs commerciaux. C’est que, pour elle, nationaliser ne signifie pas mettre la totalité de l’économie au service de la nation, décider de satisfaire tous les besoins de la nation. Nationalisation pour elle signifie très exactement transfert aux autochtones des passe-droits hérités de la période coloniale. Comme la bourgeoisie n’a ni les moyens matériels, ni les moyens intellectuels suffisants (ingénieurs, techniciens), elle limitera ses prétentions à la reprise des cabinets d’affaires et des maisons de commerce autrefois occupés par les colons. Elle prend la place de l’ancien peuplement européen : médecins, avocats, commerçants, représentants, agents généraux, transitaires. Dorénavant elle va exiger que les grandes compagnies étrangères passent par elle. Au sein de la bourgeoisie nationale des pays coloniaux l’esprit jouisseur domine. Elle suit la bourgeoisie occidentale dans son côté négatif et décadent sans avoir franchi les premières étapes d’exploration et d’invention qui sont en tout état de cause un acquis de cette bourgeoisie occidentale. La bourgeoisie nationale organise des centres de repos et de délassement, des cures de plaisir à l’intention de la bourgeoisie occidentale. Cette activité prendra le nom de tourisme et sera assimilée pour la circonstance à une industrie nationale. Parce qu’elle n’a pas d’idées, parce qu’elle est fermée sur elle-même, coupée du peuple, minée par son incapacité à penser l’ensemble des problèmes en fonction de la totalité de la nation, la bourgeoisie nationale va assumer le rôle de gérant des entreprises de l’Occident.
De leur côté, le prolétariat des villes, la masse des chômeurs, les petits artisans calquent leur attitude sur celle de leur bourgeoisie. Si la bourgeoisie nationale entre en compétition avec les Européens, les artisans et les petits métiers déclenchent la lutte contre les Africains non nationaux. On exige le départ de ces étrangers, on brûle leurs magasins. Ce qui rend impossible le rêve de l’Etat continental. Partout où la bourgeoisie nationale par son comportement mesquin et l’imprécision de ses positions doctrinales n’a pu éclairer l’ensemble du peuple, on a assisté à un reflux vers les positions tribalistes. On assiste, la rage au cœur, au triomphe exacerbé des ethnies. Puisque le seul mot d’ordre de la bourgeoisie est : remplaçons les étrangers, et qu’elle se hâte dans tous les secteurs de se rendre justice et de prendre les places, les petits nationaux vont également exiger que les autres tribus rentrent chez eux. Au lendemain de l’indépendance, les nationaux qui habitent les régions prospères prennent conscience de leur chance et nourrit par le comportement de la bourgeoisie, refusent de partager avec les autres nationaux. La bourgeoisie nationale se révèle donc incapable de réaliser la simple unité nationale, incapable d’édifier la nation sur des bases solides et fécondes. Le front national qui avait fait reculer le colonialisme se disloque et consume sa défaite.
La lutte implacable que se livrent les ethnies, le souci agressif d’occuper les postes rendus libres par le départ de l’étranger vont également donner naissance à des compétitions religieuses. Dans les campagnes et en brousse, les petites confréries, les religions locales, les cultes maraboutiques retrouvent leur vitalité et reprennent le cycle des excommunications. Dans les grandes villes, au niveau des cadres administratifs, on assistera à la confrontation entre les deux grandes religions révélées : l’islam et le catholicisme. Le colonialisme, qui avait tremblé sur ses bases devant la naissance de l’unité africaine, reprend ses dimensions et tente maintenant de briser cette volonté en utilisant toutes les faiblesses du mouvement. Il profite pour dresser les africains entre eux, ces africains qui hier s’étaient dressés contre lui. Dans certaines régions, les musulmans sont tenus à l’écart des postes de direction. Dans d’autres régions se produit le phénomène inverse. Les fêtes islamiques sont réactivées, la religion musulmane se défend pied à pied contre l’absolutisme violent de la religion catholique. Quelquefois le protestantisme américain transporte sur le sol africain ses préjugés anticatholiques et entretient à travers la religion les rivalités tribales. On divise l’Afrique en une partie blanche et une partie noire. Les appellations de substitution : Afrique au sud ou au nord du Sahara n’arrivent pas à cacher ce racisme latent. La bourgeoisie nationale de chacune de ces deux grandes régions, qui a assimilé jusqu’aux racines les plus pourries de la pensée colonialiste, prend le relais des Européens et installe sur le continent une philosophie raciste terriblement préjudiciable pour l’avenir de l’Afrique. Par sa paresse et son mimétisme elle favorise l’implantation et le renforcement du racisme qui caractérisait l’ère coloniale. Il n’est malheureusement pas exclu que des étudiants d’Afrique noire inscrits dans des collèges au nord du Sahara s’entendent demander par leurs camarades de lycée s’il existe des maisons chez eux, s’ils connaissent l’électricité, si dans leur famille ils pratiquent l’anthropophagie. Dans certains jeunes États d’Afrique noire des parlementaires, voire des ministres affirment que le danger n’est point d’une réoccupation de leur pays par le colonialisme mais de l’éventuelle invasion des « Arabes vandales » venus du Nord. L’unité africaine ne peut se faire que sous la poussée et sous la direction des peuples, c’est-à-dire au mépris des intérêts de la bourgeoisie.
Sur le plan intérieur et dans le cadre institutionnel, la bourgeoisie nationale va également faire la preuve de son incapacité. Dans un certain nombre de pays sous-développés le jeu parlementaire est fondamentalement faussé. Elle ne crée pas un État qui rassure le citoyen mais qui l’inquiète. L’État qui, par sa robustesse et en même temps sa discrétion, devrait donner confiance, désarmer, endormir, s’impose au contraire spectaculairement, s’exhibe, bouscule, brutalise, signifiant ainsi au citoyen qu’il est en danger permanent. Comme la bourgeoisie n’a pas les moyens économiques pour assurer sa domination et distribuer quelques miettes à l’ensemble du pays, comme elle est préoccupée de se remplir les poches le plus rapidement possible, le pays s’enfonce davantage dans le marasme. Pour cacher ce marasme, la bourgeoisie n’a d’autres ressources que d’élever dans la capitale des constructions grandioses, de faire ce que l’on appelle des dépenses de prestige. Elle tourne de plus en plus le dos à l’intérieur, aux réalités du pays en friche et regarde vers l’ancienne métropole, vers les capitalistes étrangers qui s’assurent ses services. Comme elle ne partage pas ses bénéfices avec le peuple et ne lui permet aucunement de profiter des prébendes que lui versent les grandes compagnies étrangères, elle va découvrir la nécessité d’un leader populaire auquel reviendra le double rôle de stabiliser le régime et de perpétuer la domination de la bourgeoisie. Le leader représente la puissance morale à l’abri de laquelle la bourgeoisie, maigre et démunie, de la jeune nation décide de s’enrichir. Le peuple qui, des années durant, l’a vu ou entendu parler, qui de loin, dans une sorte de rêve, a suivi les démêlés du leader, spontanément fait confiance à ce patriote. Mais le leader va révéler sa fonction intime : être le président général de la société de profiteurs impatients de jouir que constitue la bourgeoisie nationale. Son honnêteté s’effrite progressivement. Le contact avec les masses est tellement irréel que le leader en arrive à se convaincre qu’on en veut à son autorité et qu’on met en doute les services rendus à la patrie. Il se transforme alors en complice de la jeune bourgeoisie qui s’ébroue dans la corruption et la jouissance. Les circuits économiques du jeune État s’enlisent irréversiblement dans la structure néo-colonialiste. Le budget est alimenté par des prêts et par des dons. Tous les trimestres, les chefs d’État eux-mêmes ou les délégations gouvernementales se rendent dans les anciennes métropoles ou ailleurs, à la pêche aux capitaux. L’ancienne puissance coloniale multiplie les exigences, accumule concessions et garanties, prenant de moins en moins de précautions pour masquer la sujétion dans laquelle elle tient le pouvoir national. Le peuple stagne lamentablement dans une misère insupportable et lentement prend conscience de la trahison inqualifiable de ses dirigeants.
Le leader, qui a derrière lui une vie de militant et de patriote dévoué, parce qu’il cautionne l’entreprise de cette caste de bourgeois, constitue un écran entre le peuple et la bourgeoisie rapace. Il contribue à freiner la prise de conscience du peuple. Il vient au secours de la caste, cache au peuple ses manœuvres devenant ainsi l’artisan le plus ardent du travail de mystification et d’engourdissement des masses. Il multiplie les efforts pour endormir le peuple. Il revient sur l’histoire pour montrer au peuple le chemin parcouru. Mais le paysan qui continue à gratter la terre, le chômeur qui n’en finit pas de chômer n’arrivent pas, malgré les fêtes nationales, malgré les drapeaux pourtant neufs, à se convaincre que quelque chose a vraiment changé dans leur vie. Les masses ne parviennent pas à s’illusionner. Elles commencent à bouder, à se détourner, à se désintéresser de cette nation qui ne leur fait aucune place.
La présence du leader est d’autant plus nécessaire que les partis politiques à réellement parler n’existent plus. Après l’indépendance, le parti sombre dans une léthargie spectaculaire. On ne mobilise plus les militants qu’à l’occasion de manifestations dites populaires, de conférences internationales, des fêtes de l’indépendance. Le parti devient un moyen de réussite individuelle. La bourgeoisie nationale se vend de plus en plus ouvertement aux grandes compagnies étrangères. À coups de prébendes, les concessions sont arrachées par l’étranger, les scandales se multiplient, les ministres s’enrichissent, leurs femmes se transforment en cocottes, les députés se débrouillent et il n’est pas jusqu’à l’agent de police, jusqu’au douanier qui ne participe à cette grande caravane de la corruption. Les bénéfices énormes que la bourgeoisie retire de l’exploitation du peuple sont exportés à l’étranger. L’opposition devient plus agressive et le régime devient tyrannique. La jeune bourgeoisie nationale qui a institué ces régimes prend peur et les redoute. Elle refuse d’investir sur le sol national et se comporte vis-à-vis de l’État qui la protège et la nourrit avec ingratitude. Elle devine que cette situation ne durera pas indéfiniment mais elle entend en profiter au maximum. Cependant une telle exploitation et une telle méfiance à l’égard de l’État déclenchent inévitablement le mécontentement au niveau des masses. C’est dans ces conditions que le régime se durcit. Alors l’armée devient le soutien indispensable d’une répression systématisée. L’ancienne métropole pratique le gouvernement indirect, à la fois par les bourgeois qu’elle nourrit et par une armée nationale encadrée par ses experts et qui fixe le peuple, l’immobilise et le terrorise.
Dans les pays sous-développés, la bourgeoisie ne doit pas trouver de conditions à son existence et à son épanouissement. Autrement dit, l’effort conjugué des masses encadrées dans un parti et des intellectuels hautement conscients et armés de principes révolutionnaires doit barrer la route à cette bourgeoisie inutile et nocive. Elle est d’autant plus facile de neutraliser qu’elle est numériquement, idéologiquement insignifiante. Dans les pays sous-développés, il existe des intellectuels, des fonctionnaires, des élites sincères qui ressentent la nécessité d’une planification de l’économie, d’une mise hors la loi des profiteurs, d’une prohibition rigoureuse de la mystification. La situation particulière de ces hommes (soutien de famille nombreuse) ou leur histoire (expériences difficiles, formation morale rigoureuse) explique ce mépris si manifeste pour les profiteurs. Il faut savoir utiliser ces hommes dans le combat décisif que l’on entend mener pour une orientation saine de la nation. Barrer la route à la bourgeoisie nationale c’est aussi choisir le seul moyen d’avancer. La souveraineté nationale ne peut se faire que si on nationalise le secteur tertiaire. Il ne s’agit pas de le mettre au service de la bourgeoisie ou de quelques cades non formés, mais au service du peuple. Tout cela ne peut réussir que si on politise le peuple. Un gouvernement qui déclare vouloir politiser le peuple exprime son désir de gouverner avec le peuple et pour le peuple. La politisation des masses n’est pas la mobilisation trois ou quatre fois l’an de dizaines ou de centaines de milliers d’hommes et de femmes. Ces meetings, ces rassemblements spectaculaires s’apparentent à la vieille tactique d’avant l’indépendance où l’on exhibait ses forces pour se prouver à soi-même et aux autres qu’on avait le peuple avec soi. La politisation des masses se propose non d’infantiliser les masses mais de les rendre adultes.
Les partis politiques au pouvoir pilotés par les bourgeoisies nationales matraquent, emprisonnent, condamnent au silence, puis à la clandestinité tout parti d’opposition qui œuvre pour une plus grande influence des masses dans la gestion des affaires publiques, qui souhaite une mise au pas de la bourgeoisie méprisante et mercantile. Les bureaux de ces partis d’opposition sont incendiés, leurs candidats et familles physiquement attaqués, leurs meetings interdits, leurs actions circonscrits. Ce qui crée la peur des masses à l’égard des affaires politiques. Les dirigeants du parti au pouvoir se comportent comme de vulgaires adjudants et rappellent constamment au peuple qu’il faut faire « silence dans les rangs ». Ce parti qui s’affirmait le serviteur du peuple, qui prétendait travailler à l’épanouissement du peuple, dès la prise du pouvoir, se dépêche de renvoyer le peuple dans sa caverne. Sur le plan de l’unité nationale il va multiplier les erreurs. C’est ainsi que le parti dit national se comporte en parti ethnique. C’est une véritable tribu constituée en parti. Ce parti qui se proclame volontiers national, qui affirme parler au nom du peuple global, secrètement et quelquefois ouvertement organise une authentique dictature ethnique. Nous assistons non plus à une dictature bourgeoise mais à une dictature tribale. Les ministres, les chefs de cabinets, les ambassadeurs, les préfets sont choisis dans l’ethnie du leader, quelquefois même directement dans sa famille. Ces chefs de gouvernement sont les véritables traîtres à l’Afrique car ils la vendent au plus terrible de ses ennemis : la bêtise. Cette tribalisation du pouvoir entraîne, on s’en doute, l’esprit régionaliste, le séparatisme. La nation se disloque, se démembre. Le leader qui criait : « Unité africaine » et qui pensait à sa petite famille se réveille un beau jour avec cinq tribus qui elles aussi veulent avoir leurs ambassadeurs et leurs ministres ; et toujours irresponsable, toujours inconscient, toujours misérable il dénonce « la trahison ».
Pour éviter ces multiples écueils il faut se battre avec ténacité pour que jamais le parti ne devienne un instrument docile entre les mains d’un leader. Un pays qui veut réellement répondre aux questions que lui pose l’histoire, qui veut développer ses villes et le cerveau de ses habitants doit posséder un parti véridique. Le parti n’est pas un instrument entre les mains du gouvernement. Bien au contraire, le parti est un instrument entre les mains du peuple. C’est lui qui arrête la politique que le gouvernement applique. Dans un pays sous-développé les membres dirigeants du parti doivent fuir la capitale comme la peste. Ils doivent résider, à l’exception de quelques-uns, dans les régions rurales. On doit éviter de tout centraliser dans la grande ville. Pratiquement il y aura au moins un membre du bureau politique dans chaque région. Pour le peuple le parti n’est pas l’autorité mais l’organisme à travers lequel il exerce en tant que peuple son autorité et sa volonté. Si le parti se confond avec le pouvoir, alors être militant du parti, c’est prendre le plus court chemin pour parvenir à des fins égoïstes, avoir un poste dans l’administration, augmenter de grade, changer d’échelon, faire carrière.
Dans les pays sous-développés, nous devons multiplier les contacts avec les masses rurales. Nous devons faire une politique nationale, c’est-à-dire avant tout une politique pour les masses. Nous ne devons jamais perdre le contact avec le peuple. Les fonctionnaires et les techniciens autochtones doivent s’enfoncer non dans les diagrammes et les statistiques, mais dans le corps du peuple. Le bureau politique du parti doit privilégier les régions déshéritées. Le parti doit être l’expression directe des masses. Pour parvenir à cette conception du parti, il faut avant toute chose se débarrasser de l’idée très occidentale, très bourgeoise donc très méprisante que les masses sont incapables de se diriger. L’expérience prouve, en fait, que les masses comprennent parfaitement les problèmes les plus compliqués. Un homme isolé peut se montrer rebelle à la compréhension d’un problème mais le groupe, le village comprend avec une rapidité déconcertante. On peut tout expliquer au peuple à condition toutefois qu’on veuille vraiment qu’il comprenne. Et, si l’on pense qu’on n’a pas besoin de lui, qu’au contraire il risque de gêner la bonne marche des multiples sociétés privées et à responsabilité limitée, dont le but est de rendre le peuple plus misérable encore, alors la question est tranchée. Le peuple, quand on l’invite à la direction du pays, ne retarde pas mais accélère le mouvement. Plus le peuple comprend, plus il devient vigilant, plus il devient conscient. En définitive tout dépend de lui et son salut réside dans sa cohésion, dans la connaissance de ses intérêts et de l’identification de ses ennemis. Le temps mis à expliquer au peuple, à humaniser le travailleur sera rattrapé dans l’exécution. Les gens doivent savoir où ils vont et pourquoi ils y vont. Le réveil du peuple ne se fera pas d’un seul coup, d’abord parce que les voies de communications et les moyens de transmission sont peu développés, ensuite parce que la temporalité doit cesser d’être celle de l’instant ou de la prochaine récolte pour devenir celle du monde, enfin parce que le découragement installé très profondément dans le cerveau est toujours à fleur de peau. Il faut que le peuple comprenne l’importance de l’enjeu. La chose publique doit être la chose du public. On débouche sur la nécessité de multiplier les cellules à la base. Il faut une base, des cellules qui donnent précisément contenu et dynamisme. Les masses doivent pouvoir se réunir, discuter, proposer, recevoir des instructions. Les citoyens doivent avoir la possibilité de parler, de s’exprimer, d’inventer. À chaque réunion, le cerveau multiplie ses voies d’association, l’œil découvre un panorama de plus en plus humanisé. La jeunesse africaine ne doit pas être dirigée vers les stades mais vers les champs et vers les écoles. Nous devons soulever le peuple, agrandir le cerveau du peuple, le meubler, le différencier, le rendre humain. Être responsable dans un pays sous-développé, c’est savoir que tout repose en définitive sur l’éducation des masses, sur l’élévation de la pensée, sur ce qu’on appelle trop rapidement la politisation. Or, politiser c’est ouvrir l’esprit, c’est éveiller l’esprit, mettre au monde l’esprit. Politiser les masses ce n’est pas, ce ne peut pas être faire un discours politique. C’est s’acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d’elles, que si nous stagnons c’est de leur faute et que si nous avançons, c’est aussi de leur faute, qu’il n’y a pas de démiurge, qu’il n’y a pas d’homme illustre et responsable de tout, mais que le démiurge c’est le peuple et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. Pour réaliser ces choses, pour les incarner véritablement, il faut décentraliser à l’extrême. C’est de la base que montent les forces qui dynamisent le sommet et lui permettent dialectiquement d’effectuer un nouveau bond. Aucun membre de la hiérarchie du parti ne doit se prévaloir d’une quelconque mission de salut. Le sommet ne tire sa valeur et sa solidité que de l’existence du peuple au combat. Un peuple digne, c’est-à-dire conscient de sa dignité, est un peuple qui n’oublie jamais ces évidences. En fait, un peuple digne et libre est un peuple souverain et responsable. Un gouvernement et un parti ont le peuple qu’ils méritent. Et à plus ou moins longue échéance un peuple a le gouvernement qu’il mérite.
Au cours de réunions, il arrive parfois que des militants se réfèrent pour résoudre les problèmes difficiles à la formule : « il n’y a qu’à... ». Ce raccourci volontariste où culminent dangereusement spontanéité, syncrétisme simplifiant, non-élaboration intellectuelle triomphe fréquemment. Chaque fois qu’on rencontre cette abdication de la responsabilité chez un militant il ne suffit pas de lui dire qu’il a tort. Il faut le rendre responsable, l’inviter à aller jusqu’au bout de son raisonnement et lui faire toucher le caractère souvent atroce, inhumain et en définitive stérile de ce « il n’y a qu’à ». Personne ne détient la vérité, ni le dirigeant, ni le militant. La recherche de la vérité dans des situations locales est affaire collective. Certains ont une expérience plus riche, élaborent plus rapidement leur pensée, ont pu établir dans le passé un plus grand nombre de liaisons mentales. Mais ils doivent éviter d’écraser le peuple car le succès de la décision adoptée dépend de l’engagement coordonné et conscient de l’ensemble du peuple. Personne ne peut retirer son épingle du jeu. Tout le monde sera abattu ou torturé et, dans le cadre de la nation indépendante, tout le monde aura faim et participera au marasme. Le combat collectif suppose une responsabilité collective à la base et une responsabilité collégiale au sommet. Il faut compromettre tout le monde dans le combat pour le salut commun. Il n’y a pas de mains pures, il n’y a pas d’innocents, pas de spectateurs. Nous sommes tous en train de nous salir les mains dans les marais de notre sol et le vide effroyable de nos cerveaux. Tout spectateur est un lâche ou un traître. Le devoir d’une direction est d’avoir les masses avec elle. Or, l’adhésion suppose la conscience, la compréhension de la mission à remplir, bref une intellectualisation même embryonnaire. Politiser les masses, c’est rendre la nation globale présente à chaque citoyen. C’est faire de l’expérience de la nation l’expérience de chaque citoyen. Si la construction d’un pont ne doit pas enrichir la conscience de ceux qui y travaillent, que le pont ne soit pas construit, que les citoyens continuent de traverser le fleuve à la nage ou par bac. Le pont ne doit pas être parachuté, il ne doit pas être imposé, mais il doit au contraire sortir des muscles et du cerveau des citoyens. Et, certes, il faudra peut-être des ingénieurs et des architectes, quelquefois entièrement étrangers, mais les responsables locaux du parti doivent être présents pour que la technique s’infiltre dans le désert cérébral du citoyen, pour que le pont dans ses détails et dans son ensemble soit repris, conçu et assumé. Il faut que le citoyen s’approprie le pont.
La jeunesse représente l’un des secteurs les plus importants. Il faut élever la conscience des jeunes, l’éclairer. C’est cette jeunesse que nous retrouverons dans l’armée nationale. L’armée n’est jamais une école de guerre mais une école de civisme, une école politique. Le soldat d’une nation adulte n’est pas un mercenaire mais un citoyen qui par le moyen des armes défend la nation. C’est pourquoi il est fondamental que le soldat sache qu’il est au service du pays et non d’un officier aussi prestigieux soit-il. Il faut profiter du service national civil et militaire pour élever le niveau de la conscience nationale, pour détribaliser, unifier. Le pays sous-développé doit se garder de perpétuer les traditions féodales qui consacrent la priorité de l’élément masculin sur l’élément féminin. Les femmes recevront une place identique aux hommes non dans les articles de la Constitution mais dans la vie quotidienne, à l’usine, à l’école, dans les assemblées. Si dans les pays occidentaux on encaserne les militaires, cela ne veut pas dire que ce soit toujours la meilleure formule. Le service peut être civil ou militaire et de toute façon il est recommandé que chaque citoyen valide puisse à tout moment s’intégrer dans une unité combattante et défendre les acquisitions nationales et sociales. Les grands travaux d’intérêt collectif doivent pouvoir être exécutés par les recrues. C’est un moyen prodigieux d’activer les régions inertes, de faire connaître à un plus grand nombre de citoyens les réalités du pays. Il faut éviter de transformer l’armée en un corps autonome qui tôt ou tard, désœuvré et sans mission, se mettra à « faire de la politique » et à menacer le pouvoir. Le seul moyen d’y échapper est de politiser l’armée, c’est-à-dire de la nationaliser. De même y a-t-il urgence à multiplier les milices. En cas de guerre, c’est la nation entière qui se bat ou qui travaille. Il ne doit pas y avoir de soldats de métier et le nombre d’officiers de carrière doit être réduit au strict minimum. D’abord parce que très souvent les officiers sont choisis au sein des cadres universitaires qui pourraient être beaucoup plus utiles ailleurs : un ingénieur est mille fois plus indispensable à la nation qu’un officier. Ensuite, parce qu’il faut éviter la cristallisation d’un esprit de caste.
La nation n’existe nulle part si ce n’est dans un programme élaboré par une direction. On doit apprendre du combat et des victoires des autres peuples. Ce que nous voulons savoir, ce sont les expériences faites par les Argentins ou les Birmans dans le cadre de la lutte contre l’analphabétisme ou contre les tendances dictatoriales des dirigeants. Ce sont des éléments qui nous renforcent, nous instruisent et décuplent notre efficacité. Comme on le voit, un programme est nécessaire à un gouvernement qui veut vraiment libérer politiquement et socialement le peuple. Programme économique mais aussi doctrine sur la répartition des richesses et sur les relations sociales. En fait, il faut avoir une conception de l’homme, une conception de l’avenir de l’humanité. Le nationalisme, s’il n’est pas explicité, enrichi et approfondi, s’il ne se transforme pas très rapidement en conscience politique et sociale, en humanisme, conduit à une impasse. Seul l’engagement massif des hommes et des femmes dans des tâches éclairées et fécondes donne contenu et densité à une conscience. Alors le drapeau et le palais de gouvernement cessent d’être les symboles de la nation. La nation déserte ces lieux illuminés et factices, se réfugie dans les campagnes où elle reçoit vie et dynamisme. L’expression vivante de la nation c’est la conscience en mouvement de l’ensemble du peuple. C’est la praxis cohérente et éclairée des hommes et des femmes. La construction collective d’un destin, c’est l’assomption d’une responsabilité à la dimension de l’histoire. Le gouvernement national, s’il veut être national, doit gouverner par le peuple et pour le peuple, pour les déshérités et par les déshérités. Aucun leader quelle que soit sa valeur ne peut se substituer à la volonté populaire et le gouvernement national doit, avant de se préoccuper de prestige international, redonner dignité à chaque citoyen, meubler les cerveaux, emplir les yeux de choses humaines, développer un panorama humain parce qu’habité par des hommes conscients et souverains.
IV
Sur la culture nationale
Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Dans les pays sous-développés les générations précédentes ont à la fois résisté au travail d’érosion poursuivi par le colonialisme et préparé le mûrissement de luttes actuelles. Il nous faut perdre l’habitude, maintenant que nous sommes au cœur du combat, de minimiser l’action de nos pères. Ils se sont battus comme ils pouvaient, avec les armes qu’ils possédaient alors. Il a fallu que plus d’un colonisé dise « ça ne peut plus durer », que plus d’une tribu se rebelle, il a fallu plus d’une jacquerie matée, plus d’une manifestation réprimée pour que nous puissions aujourd’hui tenir tête avec cette certitude dans la victoire. Notre mission historique, à nous qui avons pris la décision de briser les reins du colonialisme, est d’ordonner toutes les révoltes, tous les actes désespérés, toutes les tentatives avortées ou noyées dans le sang. Les partis politiques partent du réel vécu et c’est au nom de ce réel, au nom de cette actualité qui pèse sur le présent et sur l’avenir des hommes et des femmes, qu’ils convient à l’action. Le parti politique peut bien parler en termes émouvants de la nation mais ce qui l’intéresse, c’est que le peuple qui l’écoute comprenne la nécessité de participer au combat.
Au sein des partis politiques, le plus souvent, apparaissent des hommes de culture colonisés. Pour ces hommes la revendication d’une culture nationale, l’affirmation de l’existence de cette culture représente un champ de bataille privilégié. Alors que les hommes politiques inscrivent leur action dans le réel, les hommes de culture se situent dans le cadre de l’histoire. Il est banal, en effet, de constater que depuis plusieurs décades de nombreux chercheurs européens ont réhabilité les civilisations africaines, mexicaines ou péruviennes. On a pu s’étonner de la passion investie par les intellectuels colonisés pour défendre l’existence d’une culture nationale. Mais cette recherche passionnée d’une culture nationale en deçà de l’ère coloniale tire sa légitimité du souci que partagent les intellectuels colonisés de prendre du recul par rapport à la culture occidentale dans laquelle ils risquent de s’enliser. Parce qu’ils se rendent compte qu’ils sont en train de se perdre, donc d’être perdus pour leur peuple, ces hommes, la rage au cœur et le cerveau fou, s’acharnent à reprendre contact avec la sève la plus ancienne, la plus anté-coloniale de leur peuple. Quand on réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser l’aliénation culturelle et convaincre les indigènes que le colonialisme devait les arracher à la nuit, et que le départ du colon devait les conduire dans la barbarie, on comprend également la nécessité de cette culture nationale historique. La revendication de l’intellectuel colonisé n’est pas un luxe mais une exigence. L’intellectuel colonisé qui situe son combat sur le plan de la légitimité, qui veut apporter des preuves est condamné à cette plongée dans les entrailles de son peuple. Cette plongée n’est pas spécifiquement nationale. L’intellectuel colonisé qui décide de livrer combat aux mensonges colonialistes, le livrera à l’échelle du continent. Le passé est valorisé. La culture, qui est arrachée du passé pour être déployée dans toute sa splendeur, n’est pas celle de son pays. Le colonialisme, qui n’a pas nuancé ses efforts, n’a cessé d’affirmer que le nègre est un sauvage et le nègre pour lui n’était ni l’Angolais, ni le Nigérien. Il parlait du nègre. Pour le colonialisme, ce vaste continent était un repaire de sauvages, un pays infesté de superstitions et de fanatisme, voué au mépris, lourd de la malédiction de Dieu, pays d’anthropophages, pays de nègres. La condamnation du colonialisme est aussi continentale. L’intellectuel colonisé qui se met en tête de proclamer l’existence d’une culture ne le fait jamais au nom de l’Angola ou du Dahomey. La culture qui est affirmée est la culture africaine. En Afrique, la littérature colonisée des vingt dernières années n’est pas une littérature nationale mais une littérature de nègres. Le concept de négritude par exemple était l’antithèse affective sinon logique de cette insulte que l’homme blanc faisait à l’humanité. Cette négritude ruée contre le mépris du Blanc s’est révélée dans certains secteurs seule capable de lever interdictions et malédictions. Les chantres de la négritude n’hésiteront pas à transcender les limites du continent. D’Amérique des voix noires vont reprendre cet hymne avec une ampleur accrue. Dans le « monde noir » verra le jour Busia du Ghana, Birago Diop du Sénégal, Hampaté Ba du Soudan, Saint Clair Drake de Chicago… Ils n’hésiteront pas à affirmer l’existence de liens communs, de lignes de force identiques. Un fait pareil s’est déroulé chez les arabes. Aujourd’hui, des médecins et des poètes arabes s’interpellent à travers les frontières, s’efforçant de lancer une nouvelle culture arabe, une nouvelle civilisation arabe.
Mais dans sa démarche, la culture est de plus en plus coupée de l’actualité. Elle trouve refuge dans un foyer passionnellement incandescent et se fraie difficilement des voies concrètes qui seraient pourtant les seules susceptibles de lui procurer les attributs de fécondité, d’homogénéité et de densité. Elle se transforme souvent en traditions fermées, coupés du présent et du futur. Si l’entreprise de l’intellectuel colonisé est historiquement limitée, il reste qu’elle contribue dans une large mesure à soutenir, à légitimer l’action des hommes politiques. Pour assurer son salut, pour échapper à la suprématie de la culture blanche, le colonisé sent la nécessité de revenir vers des racines. Parce qu’il se sent devenir aliéné et perdu, le colonisé accepte cette culture historique, décide de l’assumer. Il la confirme. Il accepte d’être mis avec les autres. Faute de le réaliser on assistera à des mutilations psychoaffectives extrêmement graves. On ne sera pas étonné d’entendre certains colonisés déclarer : « C’est en tant que Sénégalais et Français... C’est en tant qu’Algérien et Français... que je parle. » C’est que l’intellectuel colonisé s’est jeté avec avidité dans la culture occidentale. Il tente de faire sienne la culture européenne. Il ne se contentera pas de connaître Rabelais ou Diderot, Shakespeare ou Edgar Poe, il bandera son cerveau jusqu’à la plus extrême complicité avec ces hommes.
Mais au moment où les partis nationalistes mobilisent le peuple au nom de l’indépendance nationale, l’intellectuel colonisé peut quelquefois rejeter du pied ces acquisitions qu’il ressent soudain comme aliénantes. Cet intellectuel qui, par le truchement de la culture, s’était infiltré dans la civilisation occidentale va s’apercevoir que la matrice culturelle qu’il voudrait assumer par souci d’originalité, ne lui offre guère les figures de proue capables de supporter la comparaison avec celles, nombreuses et prestigieuses, de la civilisation de l’occupant. Observant lucidement l’actualité du continent qu’il voudrait faire sien, l’intellectuel est effrayé par le vide, l’abrutissement, la sauvagerie. Or il sent qu’il lui faut sortir de cette culture blanche, qu’il lui faut chercher ailleurs, n’importe où, et faute de trouver un aliment culturel à la mesure du panorama glorieux étalé par le dominateur, l’intellectuel colonisé très souvent va refluer sur des positions passionnelles et développera une psychologie dominée par une sensibilité, une sensitivité, une susceptibilité exceptionnelles. Son style devient violent. Si sur le plan poétique cette démarche atteint des hauteurs inaccoutumées, il demeure que sur le plan de l’existence l’intellectuel débouche fréquemment sur une impasse. Il privilégie les coutumes, les traditions, les modes d’apparaître et sa quête forcée, douloureuse ne fait qu’évoquer une banale recherche d’exotisme. C’est la période où les intellectuels chantent les moindres déterminations du panorama indigène. Le boubou se trouve sacralisé, les chaussures parisiennes ou italiennes délaissées au profit des babouches. Le langage du dominateur écorche soudain les lèvres. Retrouver son peuple c’est quelquefois dans cette période vouloir être nègre, un véritable nègre, un chien de nègre, tel que le veut le Blanc. Retrouver son peuple c’est se faire bicot, se faire le plus indigène possible, le plus méconnaissable, c’est se couper les ailes qu’on avait laissé pousser. Lorsque les colonialistes, qui avaient savouré leur victoire sur ses assimilés, se rendent compte que ces hommes que l’on croyait sauvés commencent à se dissoudre dans la négraille, tout le système vacille. Chaque colonisé gagné, chaque colonisé qui était passé aux aveux, lorsqu’il décide de se perdre est non seulement un échec pour l’entreprise coloniale, mais symbolise encore l’inutilité et le manque de profondeur du travail accompli.
La démarche de l’intellectuel colonisé se fait généralement en trois temps. Dans une première phase, il prouve qu’il a assimilé la culture de l’occupant. Ses œuvres correspondent point par point à celles de ses homologues métropolitains. L’inspiration est européenne et on peut aisément rattacher ces œuvres à un courant bien défini de la littérature métropolitaine. C’est la période assimilationniste intégrale. Dans un deuxième temps le colonisé est ébranlé et décide de se souvenir. Cette période de création correspond approximativement à la replongée que nous venons de décrire. Mais comme le colonisé n’est pas inséré dans son peuple, comme il entretient des relations d’extériorité avec son peuple, il se contente de se souvenir. De vieux épisodes d’enfance seront ramenés du fond de sa mémoire, de vieilles légendes seront réinterprétées en fonction d’une esthétique d’emprunt et d’une conception du monde découverte sous d’autres cieux. Enfin dans une troisième période, dite de combat, le colonisé, après avoir tenté de se perdre dans le peuple, de se perdre avec le peuple, va au contraire secouer le peuple. Au lieu de privilégier la léthargie du peuple il se transforme en réveilleur de peuple. Littérature de combat, littérature révolutionnaire, littérature nationale. Au cours de cette phase un grand nombre d’hommes et de femmes qui auparavant n’auraient jamais songé à faire œuvre littéraire, maintenant qu’ils se trouvent placés dans des situations exceptionnelles, en prison, au maquis ou à la veille de leur exécution ressentent la nécessité de dire leur nation, de composer la phrase qui exprime le peuple, de se faire le porte-parole d’une nouvelle réalité en actes.
L’intellectuel colonisé cependant tôt ou tard se rendra compte qu’on ne prouve pas sa nation à partir de la culture mais qu’on la manifeste dans le combat que mène le peuple contre les forces d’occupation. L’intellectuel colonisé dans le moment même où il s’inquiète de faire œuvre culturelle ne se rend pas compte qu’il utilise des techniques et une langue empruntées à l’occupant. L’intellectuel colonisé qui revient à son peuple à travers les œuvres culturelles se comporte en fait comme un étranger. Quelquefois il n’hésitera pas à utiliser les dialectes pour manifester sa volonté d’être le plus près possible du peuple mais les idées qu’il exprime, les préoccupations qui l’habitent sont sans commune mesure avec la situation concrète que connaissent les hommes et les femmes de son pays. Vouloir réactualiser les traditions délaissées, c’est non seulement aller contre l’histoire mais contre son peuple. Quand un peuple soutient une lutte armée ou même politique contre un colonialisme implacable, la tradition change de signification. Ce qui était technique de résistance passive peut, dans cette période, être radicalement condamné. L’intellectuel colonisé qui veut faire œuvre authentique doit savoir que la vérité nationale c’est d’abord la réalité nationale. Il lui faut pousser jusqu’au lieu en ébullition où se préfigure le savoir. L’homme colonisé qui écrit pour son peuple, quand il utilise le passé, doit le faire dans l’intention d’ouvrir l’avenir, d’inviter à l’action, de fonder l’espoir. Mais pour assurer l’espoir, pour lui donner densité, il faut participer à l’action, s’engager corps et âme dans le combat national. Il faut musculairement collaborer. L’homme de culture colonisé ne doit pas se préoccuper de choisir le niveau de son combat, le secteur où il décide de livrer le combat national. Se battre pour la culture nationale, c’est d’abord se battre pour la libération de la nation, matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible. La culture nationale est l’ensemble des efforts faits par un peuple sur le plan de la pensée pour décrire, justifier et chanter l’action à travers laquelle le peuple s’est constitué et s’est maintenu. La culture nationale, dans les pays sous-développés, doit donc se situer au centre même de la lutte de libération que mènent ces pays. Les hommes de culture africains qui se battent encore au nom de la culture négro-africaine, qui ont multiplié les congrès au nom de l’unité de cette culture doivent aujourd’hui se rendre compte que leur activité s’est ramenée à confronter des pièces ou à comparer des sarcophages. Il n’y a pas de communauté de destin des cultures nationales sénégalaise et guinéenne mais communauté de destin des nations guinéenne et sénégalaise dominées par le même colonialisme français.
La culture négro-africaine, c’est autour de la lutte de libération des peuples qu’elle se construit et se densifie et non autour des chants, des poèmes ou du folklore. On ne peut vouloir le rayonnement de la culture africaine si l’on ne contribue pas concrètement à l’existence des conditions de cette culture, c’est-à-dire à la libération du continent.
IV
Fondements réciproques de la culture nationale et des luttes de libération
La domination coloniale, parce que totale et simplifiant, a tôt fait de disloquer de façon spectaculaire l’existence culturelle du peuple soumis. Tous les efforts sont faits pour amener le colonisé à confesser l’infériorité de sa culture transformée en conduites instinctives, à reconnaître l’irréalité de sa nation. Face à cette situation, la réaction du colonisé n’est pas univoque. Tandis que les masses maintiennent intactes les traditions les plus hétérogènes à la situation coloniale, tandis que le style artisanal se solidifie dans un formalisme de plus en plus stéréotypé, l’intellectuel se jette frénétiquement dans l’acquisition forcenée de la culture de l’occupant en prenant soin de caractériser péjorativement sa culture nationale, ou se cantonne dans l’énumération circonstanciée, méthodique, passionnelle et rapidement stérile de cette culture. Le caractère commun de ces deux tentatives est qu’elles débouchent l’une et l’autre sur des contradictions insupportables. Le colonisé est inefficace parce qu’il n’analyse pas la situation coloniale avec rigueur. Il n’y a pas, il ne saurait y avoir de culture nationale, de vie culturelle nationale, d’inventions culturelles ou de transformations culturelles nationales dans le cadre d’une domination coloniale. La culture nationale est, sous la domination coloniale, une culture condamnée à la clandestinité. Au bout d’un ou deux siècles d’exploitation, la culture nationale devient un stock d’habitudes motrices, de traditions vestimentaires, d’institutions morcelées. Il n’y a pas de créativité vraie, pas d’effervescence.
Misère du peuple, oppression nationale et inhibition de la culture sont une seule et même chose. Ils acculent de plus en plus le colonisé à la lutte ouverte et organisée. Alors qu’au début l’intellectuel colonisé produisait à l’intention exclusive de l’oppresseur, soit pour le charmer, soit pour le dénoncer, il adopte progressivement l’habitude de s’adresser à son peuple. C’est seulement à partir de ce moment que l’on peut parler de littérature nationale. C’est la littérature de combat proprement dite, en ce sens qu’elle convoque tout un peuple à la lutte pour l’existence nationale. Littérature de combat, parce qu’elle informe la conscience nationale, lui donne forme et contours et lui ouvre de nouvelles et d’illimitées perspectives. Littérature de combat, parce qu’elle prend en charge, parce qu’elle est volonté temporalisée. À un autre niveau, la littérature orale, les contes, les épopées, les chants populaires autrefois répertoriés et figés commencent à se transformer. Les conteurs qui récitaient des épisodes inertes les animent et y introduisent des modifications de plus en plus fondamentales. Il y a tentative d’actualiser les conflits, de moderniser les formes de lutte évoquées, les noms des héros, le type des armes. Chaque fois que le conteur expose devant son public un épisode nouveau, il est révélé au public l’existence d’un nouveau type d’homme. Le conteur redonne liberté à son imagination, innove, fait œuvre créatrice. Sur le plan artisanal, les formes sédimentées et comme frappées de stupeur progressivement se tendent, se modifient et se réadaptent. Les spécialistes colonialistes ne reconnaissent pas ces formes nouvelles et accourent au secours des traditions de la société autochtone. Ce sont les colonialistes qui se font cette fois les défenseurs du style indigène. Ils auraient souhaité voir le colonisé répéter incessamment le même style, sans évoluer. Parce qu’il renouvelle les intentions et la dynamique de l’artisanat, de la danse et de la musique, de la littérature et de l’épopée orale, le colonisé restructure sa perception. Le monde perd son caractère maudit. Les conditions sont réunies pour l’inévitable confrontation.
La culture est d’abord expression d’une nation, de ses préférences, de ses interdits, de ses modèles. Dans la situation coloniale, la culture privée du double support de la nation et de l’État dépérit et agonise. La condition d’existence de la culture est donc la libération nationale, la renaissance de l’État. Il ne peut donc avoir culture à la période coloniale puisque l’Etat pour la soutenir n’existe pas. Il ne peut aussi avoir de culture africaine à la période des indépendances, puisque son double qui est l’Etat continental n’existe pas. C’est d’abord le combat pour l’existence nationale qui débloque la culture, lui ouvre les portes de la création. C’est plus tard la nation qui assurera à la culture les conditions, le cadre d’expression. La lutte organisée et consciente entreprise par un peuple colonisé pour rétablir la souveraineté de la nation constitue la manifestation la plus pleinement culturelle qui soit. La lutte de libération ne restitue pas à la culture nationale sa valeur et ses contours anciens. Cette lutte qui vise à une redistribution fondamentale des rapports entre les hommes ne peut laisser intacts ni les formes ni les contenus culturels de ce peuple. Après la lutte il n’y a pas seulement disparition du colonialisme mais aussi disparition du colonisé. Un combat qui mobilise toutes les couches du peuple, qui exprime les intentions et les impatiences du peuple, qui ne craint pas de s’appuyer presque exclusivement sur ce peuple, est nécessairement triomphant. La valeur de ce type de combat est qu’il réalise le maximum de conditions pour le développement et l’invention culturels. Les lendemains de la culture, la richesse d’une culture nationale sont fonction des valeurs qui ont hanté le combat libérateur.
La revendication nationale, dit-on çà et là, est une phase que l’humanité a dépassée. L’heure est aux grands ensembles et les attardés du nationalisme doivent en conséquence corriger leurs erreurs. Nous pensons au contraire que l’erreur, lourde de conséquences, consisterait à vouloir sauter l’étape nationale. L’intellectuel africain doit d’abord construire sa nation. C’est au cœur de la conscience nationale que s’élève et se vivifie la conscience internationale. Et cette double émergence n’est, en définitive, que le foyer de toute culture.
V
Guerre coloniale et troubles mentaux
L’impérialisme, qui aujourd’hui se bat contre une authentique libération des hommes, abandonne çà et là des germes de pourriture qu’il nous faut implacablement détecter et extirper de nos terres et de nos cerveaux. La vérité est que la colonisation, dans son essence, se présentait déjà comme une grande pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. Parce qu’il est une négation systématisée de l’autre, une décision forcenée de refuser à l’autre tout attribut d’humanité, le colonialisme accule le peuple dominé à se poser constamment la question : « Qui suis-je en réalité ? » Un peuple colonisé n’est pas seulement un peuple dominé. Quand la somme d’excitations nocives dépasse un certain seuil, les positions défensives des colonisés s’écroulent, et ces derniers se retrouvent alors en nombre important dans les hôpitaux psychiatriques.
Aujourd’hui la guerre de libération nationale que mène le peuple algérien depuis sept ans, parce qu’elle est totale chez le peuple, est devenue un terrain favorable à l’éclosion des troubles mentaux. L’événement déclenchant est principalement l’atmosphère sanglante, impitoyable, la généralisation de pratiques inhumaines, l’impression tenace qu’ont les gens d’assister à une véritable apocalypse. L’événement déclenchant particulier c’est la guerre coloniale qui très souvent prend l’allure d’un authentique génocide.
V
Série A
CAS No 1.
Impuissance chez un algérien consécutive au viol de sa femme.
B... est un homme de 26 ans membre du Front de Libération Nationale Algérien. Avec son taxi, il avait l’habitude d’accompagner les commandos du FLN poser les bombes dans les villes et mener des actions de guérilla urbaine. Un jour, une attaque tourne mal et il doit abandonner son véhicule pour rejoindre le maquis le plus proche. Les militaires français, le recherchant, arrivent chez lui. Puisqu’il est absent, ils amènent sa femme au poste et elle se fait violer par deux militaires français, après être torturée. Après deux années, il parvient à entrer en contact avec sa femme qui rompt leur relation et lui explique ce qui s’est passé. Ce cas était fréquent chez les combattants. B… explique la situation et les autres soldats dont les femmes ont été violées le consolent. Après quelques années, il est envoyé en mission hors du pays. Il y tente plusieurs aventures sexuelles qui ne marchent pas. Il se rends compte qu’il est devenu sexuellement impuissant. Avant toute tentative sexuelle, il ne peut s’empêcher de penser à sa femme et il s’imagine la scène de viol. Il ne peut s’empêcher de se sentir coupable de ce qui lui est arrivée puisque c’est lui qu’on cherchait. Elle a été violée parce qu’elle a gardé le silence, a refusé de parler. Elle aurait pu dire le nom d’un militant qu’on pouvait utiliser pour détruire le réseau et l’arrêter ou le tuer. Sa femme l’avait sauvé la vie et protégé son réseau. Pire elle ne s’était pas indignée de ce qu’elle avait subi à cause de lui. Etant un soldat du FLN, il avait encouragé les civils à épouser les femmes violées par les militaires français, même si certaines portaient des enfants de ces militaires. Il ne savait pas comment aborder sa femme.
CAS No 2
Pulsions homicides indifférenciées chez un rescapé d’une liquidation collective
S.... 37 ans, ne s’est jamais occupé de politique. Depuis le début de la guerre, sa région est le lieu de batailles violentes entre les forces algériennes et l’armée française. De temps à autre, comme l’ensemble du peuple, les paysans de son village viennent en aide aux combattants algériens de passage. Mais un jour, au début de 1958, a lieu une embuscade meurtrière non loin du douar où il habite. Les forces françaises montent une opération et assiègent le village. Tous les habitants sont réunis et interrogés. Personne ne répond. Les soldats mettent le feu aux maisons. Les hommes sont réunis et fusillés. Vingt-neuf hommes sont tués à bout portant. S... est blessé de deux balles qui lui traversent respectivement la cuisse droite et le bras gauche. Il s’évanouit et reprend connaissance au milieu d’un groupe de l’ALN. Il est soigné et évacué. En cours de route, son comportement de plus en plus anormal ne cesse d’inquiéter l’escorte. Il réclame un fusil, alors qu’il est civil et impotent, et refuse de marcher devant qui que ce soit. Il ne veut personne derrière lui. Une nuit, il s’empare de l’arme d’un combattant et maladroitement tire sur les soldats endormis. Il a envie de tuer tout le monde. Désormais il aura les mains liées, et c’est ainsi qu’il arrive au centre psychiatrique. En fait il ne comprend pas pourquoi il a été le seul survivant de cette fusillade.
CAS No 3
Psychose anxieuse grave à type de dépersonnalisation après le meurtre forcené d’une femme
Dj..., ancien étudiant, militaire dans l’ALN, 19 ans. Quand il arrive au Centre, sa maladie remonte à plusieurs mois. Sa présentation est caractéristique : fortement déprimé, les lèvres sèches, les mains constamment moites. Insomnie tenace. Deux tentatives de suicide depuis le début des troubles. Il parle de son sang répandu, de ses artères qui se vident, de son cœur qui a des ratés. Il nous supplie d’arrêter l’hémorragie, de ne plus tolérer qu’on vienne le « vampiriser » jusqu’à l’hôpital. En fait, étant étudiant, il était au maquis quand il apprend que sa mère a été tuée à bout portant par un soldat français et ses deux sœurs emmenées chez les militaires français. A la mort de son père, étant le seul homme, il était le responsable de la sécurité de la famille. Il avait pour ambition de s’occuper de sa mère et de ses sœurs. Un jour, ils sont allés dans une propriété de colons où le gérant, actif colonialiste, avait déjà abattu deux civils algériens. Il y avait à la maison seulement sa femme. Le groupe décida d’attendre le mari. Mais quand il regardait la femme, il pensait à sa mère. Elle se rendit compte de sa volonté de la tuer et se jeta sur lui pour le supplier. Mais il la transperça le cœur avec son couteau. Son chef le désarma et lui intima l’ordre de quitter la pièce. Quelques temps après cette femme commençait à venir dans ses rêves lui demander de rendre son sang. Le jeune malade est soigné plusieurs semaines et les cauchemars ont pratiquement disparu.
CAS No 4
Un gardien de police européen déprimé rencontre en milieu hospitalier une de ses victimes, un patriote algérien atteint de stupeur
A.... 28 ans, marié, sans enfant. Bons rapports avec ses camarades de travail. Ce qui l’embête, c’est que la nuit il entend des cris qui l’empêchent de dormir. Il nous apprend que depuis plusieurs semaines, avant de se coucher il ferme les volets et calfeutre les fenêtres au grand désespoir de sa femme qui étouffe de chaleur. Il remplit ses oreilles de coton, afin d’atténuer la violence des cris. Quelquefois même, en pleine nuit, il allume le poste TSF ou met de la musique pour ne pas entendre ces nocturnes clameurs. Dès lors, A... va nous exposer très longuement son drame. Depuis plusieurs mois, il est affecté à une brigade anti-FLN. Au début, il était chargé de la surveillance de quelques établissements ou cafés. Mais après quelques semaines, il travaillera presque constamment au commissariat. C’est alors qu’il a l’occasion de pratiquer des interrogatoires. Il torture pour extraire des informations qu’on ne veut pas donner. Il torture souvent jusqu’à la mort. Rentré chez lui, il ne cesse d’écouter les cris de ces soupçonnés arrêtés qu’on torture. Il les écoute toute la nuit. Un jour, alors qu’il venait me retrouver à l’hôpital, il rencontre un de mes malades qu’il avait interrogé dans les locaux de la police. Il est abattu et transpire. Le malade qui de son côté a reconnu le policier croit que celui-ci est venu le chercher pour le conduire à nouveau dans les locaux de la police. Il a tenté de se suicider.
V
Série B
CAS No 1
Assassinat par deux jeunes algériens de 13 et 14 ans de leur camarade de jeux européen
Tous les jeudis, les trois amis allaient chasser ensemble à la fronde sur la colline, au-dessus du village. Un jour les deux algériens décident de tuer leur camarade européen parce que les « Européens veulent tuer tous les Algériens ». Ne pouvant pas tuer les « grands », ils se sont attaqués à leur camarade qui est à leur niveau. En fait, en 1956, quarante hommes du village Rivet ont été retirés de leurs lits un soir par les miliciens français et assassinés. Parmi ces hommes se trouvaient deux proches parents des deux enfants. Puisqu’aucun de ces miliciens n’a été interpellé, les enfants ont décidé de rendre justice en tuant leur camarade européen.
CAS No 2
Délire d’accusation et conduite-suicide déguisée en « acte terroriste » chez un jeune algérien de 22 ans
Au début de la guerre, il n’a aucune réaction à l’égard de la lutte nationale. Pourtant, vers le milieu de 1955, au cours d’une veillée familiale, il a soudain l’impression que ses parents le considèrent comme un traître. Il fuit le milieu familial et s’enferme dans sa chambre, évite tous les contacts. Un jour, en pleine rue, vers midi et demi, il entend distinctement une voix le traiter de lâche. Il se retourne, mais ne voit personne. Dans la nuit, il entend toutes sortes d’insultes, des voix dans sa tête et dans la nuit le traitant de traitre face à la situation et la mort de ses frères. Il ne peut plus rien avaler. Il maigrit, se confine dans une obscurité absolue, refuse d’ouvrir à ses parents. Il se jette à la prière et prie 17 à 18 heures par jour. Il se comporte comme un fou. Un jour, il s’habille en veste et se retrouve au quartier européen. Il n’est pas interpellé alors qu’il n’a pas de papiers, tandis que les autres Algériens et des Algériennes sont arrêtés, bousculés, insultés, fouillés. Cette gentillesse des patrouilles ennemies à son égard le confirme dans son délire. Pour lui, tout le monde sait qu’il est avec les Français. Les soldats eux-mêmes ont reçu des consignes de ne pas l’interpeller. Les Algériens arrêtés, les mains derrière la nuque, attendant la fouille, lui semble chargé de mépris. Il s’avance vers les soldats, se jette sur l’un d’eux et essaie de lui arracher sa mitraillette en criant : « Je suis un Algérien. » Rapidement maîtrisé, il est conduit dans les locaux de la police où l’on s’obstine à lui faire avouer les noms de ses chefs et ceux des différents membres du réseau auquel il appartient. Au bout de quelques jours les policiers et les militaires s’aperçoivent qu’ils ont affaire à un malade. Il était content d’être torturé pour se sentir ennemi, pour ne pas se sentir traitre.
V
De l’impulsivité criminelle du Nord-Africain à la guerre de Libération nationale
Il ne faut pas seulement combattre pour la liberté de son peuple. Il faut aussi pendant tout le temps que dure le combat réapprendre à ce peuple et d’abord réapprendre à soi-même la dimension de l’homme. Il faut remonter les chemins de l’histoire, de l’histoire de l’homme damné par les hommes, et provoquer, rendre possible la rencontre de son peuple et des autres hommes. En réalité le militant qui est engagé dans un combat armé, dans une lutte nationale, a l’intention de mesurer au jour le jour toutes les dégradations infligées à l’homme par l’oppression coloniale. La période d’oppression est douloureuse, mais le combat, en réhabilitant l’homme opprimé, développe un processus de réintégration qui est extrêmement fécond et décisif. Le combat victorieux d’un peuple ne consacre pas uniquement le triomphe de ses droits. Il procure à ce peuple densité, cohérence et homogénéité. Le combat que mène un peuple pour sa libération le conduit selon les circonstances soit à rejeter, soit à faire exploser les prétendues vérités installées dans sa conscience par l’administration civile coloniale, l’occupation militaire, l’exploitation économique. Et, seul, le combat peut réellement exorciser ces mensonges qui infériorisent et littéralement mutilent les plus conscients d’entre nous. En régime colonial, la gratitude, la sincérité, l’honneur sont des mots vides. L’honneur, la dignité, le respect de la parole donnée ne peuvent se manifester que dans le cadre d’une homogénéité nationale et internationale. Dès lors que vous et vos semblables êtes liquidés comme des chiens, il ne vous reste plus qu’à utiliser tous les moyens pour rétablir votre poids d’homme. Le combattant algérien a une façon inhabituelle de se battre et de mourir et nulle référence à l’islam ou au Paradis promis ne peut expliquer cette générosité de soi quand il s’agit de protéger le peuple ou de couvrir les frères. Parmi les caractéristiques du peuple algérien telles que le colonialisme les avait établies nous retiendrons sa criminalité effarante. Avant 1954, les magistrats, les policiers, les avocats, les journalistes, les médecins légistes convenaient de façon unanime que la criminalité de l’Algérien faisait problème. L’Algérien, affirmait-on, est un criminel-né. Une théorie fut élaborée, des preuves scientifiques apportées. Cette théorie fut l’objet pendant plus de 20 ans d’un enseignement universitaire. Des Algériens étudiants en médecine reçurent cet enseignement.
La pratique révolutionnaire, si elle se veut globalement libératrice et exceptionnellement féconde exige que rien d’insolite ne subsiste. La conscience alors ne rechigne pas à revenir en arrière, à marquer le pas s’il le faut. C’est pourquoi, dans la progression sur le terrain d’une unité de combat, la fin d’une embuscade ne signifie pas le repos mais bien le moment pour la conscience de faire un bout de chemin, car tout doit aller de pair. Depuis 1954 au début de la guerre, on assiste en Algérie à une quasi-disparition des crimes de droit commun. Plus de disputes, plus de détails insignifiants entraînant mort d’homme. La lutte nationale semble avoir canalisé toutes les colères, nationalisé tous les mouvements affectifs ou émotionnels. C’est une constatation banale que les grandes secousses sociales diminuent la fréquence de la délinquance et les troubles mentaux.
Pour un colonisé, dans un contexte d’oppression comme celui de l’Algérie, vivre ce n’est point incarner des valeurs, s’insérer dans le développement cohérent et fécond d’un monde. Vivre c’est se battre pour ne pas mourir. Chaque journée vécue est une victoire. Aussi voler les dattes, permettre à son mouton de manger l’herbe du voisin ne sont pas négation de la propriété d’autrui, transgression d’une loi ou irrespect. Ce sont des tentatives de meurtres. Il faut avoir vu en Kabylie des hommes et des femmes des semaines durant aller chercher de la terre au fond de la vallée et la remonter par petits paniers pour comprendre qu’un vol est une tentative de meurtre et non un geste inamical ou illégal. C’est que la seule perspective est cet estomac de plus en plus rétréci, de moins en moins exigeant certes, mais qu’il faut tout de même contenter. La criminalité de l’Algérien, son impulsivité, la violence de ses meurtres ne sont donc pas la conséquence d’une organisation du système nerveux ni d’une originalité caractérielle mais le produit direct de la situation coloniale. L’objectif du colonisé qui se bat est de provoquer la fin de la domination. Mais il doit également veiller à la liquidation de toutes les non-vérités fichées dans son corps par l’oppression. La libération totale est celle qui concerne tous les secteurs de la personnalité. L’embuscade ou l’accrochage, la torture ou le massacre de ses frères enracinent la détermination de vaincre, renouvellent l’inconscient et alimentent l’imagination. Quand la nation démarre en totalité, l’homme nouveau n’est pas une production a posteriori de cette nation mais coexiste avec elle, se développe avec elle, triomphe avec elle. L’indépendance n’est pas un mot à exorciser mais une condition indispensable à l’existence des hommes et des femmes vraiment libérés, c’est-à-dire maîtres de tous les moyens matériels qui rendent possible la transformation radicale de la société.
Ce résumé est mis à votre disposition gratuitement par la Ligue Associative Africaine. Lisez le et faites le lire à toutes vos connaissances si possibles. Allez dans notre site web www.ligueaa.org pour télécharger d’autres résumés d’ouvrages et de centaines de milliers d’articles sur la renaissance africaine. Les portes de la Ligue Associative Africaine sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent une renaissance africaine et qui veulent mener avec nous la Grande Révolution Panafricaine et proclamer avec nous la République de Fusion Africaine.
Nous vous attendons.
Fraternellement.