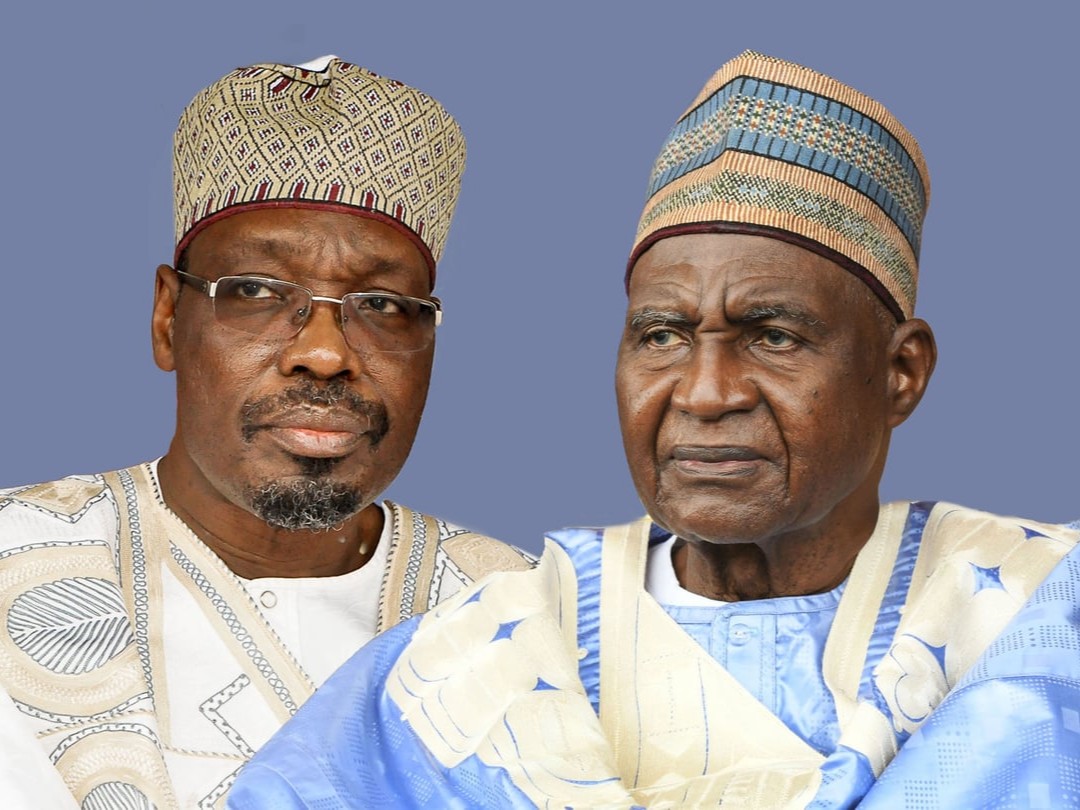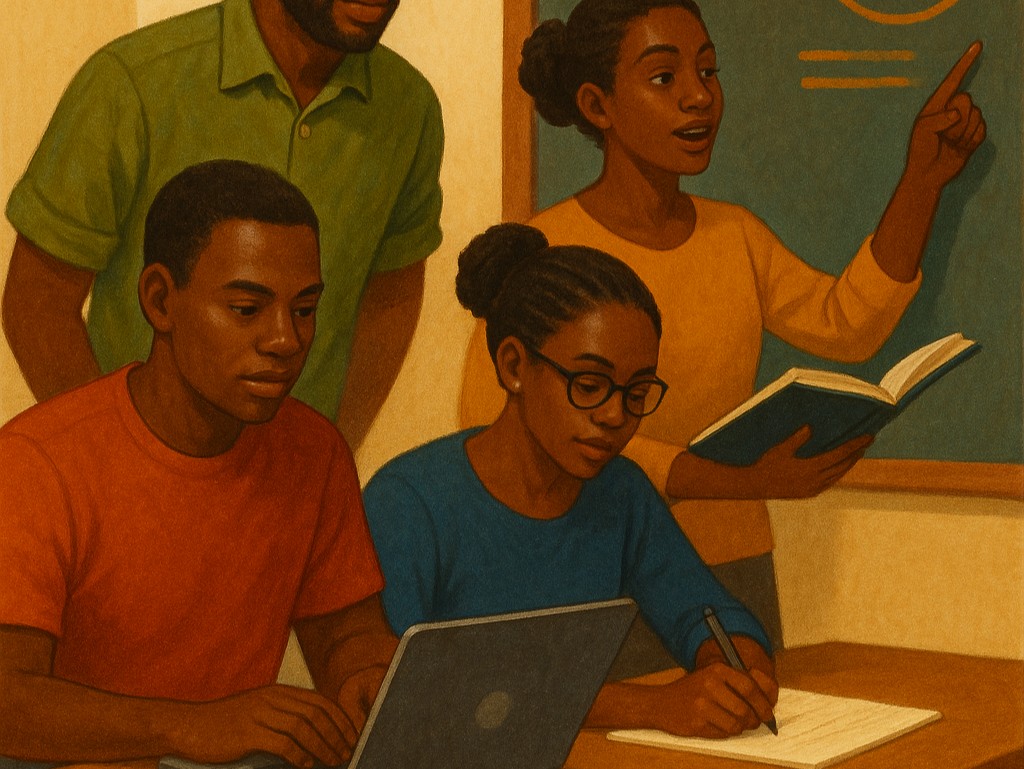Quelques textes contenus dans La lutte des classes en Afrique
Texte 1 :
L'Afrique toute entière a connu l'oppression et l'exploitation, et il n'est pas un Etat africain qui ne soit engagé dans la lutte révolutionnaire. Partout apparaît l'unité fondamentale des masses africaines animées d'un même idéal ; et il n'est pas de dirigeant qui ne prétende au moins être acquis à la cause des objectifs révolutionnaires de libération et d'unification totales de l'Afrique dans le socialisme qui ne saurait garder le pouvoir. Ainsi le moment est venu de passer à la phase décisive du processus révolutionnaire, par lequel la lutte armée qui est devenue pratique courante en Afrique doit être intensifiée et coordonnée à des niveaux stratégiques et tactiques.
En même temps, il faut s'attaquer à la minorité réactionnaire fortement retranchée parmi nos peuples. Car la succession de coups d'Etat réactionnaires perpétrés en Afrique occidentale et centrale démontre clairement l'importance et la nature de la lutte des classes en Afrique et le rapport existant entre les intérêts du néo-colonialisme et ceux de la bourgeoisie locale.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 2 :
La révolution africaine est partie intégrante de la révolution socialiste mondiale ; de même que la lutte des classes est la base du processus révolutionnaire mondial, de même est-elle à la base de la lutte des ouvriers et paysans d'Afrique. Pendant la période précédant les mouvements d'indépendance, il y eut un semblant d'unité nationale (les divisions sociales contemporaines s'effacèrent momentanément) et toutes les classes se liguèrent dans le but de chasser le pouvoir colonial. C'est cette époque qui inspira la thèse selon laquelle l'Afrique ne connaissait pas de divisions sociales et qu'il ne pouvait être question de lutte de classes dans une société traditionnelle africaine communautaire et égalitaire. Cette théorie s'avéra fausse. L'indépendance ramena les divisions sociales, qui avaient provisoirement disparu, avec une intensité accrue, surtout dans les Etats nouvellement indépendants de tendance socialiste. Car la bourgeoisie africaine, classe qui bénéficia du colonialisme, est encore celle qui bénéficie, après l'Indépendance, du néo-colonialisme. Son intérêt réside dans le maintien de structures socio- économiques capitalistes. Son alliance avec le néo- colonialisme et les monopoles financiers capitalistes internationaux la met donc en conflit direct avec les masses africaines dont les aspirations ne seront réalisées que dans socialisme scientifique.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 3 :
De façon générale, les peuples africains passèrent, au début de l'ère coloniale, à un stade supérieur de société communautaire caractérisé, d'une part, par la désintégration de la démocratie tribale, et d'autre part l'émergence de rapports féodaux et de systèmes héréditaires tribaux et monarchiques. Sous la poussée de l'impérialisme et du colonialisme, les structures socio-économiques de ce type de société s'effondrèrent, après l'introduction de cultures d'exportation telles que le cacao et le café. Les économies des colonies furent alors étroitement liées aux marchés du monde capitaliste. Avec le capitalisme et l'individualisme, des tendances à la propriété privée se développèrent. Peu à peu, la société communautaire primitive se désintégra, et ce fut le déclin de l'esprit collectif. Il y eut alors une expansion de l'exploitation agricole privée et de la petite production.
Les Européens n'eurent aucune difficulté à s'approprier des terres qui étaient biens publics. Ainsi, en 1892, au Malawi, plus de 16 % des terres furent appropriées et passèrent, pour les trois quarts, sous le contrôle de onze grosses sociétés. Dans certains cas, les «propriétaires » africains reçurent en bail des terres que les colonisateurs jugeaient peu rentables pour eux- mêmes. Ces derniers recevaient du gouvernement britannique, par l'intermédiaire des consulats, des titres de propriété. Et toute terre, n'appartenant à personne en particulier, était déclarée «propriété de la Couronne»
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 4 :
Ainsi la lutte des classes en Afrique fut d'abord dirigée contre l'impérialisme et non contre la bourgeoisie locale. C'est ce qui a retardé l'éveil des masses africaines, les empêchant ainsi de se réaliser plus tôt que la bourgeoisie locale était leur ennemi véritable.
A l'issue de la période coloniale, la plupart des Etats africains étaient dotés d'une machine administrative bien constituée, ainsi que d'un semblant de démocratie parlementaire, dissimulant un Etat coercitif dirigé par une elite bureaucratique toute-puissante. Ces Etats comprenaient : une intelligentsia totalement acquise aux valeurs occidentales, un mouvement ouvrier pratiquement inexistant, une armée et une police dont les cadres avaient été formés dans les académies militaires occidentales, et des dirigeants formés à une administration de type colonial.
Cependant, il faut heureusement noter l'apparition, au cours des luttes de libération nationales, de dirigeants issus des masses, dont ils avaient l'appui. Leurs objectifs ne se limitaient pas seulement à la libération politique, mais aussi à une transformation totale de la société. Si ces leaders révolutionnaires s'allièrent à la bourgeoisie nationale durant les luttes pour l'indépendance nationale, ils s'en séparèrent aussitôt l'indépendance acquise, bien décidés à réaliser leurs idéaux socialistes. La lutte continue.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 5 :
La lutte des
classes est un thème historique fondamental. Toute société non-socialiste
comprend deux grandes catégories de classes : les classes dirigeantes et les
classes assujetties. Les premières détiennent les instruments économiques de
production et de distribution, et les moyens d'établir leur domination
politique, cependant que les classes assujetties ne font que servir les
intérêts des classes dirigeantes dont elles dépendent sur les plans politique,
économique et social. Le conflit opposant dirigeants et assujettis est le
résultat du développement des forces de production. C'est-à-dire que dans toute
classes donnée (féodale, capitaliste ou autre), les institutions et les idéaux
sont fonction du niveau des forces et des modes de production. Avec
l'introduction de la propriété privée et de l'exploitation capitaliste des
travailleurs, les capitalistes devinrent une nouvelle classe - la bourgeoisie -
et les travailleurs exploités formèrent la classe ouvrière car, en dernière
analyse, une classe n'est rien d'autre qu'un ensemble d'individus liés par
certains intérêts qu'ils essaient de sauvegarder.
Texte 6 :
Dans les colonies britanniques, un certain degré d’urbanisation permit le développement d'une bourgeoisie et de minorités élitaires bourgeoises aux attitudes et aux organisations nettement définies. Obtenir un travail de bureau devint l'ambition de tout Africain désireux de s'élever dans la hiérarchie sociale. Les travaux manuels et agricoles semblaient indignes de tous ceux qui avaient reçu même le plus rudimentaire degré d'instruction. Mais ce ne fut qu'après la conquête coloniale qu'une structure de classe de type européen se développa, dégageant deux groupes bien distincts : le prolétariat et la bourgeoisie. Cela, les observateurs réactionnaires n'ont jamais voulu l'admettre, prétendant que les sociétés africaines étaient homogènes, donc sans classes. Une telle théorie est un défi à l'évidence même de la lutte des classes qui fait rage depuis le début des indépendances. La bourgeoisie s'est ouvertement alliée aux néo-colonialistes, colonialistes et impérialistes, dans le vain espoir de maintenir les masses africaines dans un état permanent de sujétion.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 7 :
Par sa seule apparence générale, son comportement et ses habitudes vestimentaires, il est possible de replacer un individu dans son milieu d'origine. Chaque classe a aussi ses institutions et ses organisations : coopératives et syndicats, par exemple, sont propres à la classe ouvrière tandis que les associations professionnelles, Chambres de commerce, Bourses des valeurs, clubs «Rotary», les loges franc-maçonniques, etc., sont des institutions bourgeoises.
Les idéologies ne font qu'exprimer la conscience et les intérêts des classes : le libéralisme, l'individualisme, l'élitisme et la « démocratie » bourgeoise - qui n'est qu'illusion - sont des exemples d'idéologie bourgeoise. Le fascisme, l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme sont également l'expression de la pensée, des aspirations politiques et économiques bourgeoises. Le socialisme et le communisme, par contre, sont les idéologies de la classe ouvrière, dont elles reflètent les aspirations et les institutions politiques et économiques.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 8 :
En réponse à la poussée révolutionnaire dans le monde ces dernières années, la réaction a lancé une nouvelle terminologie trompeuse. Les mythes de «la majorité silencieuse » et du «citoyen moyen » en sont autant d'exemples, s'appliquant à l'esprit contrerévolutionnaire, en faveur du statut quo. En réalité la classe ouvrière qui est la majorité dans les sociétés capitalistes, est loin d'être silencieuse : elle crie bien haut son intention de réaliser une formation radicale de la société.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 9 :
Désireuse d'adopter les théories et tendances de la bourgeoisie européenne, la bourgeoisie africaine a souvent confondu classes et races. Ne connaissant pas suffisamment la société européenne, elle est incapable de discerner les caractéristiques de chaque classe, tant dans le comportement que dans le langage, les habitudes vestimentaires, bref tout ce qui, en Europe, trahit ie milieu d'origine. Ce sont des membres de la classe ouvrière qui vivent en bourgeois dans les colonies.
Malgré le grand train de vie qu'ils y mènent, (ils possèdent des voitures, des domestiques, leurs femmes sont libérées des travaux ménagers), leurs origines sociales ne peuvent échapper à la perspicacité de leurs compatriotes. Aspirant à un statut social élevé, au lendemain de l'indépendance, la bourgeoisie indigène se mit à copier le mode de vie de ses anciens maîtres coloniaux, sans savoir qu'elle imitait en fait une race et non une classe. La bourgeoisie africaine a donc adopté un mode de vie qui, tout en étant celui de l'ancienne classe dirigeante n'est pas vraiment celui de la bourgeoisie européenne. Elle a donc pris les habitudes d'un groupe racial dans une situation coloniale. En ce sens, la bourgeoisie africaine ne fait que perpétuer la relation maître-serviteur de la période coloniale.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 10 :
Tout en adoptant servilement les idéologies de la bourgeoisie capitaliste, la bourgeoisie africaine a créé certains mythes, développés dans un contexte africain, et qui reflètent bien la mentalité bourgeoise africaine. La prétendue théorie de la «Négritude» en est peut-être l'exemple le plus frappant. Cette pseudo-théorie apparente la bourgeoisie africaine au monde culturel français. Cette conception irrationnelle et raciste, imbue des valeurs de l'Occident, et contre-révolutionnaire, reflète bien la confusion qui règne dans l'esprit de certains intellectuels africains d'expression française; d'autant plus qu'elle donne une description erronée de la personnalité africaine.
Le «socialisme africain» est une autre conception inconsistante et sans fondements, qui tend à démontrer qu'il existe une forme de socialisme réservé exclusivement à l'Afrique, se basant sur les structures communautaires et égalitaires de la société africaine traditionnelle. Il est utilisé dans le but de nier l'existence d'une lutte de classes et d'apporter la confusion dans l'esprit des vrais militants socialistes, ainsi que par certains dirigeants africains, contraints d'adopter une théorie socialiste, en raison de la poussée révolutionnaire, mais non désireux de donner une tendance socialiste au développement économique de leur pays et se réclamant, en fait, du capitalisme international.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 11 :
Si la révolution socialiste n'est pas encore passée au stade du dogme, si elle n'a pas non plus reçu la consécration de l'Histoire, il est évident qu'elle ne peut reposer sur des compromis, et que les principes du socialisme sont immuables et tendent à la socialisation des modes de production et de distribution. Tous ceux qui, par opportunisme politique, se disent socialistes tout en se réclamant de l'impérialisme, servent les intérêts de la bourgeoisie. Momentanément induites en erreur, les masses finiront par en prendre conscience et par démasquer ce prétendu socialisme, rendant ainsi possible l'avènement d'une authentique révolution socialiste. Dans le monde moderne, la lutte des races est devenue partie uintégrante de la lutte des classes. En d’autres termes : le prolétariat racial est en même teùps un problème de classes.
En Afrique, comme partout ailleurs, l’industrialisation a accéléré la croissance de la bourgeoisie et en même temps celle d’un prolétariat conscient. Ces deux classes, fondamentalement opposées dans leurs objectifs (la bourgeoisie n’ayant d’autre ambition que son enrichissement et le pouvoir politique, tandis que le prolétariat se veut socialiste et nationaliste) constituent les fondements de l’Etat raciste. Ces deux classes se proposent de deux idéologies bien différentes : la bourgeoisie se veut capitaliste, tandis que le prolétariat tend au socialisme.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 12 :
L’émergence d’une société non raciale ne peut aboutir qu’à la suite d’une action révolutionnaire des masses. Elle ne sera jamais un don de la minorité dirigeante, car il est impossible de séparer les relations raciales des relations de classes qui les nourrissent. Là encore, on pourrait citer l’exemple de l’Afrique du Sud. Au début de la colonisation hollandaise, les distinctions ne se faisaient pas entre Blancs et Noirs, mais entre chrétiens et païens. Ce n’est qu’avec la pénétration économique capitaliste qu’apparurent les rapports féodaux de type capitaliste et la discrimination raciale connue sous le nom d’apartheid. L’apartheid est le système le plus intolérable et le plus inique jamais engendré par l’Occident bourgeois capitaliste : 80 % de la population d’Afrique du Sud n’étant pas de race blanche, n’ont pas droit au vote. L’esclavage et la domination raciste coloniale sont donc la cause, et non la conséquence, du racisme. Cette situation se cristallisa et se renforça après la découverte de l’or et des diamants. La main d’œuvre africaine fut alors achetée à bas prix. Avec le temps, il devint nécessaire de justifier l’exploitation et l’oppression des travailleurs africains. Ainsi naquit le mythe de l’infériorité raciale.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 13 :
Les adeptes de l'élitisme affirment que c'est pratiquement toujours une minorité qui a le pouvoir et qu'elle échappe au contrôle de la majorité, quelles que soient les institutions démocratiques en vigueur. De plus, la force de cohésion des élites est leur atout principal. Quoique numériquement faibles par rapport à l'ensemble de la nation, elles possèdent une incontestable puissance. L'idéologie élitiste est donc bien faite pour soutenir la doctrine capitaliste et appuyer une reconnaissance formelle de la domination de facto de la bourgeoisie dans la société capitaliste. Une telle idéologie permettant de défendre le mythe de la supériorité et de l'infériorité raciales, ne peut par conséquent qu'intensifier les préjugés raciaux.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 14 :
La bourgeoisie africaine a des élites européanisées. A l'époque coloniale, ceux qui étaient à la tête des conseils législatifs et des services administratifs, ou dans les professions juridiques, médicales, administratives, ou qui avaient de hautes fonctions dans l'armée et la police, constituaient l'élite. Leur position s'est renforcée après l'Indépendance. De plus, ils n'étaient plus soumis à une autorité coloniale. Dans les nouveaux Etats, les membres des professions libérales bénéficièrent des politiques d'africanisation.
C'est aussi à cette époque qu'apparurent ce que l'on peut appeler «les nouveaux riches du Parti». C'est une élite qui se développa au sein même du Parti qui arracha l'indépendance politique au colonialisme. Les tendances de Droite et de Gauche entrèrent en conflit, car, une fois l'Indépendance acquise et le Parti au pouvoir, les éléments de Droite n'eurent d'autre ambition que leur enrichissement personnel. Ils se servirent de leurs positions privilégiées et se livrèrent au népotisme et à la corruption, discréditant ainsi le Parti, et ouvrant la voie à des coups d'Etat réactionnaires
C'est alors que, grâce à l'implantation des plans de développement économique et - parfois à l'encouragement d'entreprises commerciales locales, les capitalistes indigènes en herbe trouvèrent de nouvelles occasions de faire fructifier leurs affaires.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 15 :
Un homme d'affaires africain s'intéresse non pas tant au développement de l'industrie qu'à son enrichissement personnel par la spéculation, le marché noir, la corruption, grâce aux commissions sur des contrats et par diverses manipulations financières en rapport avec la prétendue « aides » reçue de l'étranger. C'est ainsi que le capitaliste africain est l'allié de la bourgeoisie capitaliste. Mais il n'est qu'un pion sur l'immense échiquier des monopoles capitalistes internationaux. Le capitaliste africain est ainsi en rapport direct avec les grands monopoles capitalistes.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 16 :
En constituant une intelligentsia africaine, les colonialistes avaient pour ambition, selon leurs propres termes «de former des cadres locaux appelés à devenir nos assistants dans tous les domaines, et de s'assurer le développement d'une élite soigneusement sélectionnée». Ils voyaient là une nécessité à la fois politique et économique. Ils procédaient de la façon suivante: «Nous donnons la priorité aux fils de chefs et d'aristocrates... Le prestige dû à leurs origines doit renforcer le respect que le savoir inspire ».
Au Ghana, en 1953, sur les 208 étudiants de l'Université, 12% étaient issus de familles possédant un revenu inférieur à 600 livres par an, tandis qu'un pourcentage de 38% avait un revenu annuel variant entre 250 et 600 livres, et que le pourcentage restant (50%) avait un revenu d'environ 250 livres par an. On comprend l'importance de ces chiffres lorsque l'on sait que ce n'est qu'en 1962, après que de grands efforts furent accomplis dans le domaine économique, qu'il fut possible à la population d'avoir un revenu annuel d'environ 94 livres par tête d'habitant.
A l'opposé des Britanniques et des Français, les Belges ne voulurent pas former une intelligentsia. Leur mot d'ordre semble avoir été le suivant: «Pas d'élite, pas de problème». On connaît les résultats d'une telle politique : en 1960, au Congo, il était pratiquement impossible de trouver des autochtones suffisamment qualifiés pour être à la tête du nouvel Etat, encadrer l'armée, ou occuper les nombreux postes administratifs et techniques, laissés vacants par le départ des colonialistes.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 17 :
L'intelligentsia a toujours mené les mouvements nationalistes à leurs débuts. Son but n'était pas d'apporter une transformation radicale des structures sociales, mais de prendre la place du pouvoir colonial. Son intention n'est pas de changer «le système», mais de le contrôler. En ce sens, elle est bourgeoise et opposée formellement à toute transformation socialiste révolutionnaire.
Après l'indépendance, l'intelligentsia perdit son homogénéité. On pouvait distinguer trois groupes bien distincts : Il y avait d'abord les alliés de la nouvelle classe indigène privilégiée, c'est-à-dire la bourgeoisie bureaucratique politique et commerciale, ouvertement alliée à l'impérialisme et au néo-colonialisme. Parmi eux se recrutaient les théoriciens antisocialistes, anti- communistes, se réclamant des valeurs politico-économiques du monde capitaliste. Puis venait le groupe des partisans d'un développement « non capitaliste» et d'une « économie mixte» adaptés aux pays les moins industrialisés, comme phase nécessaire à la progression vers le socialisme. Mal interprété, ce concept peut se révéler plus dangereux à la cause socialiste révolutionnaire de l'Afrique qu'un concept nettement favorable au capitalisme, s'il n'est utilisé dans un but très provisoire ; car il pourrait retarder le processus révolutionnaire. L'Histoire l'a prouvé : permettre au capitalisme et à l'entreprise privée de se développer simultanément dans un Etat qui se dit socialiste, c'est ouvrir la voie au triomphe des forces réactionnaires. Le secteur privé ne cessera de s'étendre au détriment de la ligne socialiste suivie par le gouvernement. Finalement, sauf dans les cas contraires, la réaction parviendra, avec l'aide du néo-colonialisme, à perpétrer un coup d'Etat qui renversera ce gouvernement socialiste.
Les intellectuels révolutionnaires constituent le troisième groupe qui apparut au sein de l'intelligentsia après l'Indépendance. Ce sont ceux qui ont encadré les masses dans leur lutte pour le véritable socialisme. Formés pour la plupart dans les écoles coloniales, ils ont fortement réagi au processus d'assimilation, devenant ainsi d'authentiques socialistes révolutionnaires et nationalistes. C'est donc à ce groupe que revient la tâche d'annoncer et de promulguer les objectifs socialistes de la Révolution africaine, et par conséquent, de démasquer et de réfuter le flot d'idéologies capitalistes et les prétendus concepts propagés par l'impérialisme, le néo-colonialisme et la réaction indigène, à l'aide des moyens modernes de communication.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 18 :
Les intellectuels, étudiants, enseignants, etc des sociétés capitalistes et néo-colonialistes sont, pour la plupart, les membres d'une élite bourgeoise susceptible de devenir une force politique révolutionnaire, ou contre- révolutionnaire, en dépit du fait qu'ils étaient, avant l'indépendance, des leaders nationalistes. Ils sont maintenant divisés en plusieurs groupes : D'abord ceux qui prirent part à la lutte nationaliste révolutionnaire et sont maintenant dans le gouvernement, donnant leur préférence soit «aux nouveaux riches » du Parti, soit aux révolutionnaires socialistes. Viennent ensuite ceux qui sont, ou dans l'opposition, ou qui ne s'intéressent pas à la politique, ou encore ceux qui sont en faveur d'une politique de compromis. Il y a enfin, les intellectuels «de mauvaise foi», qui, tout en reconnaissant l'irrationalité du capitalisme, n'en rejettent pas les bénéfices et le mode de vie. Ceux-là sont prêts à se prostituer et à devenir les agents et alliés du privilège et de la réaction, pour défendre leurs intérêts. Les intellectuels issus de milieux prolétaires sont généralement plus radicaux que ceux qui viennent des secteurs privilégiés de la société. Mais l'élite intellectuelle est probablement l'élite la moins capable de cohésion et d'homogénéité.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 19 :
L'idéologie de la Révolution africaine lie la lutte de classes menée par les masses africaines aux mouvements socialistes révolutionnaires mondiaux, et au socialisme international. Née des luttes de libérations nationales, elle tend à la libération totale, à l'unité politique et à la socialisation du continent africain. Unique en son genre, elle s'est développée dans le cadre de la Révolution africaine. Elle est, enfin, le produit de la Personnalité africaine, autant que des principes du socialisme scientifique.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 20 :
"En Afrique, la majorité des Forces armées et de police ont été formées par l'Administration coloniale. Rares en sont les membres qui ont participé aux luttes de libération nationale. Ils ont plutôt pris part aux opérations policières visant à l'élimination de ces mouvements de libération. A cette même époque, les armées pour la plupart étaient sous les ordres d'officiers européens. Avec l'indépendance, des politiques d'africanisation et la pénurie de candidats qualifiés, un grand nombre d'Africains, qui n'avaient pourtant pas eu la formation nécessaire, reçurent le grade d'officier. Beaucoup d'entre eux, qui avaient eu des postes d'enseignants dans l'armée, appartenaient à la petite bourgeoisie instruite. Ils avaient reçu, en même temps que les anciens officiers des armées actuellement en service en Afrique, une formation militaire, soit par les colonialistes eux-mêmes, soit dans des académies militaires européennes. Une telle formation ne pouvait que les rendre acquis aux normes et idéaux de l'Occident. En raison de leur position dans la société, on pourrait les ranger dans la même catégorie que la bourgeoisie bureaucratique, dont ils partagent la préférence pour un mode capitaliste de développement. Parmi les jeunes officiers, certains, pendant leurs années d'adolescence, ont pris part aux luttes de libération nationale; ce qui les rend plus accessibles à l'idéologie socialiste révolutionnaire.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 21 :
Ce sont des paysans qui composent l'élément subalterne de l'armée et de la police. Illettrés, pour la plupart, ils ont appris à ne jamais discuter les ordres et à servir les intérêts capitalistes de la bourgeoisie. Ils sont donc détournés de la lutte engagée par les masses dont ils sont pourtant issus. Car, si l'obéissance aveugle aux ordres supérieurs est une des règles fondamentales de la discipline militaire, cette règle peut être dangereusement interprétée par la minorité privilégiée qui est en mesure de la faire appliquer pour son compte. En d'autres termes, le simple soldat, comme le simple policier, peut devenir l'instrument du maintien des régimes réactionnaires. C'est ainsi que ce paysan ou ouvrier en uniforme devient l'adversaire de sa propre classe.
La seule solution à ce problème est la politisation de l'armée et de la police, qui doivent passer sous le strict contrôle du Parti socialiste révolutionnaire et de commissions dirigées par de vrais militants révolutionnaires socialistes. Il est également indispensable que la discipline, dans l'armée et dans la police, soit fondée sur la compréhension plutôt que sur l'obéissance aveugle. Il s'agit de mettre fin à cet esprit mercenaire qui y sévit et de créer une armée nationale, ainsi qu'une milice populaire : ouvriers, paysans, soldats et policiers devraient se donner la main car ils appartiennent à la même classe et aspirent à une même révolution socialiste.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 22 :
Si dans de pareils cas, en Afrique, un coup d'Etat a permis l'instauration d'un régime moins réactionnaire, la majorité des coups d'Etat ont été perpétrés par des militaires bourgeois, étroitement liés à la bourgeoisie bureaucratique et au néo-colonialisme, et visant à assurer la continuité du capitalisme en déjouant les plans de la Révolution socialiste africaine. Dans certains pays africains où l'armée a prétendu intervenir au nom de la Revolution socialiste, elle l'a surtout fait dans un but purement nationaliste. Prétendant mettre un terme à l'exploitation étrangère, améliorer les conditions de vie, « nationaliser » dans certains cas les sociétés étrangères et fermer les bases militaires étrangères, elle n'apporte en fait aucune amélioration aux conditions de vie du peuple, qui se voit alors exploité, non plus par des étrangers, mais par la bourgeoisie indigène. Le pays est alors la proie du néo-colonialisme et de la bourgeoisie sous les traits de politiciens de second ordre ou de militaires et de policiers bourgeois. Un régime fantoche est installé. La Révolution socialiste n'aura lieu que lorsque le peuple aura pris le pouvoir.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 23 :
En général, les soldes d'officiers sont à peu près les mêmes que celles des officiers étrangers. En conséquence, la différence de statut et de pouvoir, séparant les cadres de l'armée de leurs hommes de troupe, est considérable. Bien plus qu'en Europe, aux Etats-Unis, et ailleurs. En Afrique, la solde d'un lieutenant-colonel est dix ou quinze fois plus importante qu'en Europe et en Amérique. Leur statut social artificiellement élevé donne aux officiers africains une arrogance insupportable. Même les simples soldats et policiers se prennent pour une élite, car ils ont des salaires plus élevés que les petits employés de l'administration. La pratique de plus en plus courante de nommer des cadres de l'armée à de hautes fonctions diplomatiques montre bien l'importance de leur position dans la société africaine.
L'énormité des sommes dépensées à l'entretien des armées dans les Etats africains n'a pas de raison d'être ; car les territoires africains ne sont pas menacés de l'extérieur. De plus les disputes frontalières -héritage du colonialisme- sont susceptibles de règlements à l'amiable. Les combats menés dans le but de mettre fin aux derniers bastions du colonialisme sont le fait, non pas d'armées régulières, mais de mouvements de guérilla. Si seulement une petite portion des sommes dépensées à l'entretien des armées régulières était versée à l'équipement des combattants de la liberté, la Révolution africaine n'en serait que plus proche. La seule raison pouvant justifier la création d'importantes armées régulières est la nécessité vitale qu'imposent les objectifs révolutionnaires africains : l'unification politique de l'Afrique sous la direction d'un haut état-major panafricain.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 24 :
Le fait que la plupart des armées africaines sont dirigées par des officiers, partageant les intérêts de la bourgeoisie bureaucratique et du colonialisme, donne à leur rôle dans la vie politique du continent une importance tout à fait disproportionnée. Ces armées reçoivent l'aide des pays capitalistes, sous forme de fournitures d'armes, d'équipement et d'entraînement. En 1964, on comptait, en Afrique, 3.000 experts français, et 6.000 experts militaires britanniques. 1.500 Africains suivirent un entrainement militaire en France, tandis que la Grande-Bretagne en recevait 700. Quelque quatorze Etats africains ont conclu des accords avec l'Etat d'Israël, qui leur fournit des armes et entraine leurs armées. Récemment, l'Allemagne fédérale a conclu des accords tendant à l'envoi d'experts et d'autres formes d'aide militaire, avec ces Etats situés dans les régions les plus stratégiques du continent africain. Pendant ce temps, les Etats-Unis établissent, tout en développant leurs intérêts commerciaux, des réseaux parallèles leur permettant d'exercer de fortes pressions sur la vie politique en Afrique. Tant que les Etats africains dépendront, de quelque façon, de l'aide des pays capitalistes pour l'entrainement, les armes et le ravitaillement, la Révolution africaine sera compromise. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a jamais de coups d'Etat dans les pays dont l'armée est sous les ordres d'officiers étrangers : malgré leur petit nombre, ils sont en mesure d'empêcher tout changement au statu quo, en vertu du fait qu'ils représentent la force militaire de la puissance étrangère, dont dépend la sécurité des gouvernements indigènes.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 25 :
Les coups d'Etat réactionnaires et pro-impérialistes sont la preuve de la défaite de l'impérialisme et de ses alliés qui, ne pouvant se servir des méthodes traditionnelles, ont recours aux armes pour repousser l'avance socialiste et réprimer les masses. Ils dévoilent ainsi le désespoir et la faiblesse des forces réactionnaires, et non leur puissance. L'exploitation des classes indigènes et le néo-colonialisme sont en dernier ressort leurs solutions dans leur souci de maintenir le statu quo bourgeois réactionnaire. Les observateurs bourgeois ont avancé une multitude de thèses tendant à expliquer la succession de coups d'Etat survenus en Afrique au cours de ces dernières années. Dans certains cas, on y a vu la conséquence du tribalisme et du régionalisme ; ou encore du mécontentement de certains membres de l'armée et de la police devant l'incompétence et la corruption, et le «chaos économique» créé par les politiciens. Mais aucune de ces thèses n'est en accord avec la réalité. Ce sont des explications superficielles et inexactes, qui donnent une fausse image de la réalité. Elles semblent toutes ignorer l'existence de la lutte des classes et du rôle des intérêts bourgeois, ainsi que des pressions néo-colonialistes. Elles passent sous silence - fait des plus significatifs - la nature répressive des coups d'Etat et la non-participation de la grande majorité de la population. Cependant, une fois le coup d'Etat terminé, on parle de « foules en liesse», et des manifestations tendant à faire croire que les auteurs du coup d'Etat ont eu l'appui des masses, sont soigneusement orchestrées. En même temps les cliques réactionnaires qui se sont emparées du pouvoir - et qui ne représentent que la petitesse de l'esprit bourgeois - mettent en place des soi-disant «conseils révolutionnaires» ou de «libération». L'usage de ces termes est destiné à donner au peuple l'illusion que le nouveau régime l'a libéré et n'a d'autre but que satisfaire ses aspirations. Dans le cas des coups d'Etat révolutionnaires nationalistes, les membres du nouveau régime ayant proclamé leur intention de mettre fin à la domination politico-économique des puissances étrangères, on pourrait donc croire qu'ils agissent dans l'intérêt du peuple. En fait, leur révolution n'est pas socialiste : elle est le fruit de l'action concertée de la bourgeoisie nationaliste. La situation du prolétariat urbain et rural, après le coup d'Etat, est à peine changée : il est toujours exploité et opprimé, mais cette fois par la bourgeoisie indigène dont les intérêts commerciaux - liés à ceux des puissances étrangères - se dissimulent derrière une façade nationaliste.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 26 :
Tous ces coups d'Etat sont les conséquences d'une même situation : il existe d'une part les puissances néo-colonialistes qui manœuvrent les Etats néo-colonialistes en donnant leur appui aux élites réactionnaires bourgeoises dans leur lutte pour le pouvoir; et d'autre part, des masses africaines dont la prise de conscience accrue révèle la poussée de plus en plus forte de la Révolution socialiste. Au moment de l’indépendance, les masses ne pouvaient discerner la présence du néo-colonialisme soigneusement caché derrière les nouveaux gouvernements. Mais leur prise de conscience croissant d’année en année se révèle une menace pour la bourgeoisie indigène et ses maitres néo-colonialistes, alarmés devant la croissance des activités révolutionnaires, à travers tout le continent africain.
Il n'existe pas, aujourd'hui, en Afrique, un seul pays où la prise de conscience du prolétariat ait abouti à l'instauration d'un régime socialiste. Dans tous les Etats indépendants, on trouve, d'une part le gouvernement et son parti, d'autre part la bourgeoisie nationaliste et le prolétariat. Très souvent, la bourgeoisie nationaliste est liée - de façon apparente ou non - au parti, donc au gouvernement. Lorsque le parti de la bourgeoisie nationaliste n'est pas représenté au gouvernement, la bourgeoisie nationaliste organise la subversion et tente un coup d'Etat.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 27 :
Tant que les moyens de production ne seront pas détenus par les masses, les mouvements de guérilla continueront leurs activités dans les Etats africains. Les dirigeants africains ne feront que retarder les processus révolutionnaires tant qu'ils ne se dévoueront pas à la cause du socialisme scientifique. Actuellement, le vent de la guérilla souffle sur le Gabon, l'Ethiopie, le Malawi, le Soudan, l'Erythrée, le Kenya, le Cameroun, le Niger, la Côte-d'Ivoire, et tous les Etats qui ne sont pas unis dans le socialisme.
Des gouvernements réactionnaires tentent de contenir l'éveil politique des masses soit par de prétendues politiques socialistes, soit par la répression, soit enfin en permettant des coups d'Etat militaires. Quelle que soit leur méthode, ils affirment servir les intérêts du peuple, en se débarrassant de politiciens corrompus et incompétents, et en redressant l'économie. En réalité, ils ne font que sauvegarder les intérêts capitalistes ainsi que leurs propres intérêts bourgeois, et ceux des monopoles capitalistes internationaux. L'explosion de coups d'Etat militaires en Afrique révèle le manque d'organisation socialiste révolutionnaire, le besoin pressant d'un parti prolétarien d'avant-garde, ainsi que la nécessité de créer une armée panafricaine. Qu'elle soit politique, économique, ou militaire, la lutte révolutionnaire socialiste ne sera effective que lorsqu'elle sera organisée et prendra ses racines dans la lutte des ouvriers et paysans.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 28 :
Le pouvoir colonial avait découragé toute tentative locale d'entreprise privée. En conséquence, quiconque désirait faire fortune et acquérir un statut social n'avait pas d'autres choix que d'entrer dans l'administration, dans l'armée, ou devenir membre d'une profession libérale. Les industries minières, les entreprises industrielles, les banques, le commerce en gros et les grandes exploitations agricoles étaient aux mains des étrangers. En général, la bourgeoisie africaine est plutôt une petite classe moyenne. C'est en partie à cause de ces restrictions défavorables au commerce indigène que la bourgeoisie africaine s'opposa à la domination impérialiste. Après la seconde guerre mondiale, alors que les mouvements de libération nationale étaient devenus de plus en plus virulents, les impérialistes se virent contraints d'intégrer la bourgeoisie africaine dans des sphères d'où elle était jadis exclue. Il y eut alors un plus grand nombre d'Africains dans l'administration et les compagnies étrangères. Ainsi naquit une nouvelle élite af- ricaine, étroitement liée au capitalisme étranger. En même temps, des mesures répressives frappèrent les partis progressistes et les syndicats ; les colonialistes entrèrent en guerre contre les peuples de Madagascar, du Cameroun et de l'Algérie. C'est à cette époque que les fondations du néo-colonialisme furent posées.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 29 :
Pendant les luttes de libération nationale, la petite bourgeoisie se divisa en trois catégories :
- d'abord celle qui était en faveur du colonialisme et d'un développement économique et social de type capitaliste. Les tenants d'une telle attitude étaient généralement les fonctionnaires, les membres des professions libérales, ainsi que les agents des firmes étrangères,
- puis, celle des «petits bourgeois révolutionnaires » les nationalistes qui voulaient la fin de la domination coloniale, mais ne souhaitaient pas une transformation radicale de la société. Ils constituent une partie de la bourgeoisie nationale,
- enfin, «les spectateurs», c'est-à-dire tous ceux qui suivaient passivement les événements.
En général, peu de membres de la bourgeoisie africaine ont amassé un capital assez important pour développer un monde des affaires africain. Elle reste donc une bourgeoisie compradore largement tributaire des intérêts impérialistes en Afrique. Le colonialisme et le néo-colonialisme n'encourageront jamais son intégration - à titre égalitaire - dans les sphères économiques, car ils ne veulent pas en faire une rivale. La bourgeoisie indigène se doit donc d'être subordonnée au capitalisme étranger. Voilà pourquoi sa force ne réside que dans le soutien qu'elle reçoit, d'une part, des éléments féodaux réactionnaires du pays, d'autre part de l'aide politique, économique et militaire du capitalisme international.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 30 :
Il arrive que l'impérialisme encourage les mouvements de libération, et cela dans les régions coloniales où l'exploitation capitaliste a atteint un stade où l'influence d'un parti travailliste menace les intérêts du capitalisme international. En donnant leur indépendance aux partis bourgeois, les forces indigènes réactionnaires sont en position de pouvoir, ne pouvant alors que cimenter leur alliance avec la bourgeoisie internationale. Presque toujours, les luttes de libération connaissent deux tendances : l'une étant authentiquement en faveur, non seulement d'une libération nationale, mais surtout de l'instauration du socialisme; tandis que l'autre - qui a l'appui de l'impérialisme - vise à la préservation de structures capitalistes.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 31 :
Le prolétariat urbain et rural s'allia à la bourgeoisie nationale, dans la lutte pour l'indépendance, visant à l'éviction du pouvoir colonial. Les antagonismes sociaux s'effacèrent momentanément, mais une fois l'indépendance acquise, ils réapparurent dans les politiques économiques et sociales des nouveaux gouvernements. Il n'est pas impossible que les classes fusionnent après l'indépendance : le gouvernement est alors celui de l'une ou l'autre tendance. Certains théoriciens soutiennent que dans le but de renverser l'ordre bourgeois, le prolétariat et la petite classe moyenne devraient former une coalition, gagnant ainsi la paysannerie à leur cause : Mais ils semblent ignorer ce fait : lorsqu'il s'agit de ses intérêts économiques, la petite classe moyenne se rangera toujours du côté de la bourgeoisie pour défendre les structures capitalistes. Seule l'union du prolétariat et des masses paysannes amènera des structures authentiquement socialistes. Dans les conflits engageant des intérêts politiques et économiques, ces derniers l'emportent toujours.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 32 :
Le clan est l'extension de la cellule familiale, tandis que la tribu est l'extension ethnique du clan à travers un territoire. Avant la pénétration impérialiste, en Afrique, il y avait des tribus mais pas de tribalisme, au sens moderne du terme. Le tribalisme est un produit du colonialisme, qui se servit de survivances féodales et tribales pour lutter contre la pression des mouvements de libération nationale. Le retard de la formation des nationalités est le résultat de la conquête coloniale, balkanisant l'Afrique au mépris des frontières géographiques, linguistiques et ethniques. La croissance de l'économie et l'évolution des structures sociales en souffrirent. Des structures patriarcales et féodales furent artificiellement présentées et l'on s'ingénia à freiner par tous les moyens possibles l'émergence d'un prolétariat politisé et conscient. Or, les modes d'exploitation capitalistes employés dans les régions minières et dans les plantations, comme en Afrique du Sud et de l'Est, et au Congo-Kinshasa, ne pouvaient que provoquer l'émergence d'un prolétariat. Aussi la classe ouvrière fut maintenue au sein de structures traditionnelles, de manière à lui interdire toute prise de conscience.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 33 :
A l'époque néo-colonialiste, le tribalisme est l'instrument du pouvoir des classes bourgeoises, dans leur effort pour contenir le mécontentement des masses. Beaucoup de ces soi-disant antagonismes tribaux sont en réalité le résultat des antagonismes sociaux en rapport avec la transition d'une situation coloniale à une situation néo-coloniale. Le tribalisme est la conséquence, et non la cause, du sous-développement. La plupart des conflits « tribaux » sont le fait de l'exploitation bourgeoise ou féodale, en relation étroite avec les intérêts de classe de l'impérialisme et du néo-colonialisme. Les chefs traditionnels se virent délaissés au profit de la nouvelle bourgeoisie urbaine, qui était en meilleure position pour défendre les intérêts du capitalisme international. On parle de conflits tribaux, alors qu'il s'agit d'une lutte de classes. L'apparition de tribus, dans tous pays, est considérée comme un processus normal, au dire du développement historique. Les tribus, comme les nationalités, peuvent toujours exister, mais le tribalisme (ou politique des tribus) doit etre éliminé. Grâce à un gouvernement socialiste panafricain, le tribalisme (et non les tribus) disparaîtra. Ceux-là peuvent être admis dans les rangs de la révolution socialiste. Cependant, dans la plupart des pays où le développement capitaliste en est encore à ses débuts, la petite minorité bourgeoise se sent menacée par la poussée du socialisme. En conséquence, les élites bourgeoises coopèrent étroitement entre elles, ainsi qu'avec les militaires. Des coups d'Etat néo-colonialistes et bourgeois sont perpétrés par des militaires, dans le but d'empêcher toute prise du pouvoir par le peuple et par les socialistes.
Ces coups d'Etat ont l'appui de l'énorme machine néo-colonialiste. Car, dans le but de protéger leurs intérêts, les impérialistes et les néo-colonialistes apportaient leur appui à la classe privilégiée pendant l'époque coloniale. La bourgeoisie indigène et le néo-colonialisme ont des intérêts communs dans le maintien de leur suprématie et des structures de l'Etat colonial.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 34 :
La bourgeoisie bureaucratique, en particulier, est «l'enfant chérie des gouvernements néo-colonialistes. Nombreux sont les Etats africains qui dépensent des sommes énormes - à tort – pour leur bureaucratie. Le Gabon, par exemple, dont la population est inférieure à 500.000 habitants, possède un Parlement de 65 membres, recevant chacun 165.000 francs par an, alors que le salaire annuel de l'ouvrier moyen n'est que de 700 francs. Au Dahomey, 60% du revenu annuel sont consacrés aux soldes des fonctionnaires du gouvernement. Héritière des anciennes classes dominantes, la bourgeoisie bureaucratique est étroitement liée aux firmes étrangères, aux diplomates des pays impérialistes, et aux classes exploitantes africaines. Tout en n'ayant pas une grande force de cohésion, c'est une élite acquise au mode capitaliste de développement, et l'un des agents les plus dévoués du néo-colonialisme.
Après l'indépendance, la position des bureaucrates fut renforcée par les politiques d'africanisation des nouveaux gouvernements, ainsi que par le surcroît de travail amené par les larges transformations économiques et sociales projetées par ces mêmes gouvernements. Car les bureaucrates ont la compétence administrative et technique requise pour ce travail. En outre, ils sont en mesure de sélectionner et d’organiser les informations nécessaires aux ministres pour la formulation des politiques. En ce sens, ils jouent un grand rôle dans les prises de décisions politiques. Mais beaucoup de bureaucrates assument des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas été préparés. Ces bureaucrates ont tendance à se montrer arrogants et à s'isoler de la classe inférieure des fonctionnaires.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 35 :
Il appartient au prolétariat urbain d'Afrique de gagner les masses paysannes à la cause de la Révolution, en apportant la révolution au monde rural. Car, en général, les masses paysannes sont encore désorganisées, non révolutionnaires et illettrées. Mais l'alliance du prolétariat urbain et des masses paysannes, dans la lutte pour le socialisme, consacrera la Révolution africaine. La bourgeoisie africaine et ses maîtres impérialistes et néo-colonialistes ne pourront venir à bout de leur alliance.
Dans beaucoup d'Etats africains, l'absence d'industrie, à grande échelle, l'absence de qualification professionnelle et le faible niveau d'éducation des travailleurs en retardent la prise de conscience. Ils sont souvent non-révolutionnaires et ont une mentalité de petits bourgeois. Au Sénégal où la classe ouvrière est supérieure à celle de beaucoup d'autres Etats africains, où la population mâle (ouvrière) comprend 95% d'illettrés et la population féminine 99%, il existe un puissant mouvement ouvrier.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 36 :
Sous la domination coloniale, la lutte des ouvriers visait essentiellement l'exploiteur étranger. En ce sens, c'était plus une lutte anti-coloniale qu'une lutte de classes. Et l'on en notera la nuance raciale. L'aspect socio-racial de la lutte des travailleurs africains existe toujours à l'époque néo-colonialiste, tendant à négliger l'existence de l'exploitation bourgeoise indigène. En attaquant les Européens, Libanais, Indiens et autres, les ouvriers tendent à oublier l'exploiteur indigène réactionnaire. Une telle situation se retrouve dans les Etats colonialistes où réside un prolétariat immigrant, et où le chômage sévit. Devant le mécontentement des ouvriers, le gouvernement fait en sorte que l'on tienne la présence de ces ouvriers «étrangers» pour responsable de la situation générale plutôt que sa propre politique réactionnaire. Ceux-ci subissent alors les vexations, non seulement des travailleurs nationaux, mais aussi du gouvernement, qui prend alors des mesures tendant à la restriction de l'immigration, à la limitation des chances d'embauche, et même à l'expulsion de certaines catégories. Ainsi le gouvernement fait croire aux travailleurs nationaux que la présence des travailleurs immigrants est la cause principale du chômage et des mauvaises conditions de vie. C’est cela qui crée une atmosphère de tension générale, réveillant ainsi de vieilles querelles ethniques et nationales. Voilà comment, au lieu de se liguer aux immigrants pour faire pression sur le gouvernement, le prolétariat national prend le parti du gouvernement. Et c’est ainsi que la bourgeoisie profite de leur manque de conscience de classes pour les diviser.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 37 :
Le prolétariat immigrant des villes peut devenir un élément déterminant de la progression socialiste. En effet, ces hommes travaillant dans les villes et dans différents Etats africains, pour s'en retourner chez eux après un certain temps, sont un lien entre les mouvements révolutionnaires prolétariens et ceux du monde rural et des autres Etats. Ils sont donc un élément essentiel du processus révolutionnaire, soulignant ainsi l’importance de la mobilité permanente de la main d’œuvre africaine, qu’il est nécessaire d’organiser.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 38 :
Les syndicats participèrent activement à la lutte de libération nationale, en organisant des grèves, des boycottages et d'autres formes d'activisme. Les puissances coloniales s'opposèrent vigoureusement à l'action des syndicats, en essayant - parfois avec succès - de faire vaciller le pouvoir des dirigeants syndicaux par l'introduction de politiques réformistes et l'infiltration d'un socialisme de droite.
En mai 1961, sur l'initiative des syndicats ghanéens, maliens, la Conférence Syndicale Panafricaine se réunit à Casablanca. 45 organisations syndicales et 38 pays furent représentés. Les bases de l'Union Syndicale Panafricaine (U.S.P.) y furent jetées selon les principes de la solidarité prolétarienne et de l'internationalisme. Une organisation syndicale, la Centrale Syndicale Panafricaine (C.S.P.) fut fondée en janvier 1962, à la suite d'une conférence tenue à Dakar, où étaient présents les délégués des organisations africaines affiliées à la Confédération Internationale des Syndicats Libres, et 8 organisations syndicales indépendantes. Aucune allusion ne fut faite dans la Charte de la Confédération des Syndicats africains aux monopoles étrangers ou à l'internationalisme prolétarien.
Le mouvement syndical, en Afrique, doit être organisé à l'échelle du panafricanisme, avoir une orientation socialiste, et se développer dans le contexte de la lutte des travailleurs africains. C'est pourquoi la création d'une Union Syndicale Panafricaine doit tendre au développement de l'action syndicale sur tout le continent africain. Tout en étant différente des autres unions syndicales dans d'autres pays, elle travaillera avec elles sur le plan international.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 39 :
Le néo-colonialisme procède des façons suivantes : contrôle économique grâce au système « d'aide» et de prêts et grâce aux échanges commerciaux et financiers; mainmise sur les économies locales par le vaste dispositif des corporations internationales ; contrôle politique des gouvernements fantoches ; pénétration sociale par la bourgeoisie indigène ; imposition d'accords de «défense » et implantation de bases militaires et aériennes ; infiltration idéologique, nettement anti-communiste, par les moyens de communications modernes (presse, radio, télévision), et impérialisme collectif, notamment en ce qui concerne la coopération politico-économique et militaire entre la Rhodésie, l'Afrique du Sud et le Portugal.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 40 :
« L'aide économique» accordée par les pays capitalistes est l'une des manières les plus insidieuses employées par le néo-colonialisme pour freiner le développement des pays du Tiers-Monde, retardant ainsi l'industrialisation et la croissance d'un prolétariat important. Seulement 10% de l'aide américaine aux pays africains sont employés au développement de l'industrie, et cela dans les pays considérés acquis au capitalisme. Par contre 70% de l'aide des pays socialistes vont à l'industrialisation et à l'organisation de la production profitable. Les taux d'intérêts sur les prêts des pays capitalistes varient entre 6,5 et 8%, tandis que ceux des pays socialistes ne sont que de 2,5%.
L'aide socialiste est surtout employée à la planification, tandis que l'aide occidentale vise le secteur privé. L'aide française à ses ex-colonies africaines se chiffre à près de deux milliards de francs. Grâce à ces deux milliards, la France maintient des liens culturels, politiques et économiques, qui font de ces pays de grands marchés pour les exportations françaises. Pour les gouvernements français, il s'agit « d'un bon investissement ». Une très grande partie des sommes dépensées par l'Ouest pour «l'aide bilatérale», ne sortent pas du pays donataire car elles sont données sous forme d'articles de consommation ; ou alors, ces sommes reviennent aux pays donataires en remboursements, à échéance relativement courte, d'autres exportations.
Il y a encore bien d'autres façons pour les pays donataires de récupérer les sommes qu'ils dépensent pour «l'aide ». Sur 100 livres que la Grande-Bretagne a dépensées au titre de «l'aide bilatérale » pendant l'exercice 1964-66, 72,5 livres étaient destinées à l'envoi d'articles de consommation, ou à l'achat de biens et de services britanniques.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 41 :
Beaucoup de projets « d'aide» sont destinés à équilibrer la balance de paiements des pays donataires plutôt qu'à favoriser le développement économique du pays bénéficiaire. Celui-ci doit non seulement assumer le remboursement d'une lourde dette, mais aussi accepter une dépendance politique et économique, qui freine son développement et retarde sa croissance économique.
Les crédits accordés par les pays capitalistes aux pays africains, asiatiques, latino-américains pour mettre en place une infrastructure, sont destinés à favoriser l'exploitation par les monopoles privés. L'objectif est politique aussi bien qu'économique. Il s'agit de bloquer l'avance socialiste en donnant à la bourgeoisie indigène une part des intérêts capitalistes, tout en étendant l'emprise monopoliste internationale sur les économies des pays en voie de développement.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 42 :
Au sommet de la hiérarchie sociale dans les zones rurales se trouvent les propriétaires terriens féodaux traditionnels, qui vivent de l'exploitation des paysans, et les propriétaires capitalistes pour la plupart absentéistes, qui vivent de l'exploitation d'une main-d’œuvre salariée. Parmi les propriétaires capitalistes - qui forment la bourgeoisie rurale - se range le clergé des diverses sectes et religions, vivant de l'exploitation féodale et capitaliste des paysans. La bourgeoisie rurale possède des fermes relativement grandes, d'un capital, de la main-d’œuvre qu'elle exploite ; elle se spécialise dans la culture d'exportation. Les petits agriculteurs, que l'on pourrait ranger dans la catégorie de la petite bourgeoisie rurale, possèdent un petit capital et cultivent la terre qui leur appartient ou qu'ils louent. Ils emploient des membres de leur famille ou une main-d’œuvre salariée. En général, lorsque la terre est louée, le petit agriculteur garde environ les deux tiers des recettes de la ferme, et en donne un tiers au propriétaire. Après la petite bourgeoisie rurale, viennent, dans la hiérarchie rurale, les paysans qui cultivent de petites portions de terre et sont souvent forcés de vendre leurs services comme journaliers. Au bas de l'échelle sociale, les ouvriers agricoles forment le prolétariat rural et ne possèdent rien d'autre que leur travail.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 43 :
Le paysan peut devenir un élément révolutionnaire à condition d'être encadré par le prolétariat rural et urbain. Le prolétariat rural est constitué de travailleurs au sens marxiste du terme. Ils sont partie intégrante de la classe ouvrière et la couche sociale la plus révolutionnaire du monde rural africain. Il s'agit de développer le potentiel révolutionnaire de cette couche rurale des paysans et ouvriers agricoles, car ils constituent la force principale de la révolution. Il revient aux cadres révolutionnaires la tâche primordiale de les amener à prendre conscience des réalités de leur potentiel économique, et de les gagner, eux et les petits fermiers, à une méthode socialiste de production et de distribution agricoles. Cela doit se faire par le développement de divers types de coopératives agricoles : elles sont essentielles, si une transition d'un mode d'agriculture privée, basée sur la petite production, à une agriculture moderne, mécanisée, socialiste, doit se faire. Des coopératives de marché existent déjà dans plusieurs pays africains, et y connaissent un grand succès, bien que les coopératives de crédit soient moins générales en raison du manque de fonds. Mais la plus importante forme de coopération agricole est la coopérative de production, qui gère la production et le mécanisme de production agricole.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 44 :
Dans les pays néo-colonialistes, les coopératives ne servent que les intérêts de la bourgeoisie rurale et des monopoles capitalistes. Les élites néo-colonialistes exploitent l'isolement relatif et le retard culturel des masses paysannes, les amenant ainsi à accepter leur domination politique. C'est surtout dans le monde rural que subsistent des vestiges du féodalisme. Le plus souvent, les conditions de vie des paysans n'ont pas changé depuis les époques précoloniales et coloniales : ils doivent toujours payer de lourdes taxes et faire des travaux forcés. Lorsqu'ils émigrent en ville, ils sont généralement les victimes des exploiteurs coloniaux et néocoloniaux.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 45 :
Sous la domination coloniale, ainsi que dans les Etats néo-colonialistes, le gouvernement a recruté beaucoup parmi les masses paysannes pour son armée et sa police, car on les dit plus «loyales». En fait le gouvernement ne fit qu'exploiter l'ignorance, et l'esprit de soumission et de conservatisme, caractéristiques des masses paysannes illettrées dans le monde. Pendant les luttes de libération nationale, les paysans se battirent pour l'indépendance et contre le féodalisme, dans les mouvements politiques créés par les dirigeants syndicalistes, les ouvriers et les intellectuels révolutionnaires. Car, il est indispensable que les masses paysannes reçoivent l'appui de leurs alliés naturels, dans la lutte révolutionnaire socialiste. Dans les pays où les luttes révolutionnaires socialistes ont amené le renversement de gouvernements bourgeois - comme en Chine, à Cuba, au Vietnam, en Corée - les masses paysannes ont été les alliées d'autres forces sociales, encadrées par des partis marxistes. Les liens étroits qui unissent le prolétariat et les masses paysannes sont les mêmes que ceux qui unissent les mouvements de guérillas urbains et ruraux. Ils sont tous partie intégrante de la lutte révolutionnaire socialiste, et l'un ne peut pas parvenir à la victoire finale sans l'autre.
La lutte révolutionnaire socialiste en Afrique, doit reposer sur les masses paysannes et le prolétariat rural, car ils forment la grande majorité de la population, et leur avenir est dans le socialisme. Les combattants de la Liberté, qui sont parmi ces masses, dépendent d'elles quant au recrutement et au ravitaillement. Le monde rural est le bastion de la révolution. C'est le champ de bataille sur lequel les masses paysannes, avec leurs alliés naturels - le prolétariat et l'intelligentsia révolutionnaire - seront la force motrice de la transformation socialiste.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 46 :
L'action politique est à son paroxysme lorsque le prolétariat tout entier, sous la direction d'un parti d'avant-garde guidé par les seuls principes du socialisme scientifique, parvient à renverser le système de classes : la révolution est alors complète. Les bases d'une révolution sont jetées, lorsque les structures organiques et l'état d'une société donnée ont amené les masses à souhaiter ardemment un bouleversement total des structures de cette société. Alors qu'il n'existe pas de dogmes fermement établis quant à la révolution socialiste, du fait que les situations historiques ne se répètent pas. L’expérience a prouvé que, lorsqu'il y a lutte des classes, la révolution socialiste ne peut être réalisée sans le recours à la force. La violence révolutionnaire est un principe fondamental des luttes révolutionnaires. Car, à moins de s'y voir contraintes, les élites privilégiées ne céderont pas le pouvoir ; même si elles acceptent d'effectuer des réformes, elles ne céderont jamais, sauf si elles savent leur position menacée. Seule l'action révolutionnaire les y contraindra. Il n'est pas de grand événement historique qui n'ait été accompli au prix d'efforts violents et de vies humaines. Quiconque est convaincu que le passage d'un mode de production capitaliste à un mode de production socialiste se fera sans le recours à la violence doit s'attendre à une grande désillusion. Car le changement qualitatif inhérent à la révolution socialiste est beaucoup plus profond que celui que provoqua le passage d'un mode féodal à un mode capitaliste. Les révolutionnaires socialistes veulent une transformation totale de la société et l'abolition du système de classes.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 47 :
La révolution socialiste s'oppose aux concepts élitistes, et tend à l'abolition du système de classes ainsi qu'à l'élimination du racisme. Les révolutionnaires socialistes se battent pour l'instauration d'un Etat qui se fasse garant des aspirations des masses, et leur assure une participation à tous les échelons du gouvernement. Dans une société capitaliste, la liberté est le droit de faire ce que la loi permet, dans l'intérêt de la classe bourgeoise au pouvoir. Or, plus il se développe, plus le capitalisme est anarchique. La révolution socialiste en est donc l'aboutissement logique et inévitable. Dans les pays où le développement capitaliste et industriel en est à ses débuts, et où la bourgeoisie ne représente qu'une petite minorité de la population, le prolétariat est en mesure, par une prise de pouvoir révolutionnaire, d'instaurer un régime socialiste. Sous la direction des révolutionnaires socialistes, l'Afrique peut passer d'un stade de propriété bourgeoise-capitaliste à un stade où les moyens de production sont distribués selon un mode de propriété socialiste-communiste. Mais la lutte révolutionnaire ne saurait compter sur la participation de la bourgeoisie et de la petite classe moyenne ; car malgré leur participation aux luttes de libération nationale, elles tenteront toujours, pour sauvegarder leurs « gains», de bloquer la création d'un Etat socialiste. Elles sont dévouées au capitalisme et leur survie dépend de l'appui qu'elles reçoivent de l'impérialisme et du néo-colonialisme. Ce n'est qu'avec le renversement de la suprématie bourgeoise dans les Etats néo-colonialistes, par la révolution socialiste, qu'une transformation totale de la société sera accomplie.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 48 :
Tout en se concentrant sur la destruction de l'impérialisme, du colonialisme et du néo-colonialisme, la Révolution africaine tend à une transformation complète de la société. Il ne s'agit plus pour les Etats africains de choisir un mode capitaliste ou non capitaliste de développement, car le choix a déjà été fait par les travailleurs et les paysans d'Afrique : la libération et l'unité du continent, que seule la lutte armée dans le socialisme réalisera. Car l’unité politique de l'Afrique et socialisme vont de pair. L'un ne peut être réalisé sans l'autre. «Capitalisme populaire », « capitalisme éclairé», «paix des classes», «harmonie sociale», tout cela représente des tentatives bourgeoises et fallacieuses d'endoctrinement des masses. Certains suggèrent une voie « non- capitaliste» suivie par une «union de forces progressistes» ; or un tel système ne peut convenir à l'Afrique des temps modernes. Car les Etats africains ne peuvent choisir que l'une ou l'autre de ces deux possibilités : ou revenir à une domination impérialiste par le capitalisme et le néo-colonialisme, ou adopter les principes du socialisme scientifique.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 49 :
Le socialisme ne peut être réalisé que dans la lutte des classes. En Afrique, l'ennemi interne, qui est la bourgeoisie réactionnaire, doit être démasqué : il s'agit d'une classe d'exploiteurs, de parasites et de collaborateurs des impérialistes et néo-colonialistes, desquels dépend le maintien de leurs positions puissantes et privilégiées. La bourgeoisie africaine est essentielle à la continuité de la domination et de l'exploitation impérialistes et néo-colonialistes. Devant la nécessité de son élimination, un Parti révolutionnaire socialiste d'avant-garde organisera et encadrera la solidarité ouvrière-paysanne. Grâce à la défaite de la bourgeoisie indigène, de l'impérialisme, du néo-colonialisme et des ennemis extérieurs de la Révolution africaine, les aspirations du peuple africain seront réalisées. Comme dans les autres régions du monde où le sort de la révolution socialiste repose, en grande partie, sur la participation des masses paysannes, une tâche gigantesque attend les cadres de la Révolution africaine : ils doivent provoquer l'éveil des masses urbaine et rurale, et amener la révolution dans les campagnes ; c'est alors que les combattants de la liberté - de qui dépend en grande partie la révolution en sa phase armée - pourront étendre leurs opérations. En même temps, il faut politiser les piliers du pouvoir - la bureaucratie, la police et l'armée -.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 50 :
La victoire des forces révolutionnaires dépend de l'habileté du Parti révolutionnaire socialiste à fixer l'importance des classes sociales et à distinguer les alliés et les ennemis de la révolution. Le Parti doit aussi être en mesure de mobiliser et de diriger l'ensemble des forces pour la révolution socialiste déjà en existence et d'éveiller et de stimuler l'immense potentiel révolutionnaire encore inexploité. Tant que la violence sera utilisée contre les peuples africains, le Parti n'arrivera pas à ses fins sans utiliser toutes les formes de la lutte politique, y compris la lutte armée. Si la lutte armée doit être engagée de façon efficace, elle doit - comme l'est le Parti - être centralisée. Un haut état-major panafricain, encadré par un Parti ouvrier panafricain, devrait pouvoir planifier une stratégie et une tactique unifiée, portant des coups mortels à l'impérialisme, au colonialisme et au néo-colonialisme, ainsi qu'aux régimes minoritaires européens en Afrique.
La résistance armée n'est pas un phénomène nouveau, pour l'Afrique : pendant des siècles, les Africains ont lutté contre l'intrusion colonialiste, bien que ces combats héroïques aient été passés sous silence par les historiens étrangers bourgeois. En fait, les Africains n'ont jamais cessé de résister à la pénétration et à la domination impérialiste.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970
Texte 51 :
L'indépendance politique n'a pu amener ni la fin de l'oppression et de l'exploitation économique, ni celle des ingérences étrangères dans la vie politique. La période néo-colonialiste commença lorsque les monopoles capitalistes internationaux donnèrent leur appui, durant l'époque coloniale, à la bourgeoisie indigène, dans le but d'assurer leur mainmise sur la vie économique du continent.
Le néo-colonialisme usa d'une nouvelle arme de violence à l'encontre des peuples africains, sous diverses formes de domination politique indirecte, par la bourgeoisie indigène et les gouvernements fantoches téléguidés par le néo-colonialisme ; exploitation économique directe par une extension des opérations de puissantes corporations : contrôle des moyens de communications, infiltration idéologique. Et bien d'autres manières insidieuses d'implantation.
Kwame Nkrumah, la lutte des classes en Afrique, panafBooks ltd, 1970