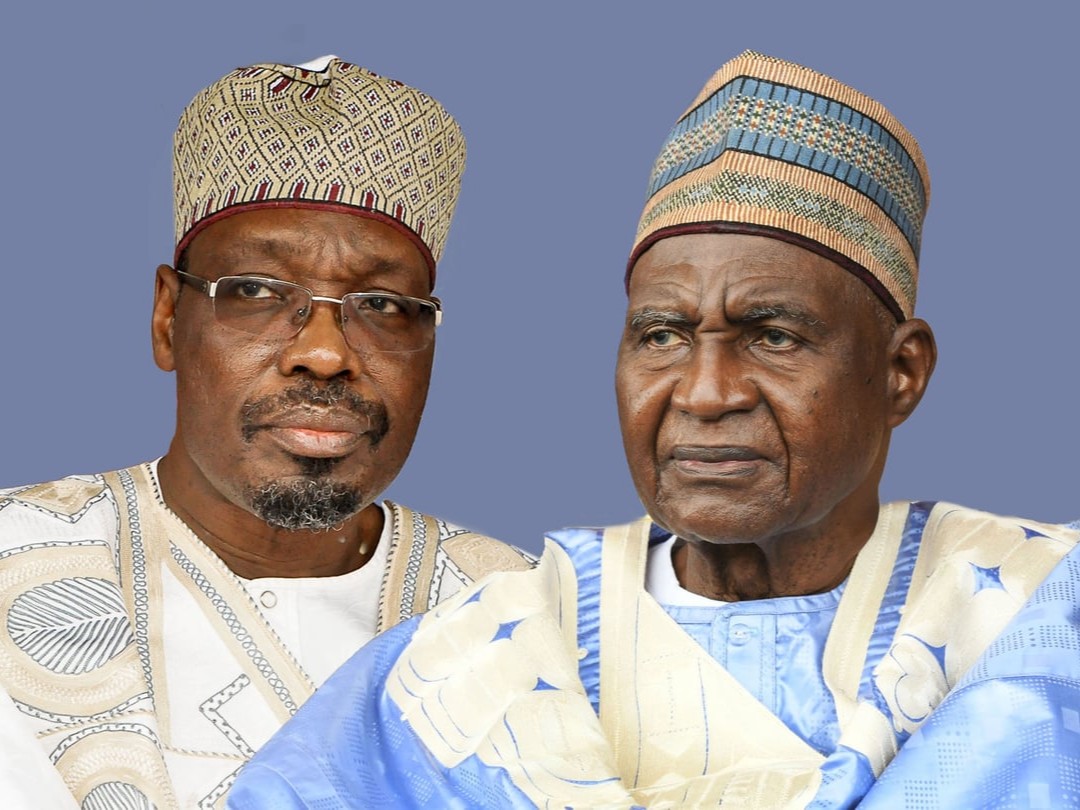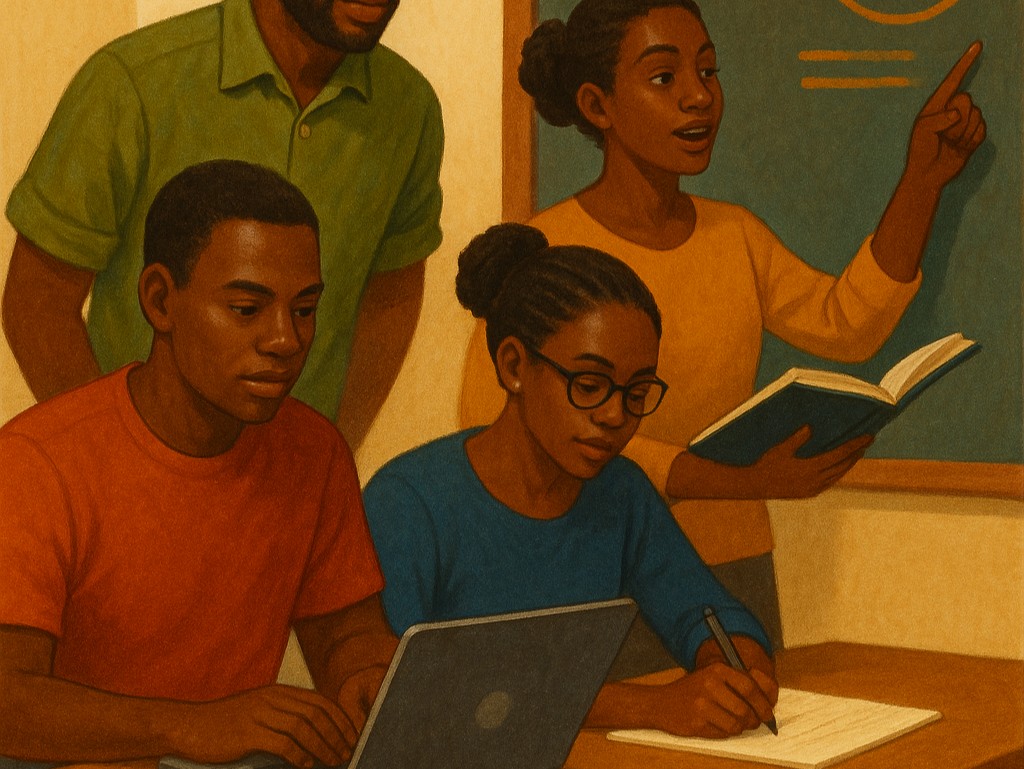Résumé de l’ouvrage : ABC DEMOCRATIE LA LUTTE CONTINUE… CONTINUE… CONTINUE… Vol 3
Leçon 7 : Comment voter
Elire c’est choisir. Il n’y a pas de vraie élection quand il n’y a pas de choix, quand on est soumis à une contrainte physique ou morale. Dans la démocratie, les citoyens ne sont plus les purs objets du pouvoir, soumis à son arbitraire. Ils sont sujets responsables, à des titres divers, de ce pouvoir. Dans un régime démocratique, l'autorité n'est pas l'apanage d'une famille, d'une caste, d'une classe sociale ou d'une tribu, mais du peuple dans son ensemble. Les citoyens doivent se prendre en charge, assumer eux-mêmes leur destin individuel et social et le bien-être de tous. La démocratie est un ensemble de structures juridico-politiques qui donnent à tous les citoyens, sans discrimination, la possibilité effective d'apporter leur part librement et activement à la réflexion, aux décisions et à l’exécution de tout ce qui concerne la vie leur pays. Des élections vraiment libres sont sans aucun doute la première condition pour arriver à une réelle démocratie.
Pour obtenir des élections libres, de manière personnelle, l'électeur doit prendre part au vote. Et s’il vote le mauvais candidat, il perd le droit de se plaindre. Il doit savoir qu'il doit voter seul et faire le choix de son candidat dans un isoloir. S’il n y a pas d’isoloir, il peut l'exiger. Il ne doit pas se tromper, corrompre, se laisser corrompre par les dons en argent ou en nature des candidats, ne pas se laisser influencer par des slogans, s'informer sur ses droits en tant qu'électeur, s'informer sur la vie des candidats et le programme des partis en lice. Collectivement, les électeurs peuvent constituer des équipes de contrôle pour s’assurer que chaque électeur vote librement, que des tricheries n'interviennent pas durant le transport des urnes du bureau de vote vers le lieu de dépouillement, que le dépouillement se fasse dans la transparence. Pour qu'il y'ait élection démocratique, chaque citoyen doit avoir le droit de voter, avec une voix s'il remplit les conditions de vote. Le résultat du vote doit être exact, correspondre réellement aux opinions exprimées par le peuple. Parfois des politiciens viennent donner beaucoup d'argent, à manger et à boire à la population. Certains chefs de village imposent à leur population qui voter et parfois c'est lui-même le candidat. D'autres candidats demandent aux populations de les voter parce qu'ils sont du village ou de la tribu. D'autres candidats vont au village promettre des choses impossibles à réaliser. Comme le précisait Ka Mana : « la politique du pays a besoin d'une mutation radicale inspirée et guidée par un nouveau type d'hommes d'Etat et de responsables politiques, pour qui la politique soit non une carrière prestigieuse dans le tape-à-l’œil, mais une éthique de la responsabilité et une dynamique d'imagination créatrice pour affronter les enjeux et les défis de notre destinées.» Ensemble nous sommes forts, surtout si nous marchons tous dans la même direction. Ensemble nous pouvons réaliser de grandes choses, choisir des candidats valables, et ainsi lutter contre la fraude électorale.
Pour juger de la valeur d’un candidat nous devons juger de ses capacités intellectuelles. Il ne s'agit pas seulement de ses études, mais de son expérience, de sa capacité de raisonnement, de sa capacité à comprendre et résoudre les problèmes d'une communauté ou d'un groupe organisé. On doit aussi juger des motivations du candidat à élire : A-t-il l'amour de ses frères et sœurs ou veut-il seulement le pouvoir et l'enrichissement ? Veut-il seulement le développement de sa région ou de sa tribu ? On doit aussi étudier son comportement moral et social. Dans ce cas, son passé est capital. Est-il un homme de parole ? A-t-il montré dans son quartier ou son lieu de travail qu’il veut aider les autres ? Est-il respectueux ? Est-il sociable ? Quel est son attitude envers ceux qui ne partagent pas ses opinions ? Pour élire, on doit aussi étudier la connaissance que le candidat a des problèmes du pays. Sait-il comment fonctionne la justice ? L'armée ? L'économie ? La politique? Le social? Il faut aussi étudier sa vision du monde. Croit-il au bien-être de tous ou croit-il que certains sont nés pour commander d’autres. Soutient-il les pays agressés ou plutôt les agresseurs ? Pour voter, on étudie aussi le parti politique du candidat ainsi que les valeurs et le programme de ce parti.
Leçon 8 : Les méthodes non violentes de lutte
Fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la démocratie ne peut s'accommoder de la violence. La démocratie n’est possible que dans un climat de non-violence. Mais pour le gouvernement violent, la non-violence est un appel du peuple à la passivité. Il y'a donc la non-violence passive et la non-violence active. Il est question ici de la non-violence active. Elle est très utile quand les acteurs du changement ont le rapport de forces armées en leur défaveur.
Dans nos quartiers nous assistons souvent aux bagarres de couples, avec des badauds qui, au lieu de séparer, encouragent. Des manifestants cassent, jettent les pierres sur les véhicules, démolissent les portes des bâtiments, se battent entre eux. Des parents soumettent leurs enfants à des traitements inhumains en disant faire leur bien. Des professeurs exploitent les élèves, allant jusqu’à leur demander de travailler dans leurs champs. La corruption se généralise dans les écoles. Des chefs politiques et coutumiers tyrannisent leur population. Des hommes et des femmes sont exilés, torturés, bannis par les dirigeants politiques en place tout simplement parce qu'ils ont osé exprimer des opinions contraires à celles de leur chef. Des conspirateurs politiques sont exécutés. Les bandits commettent des crimes, ceux qui sont arrêtés sont tués par la population. Des ouvriers ont des salaires insignifiants et sont exploités par leurs employeurs, obligés de recourir soit à la prostitution, soit au vol, soit à la corruption pour nouer les deux bouts de chaque mois. Dans les entreprises, on assiste à des licenciements massifs sans préavis ou à des suppressions d'emplois et des avantages sociaux auxquelles les employés ont droit. Nous assistons à des arrestations arbitraires et au rançonnement des pauvres par les forces de l'ordre. Nous voyons régulièrement des soldats disperser à coups de matraques et de crosses des manifestants (étudiants, fonctionnaires, grévistes…) qui n’ont comme seul tort que de crier sur la rue leur soif de dignité et de liberté. Ils vont même jusqu'à tuer, appelant cela rétablir l’ordre et la paix sociale. On assiste à des parades militaires avec déploiement d'armes sophistiquées pour dissuader l’ennemi éventuel. Des pays annexent et colonisent d’autres.
Efficacité de la non-violence
Nous avons vu des peuples qui, par des moyens non violents, ont réussi à renverser des dictatures. Ce fut le cas aux philippines en 1986. Des hommes et des femmes combattent pour la liberté et parviennent à résoudre des conflits sociaux avec des moyens non violents. Des travailleurs parviennent à avoir des augmentations de salaires après une grève pacifique. Des gens parviennent à faire libérer leurs concitoyens détenus injustement, à mettre fin aux arrestations arbitraires en allant tout simplement s’asseoir devant les locaux de la gendarmerie.
Les différentes formes de violence
Il y a deux principales formes de violences : la violence individuelle et la violence structurelle. La violence individuelle est celle que nous vivons dans nos relations interpersonnelles. Elles sont psychologiques, affectives, sociales et culturelles. La violence institutionnelle ou structurelle est celle qui est liée au fonctionnement des institutions politiques (dictatures), économiques (salaires injustes), juridiques (lois injustes), religieuses (intolérance religieuse, guerre de religions) et idéologiques (les idéologies qui prônent les rapports sociaux de dominations). Cette violence pèse généralement sur les plus faibles et les plus pauvres, ceux qui ne savent pas se défendre. C’est la violence de l’ordre établi qui est l'ordre des puissants, des nantis. D’une manière générale, la violence commence par toute action qui nie la dignité humaine (injures, calomnie, diffamation). Elle s'exprime par des traitements dégradants, tortures, humiliations, viols, enlèvements, coups et blessures.)
La résignation, la passivité, la lâcheté, l'indifférence, le fatalisme, la fuite dans la prière ou les sectes, le désespoir et le silence sont les manières classiques de réagir à la violence qu'on subit. Ces manières sont liées à l'impuissance et à la peur. Une autre manière est la contre-violence, qui consiste à réagir à la violence de l'autre par une violence plus forte ou de même intensité. A la contre-violence de l'opprimé, l'oppresseur répond généralement par une violence répressive pour rétablir l'ordre et la paix. La troisième réaction à la violence est la non-violence active. L’opprimé se défend en utilisant d'autres moyens que ceux de l'oppresseur.
Comment mener une action non violente ?
Le non-violent cherche à s'unir à d’autres qui partagent le même idéal et s'engagent dans le même combat. Il devra trouver où ils sont, les découvrir, les rencontrer et s'engager avec eux à marcher main dans la main pour un même idéal. Il faut une préparation et une stratégie bien élaborée pour répondre à la violence structurelle. L’action non violente sollicite l'imagination créatrice des victimes de la situation injuste ou violente. Il n’y a pas d'action adaptée à toutes les situations. Dans la lutte non violente, les actions à entreprendre doivent être décidées de façon démocratique. Elles ne peuvent pas être décidées par une seule personne qui les impose au groupe.
La première étape d'une action non violente est la préparation. Il faut analyser d'abord la situation de violence en identifiant la situation injuste ou violente, en recherchant l'auteur ainsi que les victimes de la violence, les complices de l'injustice, les causes de la violence et les conséquences immédiates et à long terme. Ensuite, il faut préparer des équipes pour raffermir l'esprit de non-violence et créer des convictions et des motivations pures : conférences, recollections, retraites, prières, jeûnes. Il faut aussi faire des jeux de rôles pour habituer les participants à la lutte non violente et les amener à contrôler leurs pulsions agressives. On apprend aussi à parler aux militaires pour toucher leur sensibilité et conscience.
La deuxième étape concerne les actions. Lorsque toutes les tentatives de dialogue échouent, on passe aux actions directes : manifestations/marches pacifiques par exemple, démonstrations, pétitions, lettres ouvertes, jeûnes, prières. Le but est d’exercer la pression morale sur l'auteur ou les auteurs de l’injustice, et l'amener au changement. L’arme la plus lourde de la non-violence est la désobéissance civile. Il s'agit de désobéir aux lois et aux ordres injustes. La désobéissance civile constitue un refus de collaborer avec le mal. Le boycott et la grève exigent une préparation particulière. Il faut prendre des dispositions pour ne pas provoquer la destruction des personnes et des biens. Lorsque le personnel d’un hôpital grève par exemple, un service de permanence doit être organisé afin d'éviter que les malades soient pénalisés.
La troisième étape est l'alternative constructive. La lutte non violente ne s’attaque pas aux causes profondes. Elle supprime les effets pendant un moment, mais laisse les causes intactes.
Leçon 9 : Les Syndicats
Dans des situations de crise, les travailleurs sont les plus faibles. Ils sont souvent victimes de mesures injustes. Même dans les périodes saines, ils ne sont pas à l'abri de l’exploitation. Ils doivent avoir la possibilité de défendre leurs droits légitimes. Les travailleurs sont souvent exploités à cause de leur ignorance. Ils ne connaissent pas leurs droits, ni les obligations de l'Etat et des chefs d'entreprises. Parfois ils déclenchent des actions, mais mal préparées ou dans le désordre, elles aboutissent plutôt à une situation d'anarchie qu'à une solution des problèmes, ou encore leurs actions ne produisent pas de résultats parce qu'ils ne sont pas animés par l'esprit de solidarité.
Faits et commentaires
Dans une entreprise, dix ouvriers sont licenciés du jour au lendemain. Le patron leur paie les jours qu'ils ont travaillés et leur demande de signer la résiliation du contrat de travail. Vu leur âge, ils n’auront plus de chance d’être engagés dans une autre entreprise. Ils se demandent comment ils vont nourrir leurs enfants. Quelques temps après, il apprennent que le patron les a remplacé par des ouvriers plus jeunes, et tous originaires de la région du patron. Dans une autre entreprise, les travailleurs doivent faire dix heures de travail par jour, avec des salaires dérisoires. Tout employé qui demande l'augmentation de salaire est licencié sans préavis. A plusieurs reprises, des enseignants ont fait la grève. Après un certain temps, quelques professeurs ont reçu des voitures pour leurs déplacements, d'autres n’ont rien reçu et continuent à refuser de donner cours.
Le monde du travail occupe une place très importante dans chaque Etat. Car grâce au travail et à son organisation que l’Etat peut contribuer à la prospérité du peuple tout entier. L'Etat porte donc une grande responsabilité dans le domaine de l'emploi. C'est pourquoi il élabore une législation et une règlementation du travail. Un contrat de travail contient les droits et les obligations de l'employeur et de l'employé, et l'Etat veille à sauvegarder les droits et les obligations des uns et des autres. L’Etat mène aussi une politique salariale juste pour tous les citoyens et élabore dans ce but une bonne législation. Il doit également veiller à ce que la législation soit appliquée.
Que faire ? Action syndicale
Individuellement les travailleurs sont faibles. Pourtant ils sont nombreux et c'est leur grand nombre qui sera leur force. S'ils se réunissent, s’ils s'organisent, s’ils se choisissent des chefs, s’ils sont vraiment solidaires et emploient les moyens dont ils disposent, alors ils pourront exiger des employeurs le respect de leurs droits. Les travailleurs de toutes les professions ont le droit, selon la loi, de s’organiser en syndicats. La sagesse populaire nous enseigne la force de la solidarité. Les syndicats ont donc un rôle important à jouer, et cela dans plusieurs domaines. Un syndicat ne peut pas fonctionner efficacement sans dirigeants dynamiques et motivés. Ce sont les travailleurs qui doivent choisir librement leurs dirigeants. Les travailleurs auront un contrôle sur les dirigeants élus par eux et les dirigeants soutiendront les travailleurs dans les actions à mener. Les dirigeants doivent être compétents. Ils doivent connaitre les lois, les droits et les devoirs des employés et des employeurs. Ils doivent être honnêtes, accepter de s’engager avec et pour leurs camarades, ne pas se laisser corrompre, être courageux et ne pas devenir eux-mêmes des exploiteurs. Le dirigeant syndical entretient le dialogue constant avec les travailleurs, écoute les travailleurs pour connaitre leurs problèmes, étudie les problèmes, réfléchit et cherche des solutions justes, prépare et élabore des actions à mener avec les travailleurs, conscientise et informe correctement les travailleurs, coordonne les actions dans les phases de l'exécution, évalue les actions menées. Il est le porte-parole de ses collègues auprès du patron et vice-versa. Il doit veiller à la poursuite du succès de l’entreprise. Si les travailleurs sont bien payés, le patron peut exiger qu’ils travaillent bien. Ainsi l'entreprise produit d'avantage et ce sera pour le profit du travailleur lui-même, de l'entreprise et de l'économie de tout le pays. Si les entreprises fonctionnent bien, tous en profitent.
La plus grande force des syndicats est la solidarité. Si les travailleurs sont et restent solidaires, s'ils ne se laissent pas corrompre, ils seront capables de défendre leurs droits et d'exercer une pression sur les patrons et le gouvernement en vue d'obtenir le respect de leurs droits. Plusieurs dangers menacent la solidarité dans les syndicats. Il y a la multiplication des syndicats qui occasionne le risque d'éparpiller les forces, la corruption des dirigeants syndicaux, quand les travailleurs acceptent le licenciement des meneurs de la grève pour garder leurs emplois, quand les dirigeants des syndicats sont nommés par le parti politique. Il défendra les intérêts du parti e non des travailleurs. Mais un syndicat peut être organisé par un parti politique, mais il doit veiller à garder son autonomie.
Le premier moyen dont dispose un syndicat est le dialogue- négociation avec le patronat ou le gouvernement. En cas d’échec du dialogue, le syndicat peut organiser un arrêt temporaire du travail pour faire pression et provoquer un retour au dialogue. L’étape suivante sera une manifestation pacifique, une marche pacifique ou un sit-in (action de s’asseoir en un lieu public ou sur la voie publique). Par cette action, les travailleurs exposent leur problème au grand public pour que les mass-médias répandent leurs revendications. Cette action porte généralement beaucoup de fruits, car personne ne veut être traité d'injuste par l'opinion nationale et international. Si le sit-in ne marche pas, le syndicat peut engager une grève. C’est le dernier moyen du syndicat. La stratégie qui assure la réussite des actions syndicales est axée sur plusieurs points. D’abord il faut analyser la situation, examiner tous les aspects du problème, les causes de la crise. Il faut définir l'objectif, définir la nature des revendications. Une grève déclenchée sans objectifs précis dégénère en anarchie et n'aura pas de résultats. De telles grèves découragent les travailleurs et sapent la solidarité. Il faut aussi que ce soit des revendications justes et réalisables. Les autres doivent aussi connaitre les revendications, sinon les grévistes auront l'opinion publique contre eux et perdront toute crédibilité. Il faut donc savoir sensibiliser l'opinion et la gagner à la juste cause. Il faut convaincre et motiver tous ceux qui seront touchés indirectement par elle. Il faut mener toutes les actions dans la non-violence. Les travailleurs doivent obéir uniquement aux ordres des vrais dirigeants désignés d’avance et non pas à des meneurs ou des démagogues improvisés. Il faut éviter que des casseurs se mêlent à l'action et créent la violence.
En défendant leurs droits, les travailleurs doivent respecter ceux des autres. Avant la grève, il faut respecter les règles de procédure comme le préavis de grève. Le but de la grève doit être juste. La grève ne doit pas viser la fermeture de l'entreprise. Elle doit sauvegarder le bien commun. Elle ne peut paralyser les secteurs vitaux comme le transport, l'eau, l'électricité, les soins médicaux... Il ne faut pas abuser du droit de grève.
Leçon 10 : Critique de la démocratie bourgeoise
La démocratie prêt-à-porter réintroduite en Afrique au début des années 1990 est à plus d'un titre un concept problématique. Fomenté et manipulé par les pays occidentaux, le processus de démocratisation connait partout des échecs en tant que facteur de stabilité politique, d'unité nationale et de développement économique. Historiquement les occidentaux ont toujours été peu soucieux des aspirations et besoins réels de l'Afrique et des Africains. La réintroduction du concept de démocratisation en Afrique semble participer d'une stratégie globale de l'impérialisme culturel occidental et viserait à juguler la montée des luttes porteuses des aspirations des masses africaines et garantir la pérennité du néocolonialisme et des intérêts occidentaux en Afrique. La démocratie athénienne qui est présentée comme la plus parfaite des démocraties n’a fonctionné qu'un temps court dans un espace géographique n'excédant pas 2600 km2. La démocratie occidentale moderne est née dans un univers de pratiques contraires aux valeurs professées. Elle est née du meurtre des Indiens et de la négation de l'humanité des Africains. L’égalité pour tous signifiait l'égalité pour les blancs. L’ethnocentrisme et le racisme inhérents au capitalisme entame la crédibilité des prétentions universelles de la démocratie occidentale. Au sein même de la population blanche, les différences de classe détermine l’aptitude ou non à jouir des avantages de la démocratie. L’agent historique de la révolution démocratique en Europe a été en effet la bourgeoisie. Cette dernière a mis sur pied un Etat, élément de domination de classe sur les autres groupes sociaux. L’Egalite dont parle cette bourgeoisie est une égalité civile et non une égalité économique et sociale. Le suffrage universel qui fait la fierté des démocraties européennes n'est pas le meilleur moyen d’expression de peuples. L'électorat européen et américain est pour l'essentiel manipulé par une minorité technocratique ayant une assise financière, et qui impose ses points de vue par le mécanisme de communication de masse.
L’importation de la démocratie occidentale en Afrique est une erreur. Certains des protagonistes de cette démocratie occidentale en Afrique sont les partisans de l’ordre néocoloniale : anciens ministres, anciens députés, anciens fonctionnaires internationaux, anciens laquais de la Banque Mondiale et du F.M.I. En tant que berceau de l’humanité, l’Afrique a constitué un pôle d’initiatives et de développement historique dans les domaines scientifiques, technologiques, politiques depuis l'antiquité. Le concept africain de la Mâat est antérieur de plus de 20 siècles aux concepts grecs de la démocratie. Cette Mâat a fait tenir pendant des siècles la civilisation de l'Egypte pharaonique. Pourquoi abandonner ce qui a fait ses preuves pour copier ce qui ne marche pas ailleurs ?
Leçon 11 : L’endettement de l’Afrique
La dette extérieure est l’argent que nos pays doivent aux banques, aux gouvernements, pays et autres institutions des pays capitalistes les plus riches du monde. En 1991, la dette de l’Afrique subsaharienne s'élevait à 17.5 milliards de dollars et 223 milliards de dollars en 1995. La dette représentait en 1991 340% des ventes des pays de l'Afrique subsaharienne. Cela signifie que si nous avons vendu pour 100 dollars, nous devons rembourser 340 dollars pour la dette. La conséquence est que d’années en années, nous nous enfonçons dans la misère. Ce que nous gagnons en vendant nos produits ne suffit pas pour payer notre dette.
La dette est le fruit des décisions prises par les dirigeants de nos pays et des pays occidentaux, tous complices de notre misère. Une fois indépendants, les pays africains empruntent beaucoup d'argent chez les riches à des taux fixes et faibles. Mais à partir des années 1970, le taux d’intérêt n’était plus fixe, passant de 9 % qui étaient supportable à 15%, puis 19%. Les pays africains quant à eux utilisent les sommes empruntées pour le prestige et ne produisent pas. A partir de 1980, les pays africains deviennent incapables de payer leur dette. Une partie importante de la dette a été utilisée par les gouvernements pour réprimer leurs populations qui aspiraient à plus de liberté. Une autre a été détournée par les gouvernements ou utilisées pour une vie de luxe. L’essentiel de cet argent est retourné en Europe et en Amérique sous formes de détournements.
Dans les 1980, les pays européens et les Etats-Unis d'Amérique sont en crise. Ils augmentent d’avantage le taux d’intérêt des pays pauvres. Les riches se sauvent toujours dans le capitalisme en appauvrissant les plus pauvres. L'argent quitte plus le sud (pauvre) vers le Nord (riche). C’est en fait le sud qui finance et aide le nord. Entre 1982 et 1990, le sud a reçu du Nord 997 milliards de dollars, pendant que le nord a reçu du sud 1345 milliards de dollars à la même période pour rembourser sa dette. Les pays du tiers-monde ont remboursé en 12 ans 1662 milliards de dollars comme intérêts, soit 3 fois leur dette initiale qui reste encore à rembourser. Les pays pauvres paient depuis les intérêts de la dette. Les pays africains qui se sont spécialisés dans la production de matières premières pour les industries du nord se sont confrontés à une crise due à la saturation des marchés ou au remplacement du caoutchouc par des produits synthétisés. Ce qui fait chuter le prix des matières premières. En 1960, la Côte d’Ivoire doit vendre 3 tonnes de bananes pour acheter un tracteur. En 1970, elle doit vendre 10 tonnes et 20 tonnes en 1988 pour le même tracteur.
Plus de 50% de la dette n’est pas arrivée en Afrique. Nous remboursons aujourd’hui ce qui n’est arrivé chez nous. Les riches nous ont prêté l’argent parce qu’ils savaient qu’on ne pourra pas rembourser. Ils savaient qu’on devait payer avec notre souveraineté, en devenant leur néo colonie. Ils savaient qu’on devait enrichir leurs banques en payant constamment les intérêts de la dette. Quand on a été incapables de payer la dette, ils nous ont imposé les Plans d’Ajustement Structurels : limiter les dépenses publiques et plus précisément le social qui ne produit pas, privatiser les entreprises publiques, dévaluer la monnaie locale… Les Plans d’Ajustement Structurels créent le chaos dans les pays. La misère sociale augmente, mais la dette continue d'augmenter. Le Fond Monétaire International propose les FASR (Facilités d’Ajustement Structurel Renforcées) qui consiste à faire des prêts aux taux d'intérêt bas et au remboursement lent. Ces mesures permettent au FMI de maintenir sa forte emprise sur les pays pauvres et de les rendre définitivement dépendants.
Nous payons notre dette avec notre travail. La dette se paie en dollar. Nous devons donc travailler pour vendre à l'étranger afin de pouvoir payer la dette. Nous devons arrêter de payer la dette. Si l'argent que nous travaillons sert à payer la dette, avec quoi bâtirons-nous des écoles ? Des dispensaires ?