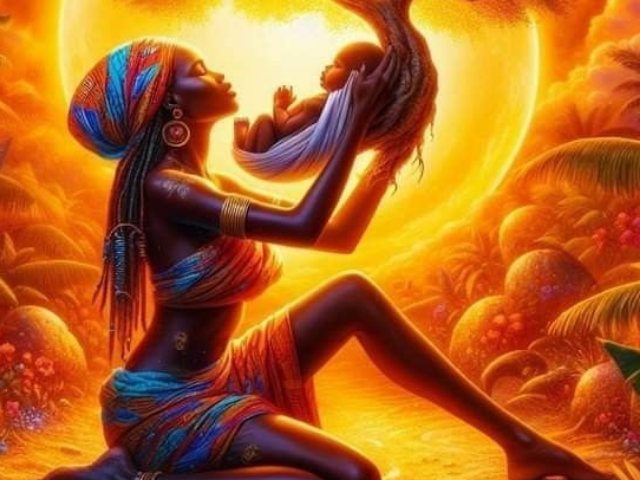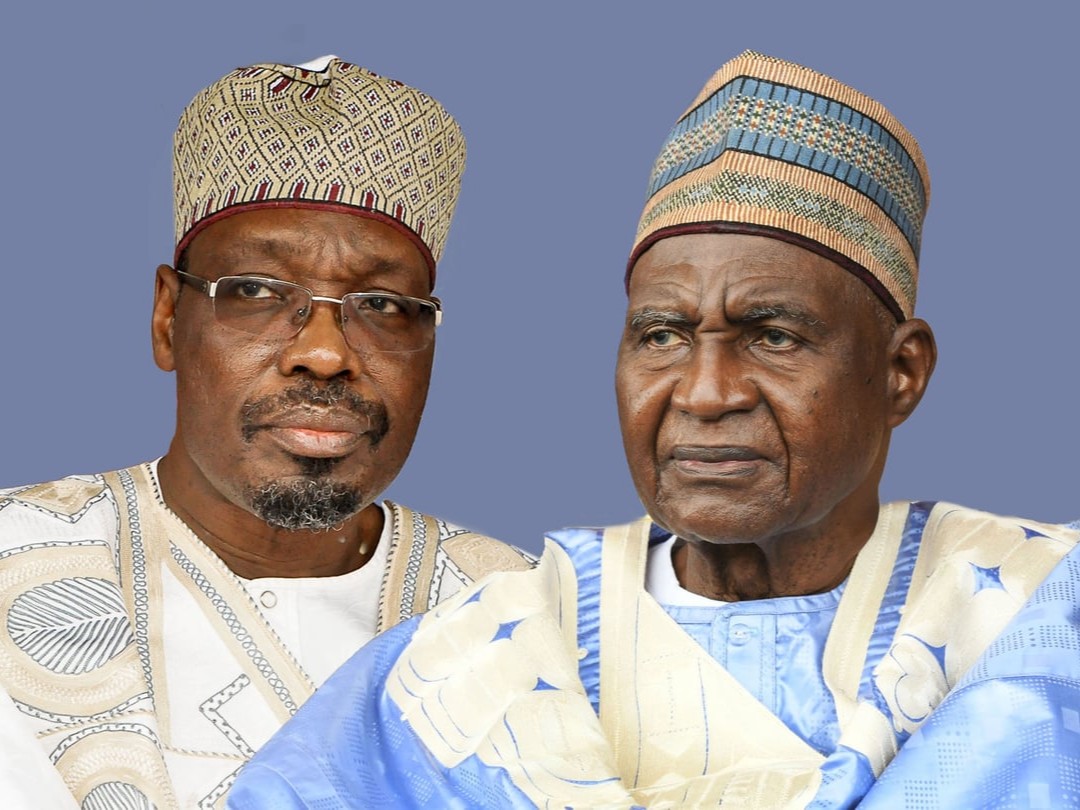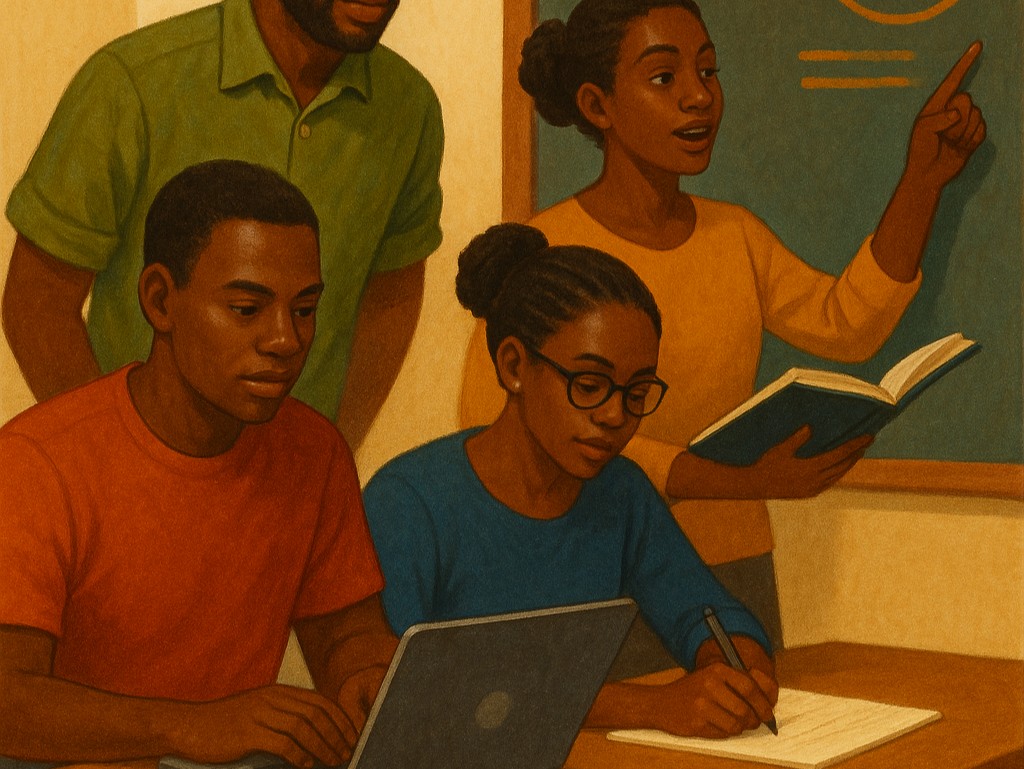Résumé de l’ouvrage : ABC DEMOCRATIE LA LUTTE CONTINUE… CONTINUE… CONTINUE… Vol 2
Leçon 2: L'engagement politique du citoyen
I- Faits et commentaires
En 1986, le peuple philipin effectue une marche pacifique pour protester les résultats du scrutin présidentiel. Cette marche aboutit au départ du président Marcos. En Afrique du sud, les africains ont organisé des villes mortes, des grèves et des marches contre l'apartheid. En 1990 en Mauritanie, l'Union des Travailleurs a refusé les réformes constitutionnelles de Ould Taya et a plutôt réclamé la convocation d'une conférence Nationale. Au Togo, les étudiants, jeunes chômeurs et élèves ont manifesté dans les rues en mars 1994 pour réclamer l'instauration du multipartisme et de la démocratie. C’est en réponse à la grève générale observée par les travailleurs que le gouvernement nigérien a proclamé le 15 novembre 1989, le multipartisme. Au Cameroun, l'arrestation de Yondo Black est ses compagnons à qui le pouvoir reprochait d'avoir voulu créer un parti politique a marqué le réveil de la société civile camerounaise. La création du SDF, l'affaire Mongo-Njawe, la création de CAP Liberté ... sont autant d’événements qui ont marqué l'engagement des Camerounais pour une société plus juste et démocratique. En 1991, les forces démocratiques se sont réunies au sein de la Coordination des Partis d'Opposition et Associations (CAP-Liberté, OCDH, HRW...), des organisations de femmes et des organisations estudiantines (le parlement). Forte de son soutien populaire, la coordination a lancé le mot d'ordre de villes mortes pour la Conférence Nationale Souveraine. Le pouvoir a réagi avec une extrême brutalité : 400 morts en 8 mois. Les services de la police politique ont engagé une action de désinformation pour saper le travail de la Coordination et ainsi désorganiser la lutte pour l'avènement de la démocratie.
Ce que nous pensons de ces faits
Toutes ces manifestations sont politiques et ont été faites par le peuple. La politique n’est donc pas réservée aux seuls politiciens. Elle est ouverte à tous, parce qu’elle est une nécessité de la vie sociale. Faire la politique pour le commun des mortels signifie mentir, voler ou tuer. Cette conception a été imposée par les avatars de la politique. La politique se définie comme l’organisation de la société en vue du bien commun de tous ses habitants. Elle ne vise ni la conquête ni l’exercice du pouvoir, mais cherche à promouvoir l’homme et la société. Dans ce sens, l’économique, le social, le religieux font partie de la politique. Quand un groupe de personnes s’organise dans une communauté pour aménager l’état des routes, ce groupe de personnes fait la politique. Quand plusieurs personnes se mettent ensemble pour réfléchir sur leur situation dans l’entreprise et l’améliorer, ils font la politique. Lorsqu’elles se mobilisent pour le bien commun, la justice, la défense de leurs droits, la dénonciation, les populations font de la politique. La politique concerne donc tous les citoyens puisque tous sont appelés à participer activement à l'organisation de la cité. La politique peut se définir comme l'ensemble des activités qui concourent à l'organisation de la cité et à l'exercice du pouvoir. Ces activités sont exercées par certains citoyens qui ont la politique pour métier. Il s'agit des politiciens sur le terrain ou des politologues qui font des recherches scientifiques dans le domaine de la politique. Dans ce contexte, faire la politique c'est entrer dans les structures du pouvoir politique : gouvernement, parlement, partis politiques...
Les chefs politiques dans une société démocratique reçoivent leur pouvoir du peuple qui a en retour, le devoir de les contrôler. L’exercice du pouvoir est orienté à la recherche du bien commun.
Sens de différentes manifestations de la politique
La politique révèle l'aspiration du peuple à la liberté, à la démocratie, à la dignité et à la plénitude de la vie. Dans beaucoup de pays du tiers-monde, les gouvernants ont érigé des régimes dictatoriaux qui, au lieu de servir l'intérêt du peuple, le maintiennent dans la pauvreté la plus abjecte. Ils conçoivent tout en fonction d’eux-mêmes, de leurs intérêts et de leur pouvoir. Ils s'imposent par la force, confisquent les libertés des personnes en les soumettant à des tortures et à des situations inhumaines. Ils sont incapables de répondre aux attentes du peuple. En manifestant dans la rue, le peuple ne révèle pas seulement ses attentes et ses aspirations, mais met à nu les mécanismes de la dictature qui étouffe sa dignité, ses droits et l’écarte de la gestion de la chose publique. Dignité et droits de l’homme, bien commun, espace politique viable, démocratie, sont des valeurs inaliénables sur lesquelles reposent toutes pratiques politiques et vers lesquelles elle doit tendre.
Sens de la réaction des autorités
Les autorités civiles et religieuses sont hostiles aux manifestations du peuple et les répriment souvent de manière sauvage parce qu'elles perçoivent ces manifestations comme une atteinte à leur sécurité, à leurs intérêts et surtout au pouvoir dont ils ont fait leur propriété. Dès qu'un pouvoir ne trouve pas ses intérêts dans ceux de son peuple, il se révèle incapable de le servir. Pour les dictateurs, toute initiative qui ne vise pas à consolider leur pouvoir est étouffée, aussi bonne soit elle. La religion adopte cette logique et fait alliance avec le pouvoir. La religion qui interpelle le pouvoir ou le conteste est qualifiée de subversive. Un engagement ferme prenant la forme d’une lutte qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême est nécessaire dans une dictature. Vouloir un état de droit, c'est accepter de s'engager dans une lutte contre les forces avilissantes et asservissantes. Par la peur, le silence, la lâcheté et la passivité, l'on se rend complice, coupable et responsable des actes des dictateurs. C'est parce qu'on ne résiste pas assez à leur force qu'on les encourage, qu'on leur permet d'agir et de devenir d'avantage dictateurs.
Que faire?
Il faut dès maintenant s'engager politiquement et passer à l'acte.
1- s'informer ou informer les autres
Les médias, tant nationaux qu’internationaux, constituent des instruments importants de communication et d'information. Les citoyens doivent lutter pour que les organes de presse leur livre des informations vraies et objectives. Il faudra développer l'esprit d'analyse, le sens critique pour ne pas accepter n'importe quoi. Dans une communauté, ceux qui connaissent ont l'obligation de faire sortir les autres de leur ignorance. Pour cela, on organise des séminaires et des cours appropriés. L'information doit aussi sensibiliser aux injustices et au mépris de la dignité des autres. Les actes d’injustice ou de mépris de la personne humaine doivent être signalés ou rendus publics, surtout si l'on veut les combattre. Au cas où l'accès aux médias officiels apparaissait impossible, on utilise alors les affiches. L'information qui va de bouche à oreille est aussi très efficace. L'information est un aspect très important dans l'engagement.
2- Se former et former les autres
Il s'agit ici de la formation politique. Une personne formée politiquement cesse de percevoir la dictature et la misère comme des fatalités décidées par Dieu ou le diable. Elle les analyse comme des maux créés par des hommes et qui peuvent par conséquent être soignés par d’autres hommes. En apprenant à maitriser les techniques d'organisation des masses ainsi que les mouvements historiques de flux et de reflux dans la lutte, nous résistons mieux au découragement et à la corruption, au fatalisme et à l'apathie. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être de simples objets que l'on manipule. Nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maitres de notre destin.
3- s'engager personnellement dans la société
La politique ne devrait pas avoir d'autres objectifs que la promotion de la personne humaine, du bien commun et de toute la société. A ce titre, les citoyens sont appelés à s'engager dans différents domaines de la vie publique surtout s’ils en ont les compétences. De manière plus directe, ils peuvent poser leur candidature pour un poste de responsabilité plus important et ce uniquement dans le but de rendre service à la nation. Le citoyen qui vote doit être guidé par l'incorruptibilité, le souci de l'objectivité et du bien commun.
4- S'engager dans une organisation
On peut adhérer à un parti politique pour participer à la vie politique et pour orienter et influencer les options et décisions politiques. Les citoyens devront d’abord examiner la valeur du projet de société, le programme d’action du parti politique, les qualités morales de ses leaders et leur sens de créativité avant de s’y inscrire. Un moyen de pression est une action insistante qui tend à contraindre les autorités à agir en faveur du bien commun et des intérêts de tous. L’action de pression comprend le dialogue. C’est l'échec du dialogue qui détermine les actions directes de pression : non-coopération, désobéissance civile (grèves, boycotts, sit-in, marches pacifiques, villes mortes, jeûnes ...) Ces actions demandent une bonne et intensive préparation, la participation de tous, l'esprit de sacrifice pour une lutte qui concerne les problèmes graves de chacun.
5- Prévoir des programmes alternatifs et constructifs
Après la pression, il faut concevoir un programme qui établira l'homme dans sa dignité. Par exemple, après le régime dictatorial, il faudra mettre sur pied des structures démocratiques qui favorisent les libertés humaines et permettent à tous de participer à la gestion de la société, sinon on retombera dans une autre dictature. Les populations doivent être fortement impliquées dans ce programme alternatif, pour pouvoir agir eux-mêmes sur leurs conditions de vie. Quand les institutions d'un pays se révèlent incapables de répondre aux attentes et aux aspirations de leur peuple, il revient à celui-ci de s'organiser, de créer, d’inventer pour pallier cette lacune.
Leçon 3: La démocratie
I - Faits et commentaires
A- Ce que nous entendons et ce que nous voyons
Certains ont assimilé la démocratie au multipartisme, d'autres à une idéologie ou à une forme de gouvernement supérieur à la dictature. En 1989, le président français François Mitterrand déclare que l'aide française au tiers-monde sera conditionnée par la démocratisation de d'Etat et le respect des droits de l’homme. Par démocratisation il entend : système représentatif, élections libres, liberté de presse, indépendance de la magistrature, refus de censure. La même année, on assiste à la chute du mur de Berlin et à la réunification des deux Allemagnes, à la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud, à la destitution et à l’exécution du président roumain, à l’assassinat du président Samuel Doe du Libéria, à l’assassinat du président Moussa Traoré du Mali. Au Zaïre, l’un des plus grands dictateurs de l’histoire de l’Afrique, Mobutu est contraint à la fuite et à l’exil. Au Cameroun, les partis politiques sont nés ainsi que les syndicats. Des grèves se multiplient. Les manifestations populaires sont réprimées dans le sang. Les conditions de vie des populations n’ont cessé de se dégrader. Les abus des chefs d’entreprises, de certains maris dans les foyers, des chefs religieux et politiques se multiplient. A tous les niveaux, les méthodes d'exercice du pouvoir restent dictatoriales.
II- Ce que nous pensons de ces faits
Le terme démocratie n'est pas compris par tout le monde de la même manière. Certains parlent de démocratie et continuent de réprimer les autres. La démocratie veut dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. De ce fait, elle exclut le pouvoir d'une autorité qui ne procèderait point du peuple : dictature, oligarchie, monarchie, particratie... La démocratie n'est pas seulement un mode de gouvernement mais aussi un ensemble de valeurs sur lequel repose l'exercice du pouvoir. Les quatre piliers de la démocratie sont : La participation, l'égalité, la liberté et le sens du bien commun.
1- La participation
Tous les citoyens participent à la gestion de la chose publique, soit directement (démocratie participative), soit indirectement (démocratie représentative).
2- L’égalité
Tous les citoyens sont égaux en droit. Il n'y a pas ceux qui sont nés pour dominer les autres. Il n'y a pas ceux qui font les lois et ceux qui doivent se soumettre à ces lois.
3- La liberté
La démocratie apparait comme un ensemble de mécanismes protecteurs, une formule de gouvernement conciliant la liberté de l'homme avec les exigences de l'ordre politique. La démocratie combat pour la liberté.
4- Le sens du bien commun
Le bien commun est le bien qui appartient à toute la communauté, et qui est à distinguer du bien privé. La recherche du bien commun et le respect de ce bien doivent passer avant le bien privé. Les biens communs sont destinés à tous pour que chacun puisse en jouir. La justice distributive est celle qui veille à ce que les biens soient répartis de manière équitable de telle sorte que personne ne puisse manquer du nécessaire. La démocratie est donc le respect de l'autre, l'acceptation de la différence et la tolérance. C'est aussi un système de régulation pacifique des conflits par la médiation de la règle commune qui précise les droits et les libertés tant sur le plan individuel que collectif.
B. Que faire ?
Pour qu'advienne la société camerounaise démocratique, il nous faut engager des actions qui visent d’une part le changement des mentalités et d’autre part le changement des structures politiques et socio-économiques. Ceci demande de chacun un esprit de persévérance malgré les obstacles qu'on peut rencontrer.
Le changement de mentalité et de comportement requiert une action de conscientisation et de formation. Il faut organiser partout des conférences-débats, des séminaires et des sessions en suivant des méthodes actives et participatives qui sont plus conformes à l’esprit démocratique. Cette formation-conscientisation devrait amener chaque participant à incarner dans sa vie quotidienne les valeurs qui sous-tendent le système démocratique : le respect de la différence, la tolérance, le sens de la responsabilité, le souci de la participation, le respect du bien commun, la lutte pour la liberté... Chaque membre de notre société devrait aussi s'engager à exercer le pouvoir qu'il a sur les autres de manière démocratique (en famille, au travail, dans un parti politique...) Tout comportement autocratique, dictatorial devra donc être résolument combattu d’abord en nous-mêmes et puis chez les autres. Il faudra son esprit critique vis-à-vis des discours politiques pour ne pas se laisser manipuler, se libérer de la soif du pouvoir, de l'argent et des honneurs. Il faudra utiliser les medias pour ce changement de mentalité ou au besoin, créer des outils médiatiques : journaux, radios, télés libres.
Le changement de structure politique et socio-économique est la deuxième condition de la démocratie. L'objectif principal des mouvements de revendication populaire de 1991 initiés par les associations telles que CAP Liberté était le changement des structures politiques et socio-économiques du Cameroun à travers une évaluation impartiale des structures qui ont régi le pays depuis l'indépendance. Cette évaluation devait être faite à travers une Conférence Nationale Souveraine devant définir les options fondamentales à base desquelles l'on construirait les structures et institutions chargés de gérer les intérêts du peuple camerounais. Nous n’avons pas eu cette conférence. Il faut changer les structures politiques d'abord et aller ensuite aux élections ensuite.
Leçon 4 : Le rôle de la presse
I- Besoin d'expression et frustrations
La tension monte, les langues se délient
Les Africains ne chantent plus tellement les louanges des dictateurs. Au contraire, on exprime volontiers son opposition au régime. Ce qui fait monter la tension, parfois jusqu'aux crimes. Les médias exercent un pouvoir puissant. Le presse surveille et critique les faits et gestes du pouvoir. C’est pourquoi les responsables politiques en Afrique tiennent absolument à contrôler les médias. La parole orale et l'image ont la force d'atteindre et d’influencer facilement jusqu'aux couches analphabètes de la population. La liberté est plus grande en Afrique pour la presse écrite. Mais à cause des difficultés matérielles et financières, cette presse n'atteint qu'une minorité intellectuelle des villes. Les imprimeries sont souvent incendiés par des militaires ; les vendeurs de journaux traqués, battus, enlevés. Les journaux sont souvent déchirés ou brûlés, parfois les organes de presses sont interdits pendant des mois.
1- Que penser d’une presse libre et responsable ?
Les médias jouent 3 rôles traditionnels : divertir, informer, former.
Divertir
Les pouvoirs dictatoriaux ont souvent recours aux médias pour distraire le peuple, le tromper, lui refuser l'information véritable et utile. Les médias deviennent ainsi une drogue pour endormir le peuple (films, musiques, sport.)
Informer
Le rôle des médias est d'apporter l’information, d'annoncer au grand monde possible les événements qui se passent à un endroit ou à un autre du globe. Les agences de presse stockent des informations et les proposent aux clients abonnés. Les différents médias qui vont puiser à la même source évoquent les mêmes événements, parfois dans les mêmes termes. Les agences de presse couvrent la planète entière avec des correspondants, des envoyés ou des reporters. Le traitement de l’information commence par le choix à opérer dans la multiplicité des faits et événements.
Eduquer
L'information donnée par la presse aide l’individu à un meilleur épanouissement de ses facultés physiques, mentales et spirituelles... La presse doit remplir les fonctions explicites d'éducation et d'intégration sociale, surtout dans le tiers-monde. La presse devient donc facilement politique, car elle contribue à consolider les frontières géographiques dans les jeunes nations africaines, à rassembler les citoyens autour d'un idéal commun et d’éviter toute velléité de sécession, de séparatisme ethnique, religieux ou autre. À l'époque du monopartisme, la presse n'a pas été épargnée. Il y avait une seule radio officielle, une seule presse officielle pour dire toujours la même chose, acclamer toujours le chef unique.
II- Une tâche pour les démocrates
Education à l'esprit critique
La première chose à faire pour développer et préserver la liberté d'expression c’est de se faire soi-même son opinion de tout ce qu’on entend ou lit. Le journaliste peut mentir pour un intérêt ou un autre, ou se tromper. Nous devons toujours nous demander qui dit quoi ? A qui? La loi oblige généralement tout journal d'afficher publiquement ses propriétaires et éditeurs ou directeur. C’est pour les besoins de la justice, en cas de délit. Le lecteur a intérêt à connaître ceux qui produisent un journal, ceux qui financent, et qui donc influencent d'une manière ou d’une autre. Il y a des journaux payés pour faire la propagande d’une autorité. La concurrence entre médias envoie le journaliste à la recherche de scoop, de l'information sensationnelle et exclusive qu'il sera le premier à livrer au monde. Sa vigilance peut alors facilement être prise à défaut. A vouloir arriver vite, avant les concurrents, on tombe dans la précipitation. Le journaliste qui fait une erreur peut le corriger, et celui qui se sent lésé dans le traitement d'une information peut faire un droit de réponse dans la même presse pour se défendre. Le média est tenu de publier le droit de réponse gratuitement. Pendant la campagne électorale, les médias sont parfois utilisés pour calomnier et insulter les adversaires, mais aussi pour faire de promesses irréalisables. Nous devons donc exercer notre esprit critique.
Recoupement
Tout utilisateur des medias a besoin de plusieurs sources médiatiques et les confronter pour se faire sa propre idée sur les événements rapportés.
Objectivité
L’objectivité est un idéal jamais atteint totalement. Chacun voit la réalité à sa manière, selon ses désirs cachés, son éducation, ses projets de vie... On demande à un journaliste d'être au moins sérieux et sincère dans la vérification des faits rapportés et dans la manière de les rapporter.
Vivre l'exigence de la vérité
Ethique et déontologie
L'honnêteté attendue de journaliste est une valeur morale. Il faut un sens moral aigu pour respecter l'intimité, la vie privée, la réputation d'autrui, pour éviter tout mal à propos de l'information, de la culture et du divertissement. La réflexion morale montre les limites de toute information. Mais ce qui doit être dit doit être dit. Le journaliste doit garder sa liberté, son indépendance vis-à-vis de tout pouvoir dont les intérêts viendraient le forcer à manipuler l'information, à truquer les faits, à mentir.
Leçon 5 : comment se libérer des manipulations?
Le rideau s’ouvre
Nous sommes tous le jouet de certaines personnes qui nous font marcher, exactement comme des marionnettes qu’on manipule par des fils. Au monde, il y a suffisamment de nourriture, de biens, de richesses pour tous les habitants. Mais seule une petite partie de la population vit dans l’extrême richesse, une autre petite partie vit bien tandis que la grande majorité croupit dans la misère. Ils travaillent toute leur vie, meurent avant l’âge de misère, de malnutrition, de maladies, d’excès de soucis. Mais ils ne se plaignent pas parce qu’ils considèrent que c’est une fatalité contre laquelle ils ne peuvent rien. Ils se résignent. Les accapareurs de richesses ont trouvé quelque chose pour empêcher à ceux qui misèrent de s’opposer à eux.
I- Un théâtre de marionnettes
On est dans un jeu où une grande poupée manipulée tient des fils et manipulent les autres plus petites. La personne qui manipule la grande poupée manipule en même temps toutes les autres. Le monde ressemble à un grand théâtre. Nous nous croyons indépendants, mais erreur! Nous ne voyons pas seulement les fils qui nous tirent dans tous les sens, qui nous font danser au gré de ceux qui mènent le jeu.
Comment se présente ce théâtre?
Les puissants manipulent tous les fils. Ils dominent tout le monde. Quand ils se battent entre eux, les marionnettes s'entretuent. Les puissants les regardent s’entre-déchirer. Car les marionnettes travaillent pour eux. Les arrivistes se laissent manipuler par ceux d'en haut dans l'espoir d'arriver à l’échelon supérieur et pouvoir à leur tour jouir de cette position privilégiée. Ils sont les humbles serviteurs des puissants. Les amorphes sont les dociles, les plus maniables. Toujours prêts à dire oui, à se laisser tirer vers le bas. Les écrasés n'ont personne en dessous d'eux, personne à manipuler. Ce sont les plus pauvres. Ils ne peuvent qu'essayer de supporter. Les rebelles solidaires ne se trouvent nulle part dans la chaine. Ils veulent supprimer les ficelles. Ils se retrouvent, se concertent, se solidarisent et passent à l’action. Dès que quelqu'un s’attaque à la chaine, les fils s'entremêlent. Ceux d’en haut se fâchent et le théâtre risque de s’écrouler.
II- Les huit fils de la marionnette
1. Le fil au front
C'est le fil de la fatalité. Il nous enseigne que ça ne sert à rien de vouloir changer quelque chose. La vie est comme ça. Certains naissent riches et d’autres naissent pauvres.
2. Le fil au cœur : la religion
Il nous enseigne que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, et il a un plan pour chacun de nous. C’est le grand art des manipulateurs : faire croire aux gens que la soumission, l'obéissance, la tranquillité, l'acceptation de la situation, c'est faire la volonté divine. Les manipulateurs enseignent que Dieu viendra résoudre tous les problèmes des hommes et chasser les méchants.
3. Le fil au cou : La soumission
Il nous demande de supporter pour le maintien de l'ordre, pour la sécurité. Ceux qui dirigent le théâtre ont des bâtons, des revolvers, des tanks, des bombes atomiques pour se défendre et prétendent défendre la patrie. Ils donnent des armes aux pauvres des pays pour s’entretuer au nom de la patrie.
4. Le fil au cerveau : l'ignorance
Ceux qui contrôlent le théâtre aux marionnettes ont des écoles ou eux-mêmes et leurs enfants apprennent l’art de jouer avec les ficelles avec un maximum d'efficacité. A côté, ils construisent des écoles de seconde classe où l'on enseigne à obéir et à se laisser manipuler. Ces écoles sont privées de connaissances.
5. Le fil dans les yeux et les oreilles: Les médias
Ils mêlent à la vérité toute une série de mensonges. Même quand on ressent le mensonge, on est obligé de continuer de les suivre pour s’informer. Ils conditionnent notre comportement. Les médias qui disent la vérité, qui se solidarisent de la misère du peuple sont très peu, et sont constamment étouffés. Il faut des millions pour avoir une chaine de télévision. Il est clair que ceux qui ont ces chaines sont du côté des manipulateurs.
6. Le fil au pied : L’appât du gain matériel
On fait miroiter à nos yeux différents types de gains. Les arrivistes, amorphes et écrasés courent derrière ces gains en enrichissant les puissants. De temps en temps, pour ne pas nous décourager, les puissants nous laissent goûter, pas plus.
7. Le fil aux épaules : l'indifférence, l'individualisme
L’astuce consiste à convaincre chacun que le problème de l’autre n’est pas son problème. Chacun se retrouve seul dans son coin. Par les médias, l'école, la famille, on nous pousse sans cesse à l'individualisme.
8. Le fil aux mains: La compétition stérile
L'esprit de concurrence provoque le plus souvent la destruction de la nature, souvent aussi des guerres féroces. Dès l'enfance, on cherche à faire de nous des premiers. Tous les moyens sont bons, pourvu qu'on gagne, vient alors l’orgueil, la jalousie, le mépris des faibles. Seuls les forts l'emporteront. Les faibles seront écartés. Il n'y a pas de place pour eux dans le monde de concurrence effrénée.
III- Comment couper les huit ficelles
Si nous coupons un seul fil, les autres vont lâcher aussi, car tous sont entremêlés.
a- Se libérer de la fatalité
La vie n'est pas une fatalité, telle doit être notre première pensée. Tout a une cause, tout peut s'expliquer. Si une armée de volontaires ne s’était pas levée pour combattre les razzias négrières, il y'aurait eu plus d'esclaves. Ceux qui pensaient à la fatalité ont en tort. Il faut toujours chercher le pourquoi des choses.
b- Se libérer de l’opium du peuple
Je suis croyant mais je ne crois pas à ce Dieu qui m'obligerait à ramper, à tout subir. Le vrai Dieu est juste et libérateur. Ce sont les manipulateurs qui ont inventé ce Dieu qui nous paralyserait. Certaines religions sont payées par l'étranger pour endormir les gens qu'ils soumettent, pour les évader et les empêcher de se révolter contre les injustices. On cherche à droguer les jeunes avec les boissons alcooliques, le sexe, la cigarette pour les rendre totalement malléables.
c- Se libérer de la soumission
Théoriquement les agents de l'ordre, les forces armées sont là pour assurer notre protection, or celui qui paie commande. Celui qui paie pour avoir les manieurs des matraques commande aussi ces manieurs de matraques. Dans beaucoup de pays, ce sont souvent les voleurs et les assassins qui contrôlent la police et l'armée. Ils disent qu'ils sont pour notre défense, mais ils écrasent toute tentative de résistance. Les tanks, les avions, les armes appartiennent aux plus riches. Ils poussent les plus faibles à renoncer à tout armement pour pouvoir les écraser plus facilement. C’est ainsi que les puissants se maintiennent au pouvoir.
d- Se libérer de l'ignorance
Nous devons accroître sans cesse nos connaissances, chercher à connaitre comment fonctionnent les êtres et les choses. La formation politique nous permet de mettre notre savoir au service de la bonne cause.
e- Se libérer de la manipulation des médias
Face aux médias, on doit toujours se demander ce qu'on veut nous vendre et celui qui veut nous vendre. Il ne s'agit pas de celui qui se présente à l’écran. Celui-là fait juste son travail. Il faut varier nos sources pour avoir des bonnes informations.
f- Comment ne pas courir derrière les carottes ?
Il ne faut pas permettre qu’on nous manipule. Le produit pour lequel on fait un maximum de publicité n'est pas nécessairement le meilleur, simplement que le promoteur est un homme qui a beaucoup d'argent. De même, celui qui gagne une guerre n’est pas nécessairement celui qui a raison, mais celui qui est le plus fort.
g- Se libérer de l'indifférence et de l'individualisme
Les puissants réussissent à ce que chaque personne ne s'occupe que de ses propres problèmes. Ils réussissent à faire croire aux gens que les problèmes de la société ne les regardent pas. Pour pouvoir se libérer, on doit contribuer à la libération des autres puisqu'on est lié, et le monde tend à devenir un village planétaire. Ils interdisent souvent les réunions, opposent les peuples contre les peuples, les races contre les races.
h- Se libérer de la compétition futile
Il faut se convaincre que nous serions beaucoup plus heureux en nous aidant les uns les autres. Nous avons tous un instinct d'agressivité qui nous amène à lutter contre la difficulté. Cette agressivité est souvent orientée vers les jeux. Les puissants cherchent à tirer profit de cette agressivité et organisent des championnats et des concours. On peut utiliser cet instinct d'agressivité autrement, ensemble pour lutter contre la maladie, la famine, les dangers de la nature, pour essayer de rendre le monde heureux.
Leçon 6 : Comment choisir son parti politique ?
I- Faits et commentaires
Depuis 1990, on parle beaucoup de multipartisme, des leaders des partis politiques font le procès de la gestion du pays. Nous voyons des partis qui ont des membres et d'autres n'en ont pas, si ce n'est le président et la direction provisoire. Certains partis n'existent que par des déclarations publiées dans tel ou tel journal de la place. Des partis organisent des manifestations pour témoigner de leur présence. Des leaders donnent de l'argent ou font des largesses aux gens pour acheter leur sympathie ou leur adhésion. Des gens exigent de l'argent ou des biens matériels pour adhérer à un parti. Des gens ont des problèmes en famille parce qu'ils ont refusé d'adhérer à tel ou tel parti. Des gens ont des difficultés au travail parce qu'ils ont refusé d’adhérer au parti du patron. Beaucoup n'appartiennent à aucun parti politique. Certains partis se regroupent tandis que d’autres se divisent. Certains leaders de partis politiques vont en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique se faire accréditer par les puissances qui continuent de nous opprimer. Des membres de l'ancien parti unique deviennent des leaders des partis de l’opposition. Des partis se créent sur des bases tribales, régionales, d'autres sur des bases idéologiques. Certains partis dialoguent avec le pouvoir tandis que d'autres refusent toute entente avec le régime. Tous les partis annoncent une société nouvelle, faite de justice et de démocratie.
II- Regards sur l’histoire
Le multipartisme n'est pas nouveau en Afrique. C’est à partir des années 1940 que les partis politiques commencent à se créer au Cameroun. On est ensuite passé au monopartisme pour revenir au multipartisme. Le parti unique refuse les libertés fondamentales, empêche toute initiative privée et favorise la personnalisation du pouvoir par la concentration du pouvoir entre les mains d'un individu. Le parti unique frustre le peuple dans la mesure où ses intérêts ne sont pas pris en compte par ceux qui ont le pouvoir. C’est cette insatisfaction du peuple qui, conjuguée avec d'autres facteurs externes, a conduit à la réinstauration du multipartisme.
III- Ce qu’est un parti politique
Un parti politique n'est pas une association ethnique ou tribale, ni un club d'amis ou un cercle culturel. C’est une organisation visant à rechercher le soutien populaire à travers des élections ou de toute autre manière, dans la volonté délibérée de prendre et d’exercer le pouvoir, seul ou avec les autres, et possédant une structure durable et des implantations locales bien établies.
IV- Le rôle d’un parti politique
En plus des autres rôles, trois rôles sont essentiels à un parti politique. En vue des élections, le parti politique sensibilise et encadre ses militants pour qu’ils se décident à choisir les candidats présentés par le parti. Le parti exerce un contrôle sur les autorités qui exercent le pouvoir. Il propose aux militants et à l'opinion les critères d'appréciation des réalités politiques, sociales, économiques et culturelles basées sur l'idéologie, un système de valeurs.
Il existe plusieurs types de partis politiques. Nous avons le parti des cadres qui vise surtout à réunir les notables. Son financement est surtout extérieur. Le parti des masses cherche à réunir le maximum de personnes possible. Une opposition qui ne propose pas d’alternative constructive n’est d’aucune utilité.
Que faire?
Il n'y a aucune obligation morale à adhérer à un parti politique pour participer à la vie politique ou pour influencer les décisions politiques. On peut être sympathisant sans être membre adhérent. On peut se contenter aussi d'appartenir juste à un groupe de pression. Un groupe de pression est une organisation regroupant plusieurs personnes qui, sans chercher à conquérir le pouvoir, font pression sur le pouvoir, sur les gouvernants, de façon à les amener à agir dans le sens qui leur est favorable. Entre les groupes de pression et les partis politiques, il peut exister des rapports d'action réciproque.
Pour adhérer à un parti politique, il faut vérifier les critères suivants :
- Son projet de société et son programme d'action doivent viser le bien Commun ;
- Les qualités morales, la compétence et la crédibilité des leaders et de ses membres fondateurs ;
- Sa capacité à innover et sortir des sentiers battus.
Une fois l'adhésion faite, il faut éviter de tomber dans le piège du fanatisme, et du chauvinisme qui engendrent l’intolérance et peuvent aboutir à la guerre. On doit développer notre esprit critique, même vis-à-vis de notre propre parti.
On juge un parti politique, non sur ses discours, mais sur ses actes en faveur de l'homme et de la société. Plusieurs partis se créent uniquement pour la course au pouvoir. Le multipartisme contribue au développement de la démocratie. Mais dans notre pays, la multiplication à l'infini des partis politiques ne semble pas constituer un choix pour la démocratie. Certains de ces partis ne sont que des émanations et des ramifications de l’ancien parti unique. Ils sèment la confusion.