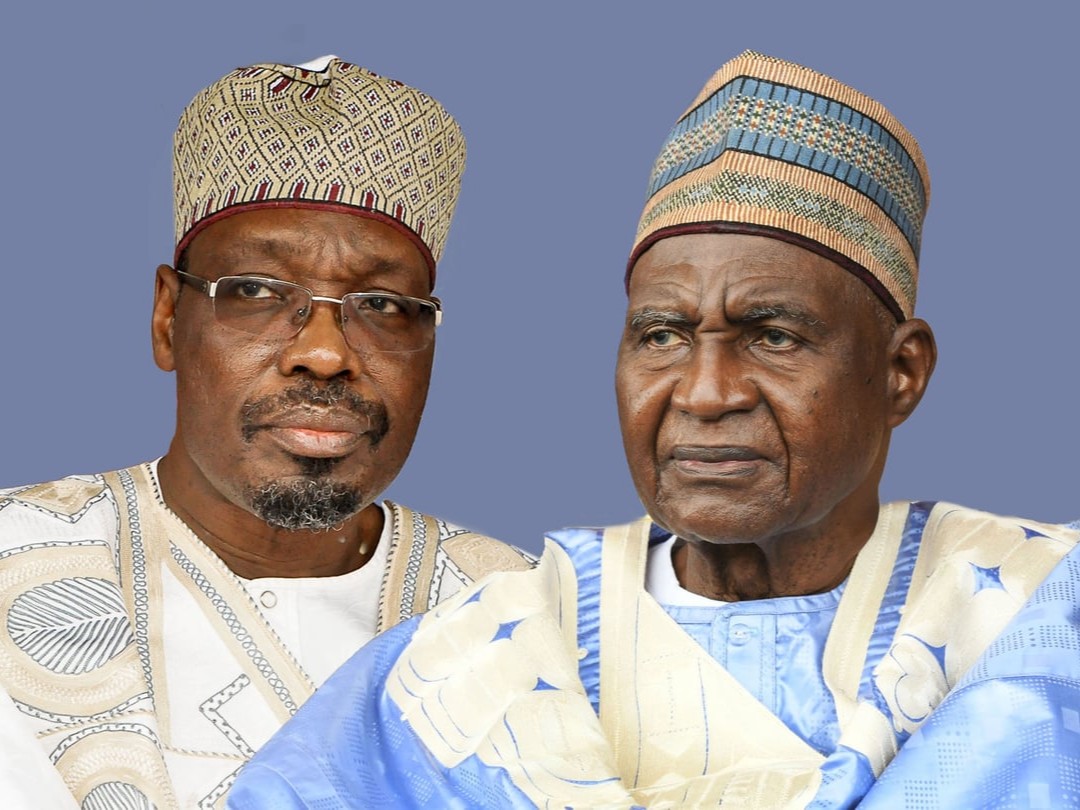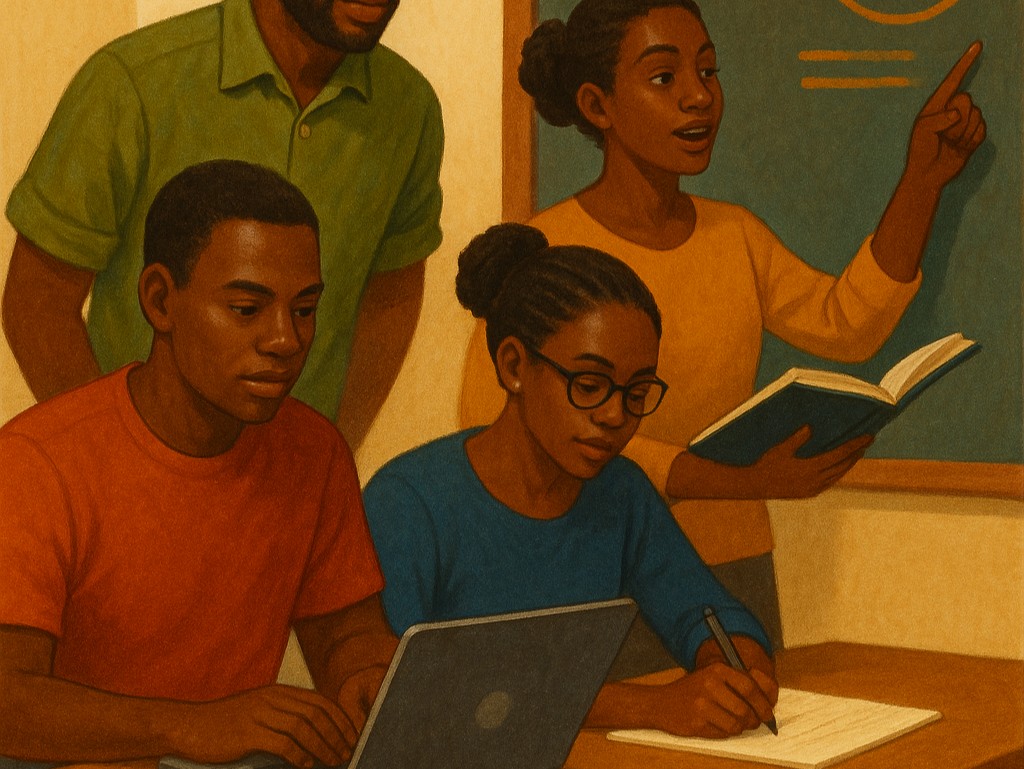Résumé d’ouvrage : La faim dans le monde pour débutants
Quand vous avez faim, si vous êtes nés du bon côté de la planète et dans la bonne classe sociale, il suffit d'ouvrir le réfrigérateur le plus proche pour satisfaire votre appétit. Sinon vous risquez d'avoir le ventre creux pour le restant de votre courte existence, comme les 800 millions d'individus qui ont mal choisi leur lieu de naissance et leur classe sociale. La faim dans le monde n’a rien d'une fatalité. Elle dépend de la volonté des hommes. La faim existe et se perpétue à cause de minorités qui tirent bénéfice du sous- développement.
Nos lointains ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils ne possèdent pratiquement rien comme bien. Les fruits de leurs chasses et cueillettes sont partagés. Ils ne pensent pas qu'on puisse un jour vendre la nourriture qui maintient la vie. Dans les régions où le climat était moins clément, on commença à emmagasiner de quoi subsister durant les saisons froides et sèches. Aussi la multiplication des espèces déclencha une concurrence de plus en plus âpre pour s'approprier la nourriture. Avec l'agriculture, la chasse et la cueillette fut de plus en plus délaissée. Quand les agriculteurs se sédentarisent, il leur est possible d'accumuler des richesses matérielles, à commencer par la nourriture, et de construire des habitats plus ou moins durables. L'agriculture et la stabilité qui en découle favorise les avancées en matière de peinture, musique, architecture, philosophie...
La culture et l'agriculture vont ensemble. Toutes deux impliquent stabilité, pérennité et confiance en l'avenir. L'agriculture est aussi à l'origine de la répartition inégale des richesses et de la division de la société en classes, dominante et dominée. Certains tentent de se procurer à moindre peine leur part de nourriture en contrôlant la terre et les individus qui la cultivent. Ils découvrent vite qu'il est plus commode de s'adjoindre un corps de police et une bureaucratie susceptibles de les aider à maintenir la production à leur place : c’est la naissance des Etats. Les Etats développent leurs armées afin de protéger leurs stocks de vivre contre les intrus et d'étendre leur contrôle aussi loin que possible. Une poignée d'individus accaparent la terre pour n’en laisser que les miettes, ou rien du tout, à la grande masse de paysans qui doivent travailler comme des serfs, métayers, fermiers, journaliers... Ils triment sous le roi, une communauté religieuse, un chef de clan, un seigneur, un gentilhomme, ou un cultivateur plus riche. La main mise d’une minorité, qu'elle que soit la forme qu’elle revêt, sur la nourriture et les ressources agricoles a été de tout temps la cause principale de la faim. Les paysans disposent d'un équipement rudimentaire et d’une main d'œuvre familiale. Ils produisent pour satisfaire leur propre consommation et pour remplir leurs obligations envers le pouvoir politique et économique : corvées, dîmes à l'église, redevances, impôts sur le revenu. Le paysan donne plus de 40% de sa production à la classe dirigeante et ne conserve que 60%, parfois moins de 30%.
Le tiers-monde n’a pas toujours eu le monopole de la faim. L'Europe l'a durement connu. Dans la France avant la révolution, le paysan était astreint à une dizaine d’obligations différentes par les détenteurs du pouvoir politique et économique. L’Eurоре a connu plus de 89 grandes famines entre le Xe et le XVIIIe siècle, en moyenne tous les dix ans. Entre 1846 et 1850, l'Irlande fut le théâtre de l'une des dernières grandes famines européennes. Tout au long de cette famine, l'Irlande produisait de quoi nourrir le double de sa population. Le paysan irlandais produisait pour son propriétaire qui revendait hors du pays. Il souffrait de voir sa progéniture affamée malgré sa production. S'il ne payait pas ses redevances, il était expulsé et condamné à mourir. La nourriture atteignit des prix astronomiques, et l’argent manquait. Pour survivre, les gens mettaient en gage leurs misérables biens, se nourrissaient de racines et d'herbes, puis mouraient. Au moindre signe de révolte, les autorités expédiaient non pas de la nourriture, mais des troupes. Plus d'un million de ceux qui demeuraient valides émigrèrent hors d'Irlande. On peut tout simplement remplacer Irlande actuellement par tiers-monde pour comprendre pourquoi tant de gens ont faim à l'heure actuelle : exportation de nourriture en temps de pénurie, endettement et loyer élevé de la terre, éviction des cultivateurs, parcellisation des sols, aucun emploi de rechange, la situation de domination extérieure.
La révolution industrielle
A partir du XVIII siècle, le marché du travail commence à se développer grâce aux industries nouvelles. On avait besoin de plus de bras et d'équipements. Avec les industries, les pays désormais développés ont une énorme avance et ce sont leurs produits industriels qui fournissent 93% marché mondial. De plus, ces pays dressent des barrières, histoire de protéger leur commerce extérieur. L'industrie dans les pays pauvres est loin de créer assez d'emplois pour ses individus, qui en ont besoin. Ce qui fait de tous ces malheureux sans travail et sans revenus des crève-la-faim. Avec les industries, des millions d'Européens migrèrent dans des régions comme l’Amérique, l'Australie, l'Argentine, le Canada, l'Algérie, l'Afrique du Sud. L'émigration qui s'opère maintenant du tiers-monde vers les pays industriels profite aux riches. Les travailleurs émigrés font le sale boulot. La fuite des cerveaux fournit aux pays industrialisés des médecins, des ingénieurs et des techniciens originaires du tiers-monde. D'où une concentration encore plus efficace dụ savoir-faire entre les mains des nations prospères. Le colonialisme est, d’une certaine façon, une forme plus violente d'émigration. C’est aussi un bon système pour extorquer par la force leurs richesses aux peuples conquis.
Les famines existaient avant la colonisation dans les colonies, mais elles n'avaient jamais eu ni l'ampleur ni la gravité de celles de la colonisation et après. Les dirigeants ne pouvaient pas laisser mourir leurs sujets de faim, ne serait-ce que parce qu'ils avaient besoin d'eux pour rentrer la future récolte. Les explorateurs relatent l'abondance alimentaire qu'il y' avait dans les pays aujourd'hui appelés tiers-monde. En Haute-Volta (Burkina Faso), un pays désertique, les greniers contenaient les graines en réserve de plus de trois années pour pouvoir traverser les périodes difficiles. La cause de la famine n'est pas la sècheresse, mais le fait de forcer un pays à consacrer ses ressources à la production de végétaux ou de matières premières destinés à un autre pays. C’est là toute l'astuce du colonialisme. Avec le colonialisme, les populations n'ont plus seulement à affronter les abus de leurs propres dirigeants, mais aussi au niveau international. Les puissances coloniales recherchaient des matières premières pour industries. En plus de prendre gratuitement ces ressources dans les colonies, ils forçaient les colonisés à quitter leurs terres qui assuraient leur subsistance et à travailler dans les mines et les plantations des colons. Des milliers de colonisés mourraient de faim ou de mauvais traitement.
Au lieu de créer des plantations, les français élevaient des impôts pour obliger les indigènes à travailler leurs propres terres pour la France. Les indigènes étaient obligés de cultiver les produits de rentes, qu'ils vendaient à la France à vil prix pour pouvoir payer leurs impôts à la même France. Les colonisés négligeaient leurs produits agricoles, et le peu d'argent qui leur restait ne leur permettait pas d'acheter les produits français trop chers. Le Français émet du papier monnaie. L’Africain doit le gagner en échange du travail que lui impose le Français. Le papier monnaie retourne dans la poche du Français, via les impôts. Les colonisés étaient également soumis aux corvées. Beaucoup étaient obligés d'émigrer pour trouver un emploi salarié qui peut permettre de payer leurs impôts. Pas étonnant que les greniers se soient vidés très vite et que la faim soit devenue chronique. Le colonisé ne devait pas utiliser la famine comme excuse pour ne pas payer ses impôts. Malgré la famine, il devait payer ses impôts. L'important avec une culture de rapport, c'est de savoir qui la consomme. Durant les trois terribles années famine de 1976 à 1978, au cours desquelles six millions d'Indiens trouvèrent la mort, près de quatre millions de tonnes de céréales furent exportées. Les métropoles s'enrichirent au dépens de leurs colonisés et leur laissèrent sur les bras un problème alimentaire. Malgré les indépendances, le colonialisme économique subsiste et ses conséquences sur le mode d'alimentation des populations sont tout aussi désastreuses. Dans beaucoup d’anciennes colonies, les nouveaux dirigeants d'ordinaire formés dans et par les ex mères-patries, n'ont fait aucun effort pour changer les modèles coloniaux d'agriculture. Qu'arrive-t-il à un pays encore dominé lorsque son revenu en devises fortes dépend d'une ou de deux cultures de rapport : Canne à sucre, Cacao, arachide, café, thé... Les prix de ces denrées sont fixés par les bourses de commerce des Etats riches. Les pays exportateurs sont vulnérables à la spéculation. Presque tous les conditionnements subis par les produits comme la transformation des graines de cacaoyers ou grains de Caféiers en café soluble, sont effectués par les pays industrialisés. Les pays producteurs ne reçoivent que 15% du prix total généré par l'achat des dérivés des denrées qu'ils produisent. Pendant ce temps, les prix demandés par les pays riches pour les biens manufacturés ne cessent d’augmenter, processus connu sous le terme d’inflation. Dans un grand nombre de pays en voie de développement, de larges chapitres du budget sont affectés à l'achat de biens de consommation plutôt qu'à celui des biens d’équipement. C’est à dire à des produits susceptibles d'en créer d'autres.
Quand on investit peu dans l'agriculture, les rendements baissent et les emplois stagnent. Pas de travail = pas d’argent = pas de nourriture. Les cultures vivrières étant délaissées, la disette s'installe. On est obligé d'importer les produits alimentaires de l'extérieur, et réprimer le peuple pour éviter les émeutes. En 1973, treize nations à peine sorties de graves crises de pénurie consacraient à la défense un budget au moins deux fois supérieur à celui de l'investissement agricole. Les pays du tiers-monde exportent des produits agricoles à des prix qu'ils ne contrôlent pas et importent des produits agricoles à des prix qu'ils ne contrôlent pas.
Les élites des pays riches sont puissantes, mais elles ont peur des populations du tiers-monde, et plus précisément de leur nombre. Le fort nombre des populations du tiers-monde peut dégénérer en révolution, et la révolution peut devenir internationale et menacer le pouvoir de ces élites même dans les pays riches. Dans son essai sur principe de population, Malthus démontrait que la population croit géométriquement (1 ; 2 ; 4 ; 8...) lorsque son développement n’est pas contrôlé, alors que la production alimentaire ne peut progresser qu'arithmétiquement (1 ; 2 ; 3 ; 4...) En conséquence, la première a toujours tendance à distancer la seconde, bien que ce déséquilibre soit corrigé par les épidémies, famines, guerres et autres calamités qui affectent de préférence les classes les plus pauvres. Malthus a été beaucoup critiqué. Le problème se situe au niveau de l'inégale répartition des biens. Malthus n'a jamais préconisé le contrôle des naissances dans le but de permettre aux riches d'accumuler davantage. Il espérait améliorer le sort des travailleurs démunis en les amenant à réduire leur nombre. Ceux qui prônent la limitation de naissance pour mieux s'assurer le contrôle des richesses ne sont donc pas malthusiens. Ils craignent qu'une masse trop importante de miséreux n’émettent des revendications politiques impossibles à satisfaire sans bouleverser fondamentalement le système actuel de distribution des richesses et du pouvoir, ou ne déclenche une réaction révolutionnaire en chaine qui pourrait atteindre même les pays riches. Nous avons entendu dire que la surpopulation est la cause de la faim. Les nations riches (au total le quart de la population de la planète) s'approprient les deux tiers de la production alimentaire du globe et leurs animaux engloutissent le tiers des céréales. La Chine avec le milliard d'habitants nourrit décemment sa population. Un chinois ne dispose que de la moitié de la surface cultivable d'un habitant de l'Inde sous-alimentée. Pas de disette, non plus, à Taïwan ou en Corée du sud où on compte également de moitié moins de terres qu'au Bangladesh et en Indonésie.
La concentration des terres dans les mains de quelques-uns et l'insécurité due aux systèmes de fermage limitent sérieusement le rendement agricole. Ceux qui détiennent le pouvoir essaient de maintenir la population à un niveau susceptible de s'ajuster aux structures foncières injustes du moment. On comprend donc leur participation massive aux campagnes de contrôle de la natalité. Il ne leur revient jamais à l'esprit que les gens ne sont pas seulement des bouches et des ventres, mais aussi des cerveaux et des bras, et qu'ils sont capables d'augmenter et d'améliorer la productivité, si on leur en donne la possibilité ! Les parents du tiers- monde considèrent les enfants comme une main d’œuvre d’appoint pour assurer leurs vieux jours. Les taux de natalité baissent quand les gens bénéficient d'une certaine sécurité et du droit à la terre. Une poussée démographique peut aggraver la faim, mais pas la provoquer.
Beaucoup de régions tropicales ont des écosystèmes fragiles, et leurs populations en sont conscientes. A travers des siècles, ils ont appris à les utiliser rationnellement, et c'est ainsi qu’ils ont survécu. Un désert peut paraître inhospitalier, mais les pasteurs nomades savent en tirer parti. L'important est de connaitre l'environnement. L'ennui pour de nombreux paysans du tiers-monde, c'est qu'ils ne peuvent plus exploiter ces milieux selon les méthodes traditionnelles qui en assuraient la protection, pour la bonne raison des cultures de rapport. Les riches fermiers et les étrangers ont tendance à occuper les terres les meilleures, les plus fertiles et les moins accidentées. Les cultivateurs et les pasteurs pauvres (la majorité) sont repoussés sur les versants des collines et autres parcelles médiocrement productives. Ils sont alors accusés de sur cultiver et de sur pacager les sols. Ils y sont effectivement contraints s'ils veulent survivre. 4% des plus grands propriétaires terriens contrôlent la moitié des terres cultivées du globe. Dans 83 pays pauvres, 3% des propriétaires fonciers possèdent et contrôlent les quatre cinquièmes de la terre. Même en tenant compte de tous les handicaps, dans la plupart des régions, les petits agriculteurs produisent plus de nourriture à l'hectare que les grands. C'est parce que les petits paysans consacrent à la terre tout ce qu'ils ont, principalement leur force de travail. Mais une telle productivité n'est pas possible là où la qualité des sols s'est dégradée. On se trouve obligé en Afrique de réduire la période de la jachère qui parfois durait une dizaine d'années. Entre temps les paysans doivent payer l'engrais оu l'irrigation, et les propriétaires terriens attendent leurs redevances. Les paysans ont des difficultés pour trouver des prêts. Avec toutes les redevances à payer, les paysans ne parviennent pas à faire des économies. Les banques leur demandent au moins 6% d'intérêt le mois. Ils ne peuvent que faire de petits prêts. Le paysan pauvre du tiers-monde produit avant tout pour la subsistance de sa famille. S’il n'arrive pas à produire suffisamment pour se nourrir, lui et sa famille, il doit compter, avec une hausse régulière du prix des aliments d'une récolte à l'autre. Il sait que durant les mauvaises années les prix vont grimper d'avantage. Il vit à la petite semaine, et les données sur lesquelles il s'appuie pour prendre des décisions sont sans cesse changeantes.
Comment le paysan calcule rendement ?
Il arrive que le cultivateur ne connaisse même pas la taille exacte de son lopin et n'ait pas une idée claire de son rendement moyen. Mais ce qu'il sait, à semaine ou à la journée près, c'est le laps de temps pendant lequel il a été capable de nourrir sa famille sur sa récolte et le moment à partir duquel il lui a fallu débourser de l'argent pour acheter de quoi manger. Les bonnes et les mauvaises récoltes affectent différemment les familles en fonction de leur position dans l'échelle sociale et économique. Supposons quelques familles possédant la terre qui stockent des aliments pour un an. La deuxième année il ne pleut pas, et les conséquences se font ressentir en troisième année. Les denrées stockés ne sont pas égales et on suppose sept familles. Toutes les sept familles arrivent à subvenir à leurs besoins alimentaires la première année. La seconde année, seulement trois familles pourront stoker des aliments, et la troisième année, seulement deux pourront le faire. Les deux premières familles, avec les aliments stockés la troisième année, peuvent augmenter les prix pour les revendre. La troisième famille n'a pas de réserve la troisième année. Elle économise sur la nourriture de chacun, afin de continuer à payer l'école des fils. Elle n'achète ni vêtements ni équipement agricole dans l'espoir d'une meilleure récolte à la fin de l'année trois. La quatrième et la cinquième famille ne peuvent que tenir une partie de la deuxième année. Ses membres cherchent le travail pour pouvoir continuer de nourrir la famille. Ils sont employés sur la terre d'un autre alors qu'ils doivent cultiver leurs propres terres. Ils sont obligés de réduire leur consommation et d'emprunter du grain. La sixième famille emprunte plus tôt, hypothèque sa terre en garantie, accepte que ses filles se marient tôt, travaillent chez les autres en échange d'être nourries, ce qui fait toujours des personnes de moins en charge. Les garçons vont chercher le travail pour soutenir la famille. La septième famille est très endettée et vue leur condition, personne ne veut leur prêter davantage. Elle vend son bétail et sa parcelle à vil prix, et ses membres commencent à mourir de faim ou vont en ville. Chaque mauvaise année diminue la capacité de survie des familles situées au bas de l'échelle.
Une mauvaise année a un effet beaucoup plus fort sur le prix que sur la production. En 1973, le volume des récoltes n'a baissé que d'environ 2% tandis que les prix des céréales ont atteint parfois le record de 300%. Celui qui n’a ni terre, ni argent est condamné à la faim et quelque fois à la disparition physique. Quand de larges tranches de la population se trouvent simultanément dans cette situation, on a une famine. Chaque famine a des causes spécifiques : rapports entre classe dominante et classe dominée, catastrophe naturelle… Les pauvres ont par définition une marge de choix très réduite. La maitrise de l'approvisionnement étant un problème vital dans tout groupement humain, elle engendre des conflits. Lorsque les antagonismes s'accentuent, la société toute entière peut se désagréger. Une famine constitue une crise sociale majeure, quand elle passe, le sort des pauvres ne pourra qu’empirer, à moins qu'ils n'aient réussi à renverser la situation.
Les famines ont des caractéristiques communes :
- Il n'y a pas d'argent et les prix des denrées alimentaires grimpent ;
- Les spéculateurs font fortune et revendent très chers leurs stocks ;
- Les dettes se multiplient après la famine ;
- Les semences sont mangées et les bêtes de trait vendus ;
- Les rendements de l'année suivante baissent ;
- Les paysans sont forcés de s'endetter lourdement ;
- Les terres se concentrent davantage chez quelques possesseurs ;
- Les propriétaires expulsent les agriculteurs « excédentaires » qui pourraient réclamer une part de la récolte ;
- La baisse des salaires dans les emplois dû à l'arrivée des individus évincés de la terre, et davantage de chômeurs.
Тous ces éléments préparent le terrain pour une famine encore plus terrible au prochain cataclysme naturel. Avec leurs programmes « d'aide » et leur modèle de développement, les pays riches et les organismes internationaux contribuent à aggraver une situation déjà catastrophique. Ils proposent la réduction des naissances au lieu de changer les conditions de vie qui font que les gens ont besoin d'enfants, ils encouragent les cultures de rapports et élèvent les barrières douanières sur les autres produits du tiers-monde, ils soutiennent des régimes qui n'ont aucune intention d'améliorer le sort des populations pauvres, ils font tout pour ruiner les efforts de ceux qui essaient de promouvoir une politique de réforme agraire et une juste répartition des richesses. Leur but est de profiter pour modeler les systèmes de production et de consommation alimentaires du tiers-monde sur le leur ou de les utiliser à leur avantage.
Un système alimentaire intègre les facteurs de production (semences, matériel et produits chimiques, recherche et crédits ...), la production proprement dite (tout ce que fait l'éleveur ou le fermier) et les activités en aval de la récolte (stockage, transformation, distribution, restauration, bref tous les traitements subis par les denrées alimentaires du moment où elles quittent la ferme et celui où elles atteignent le consommateur).
L’agriculture industrielle
Aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, seulement 2 à 3% de la population travaillent réellement dans l'agriculture. On produit des quantités fabuleuses de nourriture avec peu de bras car on consacre des capitaux énormes aux outils de production tels que les semences hybrides, engrais et équipement mécanique permettant d'économiser de la main-d'œuvre. Le coût des facteurs de production croit régulièrement prenant jusqu'à 80% des gains de l'agriculture. Pour rentabiliser un matériel puissant et amortir les coûts, les fermiers doivent essayer d'acquérir le plus de terres possible. Ils ne peuvent généralement le faire qu'au détriment de leurs voisins plus modestes. Aussi, ils recourent à l'emprunt pour s'agrandir et acheter l'équipement nécessaire. Mais les revenus agricoles ont chuté d'au moins un tiers entre 1979 et 1980 et d'un autre tiers en 1981. Même durant les bonnes périodes, environ 700 exploitations nord-américaines font faillite chaque semaine. Il faut actuellement à peu près 400 000 dollars pour créer un seul emploi dans l'agriculture, soit dix fois plus que dans l'industrie. Aux Etats Unis, 90% de la nourriture est fournie par un tiers de fermiers tandis que les deux tiers restants sont obligés de compléter leurs revenus par une activité extra-agricole. La formule est : « Grandissez ou déguerpissez ». Cette situation engendre le chômage, surtout parmi les minorités (il n'y a pratiquement plus de fermiers noirs aux Etats-Unis). Même les riches agriculteurs se plaignent d’être rançonnés par les grandes compagnies qui les fournissent en tracteurs, semences et aliments pour bétail. Là où quatre, trois, voire deux firmes contrôlent plus de la moitié du marché dans chaque gamme de produits, on parle d'oligopole. Quand peu de vendeurs ont beaucoup d'acheteurs, ils n'ont pas intérêts à se concurrencer sur les prix. Ils achètent les produits agricoles, les conditionnent et les revendent 10 à 12 fois au-dessus de leur prix. Ils entraiment le changement des modes d'existence de centaines de familles d'agriculteurs chaque semaine, le tarissement des marchés locaux du fait que tout est conditionné et commercialisé à l'échelle nationale, la lente désagrégation des centres ruraux au fur et à mesure que leurs habitants partent de plus en plus nombreux vers les villes faute de pouvoir gagner décemment leur vie. Il y a de plus en plus de mal nourris aux Etats Unis, se traduisant par l'obésité. Le gouvernement américain est obligé de dépenser 10 milliards par an pour subventionner l'agriculture et empêcher la population démunie de mourir de faim.
Pour survivre à ce système, chaque agriculteur doit tirer le maximum de la terre qu'il travaille, et tout de suite. Ils déversent des pesticides qui finissent par détruire les prédateurs naturels et provoquent parfois l'apparition de nouveaux parasites. Ils augmentent les doses d'engrais, et utilisent l'eau sans réserve, menaçant d'assécher les réserves d’eau. Le système entraine une surconsommation des ressources énergétiques comme le pétrole, et une menace génétique, puisque très peu de variétés d’aliments sont produites. Lorsqu'une maladie s'attaque à une espèce, une énorme partie de la production risque d'être anéantie. Ce système est incapable de fournir une alimentation saine et bon marché aux citoyens des nations riches et doit tabler sur la charité des gouvernements pour distribuer des subsides aux consommateurs les plus pauvres. En cas de guerre ou de cessation de l'approvisionnement en pétrole, c'est la catastrophe.
Ce système qui ne parvient pas à répondre aux besoins des nations développées ne peut pas fonctionner dans le tiers-monde. Son idée a toujours été de tirer le maximum de chaque individu et non pas de chaque mètre carré de terrain alors que dans la plupart des pays dominés, il y a peu de terres et des millions de bras de désœuvrés en quête d'un travail productif. Le plus simple aurait été de remplacer dans les nations pauvres la main d'œuvre par du capital. Mais les compagnies qui dominent le système ne sont pas seulement nationales, mais multinationales. On les dénomme l'agro-industrie. Elles s'activent à remodeler les systèmes alimentaires du tiers-monde à l'image de ceux des nations riches. Les multinationales considèrent les tropiques comme un réservoir inépuisable et bon marché des comestibles de luxe. Les nouvelles cultures de rapport comme les fruits, les légumes, les fleurs, les poissons et viandes sont venus s'ajouter aux plantations de thé, café, cacao... Jamais des pauvres n'ont consacré autant de terres, de travail, d'énergie à ravitailler les riches qui ont déjà largement de quoi se nourrir. L'agro-industrie s'emploie à écouler vers le tiers-monde ses facteurs de production et ses produits agricoles transformés ; d'utiliser les terres et la main d'œuvre bon marché pour produire de la nourriture qu’elle peut vendre au prix fort sur les marchés du nord. Pour y arriver, elle passe par les programmes d'aide des gouvernements occidentaux ou des fondations privées qui fournissent les routes, l'énergie électrique, l'éducation et la formation professionnelle sans lesquelles les affaires ne peuvent pas démarrer. Une fois ces bases posées, l'agro-industrie rapplique.
Dans les années 60, la meilleure méthode, pensait-on, pour accélérer la production dans les pays en voie de développement consistait à promouvoir une série de techniques résumées dans le slogan la révolution verte. On commence par les semences améliorées (fabriquées par l'homme) qui augmentent la production à condition de recevoir beaucoup d'engrais, d'insecticides, d'herbicides et d'être semées dans des terrains savamment irrigués et drainés. Mais seuls les agriculteurs riches peuvent acheter les semences et assurer cet entretien. La révolution verte entraine effectivement une augmentation de la production globale. Et si elle revient plus chère, elle rapporte en général davantage. Comme l'agriculture devient une activité de plus en plus rentable, les propriétaires expulsent leurs fermiers et métayers et exploitent eux-mêmes leurs terres. Pour ce faire, ils utilisent des tracteurs et des moissonneuses- batteuses : Les machines ne se mettent pas en grève et ne réclament pas une augmentation de salaire. Ce qui réduit les emplois. Les fermiers sont obligés de vendre une quantité importante de leur production pour acheter de quoi produire.
Ceux qui ne savent pas lire ou qui sont pauvres ont du mal à s'intégrer dans cette révolution verte. Les pays riches s'activent à exporter cette révolution verte dans le tiers monde. Le but est de créer de nouveaux marchés pour développer l'industrie américaine des produits chimiques et des tracteurs, et aussi de favoriser la stabilité sociale en évitant les réformes agraires. La révolution verte augmente en même temps la production et la faim, la production devenant trop chère. Les riches se sont davantage enrichis tandis que les pauvres se sont davantage appauvris. Les pays riches ont renforcé leur domination sur le tiers-monde. Les revendications des prolétaires des pays industrialisés ont conduit à l'augmentation des salaires et dans le même sens des coûts de production. La production des denrées alimentaires dans le tiers-monde revient moins coûteuse, et permet de ravitailler les pays riches. Certains pays du tiers-monde dont un grand nombre de citoyens souffrent de sous-alimentation (Mexique, Brésil, Philippines, Thaïlande) sont parmi les plus gros exportateurs de denrées alimentaires dernière mode. Les niveaux d'alimentation se sont effondrés et les habitants de ces régions ont été obligés de réduire leur consommation. L'aide américaine à travers l'USAID vise à étendre les cultures d'exportation et non à nourrir les autochtones. Les autochtones ne peuvent pas acheter ; Се ne sont donc pas de consommateurs, et c'est de consommateurs qu'on a besoin. En Amérique, environ 30 millions de chats et 35 millions de chiens sont de meilleurs consommateurs que beaucoup de misérables êtres humains. Les richesses du tiers-monde contribuent à nourrir ces chiens et chats.
Les multinationales s'activent à modifier les habitudes alimentaires du tiers-monde afin de faire d’eux des consommateurs. Ils provoquent l'identification à un produit et la fidélisation à la marque qui le produit, aidé par l'analphabétisme généralisé. Ils ciblent prioritairement les femmes et utilisent les médias ayant le coefficient de pénétration le plus fort dans les campagnes. Ils rapprochent le produit de la modernisation qu'ils confondent avec l'occidentalisation. Les africains par exemple sont fiers d'acheter plus cher la même denrée qu'ils produisent. Inciter les gens à vouloir se nourrir ainsi, ce n'est pas seulement leur soutirer leurs maigres économies ou déprécier leurs traditions, c'est parfois aussi les mettre en danger de mort. L'industrie des aliments pour nourrissons écoule sa marchandise auprès des mères du tiers-monde qui ne disposent ni d'équipements pour stériliser les biberons, ni d'eau pure, ni de revenus suffisants pour acheter ces produits. Convaincues par la publicité qu'ils sont meilleurs pour leurs bébés que leur propre lait, elles les diluent dans de l'eau polluée ou à des doses trop réduites, quand ce n'est pas les deux à la fois. Les diarrhées du nouveau-né et les accidents mortels ont atteint un tel niveau que l'Organisation Mondiale de la Santé a voté à l'unanimité (Les Etats-Unis exceptés) un code déontologique destiné à contrôler les méthodes publicitaires des multinationales et décidé de lancer une campagne en faveur du retour à l'allaitement maternel.
Les produits de marque ne stimulent pas la production locale et ne créent pas de débouchés, car ils sont rarement fabriqués à partir des denrées locales. Le pain qui inonde le marché du tiers-monde est fait à 100% du blé d'importation. Ces produits ne créent pas d'emplois, car ils utilisent la technologie des pays industrialisés. Au contraire, ils obligent les entreprises locales à fermer par la concurrence que les produits de marque leur font. Ce sont les produits les plus tocards fabriqués par les multinationales qui rencontrent le plus vif succès : bière, bonbons, biscuits, boissons alcoolisées. Plus les populations sous-alimentées sont miséreuses, et plus elles ont tendance à dilapider une part disproportionnée de leurs maigres ressources pour s'offrir un luxe quelconque plutôt que ce dont elles ont besoin. Les multinationales ciblent marché des affamés. Elles n'ont pas été créées pour aider les peuples à se nourrir convenablement, ni pour créer des emplois, ni pour participer aux projets de développement du tiers-monde. Leur objectif est d’assurer un rendement maximal du capital que leur ont confié leurs actionnaires. Les dirigeants du tiers-monde qui permettent à un tel système d'asservir leurs économies nationales et déclarent en même temps qu'ils vont remédier à la sous-alimentation se trompent ou trompent les autres.
Pour sortir de ce cycle vicieux de la faim, il faut éviter l'aide alimentaire permanente, sauf aux cas d'urgence. Dans ce cas, l'aide alimentaire doit être massive, généreuse et surtout rapide. Quand les programmes de secours s'institutionnalisent et se prolongent, ils multiplient des problèmes et rendent les pays pauvres dépendants. Les citoyens des nations industrialisées qui veulent vraiment éliminer la faim devraient encourager l'instauration d'un vrai débat démocratique sur de nouveaux rapports d'aide. Les États membres du FMI (Fond Monétaire International) obligent les pays pauvres à supprimer les mesures sociales en faveur des plus démunis. Quand les pays pauvres n'obéissent pas, ils n'obtiennent pas de crédits et courent à la ruine.
Quelques citations dans la faim dans le monde pour débutants
1- « La faim existe et se perpétue à cause de minorités qui tirent bénéfice du sous-développement »
2- « L’important avec une culture de rapport c'est de savoir qui la consomme ou l'utilise.
3- « Quand on investit peu dans l'agriculture, les rendements baissent et les emplois stagnent. »
4- « Les gens ne sont pas seulement des bouches et des ventres, mais aussi des cerveaux et des bras. »
5- « Une poussée démographique peut aggraver la faim, mais pas la provoquer »
6- « Les multinationales considèrent les tropiques comme un réservoir inépuisable et bon marché de comestibles de luxe. »