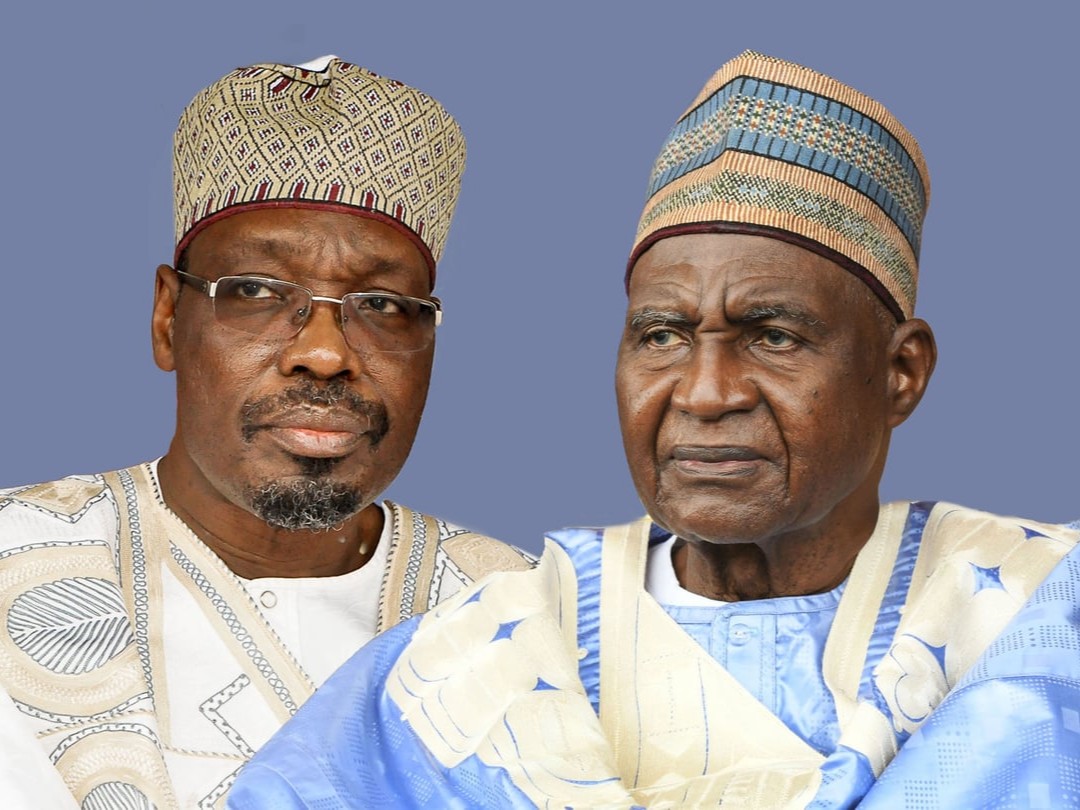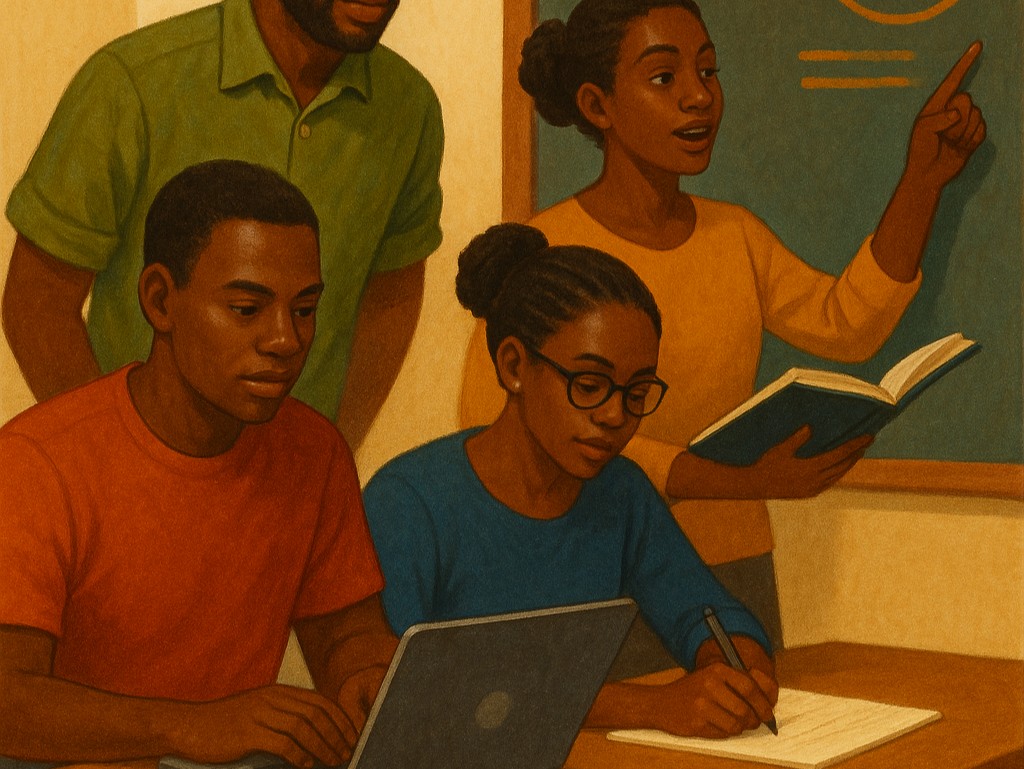Résumé de l’ouvrage : DE LA MEDIOCRITE A L’EXCELLENCE
Préface de la première édition
Le sous-developpé considère le développement comme des automobiles pour tous, réfrigérateurs, machines à laver, machines à tout faire, maisons à étages, campagnes et forêts rasées, routes et autoroutes. L’Africain voit le développement sous l'angle matériel. Avant l’indépendance, il se voyait à la place du colon une fois indépendant, avec toutes ses prérogatives. Mais 1960 n’a pas été le signal de jouissance attendu, mais le signal de travail pour sauvegarder la liberté recouvrée. Le développement est un processus complet, total qui déborde l'économique pour recouvrer l'éducationnel ou le culturel. Le développement économique et social se propose d'être l'organisateur du bonheur ou du bien-être de tous. Or nul ne peut organiser le bonheur de tous, car le bonheur est une affaire personnelle. La bataille du développement n'est donc pas la bataille du bonheur de tous, mais celle pour la liberté de l'homme. Le développement devrait se soucier principalement de favoriser l’avènement d'un type d'homme précis : le créatif, consommateur par nécessité et jamais par essence. On ne crée que là où il y a manque, une insatisfaction. Tout programme de développement qui se proposerait de réaliser une société d’abondance où l’homme tournerait en rond dans le régime de la jouissance perpétuelle, coupé de tout effort, n’aboutit qu'à produire des sous-hommes. Recherchez premièrement la libération de l'homme et le bonheur vous sera donné de surcroit.
Préface deuxième édition
Le fait que les pays en voie de développement servent juste de zone de transit des capitaux des pays industrialisés, le fait que plus de 80% des sommes investies dans les pays sous-développés retournent dans les pays industrialisés, les fait que les pays sous-développés ne sont que des consommateurs, et qui sont empêchés de produire eux-mêmes sur place, le fait qu’ils ne fixent pas eux-mêmes les prix de leurs matières premières ne sont que l'exigence de justice. Quand ce principe de justice sera respecté demain, nous ne serons qu’à la phase préliminaire du développement véritable de l'homme. Il faut se battre pour qu'un ordre de justice règne dans les relations économiques entre Etats, mais il faut aussi se battre pour que le même ordre règne dans les relations entre les individus et les diverses couches sociales à l'intérieur de chaque nation. Il faut donner les mêmes chances à tout le monde au départ, même si cela peut paraitre utopique, pour permettre à l’homme de promouvoir son propre développement.
Combattre l'impérialisme, prôner la révolution, ne s'appellent pas développement mais recherche des conditions de possibilités du développement. Plusieurs militaires ont pris le pouvoir en Afrique et ont dit avoir fait des révolutions. Mais une fois au pouvoir, ils se sont comportés comme des civils. La conquête du pouvoir seul ne suffit pas. Il faut se donner une vision claire du type d'homme ainsi que du type de relations humaines dont il conviendrait d'encourager l'avènement. Les critères de développement moral ne sont pas chiffrés, mais ils existent. L’absence de clôtures autour des concessions dans les agglomérations humaines de campagnes ou de villes montre le degré de confiance qui règne entre les habitants, tout comme l’hospitalité désintéressée grâce à laquelle les étrangers peuvent être hébergés généreusement sans craindre ď être détroussés. Mais ceci n’est possible que dans les sociétés où il n’y a pas un grand écart de fortunes entre les couches sociales. Là où une minorité accapare la plus grande partie de richesses de transforme la majorité en spectateurs, il est sûr que ces riches auront intérêt à clôturer leurs domaines par crainte de la colère des affamés et des assoiffés, que l'hospitalité ne sera pas si facile. Il faut un Etat-pédagogue qui doit définir le cadre règlementaire à l'intérieur duquel devraient s'exprimer les ambitions légitimes de chaque homme. Il faut un Etat-arbitre qui doit féliciter tous les méritants et punir tous les mauvais citoyens. Toute cette morale est le fondement de la révolution à mener. Mais la révolution n'est pas une fin en soi, car l’après-révolution devrait être aussi préoccupante que la révolution elle-même.
Quand on renverse un ordre ancien, la question est de savoir quel ordre nouveau mettre en place. Quelle révolution conduire aujourd’hui en Afrique après le renversement du pouvoir colonial? Et qui la conduire? Dans cette deuxième question, on regarde souvent l’intellectuel. Le simple fait d'avoir fait des études supérieures, d'avoir lu toutes sortes d'ouvrages, y compris ceux relatant des grandes révolutions de l’histoire ne crée pas nécessairement le révolutionnaire. Le premier moment d'une aventure révolutionnaire suppose qu'on ait clairement identifié les intérêts en présence. En Afrique actuelle, il y a les intérêts du grand capital international qui a tendance à prolonger l'Etat colonial. Il y a les intérêts de ceux qui, à l'intérieur des pays, sont les relais du grand capital international. Parmi eux se trouvent des intellectuels de renom au petit fonctionnaire qui ne songe qu’à tirer son épingle du jeu quand il se laisse corrompre. Il y a enfin les intérêts de la grande masse des paysans et autres travailleurs au nom desquels tout le monde veut parler. Les enfants des paysans devenus fonctionnaires ou élites intellectuelles sont séduits par le confort matériel immédiat. Il est donc difficile d’identifier le révolutionnaire. Chaque équipe dirigeante, qu'elle soit militaire au civile, est constituée de l'imbrication de ces divers intérêts, ce qui crée toutes sortes de tempéraments contradictoires. Le choc des intérêts égoïstes dans nos sociétés est tel qu'il rend le rôle de l'Etat bien plus important que partout ailleurs. L'Etat en Afrique se doit d'être fort, non pas pour assurer la survie des dirigeants et leur régime, mais pour imposer ses arbitrages et sauvegarder l'ordre public sans lequel le processus de développement se verrait chaque fois perturbé. La vraie révolution se fait au nom d'une vision politique, sociale, économique et culturelle déterminée.
I- Le faux problème de la pauvreté qui s'ignore
Ce qui importe dans tout processus d'enrichissement comme dans tout processus de transformation du monde, c'est la réalisation de soi, l’auto-accomplissement de l’homme qui n’est pas une donnée de la nature, mais une autoproduction historique. C’est pourquoi on peut être pauvre au milieu de nombreux biens matériels. Tout enrichissement pris comme fin en soi est, au bout de compte, un appauvrissement ; appauvrissement de l’être au profit de l’avoir. Avoir quelque chose c’est s’exposer à le perdre un jour et à être malheureux. Celui qui n’a rien ne perd rien. Par contre, celui qui a quelque chose vit dans la crainte permanente de la perdre. Celui qui possède quelque chose a en quelque sorte perdu sa tranquillité. L’enrichissement est donc en même temps un appauvrissement. L’accumulation des biens matériels n’est pas une fin, mais un moyen pour l’humanisation de l’homme. Il ne faut pas condamner tout enrichissement. Nous voulons simplement dire que le travail qui mène à l’enrichissement comporte un aspect formateur pour l'homme. Si le pauvre qui s’ignore n'est pas un homme libre, alors nul n'a le droit ď être indifférent à son sort sous prétexte qu'il tire certains avantages de cette ignorance. La pauvreté est un obstacle à la liberté, et la liberté totale suppose la liberté des autres. On n’est libre que si tous les êtres humains qui nous entourent le sont également. La pauvreté, qu'elle s'ignore ou qu’elle soit consciente d’elle-même, est un obstacle à la liberté. L'ignorance également un obstacle à la liberté
L'homme d'Afrique sous-développée se bat quotidiennement contre sa pauvreté. Mais dans une grande échelle, il reste un homme ignorant. Le bien-être et l’enrichissement qu'il recherche, à l’exemple de l'homme des pays développés ne sont pas toujours des notions claires à son propre entendement. C'est un homme qui risque de travailler contre lui-même à la longue. Les dirigeants politiques qui étudient souvent les problèmes à l'échelle de pays entiers, oublient que c'est lui, l'homme individuel, qui doit être la finalité de tous leurs plans de développement. L'économiste, pour montrer l'écart des pays développés et des pays sous-développés, compare le revenu par tête des habitants. Or cette méthode ne nous renseigne que sur un aspect du problème complexe de développement, à savoir la croissance de la production. Cette méthode cache l'homme de tiers-monde. Si le développement se transforme en une machine imprévisible, alors l'homme du pays sous-développé est définitivement perdu. Si le développement est pris en main par son principal intéressé, alors l’espoir d'un avenir meilleur serait permis,
II- La misère de l’homme.
La misère du sous développé ne saurait se résumer au cri du ventre. La recherche du pain quotidien n'est pas une fin en elle-même ni l'abondance du pain le critère d'un développement certain. La sous-alimentation est à supprimer parce qu’elle entretient une débilite physique et parce qu’elle diminue les capacités intellectuelles et empêche l'effort de bonheur. Ce n'est pas le paysan de l'Afrique noire qui meurt de faim. Il a de quoi manger tous les jours, même si c'est le même menu au quotidien. Il vit du fruit de ses champs, produit avec des méthodes peu développées, mais offrant des récoltes plus au moins suffisantes. Le chômeur de la ville moderne ne meurt pas aussi de faim, sauf s'il n'a ni cousin, ni oncle, bref aucun parent ayant un emploi en ville, ce qui est impensable. A Douala, Abidjan, Lagos, on a toujours un cousin chez qui on prend ses repas et se repose la nuit. La famille africaine n'est pas encore morte, ni le sens de la solidarité qui unit ses membres. L’homme de l'Afrique sous développée connait des misères, mais il ne meurt pas de faim.
Une première forme de sa misère est subjective, c'est la prise de conscience douloureuse par l'homme de la faille qui sépare son être actuel de ce qu’il veut être. Le chômeur qui cherche le travail en ville n'a pas ce qu'il veut. Il veut le travail, c'est à dire une garantie de son pain quotidien, une sécurité. Sa misère réside dans la conscience de la différence et de la distance, différence d’avec ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas, distance par rapport à ce qu'il n'a pas et voudrait avoir. Cette misère n'est pas spécifique à l'homme sous-développé. Cette misère est subjective parce que sa cause peut être jugée non nécessaire par d'autres. Ce n'est pas à la misère subjective qu'on peut voir la marque particulière du sous-développement, car elle se rencontre partout.
La marque particulière du sous-développement est la misère objective. Elle s'appelle ignorance, superstition, analphabétisme. C’est la véritable misère, celle qui maintient l’homme en l’état de sous-humanité par l'aliénation et le défaut de liberté qu’elle entraine. Le spectacle le plus affligeant en situation de sous-développement est celui de l’irrationalité dans le comportement de l’homme. On meurt rarement de mort naturelle. La maladie ne vient pas d'un microbe, mais est le résultat de la malveillance d'une tierce personne. La crise cardiaque est le résultat d'une foudre nocturne déchainée par un oncle. On a mal au genou parce qu'on a piétiné un gris-gris. Malgré les soins du médecin à l'hôpital, on fait venir un charlatan qui accuse un oncle jaloux. C’est superficiel de juger le développement d'une société par l'aspect quantitatif des réalisations matérielles qui y sont effectuées. Il faut regarder de près le rapport de l'homme à ses réalisations. Son ignorance est la marque d’une misère plus grande. L'ignorance va souvent de pair avec la superstition. Elle fait échec à la construction des ponts et des routes. La compréhension du développement de la communauté impose la solution moderniste. Mais dans la réalité cette compréhension ne vient pas toujours. Les Douala se sont opposés aux pouvoirs publics qui, face aux multiples inondations, ont décidé de vider le lit du fleuve Wouri. Chaque fois que des troncs d'arbres étaient sortis de l'eau par les grues, les populations la nuit les y retournaient prétextant que les pouvoirs publics troublent le repos des ancêtres.
La misère superstitieuse est une misère inconsciente d’elle-même. L'homme reste victime de l'adaptation à un monde statique et fermé. Il ne s'appartient pas, mais plutôt est le jouet des structures sacro-saintes. L'homme sous- développé ne connait pas l'étendue de son pouvoir, ce qui entraine son abandonnement à l’irrationnel. L’homme superstitieux ne se sent responsable de rien de ce qui lui arrive. C’est toujours le sort, ce sont les dieux, les ancêtres, c'est le voisin. On ne réussit jamais par la seule force de son intelligence. Derrière tout succès, il y a un sacrifice, on a nécessairement vendu un des nôtres à cet effet. Vendre quelqu’un signifie le donner en sacrifice aux forces occultes. Vos succès feront bientôt dire que vous êtes un sorcier. Dans les mentalités, le succès est nécessairement le résultat de marchandages occultes. C’est un régime de la facilite ou de l'anti-effort. Partout, l’homme a démissionné devant une nature qu’il ne cherche pas à dominer, mais dont il accepte d’être dominé. Ce n’est par la voie de l'auto affirmation de l'homme, c’est plutôt la voie de l'esclavage. L’homme par contre doit remonter la pente de la nature pour se récupérer sur une nature aliénatrice. Cette récupération ne peut être assumée que par la raison. Or l'homme sous-développé vit dans le régime de l’anti-raison. Il meurt de faim à côté des vaches prétendues sacrées, se laisse escroquer par des charlatans et subit les inondations pour le repos des ancêtres. C’est cela sa misère et son sous-développement. Sa misère est donc subjective et objective. Est misérable et sous-homme, celui qui dans son comportement, ne manifeste pas les caractéristiques de liberté et de rationalité. Il est pauvre homme et non nécessairement homme pauvre, c'est à dire qu'il est pauvre en esprit.
III- L’homme critique
L'homme de l'Afrique sous-développée est aujourd'hui un homme malade, le citadin bien plus atteint que le paysan, l'alphabétisé plus que l'analphabète. Cette maladie n'est pas physique, c'est cette désorientation culturelle et mentale qui entraine la dépersonnalisation. Le mal fondamental que le développement devait réparer est une certaine dégénérescence de l'homme pris dans un tourbillon de valeurs. Le sous-développé est égaré dans une épaisse forêt de valeurs. L'homme critique n’a pas d’identité, ni de personnalité. C’est un instrument mis entre les mains des forces aveugles.
Le rôle de la culture est de coder en quelque sorte l'environnant, c'est-à-dire de donner une signification aux objets qui nous entourent. Si le déchiffrement des significations s'effectue aisément et de manière automatique, on n’a pas besoin de nouveauté. La sécurité règne. Chaque individu s’oriente facilement dans son univers. Vu sous cet angle, la culture se présente comme un inventaire prétendument complet des problèmes posés une fois pour toutes et définitivement résolus. Mais un jour le code se perturbe. Les pistes se brouillent. L’homme devant une situation, ne trouve plus de réponses. La culture entre en crise, commence à se juger, car elle n’a plus de réponses à tout. C’est dans cette situation que se trouve la culture de nos sociétés africaines. Le code a été brisé lors de l'impact avec la civilisation occidentale, brutalement brisé par la colonisation. Et la gravité de la crise vécue aujourd'hui par l'homme africain est proportionnelle à la brutalité de cette rupture de la matrice première des significations. L’Africain égaré en pleine forêt culturelle cherche une issue. Il est désorienté, et la prise de conscience de cette désorientation peut l'exposer à l'inquiétude et à l'angoisse. Il y a un manque aujourd'hui dans la culture africaine. L'Eglise chrétienne interdit à l'Africain d'adorer ses dieux. Mais à l'intérieur même de l'église il porte ses amulettes et autres fétiches qui sont ses dieux protecteurs. Il croit en dieu, aux sorciers, mais il ne croit pas en lui-même.
Concernant la famille, certains la trouvent déjà encombrante. Autrefois, l’individu plaçait l'intérêt de la collectivité avant le sien. Même les fortes personnalités mettaient toutes leurs influences au service de la totalité. Or le clan ayant éclaté, l'instruction a forgé de valeurs nouvelles, plus précisément la science et d'argent. Les enfants instruits ont émergé au-dessus de la mêlée. Le groupe en tolérant cette émergence exige que les enfants fassent un chemin retour et font une nouvelle immersion dans la communauté et mettent leur influence et leur richesse au service de la famille. Mais l'individu ne veut plus cette immersion totale. Il veut sauvegarder son indépendance. Alors éclate le conflit entre le groupe et lui. Ce qui a changé en l'individu, c’est son rapport avec la société. Il veut s’affirmer dans le clan et non nécessairement par le clan. Les valeurs qui lui ont permis de s'affirmer sont l’instruction et l’argent, et il les a acquis hors du clan et parfois malgré le clan.
Le conflit avec le clan provoque le peur chez l’individu. Il a peur de mourir, c'est pourquoi il consent à distribuer la totalité of son premier traitement aux membres de sa famille, à leur offrir un festin avant de s'installer dans une maison qu'il vient de construire. Il n'agit plus par obligation morale, mais par la peur de mourir. Il reste membre du clan sans le rester, c'est un être dédoublé. Ce qui est certain c'est que le groupe n'hésitera pas à mettre fin à ses jours si son individualisme se montrait intransigeant. Voilà notre intellectuel engagé dans la consultation des sorciers. Avec ses amis dans les salons ou les séminaires, il contestera la valeur des sorciers et des amulettes des sorciers. Il invoquera la science comme unique instance devant laquelle il doit s’incliner. Mais quand il doit se rendre au village, il va d’abord trouver les marabouts.
Autrefois, le guérisseur du village était très honoré. De lui dépendait en quelque sorte l'équilibre physique et spirituel du village. Aujourd’hui, il s'agit principalement pour lui de s’enrichir aux dépens de ceux qui continuent de lui faire confiance. L’introduction de la monnaie a ruiné la foi africaine. On s'improvise charlatan pour soutirer de l'argent à ceux qui ne voient pas qu’un ordre socio-culturel est entrain de dépérir. Le charlatan est un être dédoublé. Il sait que l'ancien ordre est bouleversé, mais s’y accroche pour des besoins de survie. Certains, conscients de ne posséder aucun pouvoir de guérison, entrent dans un dédoublement de crise quand les patients disent être guéris par eux. Ils croient posséder ce qu’ils n’ont pas. Ils retombent dans les croyances qu'ils avaient répudiées.
Ce qui arrive au charlatan arrive aussi à l’élite. Ses contradictions s'expliquent par la demi-révolte ou sa révolte molle contre ce qu'il considère comme vision du monde périmée. La persuasion des parents et de la famille sur la nécessité du sorcier lui feront perdre petit à petit l'esprit scientifique acquis à l'école et à l'université. C’est le retour de l'homme instruit à un stade d'ignorance qu'il avait franchi. La force du milieu dépasse la résistance de l'individu. Que ce soit le charlatan ou l'homme instruit, nous avons à faire à un homme en crise. L’homme critique ne sait pas où il va. Il vogue à la dérive sur une mer elle-même critique. Sa crise s'appelle la dépersonnalisation, fausse identité ou identité d'emprunt. L’homme de l’Afrique sous-développée n'a d’yeux que pour l'occident exportateur de décadence aussi bien que de progrès. Cette fascination par l'occident s’exerce sur tous les plans : économique, vestimentaire, loisirs. Pour vendre ses œufs camerounais, le commerçant colle souvent l'étiquette « œufs de France », parce que son compatriote de retour de France a inoculé la honte, voire le dégoût de ce qui est local au profit des produits d'Europe. Jusque dans ses loisirs, l'intellectuel de l’Afrique sous-développée veut imiter l’Europe, et l’imite de la pire des manières. Il ne lit pas, ne pêche pas, ne va pas chasser, mais il se pavane dans la ville dans sa belle voiture pour impressionner la population alors qu’à la maison, ses enfants manquent parfois le strict nécessaire. Il entretient de dizaines de femmes.
L'homme instruit pense qu'il est plus facile d’entrer dans le système que d’entreprendre de l'extérieur de le secouer. Sa révolte reste théorique. Il joue la comédie verbale du révolutionnaire tandis qu'il se comporte en réactionnaire. C’est un cynique, et son cynisme ne doit bénéficier d'aucune circonstance atténuante. En Europe où il est allé étudier, il s'est habitué à un rythme de vie. Mais de retour, il doit supporter la saleté, la puanteur. Au lieu de la chasse d’eau, il doit voir des toilettes peu commodes, la corruption, la souffrance. Il est conscient de cette réalité. L’Afrique sous-développée est certes pleine d'hommes sous alimentés et affamés, mais elle est surtout pleine d’hommes masqués. Le problème du développement n'est donc pas de donner à manger à cet homme, mais plutôt de le transformer, de supprimer sa duplicité.
IV- La médiocrité
L'homme médiocre est l'homme du milieu. Il suit aveuglément son milieu. Il est l’homme du centre sans être central. Il est au centre de l’homme en ce sens qu'il est à mi-chemin de l'humanité authentique et de la sous-humanité parfaite. Il est l'homme d'un milieu en ce sens qu'il appartient au grand nombre, à la majorité, à la masse. L’appartenance à un milieu ne conduit pas nécessairement à la médiocrité. C’est l’inaptitude à prendre du recul qui mène sûrement à la médiocrité. C’est l'esprit moutonnier et le conformisme irréfléchi. Etre d'un milieu c'est penser, s’habiller, parler comme on fait dans le milieu, c’est adopter le comportement du grand nombre. L'homme d’un milieu qui suit en toutes circonstances la ligne de conduite de la majorité, se dissout dans l'anonymat d’une masse incolore et inodore. Il devient lui-même incolore et inodore. Le défaut de personnalité, le manque d’originalité sont les premiers traits de l'homme médiocre. Ce qui rend médiocre c'est l'instinct de conservation ou le besoin de sécurité.
Le milieu, la société se singularise et se distingue des autres par les comportements et les modes de vie de ses individus. Le milieu a intérêt à voir tous ses membres se conformer au mode de vie, aux croyances, bref à la culture et à l'idéologie qui le définissent. C’est par instinct de conservation que le milieu rappelle à l'ordre ceux de ses membres qui auraient tendance à s'éloigner de la ligne commune de conduite. Le milieu attend de l'individu l'obéissance envers l'ordre établi dans le milieu. L’instinct de conservation du milieu n'est que l'instinct de mort. Se conserver toujours le même, toujours identique à soi, c’est s'immobiliser, se figer dans une inertie qui serait la mort. C’est le dos tourné à l'avenir, au devenir, à la créativité et à la nouveauté. Si le milieu exige de l'homme un conformisme par instinct de survie, c'est par le même instinct de survie, de sécurité que l’homme se soumet aux lois du milieu. Pour survive l’homme doit renoncer à son originalité et à sa liberté. Il se fait esclave à la fois de la vie et du milieu. L'instinct de conservation de l'homme est aussi instinct de mort. On sauve sa vie en se faisant homme du milieu plutôt qu'en s’opposant au milieu au risque de se laisser détruire par lui pour cause de rébellion ou de subversion. Mais d'un autre côté, il y a oubli de soi dans l'anonymat de la masse, destruction de tout esprit de créativité, existence monotone et routinière. C’est cela que nous appelons la mort. C’est le dépérissement par manque de renouvèlement. Ce dépérissement est causé par la répétition tous les jours de la même chose et l’imitation du comportement du grand nombre.
L'homme médiocre est un homme mécanisé. C’est l'homme du milieu par les insuffisances et les tares qu'il manifeste au premier rang desquelles nous plaçons l'aliénation sous toutes ses formes : absence de jugement personnel et soumission, dépendance par rapport à l'opinion et au jugement anonyme de la majorité, comportements stéréotypés, recherche de la facilité et de la sécurité à tout. L’homme médiocre est un homme normal parce qu'il se comporte comme le font la plupart des hommes. Or la loi du grand nombre n'est pas nécessairement une loi dictée par la raison. La vraie normalité est celle qui obéit à la raison universelle.
Si l'homme médiocre se trouve au centre, c'est bien le centre des différences annulées. Le centre de ceux qui sont incapables de s'édifier eux-mêmes, et qui redoutent la solitude glaciale des positions excentriques. Le médiocre ne se fait pas. Il n'agit pas, mais est agi par les événements, les hommes, l’entourage ou le milieu. C’est un homme superficiel qui se laisse fasciner par l'extériorité au point d'y oublier son âme. La médiocrité s'appelle routine, conformisme, snobisme, répétitivité. L’homme médiocre se réfugie derrière la facilité du suivisme et de l’autorépétition habituelle, un être qui tourne le dos à la liberté difficultueuse et au génie créateur de l'homme, c'est à dire à l'effort par lequel on devrait se hisser perpétuellement au-dessus de soi-même. L’homme critique d'Afrique est un homme médiocre, c'est un homme qui doit reconquérir une identité précise. Le charlatan et l’intellectuel cyniques dont nous avons parlé ne sont pas des créateurs, ce sont des consommateurs. Or la création authentique ne s'effectue que par l'intransigeance, c'est à dire dans la pureté et la simplicité et non dans le mélange et la confusion d’intentions. L’homme critique est un homme au carrefour de l'embarras, il ne sait quelle direction prendre. Il transforme son embarras en raison de vivre. Le médiocre s'accommode facilement avec n'importe quelle situation. Il ne cherche pas à mettre fin au mouvement de balançoire auquel il est assujetti, ni à résoudre son embarras. C’est l'homme des fausses solutions. C'est l'homme qui ne sait pas où il va, ou qui oublie sa première destination lorsqu'il rencontre une difficulté sur son itinéraire. Il ne résout aucun problème et transforme tous ses problèmes en solutions. C’est l'homme fermé à la dimension de l'avenir, incapable de créer quoi que ce soit.
V- La modernité
Moderne se dit de ce qui appartient au temps présent ou à une époque relativement récente. C’est ce qui est actuel et contemporain par opposition à ce qui est ancien et peut-être dépassé ou démodé. Le dépassement fait intervenir le progrès. Une technique est dépassée lorsqu’elle cède la place à une seconde qui se révèle plus efficace et plus perfectionnée qu'elle. Mais un style vestimentaire ancien peut être remis à la mode sans que ce soit une régression. Tout ce qui est moderne ne représente pas nécessairement un progrès par rapport à l'ancien et au traditionnel. Le modernisme peut être un progrès sur un point, une régression sur un autre point. Il est progrès dans le domaine technologique et est souvent assimilé au développement. Adopter une technique ou un mode de vie parce qu'il est nouveau relève d’un modernisme superficiel qui est le snobisme : soumission inconditionnelle au présent, considéré comme une valeur. Qu’importe que le présent paraisse disgracieux ou inhumain.
Il faut un critère autre que celui de l’actualité pour décider de la véritable modernité comme de la véritable régression. Le moderne ne doit pas simplement être l’actuel, mais aussi le meilleur par rapport à ce qui précède et par rapport aux aspirations fondamentales de l'homme. Le critère qui devait nous fonder à assimiler modernité et progrès doit être cherché dans le perfectionnement des méthodes et instruments, et dans l’épanouissement de l’homme qui devait en découler. La modernisation ne doit pas être une simple question d'adaptation formelle au présent, mais un souci d'amélioration réelle de la condition humaine. C’est ce qui est visé dans la bataille du développement.
La tradition peut être une condition de progrès. Toute modernité suppose une tradition dans laquelle elle doit s'adosser. Du passé au présent, il faut un fil conducteur, celui grâce auquel on reconnait toujours l'identité de la réalité mouvante et changeante. Le passé d'un peuple peut handicaper sa modernisation par instinct d'autoconservation, mais l’oubli du passé est dangereux pour un peuple. Il y a dans la tradition une valeur qui est la sauvegarde de l'unité de caractère sans laquelle le peuple tout comme l’individu n’aurait pas de personnalité identifiable. La tradition favorise la continuité et non la discontinuité. Par-delà les traditions particulières, il y a la tradition universelle de l’humanité. Ce qui, dans la tradition, devrait être transmis du passé au présent c'est un certain sens de l’humain par lequel l'humanité se conserverait. La tradition est un appel au souvenir. Il faut se souvenir de soi et du devoir-être. Se souvenir de soi ne signifie pas revenir sur tout ce qu'on a été. Cela signifie faire vivre ce qui, de nous, ne saurait disparaitre sans que nous ne disparaissions du même coup. La continuité que veut assurer la tradition est une continuité du fondamental et non de l'accessoire. Les valeurs africaines traditionnelles se résument en des attitudes, des comportements, des représentations que la conscience africaine a toujours jugées positivement. C’est ce jugement qui est mis en cause. Remettre en cause n'est pas répudier le passé systématiquement, mais voir en lui ce qui peut subir avec succès l'épreuve de la critique. Ce qui doit nous servir de critère de sélection doit être une valeur absolue et non relative. La modernité quant à elle doit être le perfectionnement et l'amélioration et non l'actualité. Le critère qui doit nous permettre de valider certaines valeurs traditionnelles africaines et d’invalider d’autres c'est l'homme en tant qu'il est un être à libérer de toutes les formes de servitude entravant son épanouissement total. Une valeur africaine traditionnelle qui repose sur un fond d'ignorance et de superstition n'est pas une valeur, puisque sa conservation contribue à l'étouffement de l'humanité de l’homme. Par contre, une valeur traditionnelle qui repose sur un fond d'amour, de justice et de vérité ouvre sur une humanité universellement vraie et comme telle, impose sa conservation.
Examinons quelques-unes de ces valeurs. La solidarité est celle dont on parle le plus. Dans son état originel, elle s'insère dans le cadre des rapports entre l'individu et le clan. Le clan était tout et l’individu sa modeste partie. La solidarité intra clanique plongerait ses racines dans la consanguinité. Défendre le clan était défendre son sang, sa force vitale et celle du clan. La solidarité intra clanique ne supposait pas la solidarité inter clanique. Les clans pouvaient avoir des intérêts divergents et entrer en guerre. Par-delà les oppositions inter-claniques et intertribales et sous l'effet de la persécution raciste et colonialiste, les Africains ont constitué quelque chose comme un super clan où le trait consanguin devenait la couleur de la peau. Dans cette situation comme dans la première, la solidarité apparait comme une valeur chaque fois relativisée, et condamnée à le rester. Toute solidarité se fonde sur un égoïsme de groupe, peu importe l’étendu du groupe. La solidarité est une force et elle n’est force que pour déforcer d'autres forces. La solidarité africaine est donc une valeur relative. Elle favorise la modernisation de l’Afrique dans la mesure où elle favorise la constitution des nations, la résorption des hordes, clans est tribus. Le phénomène-nation est en effet un phénomène moderne dans le sens de l'actualité et de l'amélioration. La solidarité est un égoïsme légitime. La solidarité clanique ou tribale est à bannir au profit de la solidarité nationale parce que cette dernière favorise la naissance de véritables nations. La nation n'est pas une fin en soi, mais un instrument au service d'une cause humaine, l'organisation de la vie des hommes dans un cadre qui permettent l’épanouissement et le mieux-être de tous. Dans le cadre de l'organisation pour le bien-être de l'homme, le clan et la tribu sont aujourd’hui dépassés. L’économie moderne exige un espace bien plus vaste que celle du clan et de la tribu. Même les nations africaines se révèlent insuffisantes au regard des nécessités de développement. L'unité africaine apparait donc comme un impératif majeur de développement.
On nous dira sûrement que la vie simple jadis dans le clan et la tribu n'a rien à envier à celle d’aujourd’hui dans les grands ensembles nationaux. Nous répondons que la vie simple à faible densité de relations interpersonnelles, la vie se déployant dans un univers fermé sur lui-même, culturellement et économiquement parlant, n'est pas une vie qui puisse favoriser le plein épanouissement de l'homme. Dans la nation, la densité de la vie relationnelle se voit augmentée, une complexité de culture et des problèmes quotidiens qui amènent l’individu à mettre à contribution toutes ses facultés intellectuelles et physiques.
La notion de solidarité subit une corruption en famille et se transforme en solidarisme. Ce solidarisme étend la responsabilité mutuelle au-delà des pères, mères, frères et sœurs, cousins et neveux. Dans la situation originelle, chaque membre n'avait pas de droits, mais des devoirs. Le vivre-fort de la famille dépendait du bon accomplissement des devoirs de chacun. Dans la situation actuelle où beaucoup de membres de la famille sont incapables de s'adapter aux nouvelles conditions d'existence, une rupture se produit entre ceux qui sont incapables et ceux qui sont capables de s'adapter aux nouvelles conditions d'existence. En prônant la solidarité, les inadaptés ne voient que des droits et rarement des devoirs. Ils vont ignorer les difficultés que tel neveu a eues pour se faire une place dans la société moderne. Ils lui rappellent ses devoirs. Une dissymétrie se crée entre les mal-adaptés et les adaptés, qui veut que les adaptés aient des devoirs et les mal adaptés les droits. Les chômeurs élisent domicile chez le fortuné et vivent une vie de luxe, sans se soucier des dépenses. Le solidarisme est aujourd'hui un mal qu'on dénomme parasitisme social. C’est un frein au développement. Favoriser ce solidarisme c'est encourager la paresse, le refus de tout effort, la démission de toute responsabilité vis-à-vis de soi-même et des autres.
L'authentique situation africaine à privilégier est celle qui faisait une place identique au donner et au recevoir. Le solidarisme ou le parasitisme social crée des comportements incompatibles avec les exigences de développement économique de nos pays. Le sentimentalisme outré qui pousse les riches à entretenir les non riches fait plus de mal que de bien à l'ensemble de l'économie nationale. Il faut donner du travail aux chômeurs et non de l’aumône. Le développement des pays du tiers-monde dépend d'eux-mêmes et non de la générosité des pays développés. Le but de la générosité est de permettre à chacun de gagner sa propre liberté, que ce soit celui qui donne ou celui qui reçoit. La solidarité africaine, déplacée des cercles d'intérêts étroits vers des cercles d’intérêts plus vastes, peut contribuer de manière efficace à la résolution de nos problèmes.
La deuxième valeur à étudier est le temps. Il est reproché à l’Africain de ne pas avoir la notion de temps. Le temps dans le processus économique est celui de la prévision, de l'épargne et de la planification. On ne peut pas dire que le négro-africain n’ait aucun sens de la prévision et de l’épargne. Il suffit de mentionner les greniers dans plusieurs sociétés africaines. On pensait à la saison suivante des semailles et une bonne partie des recolles était épargnée au compte de subsistance de la période de l'entre-deux récoltes. Le Négro-africain est donc capable de prévision. Mais dans l’économie traditionnelle, la prévision est à court terme, et rarement à long terme comme dans l'économie moderne. Pas de plans quinquennaux dans l'économie traditionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de plan du tout. S'il n'y avait pas de prévisions à long terme dans ce contexte, c'est parce que l’homme africain n'en avait pas besoin. Les créations naissent de besoins ou d’insatisfactions initiales. L’économie moderne oblige à un réajustement d'échelle. Nous devons nous réadapter aux conditions nouvelles d’existence. Quand le présent du paysan africain n'est occupé que par un seul souci à la fois, toujours sur le plan économique, le présent du paysan du pays développé est occupé par plusieurs soucis. C'est peut-être la saison des récoltes comme pour le paysan africain, mais en plus, le paysan du pays développé pense aux problèmes du marché, à l'écoulement de ses produits, à la concurrence éventuelle des produits des pays voisins, à la bonne marche de ses machines. Or dans l'économie traditionnelle africaine, on ne produit pas pour vendre, on ne se préoccupe pas des débouchés. L’activité quotidienne est une activité à structure simple. Cette structure simple donne au temps une élasticité qu'on ne retrouve pas dans la structure complexe de l'économie moderne où les tâches sont exercées plus rapidement. Dans ce second cas, nous avons à faire au temps atomisé, morcelé, bref mathématisé. Dans l'économie moderne, le temps c'est la quantité de travail que nous pouvons y effectuer. Des tâches qui demandaient un mois pour être achevées dans la situation traditionnelle le peuvent être aujourd'hui en une journée, sinon moins.
La notion de temps est étroitement liée à la structure de l'activité des hommes et plus précisément au rythme avec lequel se déploie cette activité. Ce sont les conditions réelles d’existence, l'activité réelle de transformation de leur environnement qui déterminent les diverses représentations et visions du monde, que les hommes se donnent. On ne peut donc pas dire que le Négro-Africain n'a pas la notion du temps dans le processus économique. On ne saurait d'ailleurs quoi dire aux simplifications de Senghor qui trouve que la raison est hellène et l'émotion nègre, et qui ajoute que le Cogito chez l'Africain c'est le « Je danse donc je Suis ». La manière d'être du noir est une production historique et est susceptible de changement. Les notions, représentations et conceptions suggérées par le milieu et les conditions de vie n’ont rien d’éternel et de spécifique. La conception traditionnelle du temps chez le Négro-Africain n'a rien de figée. Elle change au gré de bouleversements des conditions réelles d'existence. En dehors de toute activité ou de tout repos de notre part, le temps n'existe pas. C’est nous qui faisons exister le temps en entreprenant d'accomplir une tâche précise. La tâche fait intervenir une temporalité particulière. Le temps n'existe que pour les êtres conscients et agissants. Dans le cadre de l'économie traditionnelle, le Négro-Africain, en décidant des activités relativement simples décide aussi de son temps en travaillant à un rythme voulu par lui. Dans le style de vie moderne, le temps est devenu harcelant du fait que l'homme n'a pas le loisir de décider des tâches à accomplir et du temps de leur accomplissement. Ces tâches lui sont prescrites par l'extérieur. L’homme perd l'initiative créatrice et succombe à la servitude d'un temps anonyme et conventionnel. Dans la situation traditionnelle africaine, la part du temps conventionnel se trouvait fort réduite, au profit du temps de la spontanéité. Le temps harcelant de la vie moderne et la spontanéité de la vie traditionnelle doivent tous deux être confrontés à la dignité de l'homme. Le rapport de l’homme au temps dans la situation traditionnelle est celui qui est de nature à lui sauvegarder une certaine liberté et une certaine dignité aussi. Que l'homme devienne esclave du temps sous prétexte de modernisme ne représenterait pas un progrès, mais une régression. Contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, la manière traditionnelle qu’a le Négro-Africain de vivre son temps est la plus humaine en ce sens qu’elle respecte la liberté de l'homme. L'homme moderne n'est pas une fin, mais un passage vers une nouvelle modernité. La modernité d'hier est devenue tradition aujourd'hui. Ce n'est pas la modernité, mais l'humain comme valeur qui devrait nous servir de référence dans la bataille du développement.
VI- Bien-être et bonheur
L’homme est un être qui a des besoins dont certains sont vitaux, d’autres pas. De la satisfaction des besoins vitaux dépend sa survie. L'on peut dire que tous ses besoins fondamentaux se résument dans cet unique besoin : la sécurité. Le bien-être ne saurait être ramené à la jouissance de la sécurité, c’est-à-dire à la certitude de vivre demain ou après-demain. La satisfaction des besoins vitaux ne nous garantit pas le bien-être mais seulement l'être. L’homme ne commence à exister vraiment que lorsqu'il accède au souci de qualité de l'existence qu'il veut mener. La recherche de la qualité n’est un luxe que pour les sous-hommes dans un état de survie. Le bien-être touche donc l'accomplissement total de soi. Il y a une différence entre exister banalement, en dessous de ses potentialités et exister pleinement, en se réalisant, en se faisant chaque jour davantage que le jour précèdent. Vivre tout court, ne satisfait pas l'homme. Si nous distinguons entre le vivre biologique et le vivre humain, nous sommes amenés à distinguer également entre deux formes de sécurité : la sécurité-conservation de la vie et la sécurité-conservation de l'humain. Dans la bataille du développement à laquelle l’Afrique Noire est attelée, l'objectif le plus apparent est l'amélioration du sort matériel des hommes. Il est question pour ceux-ci d'avoir des habitations saines, des baignoires, des téléphones, des automobiles.... La recherche du bien-être se présente donc comme recherche d'une aisance qui seule permettrait à l'homme d'oublier le harcèlement des impératifs de sécurité élémentaire pour se consacrer à lui-même. Le bien-être va donc de pair avec une abondance suffisante de biens ou d'objets. Mais la simple jouissance de ces objets et biens n’est pas suffisante, il faut l'émancipation à l'égard de tout ce qui est anti-vie. Cette émancipation c’est la liberté. L’homme qui peut satisfaire la plupart des besoins est un homme moins handicapé et plus libre que celui qui manque de moyens suffisants pour la satisfaction de mêmes besoins. La condition minimale du bien-être est donc le bien-avoir. La méthode de réalisation du bien-être est donc l'acquisition des objets-réponses à nos désirs. La recette du bien-être est la technique, peu importe qu'elle soit moderne ou antique. L'homme ne cherche à s'associer la nature que pour supprimer son hostilité, ceci pour vivre en sécurité. Mais le but de l'homme n'est pas de se conserver en vie jour après jour même si cela se fait dans la médiocrité. Une existence médiocre n'est pas une existence qui vaille la peine d'être vécue. Le but ultime de l'homme est d'actualiser son humanité, de s'accomplir totalement en créant des œuvres qui se proposent en addition au monde. C’est pourquoi la sécurité-conservation de vie n’est qu'un tremplin pour la sécurité-accomplissement de soi. Le bien-être jouissance transforme l'homme en enclave de l’objet. Or cet objet peut être tarissable. Le véritable bien-être devrait être le bien-se-faire. Dans le bien-se-faire, et y a un dynamisme créateur qui pousse l'homme à se hisser perpétuellement au-dessus de ses jouissances successives et à s’approfondir sans discontinuer. Le bien-être c'est en premier lieu le bien-avoir, mais simplement comme moyen, la finalité dernière étant le bien-se-faire. Le bien-étant ne saurait donc se présenter comme un homme de repos. Il est, il doit être un homme de l'effort permanent pour la réalisation d'une alimentation abondante, d’une plus grande quantité de logements mieux appropriés. Il doit vivre dans un cercle de connaissances plus étendues, faire valoir des talents autres que ceux de production de biens, atteindre en conséquence de nouveaux niveaux de dignité humaine. Bien évidemment le bien-être exige des ressources économiques supérieures aux capacités de la plupart des économies de subsistance traditionnelles de l'Afrique.
Mais le développement conçu comme une accumulation pure et simple de l'avoir est un mauvais développement. La production devenant l'objectif principal, tout lui est subordonné, y compris l'homme lui-même. Le règne de la technique est le règne de la déshumanisation de l'homme et de son aliénation sous toutes les formes. La technique a entrainé le capitalisme qui a placé le prolétaire dans une situation insupportable et humiliante. La technique aboutit au règne de la quantité. La même technique qui libère l'homme de l'inquiétude de vivre en pourvoyant surabondamment à ses besoins est aussi celle qui le précipite vers une aliénation des plus insidieuses. Il faut donc trouver le contrepoids de la technique. Et ce contrepoids nous le voyons dans l'art. Un ouvrier menuisier, un ingénieur sculpteur ou peintre vivant dans une civilisation technicienne ne seraient pas des hommes totalement aliénés. Ils conservent la possibilité de s'accomplir humainement en réalisant les œuvres de leur liberté. Sauver l'homme de l'écrasement de la puissance technique c'est fondamentalement sauver la liberté. Le bien-être de l'homme n'est effectif que lorsqu'à la certitude de satisfaire dignement tous les besoins matériels de survie se rajoute la certitude de s'approfondir et d’approfondir l’ordre du monde en vue de réaliser une harmonie des deux ordres : l’ordre intérieur et l'ordre extérieur.
Le bonheur représente la contemplation rétrospective du bien-se-faire. Nulle part, le bonheur n'est le bonheur de toujours ; pire il est confondue avec les plaisirs et les joies nécessairement fugitives, nécessairement suivis de déplaisirs et de tristesse. Tous les automobilistes savent d'expérience que rouler sur une belle route longue et rectiligne finit par endormir le conducteur. Ce qui endort c'est la stabilité et le confort. Une route sinueuse par contre ne laisse pas au conducteur le loisir de somnoler. Il est constamment tenu en éveil par les difficultés du parcours. La monotonie est mortelle pour l'homme même lorsqu'elle est monotonie d'une vie paradisiaque. Le bonheur humain est inséparable de la conscience explicite du bonheur. On ne peut pas avoir le bonheur si on ne sait pas qu’on est heureux. Le bonheur ne réside pas dans les états de plénitude et de contentement momentanés. C’est une satisfaction totale et non partitive, une plénitude terminale. L’homme a toujours rêvé de mettre un terme définitif aux efforts qu'il déploie quotidiennement pour vivre. La recherche du bonheur prend donc la forme d'une volonté de supprimer la peine, la difficulté, l'effort. Ce bonheur se propose sous forme de jouissance. Il est voué à un perpétuel échec. La vie humaine est régie par la loi du mouvement et de l’activité. En supprimant le mouvement et l'activité, on se condamne à la mort. Quand bien même on envisagerait le bonheur sous l’angle de la beauté, il présenterait une ambigüité à se poser comme valeur éthique d'une part, et d’autre part, son insuffisance d’universalité en tant que esthétique. Le bonheur se présente toujours comme aspiration à une éternité de repos, repos dans la jouissance. Mais une éternité de jouissance finit par être inconsciente d’elle-même. Il ne sert à rien de se préoccuper du bonheur. La bataille du développement ne saurait être une bataille pour le bonheur de l’homme, car ce serait alors une bataille pour la mort. Ce qui est recherché par les populations sous-développées c'est le bien-être.
VII- Liberté et libération
Si la liberté existe, elle doit avoir la même signification pour tous les humains. Mais le problème est de savoir où elle se trouve : dans l’action de supprimer les entraves qu’on affronte ou dans la suppression de ces entraves. Toute liberté qu’on peut jouir dans l'absence de contraintes est une liberté négative. C’est ce que nous appelons la liberté-chose par opposition à la liberté-production. La liberté n'est jamais acquise une fois pour toute. Le dictateur doit être éjecté du pouvoir, le sous-développement doit être résolu, notre paresse doit être vaincue ; alors seulement nous aurons manifesté notre liberté. La liberté ne saurait être un luxe, un couronnement pour l’action de l’homme. Il n’y a pas de liberté qu'on puisse gagner définitivement. La vraie liberté n’est pas à escompter à un terminus quelconque. La vraie liberté s'éprouve et se prouve dans l’action libératrice. Et l'on passe d'une action libératrice à une action libératrice sans qu'on puisse avoir résolu toutes les aliénations ni satisfait toutes nos aspirations qui sont toujours des incitations à créer.
La liberté comporte deux aspects fondamentaux devant être nécessairement associés, mais que nous retrouvons souvent dissociés dans l'histoire de la pensée. Ce sont premièrement la possibilité de détachement, secondement l'activité de transformation du réel. Le moment du détachement est le moment de la recherche de la vérité. A y regarder de près, c'est le moment où l'on prend conscience d'une première aliénation qui est l'ignorance. On se rend compte qu’on est le jouet des forces extérieures : slogans publicitaires, propagande et endoctrinement politiques, les diverses modes vestimentaires, idéologiques, les comportements de masses. Un homme immergé dans un tel contexte, incapable de détachement par rapport au contexte ne peut pas être libre tant qu'il ne s'est pas libéré de sa léthargie. Le détachement représente le premier pas vers la liberté. On peut se détacher de son milieu de trois manières. Premièrement, une faille se fait jour dans le système total des aliénations et révèle le mécanisme tout entier. Lorsque tout tourne correctement, l'homme mécanisé ignore l'existence du mécanisme en tant que tel. La faille réveille donc le dormeur aliéné. Cette faille peut arriver par vieillissement ou par l'introduction d'un corps étranger. L'Africain commence à interroger sa culture suite à l'introduction du christianisme étranger. Deuxièmement, le détachement se fait quand la pression du système devient si forte qu’au lieu d'endormir les individus, elle leur fait ressentir une réelle souffrance. La souffrance fait prendre conscience de la tyrannie du mécanisme. On n'est jamais totalement endormi sous une dictature. Le dictateur peut s'accrocher au pouvoir, mais le peuple est conscient de sa propre souffrance. Troisièmement, le détachement peut se faire par quelques éclaireurs qui amènent les autres à se réveiller. Il existe dans chaque société des hommes qui remettent en question le système. C’est en effet le rôle de la philosophie et des philosophes de veiller constamment pour pouvoir révéler aux autres le sens du présent et la direction de l'avenir. Le philosophe est celui qui ne dort jamais. Sa voix, constamment doit trouer, percer le silence mortel des nuits de la servitude et de l’aliénation sous toutes ses formes. Le philosophe est comme l’oracle de la société. Mais seulement, ses interprétations du monde ne sont ni des visions, ni des révélations. Aucun être mystérieux ne lui souffle ce qu'il doit dire. Il réfléchit, c'est à dire analyse, compare le réel avec l’idéal qu’il porte en lui, confronte le laideur existante avec le beau devant être, l'injustice existante avec la justice devant être, bref le désordre existant avec l'ordre devant être. Il a le sens de l'humain et c'est cela au fond, appuyé sur la raison universelle, qui sert de critère à toutes ses entreprises.
Voilà donc les trois manières selon lesquelles l'homme peut manifester sa liberté en se détachant d'un ordre qui tend à l’étouffer. Les deux premières dépendent du système lui-même tandis que la troisième dépend de la capacité de l'homme de nier. C’est effectivement par la négation que l'homme manifeste d'abord son aptitude à la liberté. On nie, on se révolte, on refuse quand on n’est pas accord avec. On s'arrête au milieu d'une pente, et au lieu de descendre la pente comme d’autres, on entreprend le chemin inverse. L'homme est le seul être dans le règne animal qui ait le pouvoir de résister à la facilité et à la nature qui tend toujours à l’enrôler dans son cycle d’inertie. La liberté commence par le pouvoir de dire non, la résistance, l'opposition, la contestation. Mais la négation gratuite, l'abstention gratuite ne manifestent pas la liberté.
Le deuxième moment de la liberté est celui de la réorientation effective, de la construction du nouveau. Le dialecticien moderne en Afrique est celui qui devra dire à son confrère superstitieux et crédule que les naissances peuvent être réglées, que les naissances ne viennent pas mystérieusement de Dieu. Il doit apprendre à son confrère à distinguer dans les discours des hommes politiques, la démagogie de la sincérité. Il doit apprendre à son confrère qu'aucune force occulte ne préside à son destin. Le dialecticien ne peut que proposer un tel savoir, aider les autres à sortir de la léthargie esclavagisante de toutes les formes d’obscurantisme, tant les religieuses que les politiques. Mais cela ne suffit pas. C’est dans l’action de transformation de soi et du monde que s’achève la liberté. Le savoir seul ne suffit pas. Le savoir doit donc passer dans les actes. On se libère soi-même ou jamais. Le dialecticien qui nous fait découvrir la vérité ne peut pas emprunter nos mains ou notre entendement pour se charger de notre libération personnelle. Se libérer n’est pas se séparer d'un corps étranger handicapant. La liberté n'est liberté que pour la création. On ne crée qu’en niant et détruisant, en détruisant la matière première et autres objets. La voie de la liberté est la voie de l’effort et de la difficulté. La liberté est un vain mot sans le pouvoir de décision assorti lui-même d'un pouvoir d'action réel. Elle n'est pas un programme qu'on puisse envisager de réaliser, mais elle permet de réaliser d'autres programmes. La liberté, c'est plus exactement la libération. C'est l’effort permanent par lequel l'homme se hisse perpétuellement au-dessus de la nature et de lui-même, pour inlassablement, témoigner en faveur de la vie et au détriment des forces destructives de la mort. La liberté est au service de la vie. Elle ne se donne pas à récupérer. On doit renouveler sa liberté tous les jours. Seuls nos actes quotidiens de libération parleront de notre liberté. Nombreux sont ceux qui s’imaginent libres et qui sont en réalité des esclaves qui s’ignorent. En pays développés comme en pays sous-développés, il existe des hommes qui sont plus libres que d'autres. Il existe donc des degrés de liberté. Le problème est de savoir rendre la liberté moins aristocratique et plus démocratique. C’est le problème de savoir comment orienter notre développement pour éviter de le transformer en un facteur d'aliénation.
VIII- Culture et développement
Riche ou pauvre, développé ou sous développé, l'homme demeure menacé par l'aliénation. L’humanité de l’homme réside dans une harmonie entre la matérialité et la spiritualité. C’est pourquoi nous disons que toute retraite spirituelle que se voudrait permanente entrainerait une perte certaine du retraité. La religion se présente comme une organisation voulue par l’homme et présentant une hiérarchie définie, un lieu ou des lieux réunions, des rites et pratiques devant être observés par des membres unis sur la base d'un credo : énoncé d’un certain nombre de vérités posées comme indiscutables et que nul ne cherche à vérifier, ni à justifier d’une manière ou d'une autre. La différence des credo fait la différence des religions. La religion nait elle-même de la différence des milieux socio-culturels. Parce qu'on ne nait pas témoin de Jéhovah, ni catholique, ni musulman, on le devient culturellement, artificiellement, on devient membre d’une religion. Ce qui allie dans la religion c’est l'adhésion à un même credo. Mais au-delà de la pluralité des alliances, il y a une alliance des alliances, une religion des religions, le credo commun qui permet de parler de religion en général. C’est cet idéal de réintégration dans un grand Tout qui soit créateur de toute chose. Les religions africaines, précisément, sont des religions comportant la croyance en un Dieu unique, créateur des hommes, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, y compris les fétiches. Il existe des divinités secondaires intermédiaires entre le Dieu unique et les hommes, à la manière des saints de la religion catholique. Les religions africaines et la religion chrétienne impliquent la croyance en un Dieu unique. La préoccupation de salut existe dans les religions africaines. L'Africain cherche à se sauver d’abord ici-bas. C’est pourquoi il se concilie avec les divinités secondaires capables de lui garantir une meilleure vie ici-bas. Dans son au-delà, il n'y a ni enfer, ni paradis, mais une simple éternité de vie en tant qu'ancêtre. La préoccupation de l’ici-bas est prépondérante chez l’Africain. Quand il sacrifie une chèvre à Dieu, c'est pour lui demander l'amélioration de sa condition ici-bas (protection contre les forces maléfiques, richesses, enfants, force...) Mais nous n’avons pas besoin de recourir à la religion pour résoudre les problèmes de l'existence. De nombreuses techniques le font déjà et bien. La religion, la magie et la technique ont été réunies à l'aube de l'humanité parce que l’homme a toujours voulu suppléer au déficit de la technique par la magie et la religion. Dans la spiritualité de la religion, l’homme s'aliène bien plus qu'il ne se libère. Il s’aliène d'abord parce qu'il se dépossède de son pouvoir et surtout de sa responsabilité au profit d’êtres imaginaires. À quoi sert-il de danser Dieu, de chanter, louer, célébrer Dieu, comportements considérés comme hautement spirituels, si cela ne doit aboutir qu'à nous pousser vers l’abandon de nous-mêmes à l'irrationnel au moment précis où il faut résoudre les problèmes de la vie quotidienne ? Les pratiques religieuses, dans la mesure où elles entrainent l'homme dans une indéfinie autorépétition finissent par mécaniser la spiritualité et à vider bien des gestes de leur signification. Ce n'est pas avec la religion, strictement parlant, que nous pouvons espérer limiter les effets aliénateurs de la modernisation, car l'esprit de religion étouffe en l'homme les meilleures dispositions à la créativité à cause justement de la soumission qui le caractérise. L’esprit de religion est en effet un esprit de soumission à l'irrationnel et à l'ordre qu'on croit émaner d’un être qui nous surpasse en toutes choses et qui cumule les perfections dont nous rêvons. Or il y a en l'homme un peu plus d'initiative créatrice pour pouvoir envisager avec plus d’optimisme de faire échec aux diverses formes d'aliénations que lui présente en perspective la société devant sortir de la bataille du développement. La religion ne nous donnera pas le supplément nécessaire d'initiative créatrice, c'est-à-dire, au fond, la liberté. Ce n'est pas en se réfugiant dans une pseudo-contemplation de l'âme ni en s’abandonnant à la divinité que nous pourrons espérer sauver l'humanité de l'homme des assauts de l'anti-humain. La véritable foi est celle qui crée les actions visibles. Pour ce faire, elle empruntera le canal de l'art. L’art est la discipline qui restitue à l’homme, en même temps que l'initiative créatrice, un sens absolument nécessaire de l’harmonie. L’artiste est un travailleur tout autant de l'esprit que de la matière.
L’art n’est, ni ne saurait se vouloir une technique de transformation utilitaire du monde. L'art ne se désintéresse pas du monde et de la vie. Tout en restant préoccupé dans le monde, il n'est pas une source supplémentaire d'aliénation. Bien au contraire, il se présente comme un moyen de libération. L’artiste est un producteur. Il produit les œuvres palpables. Il produit des œuvres uniques inséparables de leur moule, des œuvres originales. L'artiste cumule la conception et l’exécution, séparées ailleurs. La spiritualité est inséparable de la matérialité et du monde, et cela pour deux raison. Premièrement, la nécessité de s'exprimer, de se manifester oblige toute spiritualité à collaborer avec la matérialité. Le poème qui n'est que rêve, le roman qui n'est que conçu ne sont rien. Il faut que l'un et l'autre s'incarnent dans les mots, s’incrustent sur du papier. Mots et papier relevant de la matérialité. Toutes les élaborations de l'esprit demeureront des chimères et des rêveries aussi longtemps qu’elles n'ont pas emprunté le chemin de la matière pour s’exprimer. Secondement, la spiritualité est constituée d’idées, et ces idées sont celles de la relation du corps à l’âme, de l’intériorité à l’extériorité. La réalité du monde demeure le souci de l'esprit. Il est des toiles de peintres qui valent de longs discours politiques et moraux. La désaliénation du corps réside dans l'établissement d'une harmonie entre l'esprit et le corps et non dans l'annihilation du corps. Pour l'établissement d'une telle harmonie, l'activité artistique est celle qui prédispose le mieux l'homme. Il n'est pas exigé de tous de devenir artistes créateurs; il suffit pour la grande masse de cultiver une sensibilité à l'art pour jouir des mêmes privilèges que ceux reconnus aux artistes eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'aller de concerts en concerts, ou de parcourir des musées pour vivre réellement une existence ! L’artiste se découvre jusque dans sa manière de porter une coupe aux lèvres. La manière d'artiste engage tout l'homme, toute notre personnalité et fait échec à l'atomisation aliénatrice. On est tout entier dans chaque geste qu'on exécute. Ici, pas de stéréotypie verbale, ni de poignées de mains données à la sauvette tandis qu'on a l'esprit ailleurs. Il faut que la bataille du développement puisse garantir la pérennité de l'artiste créateur en Afrique. Pérenniser parce que l'Africain est un artiste. Il fait tout en chantant, et danse constamment. Chanter notre servitude ou notre peur est un comportement de créateur. Bien évidemment cette chanson ne résout pas la difficulté réelle, mais la révélation de notre misère par l'art représente déjà un pas sur le chemin de la réduction de ladite misère. Le pagayeur sur le fleure Wouri seul la nuit parvient avec la chanson à dominer sa peur. Mais l’esclave noir souffrant dans les plantations des Yankees n'est pas épargné de la mort, ni de la servitude quand il chante. Le but de la chanson était de composer avec la souffrance sous peine de mourir. Composer non pas dans la compromission et l'acceptation du fait, mais s'adapter supérieurement par la production d'harmonies qui se proposent comme correctrices des dysfonctionnements réellement vécus. Pour que l'artiste soit effectivement le type d'homme que nous cherchons, c’est-à-dire le créatif, il ne faudrait pas qu'il se transforme secrètement en professionnel de l'art. Les artistes de métier ne sont pas nécessairement des créatifs. L’art organisé comme métier engendre ses propres aliénations. D’art nous ne retenons que la disposition à créer sans cesse, c'est-à-dire à rester tant soit peu maitre de soi-même dans un corps-à-corps avec le monde, un monde qu'il serait vain et lâche de fuir sous prétexte de libération. C’est dans l'engagement réel que nous nous libérons et non dans le dégagement.
L’Africain est un être de rythme. Il travaille en chantant et danse constamment. La soumission au rythme devrait entrainer chez l’Africain une discipline du corps et de l'esprit qui détermine une maitrise de soi, mais l'Africain est impulsif. La danse et le rythme chez l'Africain paraissent être naturels, or il faudrait qu’ils soient culturels. Le véritable artiste devra se démarquer de cette forme à allure naturelle. L'homme artiste que nous cherchons devra cultiver son sens du rythme, du gracieux, du beau et non se fier à une nature esthétisante.
Cultiver le sens de l'art, cultiver la liberté fait nécessairement appel à toute une éducation impliquant l'acquisition du savoir au sens large de terme. Et au centre de cette éducation nous plaçons la connaissance scientifique de soi et du monde, le savoir vrai. L’homme qui connait le monde est celui qui peut aussi le prévoir au lieu de se laisser balloter par lui de surprise en surprise. L’homme doit aussi se connaitre pour pouvoir anticiper sur ses propres réactions et les orienter dans la bonne direction. Le sous-développement de l'Afrique noire n'est pas uniquement un sous-développement économique, mais aussi un sous-développement culturel. La culture dont nous parlons ici n'est pas celle qu'on reconnait volontiers à tous les peuples du monde : culture comprise comme système complet et particulier de relation au monde (institutions diverses, coutumes, cosmogonies, système d'exploitation de la nature, organisation socio-politique...) Les diverses valeurs pratiques que comporte la culture doivent s'incarner tous les jours dans les comportements réels des hommes qui se réclament d'elle, pour ne pas se transformer en valeurs du musée, juste bonnes pour la contemplation. Or il n'y a pas de valeurs pratiques éternelles. Les valeurs de la négritude n'existent plus que dans la littérature contemporaine et point dans l'existence quotidienne. L’industrialisation et la modernisation culbuteront bien des croyances, détermineront une nouvelle forme de sensibilité, un nouveau type de relation avec la nature. Il y a de la naïveté pour un peuple à penser que parce qu'il a toujours été d'une certaine façon, cette façon est bonne éternellement. C’est une attitude qui tourne le dos à l’idéal de créativité. Dans la volonté de demeurer soi-même, de conserver une identité inamovible, il y a toujours, non aperçue, une fermeture au mouvement même de l'histoire, c'est-à-dire une aliénation. C’est pourquoi le développement doit être pour nous considéré comme l'occasion de briser le cercle de l'autorépétition aliénatrice. La culture dont nous parlons n'a rien de particulariste. Elle est plutôt l'expression de l'aspect scientifique de toute culture particulière. Et en tant que telle elle est d’abord culture des individus pris isolément et non culture d'une société globale. C'est l'homme individuel qui nous intéresse ici, avec son niveau de connaissances, son pouvoir réel sur le monde, et non la société prise globalement comme une super-individualité. C’est au service de cet homme individuel que doit se mettre le développement. C’est à lui qu'il faut donner le maximum de savoir nécessaire pour qu'il puisse connaitre un réel épanouissement. Sa formation, son éducation devront associer très étroitement l'étude et la connaissance des causes réelles des choses et une sensibilisation convenable à la beauté. A la formation scientifique de l'homme de l'Afrique moderne, il faudra par conséquent associer une solide éducation artistique si on tient à éviter la fabrication de marionnettes et de robots humains.
IX- L’excellence
De la bataille du développement devra sortir un type d’homme que nous caractérisons sous les traits du créatif pour souligner la nécessité qu'il y a de sorte à faire qu'il soit un homme libre, du moins toujours apte à le devenir. Exceller c’est se situer en haut de l’échelle dans une position supérieure à celle de tous ceux qui se rangent massivement au bas et au milieu de l'échelle. Il y a dans ce vocable l'indication d'un mouvement de sortie. Celui qui excelle sort effectivement d'une condition partagée par un grand nombre dans la médiocrité pour se poser supérieurement en marge du groupe. Le développement doit œuvrer à substituer à la médiocrité l'excellence. L’excellence se conquiert par le refus de s’abandonner aux forces extérieures, la passivité, la soumission, le manque de personnalité. L’homme ne commence à être homme qu’en apprenant à dire non. Dire non à tout ce qui le nie aussi bien en lui-même qu'à l'extérieur. Mais on ne dit pas non pour en rester là. La négation doit être suivie d'une nouvelle affirmation. C’est le moment de la création ou de la recréation. Et toute création est l’œuvre d'une liberté, et la liberté est nécessairement liberté de l'individu-homme. Aussi démissionnons-nous de notre responsabilité de créateur de notre histoire chaque fois que nous remettons à une collectivité, à une communauté, le soin de créer pour nous, le soin d'organiser pour nous notre propre histoire. L’homme excellent ne se départit à aucun moment de sa responsabilité sans se renoncer, sans se renier. L’excellence implique donc pour l'homme le devoir de responsabilité envers l'humanité. Le vouloir de l'homme excellent ne se subordonne pas à des fins partisanes ; il veut la volonté générale. L’homme excellent ne peut être tel que dans la mesure où les autres hommes le reconnaissent comme tel, c'est-à-dire se reconnaissent idéalement en lui. Et se reconnaitre idéalement en l'homme supérieur c'est accorder une valeur d'universalité à ce qu'il fait et crée. C’est vouloir sa volonté, l'accepter, la faire nôtre en quelque sorte. Et réciproquement, c'est admettre que l'homme supérieur a réellement voulu la volonté générale des hommes se réclamant de l'humain. L'homme excellent n'est pas seulement celui qui manifeste suffisamment de force pour résister aux aliénations, mais celui qui connait la bonne affirmation valable universellement.
La révolte pure n'est pas preuve suffisante de liberté. La révolution est à la révolte ce que l'affirmation est à la négation, ce que la construction est à la destruction. Donc pour construire, pour affirmer, pour révolutionner, il faut savoir dans quelle direction s'orienter. Ce n'est pas un ignorant qui parlerait de créer des valeurs nouvelles. Il faut savoir quoi créer de sorte que cette création puisse être voulue de tous. L’homme excellent en tant qu'il prend des initiatives novatrices, engage le sort de ses semblables. Il ne saurait lui être interdit de vouloir son propre bien, mais alors, il doit agir de telle sorte que vouloir son propre bien ne contredise pas celui des autres. Il n'est responsable que parce qu'il est apte à la liberté ; et si sa recherche de la liberté doit nuire à la libération des autres, il ferait échec par la même à sa propre libération. Pour que la responsabilité de l'homme excellent soit réellement ce que nous venons d’en dire, il faut donc qu'elle s'appuie sur une connaissance vraie. Il est inconcevable que l'homme excellent crée dans l'ignorance. Le savoir sur lequel s'adosse sa création est de type intuitif. Tout se passe comme si le parfait créatif renouait, au moment même où il crée, avec le mouvement général de la vie. L'homme peut en effet savoir de deux manières : soit par la manière réflexive, intellectuelle et discursive, soit par la manière intuitive, immédiate et silencieuse.
L’homme véritable, l'excellent, c'est celui qui ne balance pas entre être spectateur et être acteur, il choisit d'être acteur. C’est celui qui ne se contente pas de vaines paroles, mais qui agit immédiatement sa parole à la fois intime et publique, laissant le soin à d'autres d'expliciter cette parole déjà inscrite par lui dans ses œuvres. C’est l’homme qui comprend que le salut des autres dépend de son propre salut et réciproquement.
Par le hasard de leur naissance, certains hommes se trouvent placés plus près de la permanence du mouvement de la vie que d'autres. Il faut une prolifération d'excellences. Si l’excellence devait demeurer un phénomène d’exception, alors tout a qui se fait dans le cadre de la bataille du développement serait pure dérision. Or il faut que le développement économique, social et culturel contribue à l’amélioration de l'homme. Pour rendre l'excellence moins aristocratique, il s'agirait pour les éducateurs de concevoir l'éducation de la jeunesse africaine d'aujourd'hui dans le sens indiqué, c'est-à-dire s’attacher à développer chez les jeunes le sens critique, le sens des responsabilités, le goût de la création esthétique et l’amour de la liberté. Les programmes d'enseignement et les programmes d'activités dans les divers mouvements de jeunesse devraient accorder une place de choix aux sciences, à la philosophie comme pratique de la réflexion, à l'esthétique non pas du point de vue de la théorie de l'art mais du point de vue de la création proprement dite. Nous savons que la plupart des génies n'auraient pas donné à l’humanité leurs œuvres s’ils n’avaient pas vécu dans un contexte stimulant. Et ce contexte stimulant c’est le milieu éducatif. Et cette éducation n’est pas l'éducation traditionnelle de maitre-élève. Bien éduquer ici consistera d'abord à proposer à l'enfant un milieu stimulant qui le conditionne dans le sens voulu et qui est celui de la promotion de la liberté dans l’excellence. Il est possible de rehausser le niveau de culture de la masse et de renverser l'équilibre entre la masse et l’élite en créant une situation dans laquelle le plus grand nombre devient l’élite, et le plus petit nombre seulement le déchet. On ne peut pas éviter le déchet mais on peut réduire son importance quantitativement.
S’agissant de la fréquence de l’héroïsme et de l’excellence, seuls les actes spectaculaires frappent l'imagination et retiennent l'attention des hommes. Pourtant dans la vie quotidienne, nombre d'autres actes d’héroïsme passent inaperçus tout simplement parce que leur portée est restreinte et que le théâtre sur lequel ils se déroulent est lui-même limité et discret. Ce qui fait les êtres d'exception, les héros, c'est le fait de se trouver dans des situations qui obligent et somment en quelque sorte de faire face, sous le regard ou l'attention d'une multitude. Des situations pareilles se présentent à tout homme. Tout homme est donc capable d'excellence. Il suffit pour cela de le placer dans des conditions telles qu'il se sente obligé de se dépasser, de se surpasser. Tous les hommes sont des hommes exceptionnels en puissance. L’excellence n’est pas une faveur réservée à quelques hommes
Avez-vous bien lu le résumé? Répondez aux questions suivantes
1- Selon l'auteur, comment l'Africain perçoit-il le développement avant l'indépendance ?
A) Comme une quête de la liberté
B) Comme une prise de place du colon
C) Comme un processus économique
D) Comme un effort de travail pour tous
2- D'après l'auteur, quel est le véritable objectif du développement ?
A) Garantir le bonheur de tous
B) Créer une société d'abondance
C) Favoriser la liberté de l'homme
D) Atteindre une jouissance perpétuelle
3- Quel type d'homme le développement devrait-il encourager selon l'auteur ?
A) L'homme créatif
B) L'homme heureux
C) L'homme jouisseur
D) L'homme consommateur par essence
4- Pourquoi l'auteur rejette-t-il l'idée d'une société d'abondance ?
A) Parce qu'elle mène à une perte de liberté
B) Parce qu'elle produit des sous-hommes
C) Parce qu'elle favorise l'individualisme
D) Parce qu'elle est irréaliste
5- Quelle est la relation entre la liberté de l'homme et le bonheur, selon l'auteur ?
A) Le bonheur est une affaire collective
B) La liberté de l'homme garantit le bonheur de tous
C) Le bonheur est une conséquence de la liberté
D) Le développement vise principalement le bonheur collectif
6- Selon l'auteur, pourquoi les pays sous-développés sont-ils freinés dans leur développement ?
A) Parce qu'ils consomment trop de ressources
B) Parce qu'ils servent de transit pour les capitaux étrangers
C) Parce qu'ils sont incapables de produire localement
D) Parce qu'ils ne fixent pas eux-mêmes les prix de leurs matières premières
7- Quel est le principe que l'auteur juge nécessaire pour le développement véritable ?
A) La révolution militaire
B) La justice dans les relations économiques
C) L'indépendance économique
D) L'équité sociale
8- Comment l'auteur décrit-il la véritable révolution ?
A) Comme un changement militaire
B) Comme une recherche des conditions de développement
C) Comme une simple conquête du pouvoir
D) Comme un renversement de l'ordre colonial uniquement
9- Pourquoi l'auteur affirme-t-il que l'Etat doit être fort en Afrique ?
A) Pour assurer la survie des dirigeants
B) Pour imposer des arbitrages et maintenir l'ordre public
C) Pour sauvegarder les intérêts des élites
D) Pour promouvoir les révolutions militaires
10- Quel rôle l'intellectuel joue-t-il dans la révolution, selon l'auteur ?
A) Il est automatiquement révolutionnaire
B) Il doit identifier les intérêts en présence
C) Il n'a aucun rôle important
D) Il est un agent du capital international
11- Quelle est la véritable finalité du processus d’enrichissement selon l’auteur ?
A) L’accumulation de biens matériels
B) La réalisation de soi et l’auto-accomplissement
C) La diminution de la pauvreté
D) La satisfaction des besoins matériels
12- Pourquoi l’enrichissement pris comme une fin en soi peut-il mener à un appauvrissement ?
A) Parce qu’il conduit à une perte de biens
B) Parce qu’il génère de la frustration
C) Parce qu’il sacrifie l’être au profit de l’avoir
D) Parce qu’il cause l’isolement social
13- Quel est l’effet négatif de la possession de biens matériels selon l’auteur ?
A) Une perte de liberté
B) Une tranquillité accrue
C) Un développement personnel limité
D) Une crainte constante de perdre ces biens
14- Selon l’auteur, que représente la pauvreté pour l'homme ?
A) Une forme de liberté
B) Un obstacle à la liberté
C) Une source de bonheur
D) Un moyen de s’accomplir soi-même
15- Pourquoi la liberté totale suppose-t-elle celle des autres ?
A) Parce que la liberté individuelle est une illusion
B) Parce qu’il est impossible d'être libre en étant entouré d’individus non libres
C) Parce que la pauvreté des autres garantit la sécurité des riches
D) Parce que la liberté est une richesse matérielle
16- Quel est le principal défaut des dirigeants politiques et des économistes selon l’auteur ?
A) Ils n’étudient pas suffisamment les écarts de production entre les pays
B) Ils se concentrent uniquement sur la croissance économique
C) Ils oublient que l'homme individuel doit être au centre du développement
D) Ils ignorent les problèmes de pauvreté
17- En quoi le revenu par tête des habitants, utilisé pour mesurer le développement, est-il limité selon l’auteur ?
A) Il ne prend pas en compte les aspects culturels
B) Il cache l’individu du tiers-monde
C) Il ne reflète pas la répartition des richesses
D) Il ne mesure que la pauvreté extrême
18- Que risquent les hommes sous-développés qui suivent l'exemple des pays riches, selon l'auteur ?
A) De s’enrichir rapidement
B) De s’éloigner de leur propre culture
C) De travailler contre eux-mêmes à long terme
D) De devenir dépendants des biens matériels
19- Qu'est-ce qui peut garantir un avenir meilleur pour les pays sous-développés selon l’auteur ?
A) L’augmentation de la production nationale
B) L’implication directe de l’homme sous-développé dans le processus de développement
C) L'adoption des méthodes économiques des pays développés
D) La réduction de l'écart entre pays riches et pauvres
20- Quelle est l’une des causes principales du maintien de la pauvreté et de l’ignorance, selon l’auteur ?
A) L’échec des révolutions
B) L’absence d’éducation
C) L’indifférence des dirigeants politiques
D) Le manque de richesses matérielles
21- Quelle est la principale forme de misère qui affecte l’homme sous-développé selon l’auteur ?
A) La faim
B) La misère subjective
C) La misère objective
D) Le chômage
22- Quelle est la cause principale de la sous-alimentation à éliminer selon l’auteur ?
A) La réduction des capacités intellectuelles
B) La diminution des récoltes
C) L’incapacité à trouver un emploi
D) Le manque de solidarité familiale
23- Qu'est-ce qui empêche l’effort de bonheur selon l'auteur ?
A) Le manque d’éducation
B) La sous-alimentation
C) La pauvreté matérielle
D) Le chômage en ville
24- Pourquoi l’auteur affirme-t-il que l’homme sous-développé ne meurt pas de faim ?
A) Parce qu’il reçoit des aides internationales
B) Parce qu'il vit des fruits de ses champs
C) Parce qu'il vit en ville
D) Parce qu’il a toujours accès à l’eau
25- Qu’est-ce qui constitue la véritable misère dans les sociétés sous-développées ?
A) La pauvreté matérielle
B) L’ignorance, la superstition et l’analphabétisme
C) L’abondance de biens matériels
D) Le manque d’infrastructures
26- Quel exemple illustre la superstition dans les sociétés sous-développées ?
A) Le refus de construire des ponts
B) Le fait de piétiner un gris-gris
C) L’opposition à la construction de routes
D) Le rejet des conseils des médecins
27- Qu’est-ce que la « misère superstitieuse » selon l’auteur ?
A) Une misère liée à un manque de nourriture
B) Une misère consciente de ses limites
C) Une misère inconsciente de ses propres causes
D) Une misère due à l’absence de solidarité
28- Comment l’auteur décrit-il l'homme sous-développé par rapport à la nature ?
A) Comme un dominateur de la nature
B) Comme un être aliéné et soumis à la nature
C) Comme un créateur de son propre destin
D) Comme un être ayant appris à maîtriser les forces naturelles
29- Quelle est la perception du succès dans les sociétés sous-développées selon l’auteur ?
A) Le résultat de l’intelligence et de l’effort
B) Un signe de corruption
C) Le fruit de sacrifices occultes
D) Une récompense de la nature
30- Qu’est-ce que l’auteur considère comme une manifestation de la misère et du sous-développement ?
A) La pauvreté matérielle
B) Le manque de biens culturels
C) L’absence de liberté et de rationalité
D) Le manque de solidarité familiale
31- Quelle est la maladie qui affecte l’homme de l'Afrique sous-développée selon l’auteur ?
A) Une maladie physique
B) La dépersonnalisation
C) L’analphabétisme
D) La faim
32- Selon l’auteur, qu’est-ce qui a brisé le code culturel africain ?
A) La révolution technologique
B) La rencontre avec la civilisation occidentale
C) La migration urbaine
D) L’arrivée de la monnaie
33- Quel est le dilemme de l’Africain face à la religion selon l’auteur ?
A) Il doit choisir entre la religion chrétienne et les dieux traditionnels
B) Il croit en dieu et aux sorciers, mais pas en lui-même
C) Il refuse de porter des amulettes tout en croyant aux dieux protecteurs
D) Il a perdu foi en toute forme de religion
34- Quel conflit surgit entre l’individu et le clan dans la société sous-développée ?
A) L’individu veut protéger le clan
B) L’individu veut s’affirmer indépendamment du clan
C) Le clan veut que l’individu fasse fortune
D) Le clan soutient l'individualisme de l'individu
35- Pourquoi l’individu consulte-t-il encore les sorciers malgré son éducation ?
A) Par curiosité
B) Par peur de mourir et de briser les liens avec le clan
C) Pour impressionner ses amis
D) Parce qu’il ne croit pas en la science
36- Que représente le charlatan dans la société actuelle selon l’auteur ?
A) Un homme de science
B) Un guérisseur spirituel
C) Un être dédoublé qui profite de la crédulité des autres
D) Un homme aliéné par la modernité
37- Quelle est la crise que traverse l’homme critique ?
A) Une crise alimentaire
B) Une crise d’identité et de dépersonnalisation
C) Une crise politique
D) Une crise économique
38- Quelle attitude l’élite instruit de l'Afrique sous-développée adopte-t-elle face à la modernité ?
A) Elle rejette totalement les valeurs occidentales
B) Elle adopte une révolte molle contre les traditions et la modernité
C) Elle prône la révolution et agit en conséquence
D) Elle adopte un comportement radicalement opposé aux traditions
39- Comment l’auteur décrit-il l’attitude de l’homme instruit de retour d’Europe ?
A) Comme un modèle de transformation pour la société
B) Comme un homme transformé et prêt à lutter contre la corruption
C) Comme un homme déconnecté de la réalité locale et cynique
D) Comme un réformateur qui veut changer l’Afrique
40- Quelle est la solution proposée par l’auteur pour résoudre la crise de l'homme sous-développé ?
A) Donner à manger aux affamés
B) Apporter plus de biens matériels
C) Transformer l’homme et supprimer sa duplicité
D) Encourager l’émigration vers l’Europe
41- Comment l'auteur définit-il l'homme médiocre ?
A) Un homme qui rejette la société
B) Un homme qui suit aveuglément son milieu
C) Un homme qui se révolte contre les règles sociales
D) Un homme qui innove dans son milieu
42- Quelle est la cause principale de la médiocrité selon l'auteur ?
A) Le manque de ressources
B) L’instinct de conservation et de sécurité
C) L’absence de créativité
D) La rébellion contre l’autorité
43- Quelle conséquence entraîne le conformisme selon l’auteur ?
A) L'épanouissement personnel
B) L’anonymat et le manque d’originalité
C) L’accroissement de la créativité
D) L’isolement social
44- Que signifie l’instinct de conservation du milieu selon l’auteur ?
A) L'adaptation aux nouvelles situations
B) Le refus du changement et de la créativité
C) La révolte contre l’autorité
D) La protection de l’individualité
45- Quel comportement adopte l'homme médiocre face aux événements ?
A) Il agit avec détermination
B) Il est passif et se laisse guider par son entourage
C) Il s'oppose constamment au milieu
D) Il crée de nouvelles solutions aux problèmes
46- Quel rôle joue l’originalité pour l'homme médiocre selon l’auteur ?
A) Elle est encouragée par la société
B) Elle est vue comme une menace à sa sécurité
C) Elle est essentielle à sa survie
D) Elle est son principal objectif
47- Quelle est la caractéristique principale de la médiocrité selon l'auteur ?
A) Le génie créatif
B) Le conformisme et l'absence de jugement personnel
C) L'individualisme excentrique
D) La capacité à transformer les problèmes en solutions
48- Que signifie l'aliénation chez l'homme médiocre ?
A) Une révolte contre l’opinion majoritaire
B) Une soumission et une dépendance à l’opinion du grand nombre
C) Une recherche constante de l’originalité
D) Un rejet des valeurs de la société
49- Comment l'auteur décrit-il le rapport de l'homme médiocre avec l'avenir ?
A) L’homme médiocre est tourné vers l’avenir
B) Il est fermé à toute perspective d’avenir et à la créativité
C) Il tente constamment de créer quelque chose de nouveau
D) Il est obsédé par l’avenir
50- Quelle est la solution pour sortir de la médiocrité selon l’auteur ?
A) Suivre les modèles européens
B) Reconquérir une identité précise et se tourner vers la créativité
C) Maintenir un équilibre entre tradition et modernité
D) Se conformer aux attentes de la société
51- Comment l'auteur définit-il la modernité ?
A) Ce qui est simplement nouveau
B) Ce qui appartient au passé
C) Ce qui est récent et améliore la condition humaine
D) Ce qui est ancien mais toujours valable
52- Quelle est la relation entre tradition et modernité selon l’auteur ?
A) La tradition doit être abandonnée au profit de la modernité
B) La modernité se construit toujours à partir de la tradition
C) La modernité doit ignorer la tradition pour progresser
D) La tradition empêche la modernité de s’installer
53- Quel critère l’auteur propose-t-il pour juger la modernité ?
A) L'actualité
B) La satisfaction des désirs individuels
C) Le progrès humain et le perfectionnement
D) La conformité aux normes culturelles
54- Pourquoi la solidarité africaine est-elle considérée comme une valeur relative selon l’auteur ?
A) Elle est trop ancienne pour être encore utile
B) Elle est fondée sur l'égoïsme de groupe
C) Elle favorise uniquement les grandes nations
D) Elle repose sur des superstitions tribales
55- Quel est le principal problème de la solidarité tribale selon l’auteur ?
A) Elle freine l’épanouissement de l’individu
B) Elle favorise la division des nations africaines
C) Elle encourage l’oubli des traditions
D) Elle est en opposition avec la solidarité internationale
56- Que signifie le « solidarisme » familial selon l’auteur ?
A) Une extension de la solidarité basée uniquement sur les droits
B) Une solidarité totale où chacun a des droits et des devoirs
C) Une responsabilité limitée aux parents proches
D) Un affaiblissement des liens familiaux traditionnels
57- Selon l'auteur, pourquoi l'unité africaine est-elle un impératif majeur pour le développement ?
A) Parce que les clans et tribus ne sont plus pertinents
B) Parce que la solidarité nationale n'existe plus
C) Parce que l’unité africaine est une tradition ancienne
D) Parce que cela permet de revenir aux valeurs tribales
58- Que critique l’auteur dans le « modernisme superficiel » ?
A) Le rejet de la technologie moderne
B) L’adoption du nouveau simplement parce qu’il est actuel
C) Le retour aux traditions anciennes
D) L’incapacité à créer des solutions nouvelles
59- Pourquoi l’économie moderne dépasse-t-elle le cadre du clan et de la tribu ?
A) Parce que ces structures sont trop complexes
B) Parce qu'elles sont insuffisantes pour les exigences du développement
C) Parce qu’elles ne favorisent pas les relations interpersonnelles
D) Parce qu’elles ne respectent pas les valeurs africaines
60- Selon l’auteur, comment devrait-on sélectionner les valeurs traditionnelles africaines à conserver ?
A) En fonction de leur popularité dans le passé
B) En fonction de leur capacité à libérer l’homme de toute servitude
C) En fonction de leur pertinence pour les clans et tribus
D) En fonction de leur conformité aux coutumes coloniales
61- Selon l’auteur, comment se manifeste le parasitisme social dans la société moderne ?
A) En encourageant la productivité
B) En créant une dissymétrie entre les adaptés et les mal-adaptés
C) En favorisant l’indépendance économique
D) En aidant les mal-adaptés à devenir autonomes
62- Que propose l’auteur pour contrer le parasitisme social ?
A) Continuer de donner des aides aux chômeurs
B) Leur fournir du travail plutôt que des aumônes
C) Encourager les riches à subvenir aux besoins des non-riches
D) Favoriser l'entraide familiale à tout prix
63- Comment l’auteur décrit-il la notion de temps dans l’économie traditionnelle africaine ?
A) Comme une prévision à long terme
B) Comme une absence totale de planification
C) Comme une prévision à court terme
ID) Comme une utilisation mathématisée du temps
64- Quelle est la principale différence entre l’économie traditionnelle africaine et l’économie moderne concernant le temps ?
A) L’économie moderne utilise le temps de façon simple et flexible
B) L’économie traditionnelle n'avait pas de notion du temps
C) L’économie moderne morcelle et atomise le temps
D) L’économie traditionnelle produit pour vendre rapidement
65- Selon l’auteur, qu'est-ce qui détermine les représentations et conceptions que les hommes se font du temps ?
A) Leur culture ancestrale
B) Les conditions réelles de leur existence et leur activité
C) Leurs émotions naturelles
D) La philosophie européenne
66- Que pense l’auteur de l’affirmation de Senghor selon laquelle "la raison est hellène et l'émotion nègre" ?
A) Il la considère comme fondée
B) Il la considère comme simpliste et erronée
C) Il l'approuve en partie
D) Il la trouve pertinente pour certains aspects de la culture africaine
67- Comment l’auteur interprète-t-il le rapport du Négro-Africain au temps dans la société traditionnelle ?
A) Comme une source de stress et d'angoisse
B) Comme une forme de servitude au temps moderne
C) Comme une manière de préserver la liberté et la dignité de l’homme
D) Comme une façon d’accélérer la productivité économique
68- Quelle est la critique principale de l’auteur concernant la gestion du temps dans la modernité ?
A) Le manque de spontanéité dans l’utilisation du temps
B) L’absence de planification à long terme
C) La soumission au temps anonyme et conventionnel
D) L'incapacité à gérer plusieurs tâches en même temps
69- Selon l’auteur, pourquoi la manière traditionnelle de gérer le temps est-elle plus humaine ?
A) Parce qu’elle maximise la productivité
B) Parce qu’elle respecte la liberté et la dignité de l'homme
C) Parce qu’elle suit les normes imposées par la société moderne
D) Parce qu’elle impose des tâches rapides et urgentes
70- Que propose l’auteur comme référence principale pour guider la modernité et le développement ?
A) Le temps moderne
B) La productivité économique
C) L'humain comme valeur
D) Les traditions africaines
71- Selon l’auteur, quel est le besoin fondamental de l’homme ?
A) Le bien-être
B) La sécurité
C) La liberté
D) Le bonheur
72- Quelle est la distinction faite par l’auteur entre le « vivre biologique » et le « vivre humain » ?
A) Le vivre biologique est plus important que le vivre humain
B) Le vivre humain commence avec la recherche de qualité de l'existence
C) Le vivre biologique inclut la recherche de la qualité de l'existence
D) Le vivre humain concerne uniquement les besoins matériels
73- Quelle est la condition minimale du bien-être selon l’auteur ?
A) Le bien-se-faire
B) La liberté
C) Le bien-avoir
D) La sécurité
74- Comment l’auteur définit-il le « bien-se-faire » ?
A) Comme la recherche du repos et du confort
B) Comme l’acquisition d’objets et de biens
C) Comme un dynamisme créateur permettant à l’homme de se dépasser
D) Comme la satisfaction des besoins vitaux
75- Quel est le danger associé à la technique, selon l’auteur ?
A) Elle libère l'homme de toute contrainte
B) Elle conduit à l'aliénation de l'homme
C) Elle permet à l'homme de s'accomplir
D) Elle favorise le bonheur humain
76- Quel contrepoids à la technique l’auteur propose-t-il pour sauver la liberté humaine ?
A) L’accumulation des biens matériels
B) L'art et la créativité
C) Le repos et la contemplation
D) La recherche de la sécurité
77- Selon l’auteur, qu’est-ce qui différencie le bien-être du bonheur ?
A) Le bien-être est immédiat, le bonheur est éternel
B) Le bien-être se trouve dans la sécurité, le bonheur dans l’inconfort
C) Le bien-être est une étape, le bonheur une plénitude finale
D) Le bien-être concerne l’accumulation de biens, le bonheur concerne la contemplation
78- Pourquoi l’auteur considère-t-il que la recherche du bonheur comme une fin est vouée à l’échec ?
A) Parce que le bonheur est inséparable des plaisirs fugaces
B) Parce que la vie humaine est régie par l’immobilité
C) Parce que la recherche du bonheur ne conduit qu'à la satisfaction matérielle
D) Parce que le bonheur se trouve dans la suppression de tout effort
79- Que symbolise la route sinueuse dans l’analogie de l’auteur ?
A) Le confort et la stabilité
B) L'éveil et la lutte contre la monotonie
C) Le repos et la tranquillité
D) L’aspiration au bonheur parfait
80- Quel est le véritable objectif des populations sous-développées, selon l’auteur ?
A) Le bonheur
B) La plénitude
C) Le bien-être
D) La liberté absolue
81- Quelle est la principale différence entre la liberté-chose et la liberté-production ?
A) La liberté-chose est une liberté négative, tandis que la liberté-production est une liberté positive.
B) La liberté-chose est acquise une fois pour toutes, tandis que la liberté-production est dynamique.
C) La liberté-chose concerne l'absence de contraintes, tandis que la liberté-production concerne la suppression des entraves.
D) La liberté-chose est un luxe, tandis que la liberté-production est essentielle.
82- Selon l’auteur, pourquoi la liberté ne peut-elle pas être considérée comme un luxe ?
A) Parce qu'elle est un bien inaccessible
B) Parce qu'elle ne peut être acquise définitivement
C) Parce qu'elle est une récompense pour les actions réussies
D) Parce qu'elle est une propriété des élites
83- Quels sont les deux aspects fondamentaux de la liberté, selon le texte ?
A) La richesse et le pouvoir
B) Le détachement et l'activité de transformation
C) L'égalité et la justice
D) L'absence de contraintes et la satisfaction des désirs
84- Quelle est la première manière par laquelle le détachement se réalise ?
A) Par la souffrance individuelle
B) Par la révélation des mécanismes d'aliénation
C) Par l'intervention d'éclaireurs
D) Par l’évasion dans la culture étrangère
85- Quelle est la fonction du philosophe dans le contexte de la liberté ?
A) Être un orateur charismatique
B) Révéler des visions mystiques
C) Analyser et confronter le réel avec l’idéal
D) Apporter des solutions pratiques immédiates
86- Quelles sont les deux formes de manifestation de la liberté mentionnées dans le texte ?
A) La négation et la construction du nouveau
B) La révolte et l’acquisition de richesses
C) Le confort et l'innovation
D) La contestation et la contemplation
87- Pourquoi le savoir seul n'est-il pas suffisant pour la libération, selon l’auteur ?
A) Parce qu'il est théorique et ne conduit pas à l'action
B) Parce qu'il est limité aux idées abstraites
C) Parce qu'il est insuffisant pour le développement économique
D) Parce qu'il ne prend pas en compte les émotions
88- Selon le texte, comment se manifeste la liberté dans l’action de transformation ?
A) En détruisant des objets matériels
B) En se libérant d’un corps étranger handicapant
C) En appliquant des connaissances théoriques
D) En abandonnant les habitudes anciennes
89- Quel est le rôle du dialecticien moderne en Afrique, selon le texte ?
A) Enseigner des pratiques religieuses traditionnelles
B) Révéler la vérité et aider à sortir de l’obscurantisme
C) Accumuler des richesses matérielles
D) Promouvoir les idéologies politiques étrangères
90- Quel est le lien entre liberté et création, selon l’auteur ?
A) La liberté est le résultat de la création artistique
B) La création est un moyen de se libérer des contraintes
C) La liberté ne peut exister sans création
D) La création est une forme de liberté acquise
91- Selon le texte, quel est le lien entre la liberté et le pouvoir de décision ?
A) La liberté est un programme à réaliser avec des décisions claires.
B) La liberté est un concept abstrait sans relation avec le pouvoir de décision.
C) La liberté est effective uniquement lorsqu'elle est associée à un pouvoir de décision réel.
D) La liberté est indépendante du pouvoir d'action et de décision.
92- Quelle est la principale fonction de la liberté, d'après l'auteur ?
A) Réaliser des programmes prédéterminés
B) Permettre la réalisation d'autres programmes
C) Acquérir des biens matériels
D) Maintenir l'ordre social
93- Comment la liberté se manifeste-t-elle selon le texte ?
A) Par des actes de libération quotidiens
B) Par des déclarations publiques
C) Par l'accumulation de richesse
D) Par la passivité et l'inaction
94- Quelle est la vision de la liberté par rapport à l'esclavage dans le texte ?
A) La liberté est toujours inaccessible pour les esclaves.
B) Certains individus peuvent se croire libres tout en étant des esclaves ignorants.
C) L'esclavage et la liberté sont des concepts incompatibles.
D) L'esclavage est un état naturel que la liberté ne peut pas contrer.
95- Selon le texte, comment peut-on éviter que le développement ne devienne un facteur d'aliénation ?
A) En concentrant les ressources économiques
B) En rendant la liberté plus aristocratique
C) En orientant le développement pour le rendre moins aristocratique et plus démocratique
D) En favorisant des changements rapides et radicaux
96- Quels sont les degrés de liberté mentionnés dans le texte ?
A) La liberté absolue et la liberté relative
B) La liberté économique et la liberté politique
C) La liberté totale et la liberté partielle
D) La liberté dans les pays développés et la liberté dans les pays sous-développés
97- Quelle est la nature de la liberté, selon l’auteur ?
A) Une possession acquise une fois pour toutes
B) Une qualité statique qui ne nécessite pas d’efforts
C) Un effort permanent pour se hisser au-dessus de soi-même et de la nature
D) Une simple absence de contraintes
98- Selon le texte, pourquoi l’humanité de l’homme repose-t-elle sur l’harmonie entre matérialité et spiritualité ?
A) Parce que la matérialité est secondaire par rapport à la spiritualité.
B) Parce que la spiritualité compense les carences de la matérialité.
C) Parce que l’harmonie entre ces deux aspects est essentielle pour éviter l’aliénation.
D) Parce que la matérialité est l’unique moyen d’atteindre la spiritualité.
99- Quelle critique le texte adresse-t-il à la religion en tant que moyen de libération ?
A) La religion offre des solutions concrètes aux problèmes de l'existence.
B) La religion aliene l’homme en le dépossédant de son pouvoir et de sa responsabilité.
C) La religion permet de résoudre efficacement les problèmes quotidiens.
D) La religion est une source de créativité et d'initiative.
100- Comment l'art est-il présenté dans le texte par rapport à la religion et à la technique ?
A) L'art est une technique de transformation utilitaire du monde.
B) L'art est une source supplémentaire d'aliénation.
C) L'art est un moyen de libération et restitue l'initiative créatrice.
D) L'art est une simple activité sans impact sur l'aliénation.
101- Quelle est la vision du texte concernant l’art et sa relation avec la matérialité ?
A) L'art est déconnecté de la matérialité et n’a pas besoin de s'incarner dans le monde.
B) L'art nécessite une collaboration avec la matérialité pour exprimer la spiritualité.
C) L'art est principalement une activité intellectuelle sans lien avec la matérialité.
D) L'art ne doit pas s'intéresser aux réalités matérielles du monde.
102- Quelle est la critique principale du texte à l’égard des valeurs culturelles traditionnelles ?
A) Les valeurs traditionnelles sont toujours pertinentes et éternelles.
B) Les valeurs traditionnelles sont obsolètes et doivent être abandonnées.
C) Les valeurs traditionnelles peuvent devenir des valeurs de musée si elles ne s’incarnent pas dans la vie quotidienne.
D) Les valeurs traditionnelles sont suffisantes pour garantir le progrès culturel.
103- Selon le texte, quel est le rôle essentiel du développement pour l’individu ?
A) Assurer une conformité à la culture traditionnelle.
B) Briser le cercle de l'autorépétition aliénatrice.
C) Maintenir l'individu dans une position statique et conservatrice.
D) Garantir une augmentation des richesses matérielles uniquement.
104- Quelle est la relation entre l'éducation scientifique et artistique dans le développement de l'individu ?
A) L'éducation scientifique est suffisante pour un épanouissement complet.
B) L'éducation artistique doit être évitée pour se concentrer sur la science.
C) Une formation équilibrée entre science et art est nécessaire pour éviter l’aliénation.
D) L’éducation artistique est secondaire par rapport à la formation scientifique.
105- Quelle est la caractéristique principale de l'homme qui excelle selon le texte ?
A) La conformité aux attentes sociales
B) Le positionnement supérieur à la médiocrité et la capacité de sortir de cette condition
C) L'acceptation des forces extérieures sans résistance
D) La soumission aux normes établies
106- Comment l'excellence se distingue-t-elle de la révolte selon le texte ?
A) La révolte est une preuve suffisante de liberté, tandis que l'excellence ne l'est pas.
B) L'excellence est une construction créative et affirmative, tandis que la révolte est une destruction.
C) La révolte est la manifestation ultime de l'excellence.
D) L'excellence se concentre uniquement sur la destruction des valeurs existantes.
107- Quelle est la relation entre l'excellence et la responsabilité selon le texte ?
A) La responsabilité n’est pas nécessaire pour atteindre l’excellence.
B) L’excellence implique une responsabilité envers l’humanité et une volonté générale.
C) L’excellence se limite à des accomplissements personnels sans impact social.
D) La responsabilité est un obstacle à l’excellence.
108- Quel est le rôle du savoir dans la création selon le texte ?
A) Le savoir n’a aucune importance dans le processus créatif.
B) L’homme excellent doit créer dans l’ignorance pour préserver l'authenticité.
C) La création de l’homme excellent s’appuie sur un savoir intuitif et non sur une ignorance.
D) Le savoir uniquement intellectuel est suffisant pour la création.
109- Comment l'éducation devrait-elle être conçue pour favoriser l'excellence, selon le texte ?
A) En se concentrant exclusivement sur des matières scientifiques et techniques.
B) En offrant un milieu stimulant qui développe le sens critique, la responsabilité, la création esthétique, et l'amour de la liberté.
C) En suivant une éducation traditionnelle maître-élève sans innovation.
D) En favorisant une approche strictement théorique des arts et des sciences.
110- Quel est le paradoxe concernant la perception de l’héroïsme et de l’excellence dans la vie quotidienne ?
A) Seules les actions spectaculaires sont reconnues comme héroïques, tandis que les actes quotidiens passent inaperçus.
B) Tous les actes d’excellence doivent être grandioses pour être valorisés.
C) L’héroïsme quotidien est souvent récompensé plus que les actes spectaculaires.
D) L’excellence est uniquement reconnue dans des contextes médiatiques.
111- Selon le texte, quel est le potentiel de tous les hommes en termes d'excellence ?
A) Seuls quelques individus sont capables d’atteindre l’excellence.
B) Tous les hommes sont potentiellement exceptionnels et capables d’excellence si les conditions sont favorables.
C) L'excellence est une caractéristique innée qui ne peut être développée.
D) L'excellence est réservée aux individus qui ont déjà une position sociale élevée.
Réponses des QCM
1- B
2- C
3- A
4- B
5- C
6- B
7- B
8- B
9- B
10- B
11- B
12- C
13- D
14- B
15- B
16- C
17- B
18- C
19- B
20- C
21- C
22- A
23- B
24- B
25- B
26- C
27- C
28- B
29- C
30- C
31- B
32- B
33- B
34- B
35- B
36- C
37- B
38- B
39- C
40- C
41- B
42- B
43- B
44- B
45- B
46- B
47- B
48- B
49- B
50- B
51- C
52- B
53- C
54- B
55- A
56- A
57- A
58- B
59- B
60- B
61- B
62- B
63- C
64- C
65- B
66- B
67- C
68- C
69- B
70- C
71- B
72- B
73- C
74- C
75- B
76- B
77- C
78- A
79- B
80- C
81- C
82- B
83- B
84- B
85- C
86- A
87- A
88- A
89- B
90- C
91- C
92- B
93- A
94- B
95- C
96- D
97- C
98- C
99- B
100- C
101- B
102- C
103- B
104- C
105- B
106- B
107- B
108- C
109- B
110- A
111- B