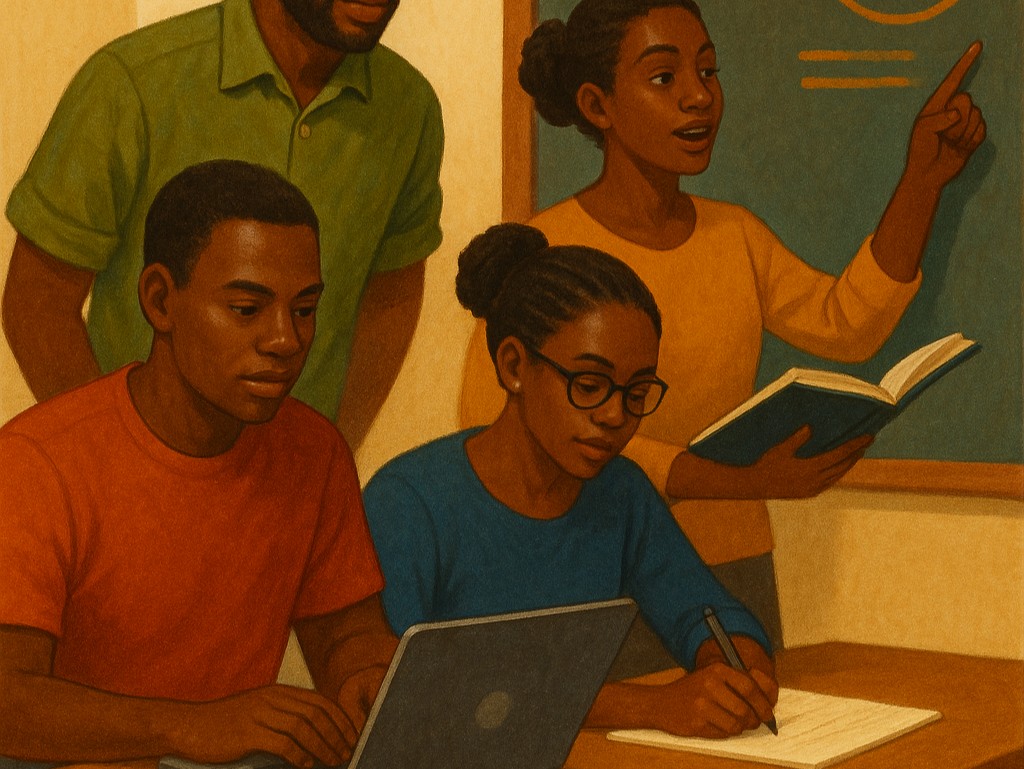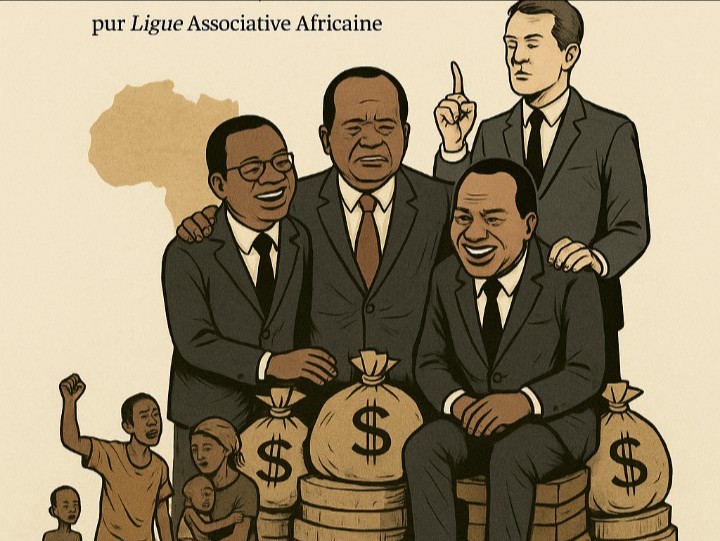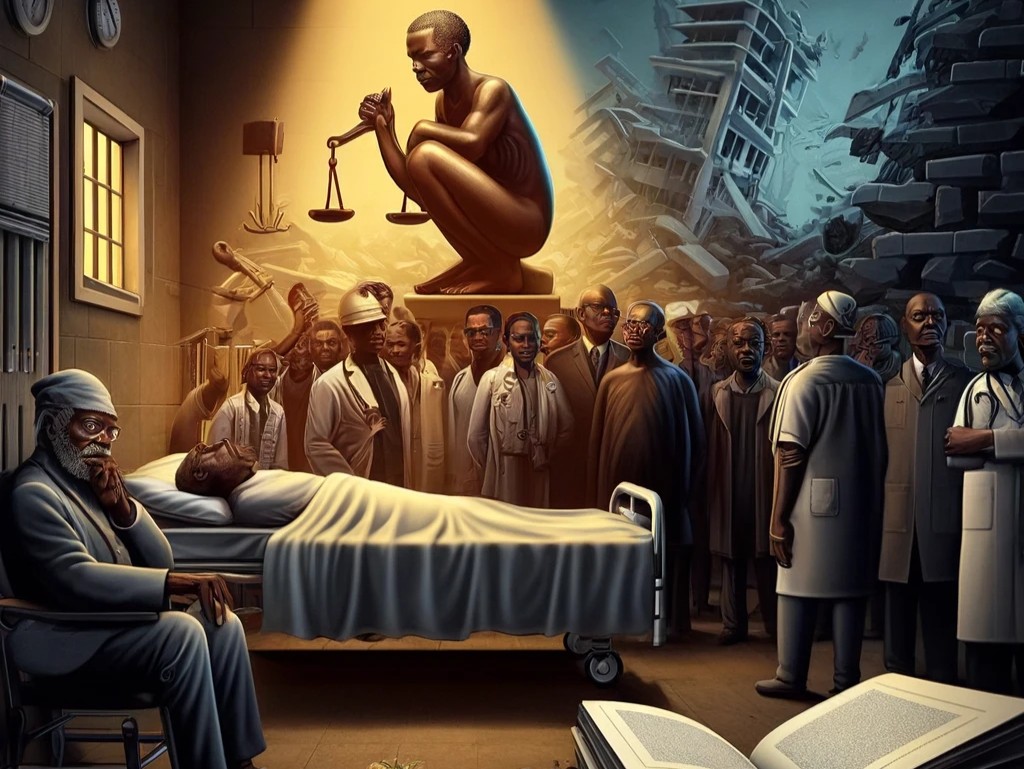Quelques textes contenus dans ville cruelle
Texte 1 :
Personne n’a jamais été misérable comme la pauvre fille que je suis. Penses-y toi-même, Banda. Les femmes me raillent dans leurs chansons à longueur de journée. Les vieillards me regardent avec compassion. Quand je passe près d’eux, les jeunes gens se détournent à peine. Les enfants pouffent de rire sur mon dos. Pourtant, je ne t’en veux pas. Mais j’ai besoin de savoir pourquoi tu m’as fait ça. Banda, pourquoi n’as-tu pas voulu de moi ? Je te demande seulement de m’expliquer...
À ces propos qu’il attendait et craignait, Banda, lentement, leva sur son amie des yeux remplis de mélancolie ; il la dévisagea avec un mélange de dépit et de pitié. Il était visiblement très perplexe. Toute sa physionomie, sa bouche particulièrement, exprimait le dégoût des âmes généreuses, enclines à la rêverie, devant les nécessités de la vie. Il détourna aussi lentement son regard qu’il l’avait levé, enfouit sa tête dans l’oreiller jaunâtre et sale, comme à la recherche d’un confident. Il restait allongé sur le lit, parmi les draps d’une blancheur indécise. Son corps long et maigre évoquait ces gigantesques serpents tout noirs que les femmes rencontrent parfois, se prélassant dans leur champ, en proie à une pénible digestion.
Dans la brousse proche, quelques perdrix attardées se répondaient encore de loin en loin. Par le toit et par les rainures de la porte, pénétrait un matin clair, bruyant et turbulent.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 2 :
D’une voix ténue, grelottante, mais décidée, elle avait repris son interrogatoire.
- Dis-moi, pourquoi as-tu refusé de m’épouser ? Comment as-tu pu préférer cette petite gosse qui ne saura jamais préparer un repas ? Alors qu’avec moi... d’abord tu n’aurais rien payé...
- Tu m’embêtes ! Éclata soudain Banda.
C’était un cri de désespoir plutôt que de colère.
Elle était assise sur l’extrême bord du lit. Curieuse et inquiète, elle considérait ce grand garçon, cet homme qui tout à coup lui apparaissait sous un jour si nouveau. Les mâles étaient donc aussi cruels, aussi insensibles les uns que les autres ? Il y eut un silence lourd et ému. Et puis, Banda parla :
- Non, mais qu’est-ce que tu t’imagines ? Que je dois t’épouser parce que tu me nourris de bœuf - je me demande d’ailleurs comment tu te le procures, mais je préfère ne pas le savoir- et parce que tu me fais dormir dans tes draps ? Un petit marché, si je comprends bien. Pourquoi ne pas me l’avoir dit le premier jour ?
Il se tut brusquement et soupira. Peut-être regrettait-il déjà d’avoir proféré ces mots, d’être allé si loin. Peut-être aussi était-il soulagé, comprenant soudain qu’il venait de consommer leur rupture et pensant que c’était aussi bien un souci de moins. Le silence fut interrompu par sa voix à elle, toujours aussi chevrotante, toujours aussi obstinée.
- Je ne te demande plus de m’épouser, dit-elle ; seulement explique-moi pourquoi tu m’abandonnes ainsi. Comment as-tu oublié tout le temps que nous avons vécu ensemble, toutes les choses que tu me disais et que j’étais belle et que j’étais la seule femme au monde avec laquelle tu te plaises vraiment ? Est-ce que j’ai fait quelque chose qui t’a dégoûté de moi ? Est-ce que... explique-moi, j’ai besoin de comprendre...
Banda se taisait. Au bout d’un petit moment, il lâcha imprudemment et avec colère :
- Ma mère !
- Quoi, ta mère ?
- Parfaitement, ma mère. Elle craignait que tu ne sois devenue stérile. Tu avais couché avec tant d’hommes... paraît-il.
Il évitait son regard qu’il sentait lui fouetter le visage.
- Banda, murmura-t-elle tout bas, en plissant la bouche, tu devrais avoir honte ! Ta mère a dit ça et tu l’as écoutée complaisamment. Resteras-tu donc toujours enfant ?
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 3 :
- J’aime ma mère. Aïe ! Je l’aime comme tu ne peux pas savoir. As-tu jamais aimé quelqu’un, toi? À la mort de mon père, j’étais âgé de quelques années seulement. Ma mère entreprit donc de m’élever. Elle y a apporté une sollicitude extrême. Elle a fait tout, m’entends-tu ? Tout ce qu’elle croyait devoir faire pour mon bien. Elle me gavait de nourriture, de bonne nourriture. Elle m’administrait un lavement toutes les semaines. Chaque soir, elle me plongeait dans une énorme marmite pleine d’eau tiède et me frottait longuement tout le corps. Trois fois par semaine, elle m’envoyait écouter les leçons du catéchiste... J’étais mieux habillé que les gosses de mon âge qui avaient leur père. Nous dormions sur des lits de bambou des deux côtés du feu que ma mère ne cessait d’attiser la nuit tandis qu’elle me racontait des fables ou me parlait de mon père, de son enfance à elle, du pays où elle était née, de ma grand-mère morte peu avant ma naissance... Certaines nuits, nous entendions hululer un hibou ou hurler un chimpanzé : je me faisais tout petit dans mon lit et ma mère en riant me disait : “N’aie donc pas peur, fils ; il ne viendra tout de même pas te chercher là, devant moi...” D’autres nuits, la pluie crépitait sur le toit, tandis que de violentes rafales balayaient la cour, agitaient les arbres là-bas derrière le village ; alors, ma mère me disait : “Mon Dieu ! écoute les mangues tomber. Un qui va être content demain, c’est toi. Pas vrai ?...” Oh ! elle me corrigeait souvent et sans ménagement. Mais le souvenir même de ces punitions me la rend encore plus chère.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 4 :
Représentez-vous, au milieu de la clairière, une haute colline flanquée d’autres collines plus petites. Sur les deux versants opposés de cette colline, se situaient les deux Tanga. Le Tanga commerçant et administratif - Tanga des autres, Tanga étranger - occupait le versant sud, étroit et abrupt, séparé de la forêt toute proche par un fleuve qui roulait des eaux noires et profondes et qu’enjambait déjà un pont de ciment armé. Ce fleuve était une des curiosités de Tanga, une espèce de cirque permanent. L’on n’avait qu’à s’accouder au parapet du pont et à attendre. Bientôt une case-pirogue débouchait en amont. Elle glissait doucement sur l’eau. Deux hommes, accrochés l’un à la poupe, l’autre à la proue, soulevaient chacun une longue, très longue perche ; tour à tour ils la plongeaient dans l’eau jusqu’à ce qu’elle touche le fond. Alors, ils appuyaient de toutes leurs forces et poussaient l’embarcation. À l’intérieur, des sacs pleins et ronds s’entassaient contre les parois de bambou, une femme accroupie sur le plancher lavait des hardes à côté du foyer qui fumait. Les gens, massés sur le pont de ciment armé ne se lassaient pas du spectacle de ces longues cases montées sur deux ou trois pirogues jumelées et qui avaient parcouru des centaines de kilomètres. Elles venaient s’échouer lourdement sur le sable et se rangeaient, l’une à côté de l’autre.
C’étaient aussi d’énormes billes de bois attachées en radeaux. Ils venaient de loin aussi ces radeaux. Des hommes les montaient, généralement nus, superbement indifférents aux huées qui descendaient du pont. Ils manœuvraient sans hâte, allaient amarrer leurs radeaux en contrebas du quai à billes. Alors s’ébranlait une des deux grues qui stationnaient sur le quai. Chuintant et branlant, roulant sur deux rails, elle s’avançait vers le fleuve. Et puis elle s’arrêtait, elle se penchait dangereusement sur l’eau ; ensuite elle se redressait tenant triomphalement une longue bille accrochée à ses deux dents. Elle se retournait et s’en allait. C’était un vrai monstre. Pour un objet qui se déplace tout seul, il était difficile de rien imaginer de plus laid.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 5 :
La circulation, abondante à Tanga, lui donnait une allure dramatique très prononcée. Il ne se passait pas de jour qu’un homme ne fût écrasé par une automobile ou qu’on n’assistât à une collision spectaculaire de camions. Il semblait justement qu’il y eût trop de camions à Tanga. Peut-être était-ce uniquement parce qu’il y en avait du monde entier : chaque usine avait envoyé au moins un échantillon la représenter dans la ville. On en voyait de longs et osseux comme la carcasse d’un animal préhistorique ; certains étaient gigantesques et massifs, faisaient un bruit à vous rendre fou ; d’autres étaient petits, trapus, ramassés. Ils arrivaient du nord ou du sud, de l’est ou de l’ouest, à une vitesse folle. Sans ralentir, ils pénétraient dans la ville, laissant un nuage de poussière triomphal flotter derrière eux, ou éclaboussaient hommes et choses de boue et de latérite rouge : les rues de Tanga n’étaient pas bitumées à l’époque.
Le Tanga commercial se terminait au sommet de la colline par un pâté de bâtiments administratifs, trop blancs, trop indiscrets. Ils flamboyaient au soleil. Leur vue laissait, on ne sait pourquoi, un irréductible sentiment de désolation.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 6 :
L’autre Tanga, le Tanga sans spécialité, le Tanga auquel les bâtiments administratifs tournaient le dos - par une erreur d’appréciation probablement - le Tanga indigène, le Tanga des cases, occupait le versant nord peu incliné, étendu en éventail. Ce Tanga se subdivisait en innombrables petits quartiers qui, tous, portaient un nom évocateur. Une série de bas-fonds, en réalité ! Les mêmes cases que l’on pouvait voir dans la forêt tout au long des routes, mais ici plus basses, plus chiches, plus ratatinées, étant bâties en matériaux de la forêt qui se raréfiaient à mesure qu’on approchait de la ville.
Deux Tanga... deux mondes... deux destins !
Ces deux Tanga attiraient également l’indigène. Le jour, le Tanga du versant sud, Tanga commercial, Tanga de l’argent et du travail lucratif, vidait l’autre Tanga de sa substance humaine. Les Noirs remplissaient le Tanga des autres, où ils s’acquittaient de leurs fonctions. Manœuvres, petits commerçants, cuisiniers, boys, marmitons, prostituées, fonctionnaires, subalternes, rabatteurs, escrocs, oisifs, main-d’œuvre pénale, les rues en fourmillaient. Chaque matin, les paysans de la forêt proche venaient grossir leurs rangs, soit qu’ils fussent simplement en quête de plus vastes horizons, soit qu’ils vinssent écouler le produit de leur travail ; il s’était constitué parmi cette population une mentalité spécifique, si contagieuse que les hommes qui venaient périodiquement de la forêt en restaient contaminés aussi longtemps qu’ils séjournaient à Tanga. Comme les gens de la forêt éloignée qui conservaient leur authenticité, les habitants de Tanga étaient veules, vains, trop gais, trop sensibles. Mais en plus, il y avait quelque chose d’original en eux maintenant : un certain penchant pour le calcul mesquin, pour la nervosité, l’alcoolisme et tout ce qui excite le mépris de la vie humaine - comme dans tous les pays où se disputent de grands intérêts matériels. C’était la ville de chez nous qui détenait le record des meurtres... et des suicides ! On y tuait, on s’y tuait pour tout, pour un rien et même pour une femme. Des Grecs y avaient laissé leur peau à cause de leur promptitude à peloter une femme pour peu qu’elle fût jolie et qu’elle pénétrât dans leur boutique. Le mari faisait irruption un jour chez le commerçant avec un mauvais fusil de chasse ou à défaut, une machette, et vous expédiait proprement dans l’autre monde. Leur amour pour la bagarre et le sang croissait au fil des jours. Quand ils en avaient assez de se colleter entre eux, ils s’en prenaient aux commerçants étrangers en nombre pléthorique ici. Ils avaient très vite flairé la sorte d’impunité qu’ils rencontreraient dans ce petit jeu dont il n’était personne qui ne connût les règles et les tours. Le mieux c’était de ne pas avoir affaire avec un colon français. Mais si cela vous arrivait, vous saviez à quoi vous en tenir - au fond, n’est-ce pas l’essentiel ? Par vantardise, certains acceptaient le risque. La police alors leur tombait aussitôt dessus et l’on n’en parlait plus, à moins que l’on en parlât encore des dizaines d’années après. Quant aux membres civils de la hiérarchie supérieure de l’administration coloniale, il semblait qu’on les payât pour briller par leur abstentionnisme.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 7 :
Les rues de ce Tanga n’avaient pas de réverbères, cela va sans dire. Les mauvais garçons, nombreux ici, en avaient profité pour, la nuit, convertir la chaussée en lieu de règlements de comptes. Cela expliquait que l’obscurité retentît sans cesse de piétinements sourds, de poursuites frénétiques, de gifles dont la sonorité ne le cédait en rien à celle d’un browning. Ces séances de brutalité, à cause du phénomène de l’accoutumance, en étaient venues à ne plus intéresser que les professionnels, la population des cases y étant totalement indifférente ; elles pouvaient durer un temps inimaginable pour un étranger, à cause de la carence nocturne de la police, commandée par des préceptes de prudence et d’économie très compréhensibles.
Combien d’âmes abritait Tanga-Nord ? Soixante, quatre-vingts, cent mille, comment savoir exactement ? Aucun recensement n’avait jamais été fait. Sans compter que cette population était en proie à une instabilité certainement unique. Les hommes quittaient la forêt pour des raisons sentimentales ou pécuniaires, très souvent aussi par goût du nouveau. Ils séjournaient ici quelque temps, à l’essai. Certains, assez peu nombreux, trouvaient impensable que l’on danse dans une case, alors que dans la case voisine on pleurait un mort dont le cadavre n’avait même pas encore été mis sous terre : écœurés, ils s’en retournaient tout simplement dans leur village, où ils parleraient de la ville avec tristesse, en se demandant où allait le monde. D’autres, convaincus à force de railleries qu’ils s’habitueraient rapidement à des mœurs aussi insolites - simple question de temps - décidaient de se fixer définitivement. Ils faisaient ensuite venir femmes et enfants, ou, s’ils étaient jeunes et célibataires, frères, sœurs, cadets, pour conserver à côté d’eux, comme un vivant et constant souvenir du village natal, qu’ils ne reverraient peut-être plus. Généralement ils y pensaient d’abord à leur village natal ; et puis, peu à peu, les années passant, ils l’oubliaient, accaparés entièrement par des préoccupations d’un tout autre genre. Il en était qui ne pouvaient réaliser ici leurs ambitions sociales : ils s’en allaient goûter à une autre ville.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 8 :
Mais qu’on ne procédât à aucun recensement, cette instabilité même ne pouvait le justifier, puisque l’Administration l’ignorait, de même qu’elle ignorait tout ce qui concernait cette demi-humanité, ses joies, ses souffrances, ses aspirations qui, certes, l’eussent déroutée, mais qu’elle n’avait jamais cherché à deviner et encore moins à comprendre, à s’expliquer. Quand elle voulait bien s’occuper de ces gens-là, deux catégories se trouvaient l’intéresser particulièrement. Ceux qui, ayant réussi à se faufiler à travers d’innombrables barrières, avaient accompli une manière d’ascension sociale et dont le Fisc s’avisait soudain qu’ils pourraient aussi bien lui payer un modique tribut, tant qu’à faire. Ceux qui, de loin ou de près, consciemment ou inconsciemment, par leurs propos ou par leurs actes représentaient une menace pour un certain état de choses, conforme à une certaine vision du monde, jugé nécessaire pour certaines raisons, ou plus exactement pour certains besoins : ce n’était pas bien difficile ; on les mettait en pension quelque part et tout était entendu pour la plus grande gloire de l’humanité.
Tanga, Tanga-Nord, je veux dire, était un authentique enfant de l’Afrique. À peine né, il s’était trouvé tout seul dans la nature. Il grandissait et se formait trop rapidement. Il s’orientait et se formait trop au hasard, comme les enfants abandonnés à eux-mêmes. Comme eux, il ne se posait pas de questions, quoiqu’il se sentît dérouté. Nul ne pouvait dire avec certitude ce qu’il deviendrait, pas même les géographes, ni les journalistes, et encore moins les explorateurs.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 9 :
- Prends garde, Koumé, prévint-elle. Tu n’as jamais été prudent, toi. Tu t’imagines que tu t’en tireras toujours, pas vrai ? Comme précédemment. Mais moi, je crois que ce n’est pas certain... Fais attention ! Ton Monsieur T... il est bien avec le commissaire de police...
- Oui, je sais. Et moi, je suis très bien avec mes copains, ne l’oublie jamais.
Il s’était levé. Il mit son vieux chapeau qui le rendait impersonnel, semblable à des millions de ses compatriotes.
- Ma petite Odilia, sache bien ceci : nous avons le nombre et le droit...
- D’autres les ont eus avant vous ; est-ce que tu as des yeux pour ne pas voir ?
- D’autres les ont eus avant nous, ça c’est exact ; mais ils les ont mal utilisés.
Il plaisantait. Il aimait à plaisanter sa « gosse de sœur » comme il disait. Il souriait, très décontracté. On n’eût jamais dit que son esprit roulait de sombres projets.
- Est-ce que vous projetez de le brutaliser ?
Pris à l’improviste, il se retourna brusquement, tremblant des lèvres, hagard, surpris comme un boxeur qui a reçu un coup bas. Il hésitait à répondre.
- Non, proféra-t-il enfin, sans trop de conviction.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 10 :
Malgré la précipitation des contrôleurs, les queues ne faisaient rien que s’allonger. Il se produisait plus d’une bousculade toutes les minutes : elle partait de l’avant ou de l’arrière et parcourait lentement la file comme une onde. Il n’était pas rare qu’un jeune homme, mécontent de se trouver à la fin de la queue, vînt se faire une place plus avant, au coup de poing généralement. Si ses adversaires estimaient qu’ils étaient dans leur bon droit, et s’ils se tenaient les coudes, la dispute se terminait à leur avantage. À moins que n’intervinssent les gardes régionaux : alors le cacao du délinquant était tout simplement confisqué. Malgré cette sévérité dans les sanctions, les jeunes gens venaient souvent de l’arrière : avec des regards d’aigles ils cherchaient un point faible dans la queue ; quand ils en avaient détecté un, ils s’y fourraient brusquement et posaient leur charge entre leurs jambes. Cette manie de la conquête leur réussissait de plus en plus. Il vint un moment où ils ne rencontrèrent plus de résistance : leur opiniâtreté à renouveler leurs assauts avait fini par décourager tout le monde. Les gardes régionaux, débordés, furent réduits au rôle peu brillant de spectateurs impuissants, tout en se promettant de sévir quand ils le pourraient. Lorsque revint le calme, tous les jeunes gens avaient conquis des places plus avancées, à la pointe de leurs poings.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 11 :
Jusque-là, la qualité du cacao avait été une affaire entre le producteur indigène et l’acheteur grec. L’Administration s’était tenue à l’écart, pour le bonheur de tous. Mais un jour, elle s’était sentie en veine de se mêler de tout. Les gens avisés auraient bien pu la voir venir. Tout avait commencé par une équipe de parasites qui se répandaient sur le pays, telle une volée de sauterelles. Ils surgissaient dans le village et vous démontraient que vos plantations étaient mal tenues, vos cacaoyers mal plantés, trop serrés, vos plants mal sélectionnés, qu’ils allaient vous apprendre comment faire pour étendre vos plantations, pour avoir un meilleur rendement, etc. Après quoi, ils vous faisaient trimer des semaines durant à abattre inutilement vos propres cacaoyers, à les compter et recompter, à déraciner les arbustes et les arbrisseaux, à transporter du bois mort. Le mieux, évidemment, c’était de ne pas regimber, ça vous aurait apporté des ennuis : ils ne rigolaient pas quand il s’agissait pour eux d'avoir l’air d’être utiles.
Ils vivaient sur le village, pendant le temps qu’ils y séjournaient, soi-disant pour instruire les gens. Ils montraient à répartir une hâte toute relative. Si vous vous lassiez de les nourrir, c’est eux qui vous invitaient et vous servaient... le dernier coq qui vous restât. D’abus en abus, ils en étaient venus au Contrôle. Jusqu’où iraient-ils ? Voilà la question que les paysans se posaient. Il n’y avait plus de sécurité stable depuis un certain temps, à cause de la complaisance que ces gens-là apportaient à fourrer leur nez dans vos affaires, à tout contrôler.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 12 :
Tanga-Sud s’étalait devant Banda, scintillant, blanc, rouge, vert, et le fascinait. Il se prit à rêver du petit train qui fumait là-bas : ses voitures étroites et coquettes comme des jouets d’enfant grec avalaient des gens, des voyageurs.
Où allaient-ils ? À la grande ville de la côte là-bas à trois cents kilomètres ?... Trois cents kilomètres ?... douze heures dans le train... Fort-Nègre, la grande ville de la côte ! Il devait être plein d’immeubles. À quoi pouvaient bien ressembler les quartiers noirs de là-bas ? Ils n’étaient certainement pas aussi laids que Tanga-Nord. Et peut-être qu’on vivait largement à Fort-Nègre, avec tout l’argent qu’il y avait là-bas ?... On n’était peut-être pas obligé de se disputer deux cents kilos de cacao avec les contrôleurs et les Grecs. On disait même que le cacao n’y avait aucune importance. On gagnait beaucoup d’argent à faire autre chose que casser des cabosses, tripoter les fèves. Et on ne payait pas une grande somme pour avoir une femme, sa femme. Maudit soit le premier homme qui obligea son futur gendre à débourser une telle somme ! Peut-être que c’est là qu’il irait, après la mort de sa mère, à Fort-Nègre. Oui, peut-être que c’est là qu’il finirait bien par aller. Il confierait d’abord sa femme à ses beaux-parents. Il ne la ferait venir dans la grande ville qu’après des mois de séjour, lorsqu’il aurait beaucoup d’argent. Il viendrait l’attendre à la gare de là-bas qui, lui avait-on dit, était une immense maison. Oui, il irait l’attendre à la gare. Elle ne le reconnaîtrait plus, tellement il serait bien habillé. Il la serrerait dans ses bras et lui dirait : « Tu ne me reconnais donc plus... » Elle écarquillerait les yeux de surprise et répondrait : « Banda, mon petit mari, est-ce que c’est vraiment toi ou est-ce que je me trompe ? » Elle ne se tiendrait pas de joie. Il l’emmènerait chez eux dans leur case en traversant tout son quartier.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 13 :
Banda vidait lentement son sac dans l'appareil de bois. Il ne pouvait détacher ses yeux des fèves qui, en roulant les unes sur les autres, faisaient un bruit de feuilles mortes qu’on piétine. Comme il les aimait ces fèves-là ! Il lui semblait qu’elles étaient sorties de son sein tant il avait mis de lui-même pour les obtenir, pour les créer, et en faire ce qu’elles étaient aujourd’hui, si rouges, si sèches. Son cacao était bon, incontestablement. Ses yeux rencontrèrent ceux du fonctionnaire. Celui-ci plongea son bras jusqu’au coude dans les fèves. Il y fourragea longuement, retira une pleine poignée qu’il étreignit plusieurs fois de sa main... Il ne disait rien. Pour être sèches, elles sont sèches, songea le jeune homme qui décrocha un bref regard triomphal à Sabina. Le contrôleur s’était mis à sélectionner les fèves, une à une, sans arrêt, avec application ; son couteau lançait de menus éclairs. Il avait le visage fermé, l’oeil rétréci. Banda, de plus en plus nerveux, s’accroupit, plaça le sac béant à l’endroit de l’ouverture pour récupérer les fèves. Il ne se releva pas : il attendait tenant à deux mains son sac par les bords. Au-dessus de sa tête les craquements secs lui indiquaient que le contrôleur n’avait pas terminé. Comme il était long : Ça c’est mauvais signe, constata Banda qui, n’y tenant plus, se releva brusquement. De nouveau, leurs yeux se croisèrent. L’autre maintint les siens ; Banda aussi, quoiqu’il eût atrocement peur maintenant.
- J’ai cinq autres charges avec moi, fit-il pour dire quelque chose. Aussitôt, il se reprocha d’avoir dit ça. Il avait parlé sans avoir été interrogé, comme autrefois à l’école lorsqu’il était menacé d’une correction. Le souvenir de ces années de constante dissimulation et de peur lui fit mal au cœur.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 14 :
Ton cacao était bon... Il n’avait rien que de la bonne qualité, d’accord, fils. Mais raison de plus pour que tu leur mouilles la barbe. Raison de plus pour qu’ils saisissent ton cacao, si tu ne leur proposes pas un petit marché. Ecoute-moi bien, fils. Vois, je ne suis plus jeune. Il y a vingt-cinq ans que je me tiens ici sur cette véranda à héler des clients. Les Blancs, j’en ai vu des tas arriver ; j’en ai vu des tas repartir. J’en sais des choses ! Quand tu étais écolier, te rappelles-tu ? Que tu habitais chez nous, je te disais souvent : « Fils, les choses vont mal ; le pays se gâte ; nous ne le voyons pas encore ; mais patience ! Nous le verrons bientôt. » Eh bien, voilà ! Si tu n’as pas la force, fils, essaie de ruser. Et toi tu n’as pas la force, Banda, c’est moi qui te le dis. À quoi te sert-il de parler ainsi, comme un homme fort ! Banda, tu n’es qu’un faible, il vaut mieux que tu le saches bien dès maintenant. Tu es encore plus faible que moi, ton vieil oncle, l’aîné de ta pauvre mère. Les contrôleurs, ils font exactement ce qui leur plaît, comme les autres aussi. Que peux-tu contre eux, fils ? Des gens ont porté plainte, ça n’a jamais eu de suite. Ça n’aura jamais de suite, je te le dis. Une supposition que tu retournes demain à la place du Contrôle, juste pour voir : il n’y aura plus la moindre trace du tas de fèves d’où sortait la fumée. Tu sais comment elles brûlent, les fèves, lentement, très lentement. Une supposition que tu retournes là-bas, il n’y aura plus la moindre trace des fèves. Où est-ce qu’elles sont parties, je te le demande, fils ? Et les ordres, dis, d’où est-ce qu’ils viennent ? De très haut, fils, je te le dis ; et personne ne l’ignore à Tanga... Pourtant, nous nous taisons... Non, fils, tu n’aurais pas dû penser comme ça.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 15 :
Il désirait retarder le plus possible le moment où il lui faudrait conter la catastrophe à sa vieille mère infirme dont la vision lui emplissait l’esprit, gisant sur un lit de bambou, les jambes repliées, le visage enfoui dans le creux de la poitrine, lamentablement voûtée, n’attendant plus que la mort. Il songeait qu’à la nuit tombante, les femmes, de retour à Bamila lui diraient, elle pleurerait sur son fils ; et tous ses espoirs s’envoleraient, faisant place à la douleur, une douleur infinie. Il sentait que ses yeux s’embuaient de larmes ; il fit un geste pour les essuyer au revers de sa main, mais se retint. Il ne voulait pas qu’on sache qu’il pleurait. Il en voulait intensément au fonctionnaire du Contrôle et à ses semblables, tous ceux qui pouvaient impunément s’offrir le luxe d’infliger la souffrance, même à une malheureuse femme comme sa mère qui n’avait fait que souffrir toute sa vie. Curieux destin : toujours souffrir. Car c’était bien à cause de ce fonctionnaire du Contrôle si sa mère allait encore souffrir. Il se disait qu’il devait se venger : mais il se demandait comment.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 16 :
Assis sur un lit, il contemplait la pluie ; elle tombait en traversant les rayons du soleil que les nuages n’avaient pas encore réussi à couvrir. De gros torrents turbulents traversaient la cour en suivant leurs sillons habituels et allaient se précipiter dans la rigole qui longeait la chaussée. Dans tout l’espace, on aurait dit de longs fils de métal brillants que quelqu’un aurait pris plaisir à secouer, à faire trembloter.
La case était basse mais plutôt vaste. On y buvait de la bière de maïs qui était la spécialité de la maison. C’était un liquide mousseux, brun, généralement froid, mais que l’on pouvait servir chaud si le client l’exigeait. Les clients s’asseyaient sur des lits de bambou, des lits de bois, des escabeaux ou des caisses vides. Pour poser leur verre, ils avaient le choix entre le sol de terre battue, leur genou ou une longue table unique. Comme la table était souvent trop haute par rapport à leur siège, ils préféraient le poser sur leur genou, ou s’ils dansaient par exemple, sur le sol. Ils buvaient en devisant par groupes de deux, trois, quatre, cinq, six. C’étaient surtout des hommes. Ils se connaissaient tous dans le quartier, comme dans tous les quartiers de Tanga-Nord. Avant d’aller prendre place, chaque arrivant faisait le tour de la salle en serrant chaleureusement les mains qui se tendaient, même celles qu’il ne connaissait pas - ce qui était, certes, passablement rare. Tous ceux à qui il touchait la main lui demandaient, à tour de rôle, gaiement, en l’appelant par son nom, ou mieux, par son prénom -.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 15 :
En songeant à l’époque où il était écolier, Banda fut d’abord étonné de les retrouver si semblables à eux-mêmes avec leur fausse cordialité, cette cordialité qui n’avait gardé de la cordialité du « pays » que les apparences ; avec leur solidarité, une solidarité spéciale, dont ils perdaient toute notion en dehors des débits de boissons. Mais bientôt, il constata que certains d’entre eux prenaient des allures, manifestaient une certaine supériorité et même quelque distance. Ils entraient, ceux-là, la mine soucieuse, la bouche dédaigneuse, le regard supérieur et vague, la main discriminatoire, la parole peu abondante, discrète. C’était généralement de petits commerçants, récemment enrichis, avec un soupçon d’obésité.
Tous, il les reconnaissait. Mais eux, ils avaient beau le regarder, même en battant des paupières, ils ne semblaient pas du tout le reconnaître. Il connaissait aussi la patronne, une grosse femme, venue de l’ouest, curieusement habillée, qui avait des dents noircies et des façons doucereuses de vous coller sa marchandise. Elle trônait tout au fond de la case, presque dans l’obscurité, entre deux marmites géantes ; dans celle de gauche, elle rinçait les verres et les gobelets et dans celle de droite, elle plongeait mécaniquement les ustensiles et les retirait pleins de bière de maïs. Elle ne se levait jamais.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 17 :
Le bruit des gouttes d’eau sur le toit avait diminué. Je vais m’en aller, se disait Banda. Mon oncle est rentré depuis des heures, lui qui n’a cure de la pluie. Il doit se demander ce qui m’est arrivé. Mais l’atmosphère de cette salle plaisait à tous ses sens excités par la bière de maïs. Il ne partait pas malgré ses résolutions... Il faudrait qu’il réfléchisse à cette idée... C’était une bonne idée, pas d’erreur possible... Il y réfléchirait.
De l’autre côté de la chaussée, les gardes régionaux fouillaient des cases, méthodiquement. Ils tenaient des lampes tempête à bout de bras : on voyait surtout leurs énormes godillots noirs qu’ils avaient dû chausser à cause de la pluie - ils allaient généralement pieds nus - ainsi que les bandes molletières glauques qui s’enroulaient autour de leurs jambes maigres. C’était la troisième fois, cet après-midi qu’ils venaient fouiller de ce côté-là sans résultat ! Au bout d’un temps, ils reformèrent les rangs et reprirent le chemin de Tanga-Sud. Pensif, Banda les regardait s’éloigner. Il faudrait qu’il réfléchisse sur cette idée...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 18 :
Il faisait noir. On entendait le menu clapotis des fines gouttes de pluie sur le sol humide. De temps en temps, Banda piétinait dans une flaque et l’eau boueuse venait l’éclabousser jusqu’à la hauteur des genoux : elle redescendait, froide, chatouilleuse, le long de ses jambes et s’infiltrait dans ses chaussures de toile. Celles-ci, à chacun de ses pas, faisaient un bruit gras, comme un court ronflement. Il se demandait à quoi lui servaient maintenant ces chaussures, il les avait mises pour ce qu’il croyait devoir être une fête et qui n’avait été qu’une randonnée fort triste et qui se terminait par une aventure dangereuse. C’est seulement quelques jours plus tôt qu’il les avait lavées et blanchies avec soin. Le même jour, il avait lavé et repassé entre autres le short kaki et la chemisette bleue qu’il portait maintenant. Ce jour-là, il sifflotait encore et chantait et riait...
Il s’arrêta, se plia en deux : sans en avoir dénoué les lacets, il arracha les chaussures de toile, l’une après l’autre, d’un mouvement rageur et nerveux. Il se sentit plus à l’aise lorsque ses pieds se trouvèrent à l’air libre. Il marchait plus vite et d’un pas plus sûr. Il éprouvait beaucoup de peine à suivre la jeune fille qu’il ne voyait pas.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 19 :
Drôle de petite fille ! C’est vrai, ce qu’il aurait dû avoir c’est une sœur aimante comme ça : il se serait senti moins seul. Pour sûr, ce qu’il aurait dû avoir, c’est une petite sœur comme ça, aimante et dévouée. Ils traversaient des quartiers, de préférence en se faufilant entre les cases et en évitant de rencontrer des gens : ils leur auraient posé des questions. C’est à Fort-Nègre que j’irai m’installer, songeait Banda. Je ne viendrai pas me rouler dans la boue de Tanga, ça c’est sûr. Il était dégoûté par la laideur et la misère de tout ce Tanga-Nord, avec ses cases ratatinées, insignifiantes, mal construites, percées de grands trous par lesquels on pouvait voir l’intérieur. Tantôt un homme et une femme se battaient ou se querellaient ; tantôt c’était un gosse que l’on corrigeait à la chicote, un bébé auquel on administrait un lavement à la poire, un phonographe que l’on faisait brailler. Plus loin, des buveurs remplissaient une case au point que l’on se demandait comment elle réussissait à ne pas s’envoler tant il y avait d’éclats de voix dedans... Ils évitaient les rues dans la crainte d’être assaillis par-derrière. Une épaisse odeur de fosse d’aisances traînait obstinément dans l’air.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 20 :
Juge donc toi-même : il ne voulait pas nous payer, ce cochon-là... Je me demande ce qu’il s’imagine : que nous sommes logés dans son ventre, peut-être : il n’a qu’à manger, et nous, on se remplit. Le salaud ! Le mois dernier, il ne nous l’a même pas encore payé et c’était le treize aujourd’hui, pas vrai ? Figure-toi qu’il trouvait toujours moyen de nous renvoyer chaque fois qu’on allait réclamer la paie. Alors, hier, comme nous en avions assez, nous sommes allés expliquer ça au commissaire de police qui nous a promis de lui parler. Mais qu’est-ce que tu veux bien qu’ils se disent, ces deux-là ? Je te le demande !... Ils sont aussi unis que l’ongle et le doigt. Il paraît même qu’ils échangent les femmes entre eux : ça ne m’étonnerait pas. Ce qu’ils ont dû faire ce matin, c’est boire du whisky au lieu de parler de nous. Il était surexcité au retour de chez le commissaire ; alors, il nous a réunis. Il était le patron et nous les ouvriers — c’est ce qu’il a dit. Il commande et nous, on obéit un point c’est tout. Ce n’était pas sage à nous d’aller raconter des histoires sur son compte aux autorités. Parce que les autorités ne pouvaient pas le forcer à faire une chose plutôt qu’une autre. Nous nous étions montrés insolents : il différerait encore la paie de quelques jours, question de nous apprendre à bien nous tenir - c’est ce qu’il disait. Seulement, nous étions décidés à ne pas nous laisser marcher cette fois sur les pieds ; à midi, sortis de l’atelier, nous avons mijoté notre petit plan ; on le forcerait à venir avec nous chez le commissaire de police devant qui force lui serait de nous payer - nous le croyions - ; tout serait fini entre lui et nous, nous ne travaillerions plus chez lui. Cet après-midi, quand il a su ce qu’on voulait lui faire, il s’est battu comme un diable. Nous l’avons quand même porté en travers sur nos épaules. Je me demande si c’est bien sa femme qui a prévenu la police avec cette rapidité que je ne lui aurais jamais soupçonnée, la fainéante ! Elle se trouvait à l’étage, probablement en train de dormir... Ce que je crois, moi, c’est qu’elle a pris peur en entendant le tumulte et qu’elle a dû envoyer rapidement le boy appeler la police. Ils sont venus à notre rencontre avec un gradé blanc. Ce n’était pas la peine d’être Jésus-Christ pour voir comment ils prenaient la chose. Nous avons lâché ce balourd.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 21 :
Mais la jeune fille se mettait alors à gémir lamentablement, irrésistiblement : sa voix montait peu à peu et éclatait dans la nuit comme le cri d’une bête atteinte à mort. Non, il ne lui reprocherait plus de pleurer. Ouais ! Il ne fallait pas lui reprocher de pleurer, car alors elle pleurait encore plus fort. Elle ne faisait pas exprès de pleurer : c’était plus fort qu’elle. Il lui caresserait les cheveux et la joue quand ils seraient à terre. Oui, c’est ça, il lui caresserait simplement les cheveux et la joue quand ils marcheraient côte à côte. Peut-être qu’ainsi elle se tairait. Il ne pouvait pas supporter de l’entendre pleurer.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 22 :
Vois-tu, petite sœur, commença-t-il, vois-tu, chaque fois que pour une raison ou pour une autre ils désirent mettre la main sur quelqu’un et qu’ils ne le peuvent pas, c’est toujours à ses parents qu’ils s’en prennent, ou à sa femme ou à son frère... Je suis sûr qu’ils iront embêter tes parents au pays... Peut-être qu’ils leur mettront la corde au cou et les traîneront jusqu’à Tanga pour les torturer et leur poser des questions chaque jour. Peut-être qu’ils les détiendront là-bas dans leur prison des mois et qui sait des années. Il faut essayer d’empêcher cela. Encore si ton frère était vivant, sa vie vaudrait tout de même qu’on fouette un peu vos parents, non ? Seulement, maintenant... tu comprends ce que je veux dire. Il n’y a plus de raison qu’ils les embêtent, vos parents. On ne peut pas maltraiter les vivants pour une faute qu’on reproche à un mort. Non, personne ne peut faire une chose pareille. Personne, pas même eux...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 23 :
Sa mère l’avait pourtant aimé et l’aimait encore d’un amour incroyable. Et lui, il aimait pourtant sa mère en ce moment, de tout l’amour dont il fût capable. Il lui avait toujours semblé, à vrai dire, que ce qui se produisait entre sa mère et lui était exceptionnel parmi les hommes, et ne pouvait s’expliquer que par des circonstances spéciales : par exemple, la mort de son père qui très tôt les laissa seuls au monde ; de même ces visites et ces départs déchirants du temps qu’il était écolier à Tanga. C’étaient toutes ces circonstances qui expliquaient qu’ils s’aiment tant, sa mère et lui. Non, ça ne pouvait pas être fréquent parmi les hommes des gens comme eux. Pourtant, s’il avait toujours rêvé d’une petite sœur aimante, c’était surtout à cause de son besoin de tendresse - il ne s’en rendait pas compte très clairement. En rêvant d’une petite sœur, ce qu’il avait souhaité c’est une tendresse qui le tiendrait chaud, quand sa mère serait morte. Et cette nuit, il s’apercevait que d’autres hommes s’aimaient avec une intensité qu’il n’aurait pas devinée. L’amour, en tant que caractéristique de l’homme le prenait à l’improviste et le laissait pantois. Il avait toujours désiré une petite sœur, mais sans trop s’expliquer pourquoi. Maintenant, il savait... il savait pourquoi il aurait été heureux d’avoir une petite sœur comme ça, aimante, courageuse et tout. Le sentier déboucha sur la grand-route.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 24 :
Je t’en prie, mère, ne te tracasse pas trop pour ce qui me concerne. Je vivrai très bien tout seul, sans femme. Je préparerai mes repas moi-même : ça s’est bien vu, quoi... et puis, je n’y suis pour rien... enfin, je me débrouillerai bien mère, ne te tracasse pas trop. Je me souviendrai de toi, je ne t’oublierai jamais. J’ai fait ce que j’ai pu, mais je n’ai pas réussi. J’ai travaillé toute l’année, ça n’était vraiment pas la peine. Si seulement j’avais pu le savoir d’avance. Mère, il y a des gens comme ça qui n’ont pas de chance, moi par exemple. Je t’assure nous n’y pouvons rien, ni toi, ni moi.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 25 :
- Vois-tu, fils, chaque fois qu’il t’arrive un malheur, cherches-en la cause en toi-même, d’abord en toi-même. Nous portons en nous-mêmes la cause de tous nos malheurs. Banda, je suis ton père. Combien de fois t’ai-je prévenu ? Je disais : « Fils, tu te comportes comme un insensé. La lumière du jour et l’immensité du firmament t’étourdissent. Tu ne fais pas suffisamment attention. Qui a jamais vécu comme toi, dans une telle insouciance de tout ce qui t’entoure, sans regarder ni à droite, ni à gauche ?... » M’as-tu écouté ? As-tu renoncé aux beuveries, aux disputes, aux femmes des autres ? T’es-tu jamais abstenu d’affronter les vieilles gens ? Je t’avais pourtant dit que cette chose-là on ne la faisait pas impunément...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 26 :
Ne quittez pas la voie de vos pères pour suivre les Blancs : ces gens-là ne cherchent qu’à vous tromper. Un Blanc, ça n’a jamais souhaité que gagner beaucoup d’argent. Et quand il en a gagné beaucoup, il t’abandonne et reprend le bateau pour retourner dans son pays, parmi les siens qu’il n’aura pas oubliés un instant, cependant qu’il te faisait oublier les tiens ou tout au moins les mépriser. Un Blanc, ça n’a pas d’ami et ça ne raconte que des mensonges : ils s’en retournent conter dans leur pays que nous sommes des cannibales ; est-ce que tu me vois, moi, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, tous ceux dont je t’ai si souvent parlé, mangeant de l’homme ? Pouah !... Ne vous laissez plus attirer par les Blancs. Que vous apportent-ils ? Rien. Que vous laissent-ils ? Rien, pas même un peu d’argent. Rien que le mépris pour les vôtres, pour ceux qui vous ont donné le jour...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 27 :
Le bois de la coque heurta violemment une chose dure. Banda fut projeté dans l’eau et ne put s’empêcher de boire quelques gorgées. Prompt comme l’éclair, il se ressaisit, s’ébroua, aperçut la pirogue entre deux clignotements d’yeux, tendit la main au hasard, toucha l’embarcation et s’y accrocha. Il se passa la paume de sa main gauche libre sur le visage et se frotta les yeux. La pirogue tanguait pitoyablement. Sous la pression de Banda, elle recouvra lentement, très lentement son équilibre. Il s’aperçut alors qu’elle n’était pas enferrée. Elle descendait toujours le fleuve, emportée par l’eau ; elle continuait son chemin et emportait Banda. Sans peine, il se hissa à bord : il n’avait pas lâché sa pagaie. Comment avait-il pu faire ? La main droite... mais oui, la même main qui s’était accrochée au bord de la pirogue tenait en même temps la pagaie.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 28 :
Il croisait des gens endimanchés : mais il ne les voyait pas : sa conscience ne les enregistrait pas. Il semblait que les organes de son corps fonctionnaient au ralenti. Son pas même était lourd et incertain. Il réagissait avec retard aux impressions extérieures. Il s’était épuisé sans s’en rendre compte. Il avait trop présumé de ses forces. Ce fut en apercevant une bande d’adolescents qu’il revint à la réalité. Ils étaient muets ; on aurait dit qu’ils prenaient un plaisir spécial à écouter la sourde rumeur de leurs piétinements nombreux et désordonnés. Banda les connaissait généralement bruyants, les enfants de cet âge. Il se demanda pourquoi ils étaient muets. Ils ne portaient rien. Ils se hâtaient aussi d’une façon anormale. Il ne pensa pas davantage aux adolescents, quoique leur mutisme l’étonnât.
Ensuite, il croisa des femmes ; il les vit. Elles n’avaient pas une hotte sur le dos : elles marchaient bras ballants et même elles portaient des robes claires. Il ne comprit pas tout de suite. Mais les femmes, qui allaient par petits groupes, se pariaient tout bas. Venant d’un groupe, lui parvinrent des morceaux de conversation, comme des bouffées. Il était question de barrages, de coups de fusil, de garçons qu’on recherchait, de Blanc mort à l’hôpital, d’arrestations, de messe, de communion... Et tandis qu’il marchait il s’aperçut que ce n’était pas un seul groupe qui avait dit toutes ces choses-là, mais bien plusieurs groupes qu’il avait croisés successivement.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 29 :
La première fois - et la seule ! - qu’elle avait interrogé l’oncle de Banda, le tailleur, sur l’assiduité de l’adolescent aux offices de piété, l’homme avait répondu en manifestant une certaine impatience. Il n’avait jamais été baptisé, lui, disait-il ; il comptait du reste ne l’être jamais, et il ne s’en portait pas plus mal. Est-ce que la meilleure façon d’élever un gosse ce n’était pas de lui donner à manger et de le laisser tranquille ? Et qu’il coure ou dorme, ou rie, ou pleure quand il lui plaît : ça c’était la meilleure façon d’élever un gosse, un garçon surtout. (En réalité, le tailleur avait un faible étrange pour son neveu, il montrait beaucoup de complaisance pour la conduite rarement irréprochable - c’est le moins qu’on en pût dire - de ce garçon trop turbulent ; on aurait même dit qu’il l’encourageait. Il s’était ainsi établi entre eux des liens de complicité à peu près indéfectibles et qui se resserraient de jour en jour.) Tout au plus concevait-il qu’on le mette à l’école pour apprendre la langue des Blancs puisque après tout ces gens-là étaient bien les maîtres du pays. Mais le catéchisme, la messe, le chapelet, la confesse, les prières du matin et du soir, et les autres lubies, à quoi diantre cela rimait-il ? Sa sœur se comportait comme si la religion avait été une chose nouvelle... Et leurs ancêtres, ceux qui vivaient dans un pays où il n’y avait pas encore de Blancs, ni de missionnaires, ni de Bonnes Sœurs, ni d’églises, ni de cloches ; leurs ancêtres, avant l’arrivée des Blancs, est-ce qu’ils ne croyaient pas en Dieu, eux ?... Qu’était-il besoin d’aller se mouiller la tête d’un peu d’eau, d’aller s’agenouiller aux pieds d’un prêtre, d’aller avaler une miette de pain sans la mâcher, pour croire en Dieu, il le demandait ?
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 30 :
Il en avait vu, lui, des prêtres indigènes, et de près. C’étaient certainement les gens qui avaient le plus de privilèges parmi les Noirs. Des maisons de briques, la table servie comme pour un Blanc, des motocyclettes, des bicyclettes ce n’est pas ce qui leur manquait. Et l’estime et le respect de tout le monde... même des Blancs ! Une supposition seulement qu’elle veuille faire un prêtre de son fils, ça ne serait pas une mauvaise idée. Mais qu’elle le dise tout de suite... Qu’on l’entende et qu’on sache à quoi s’en tenir. Seulement, à son avis, ce n’est pas avec des garçons comme Banda qu’on fait des prêtres... certainement pas ou alors il n’y entendait rien, aux enfants... Après cette prise de position sans ambiguïté de son frère, la mère, bouleversée, avait sérieusement songé à inscrire son fils à l’école des missionnaires. Mais on la prévint que les enfants n’y apprenaient pas bien grand-chose en dehors du catéchisme et des refrains latins et qu’il lui faudrait payer chaque année des droits d’écolage considérables. Entretemps, Banda avait tenté un examen de catéchisme en vue du baptême : il fut si malheureux qu’on préféra n’en plus parler. La mère maintint son fils à l’école laïque par fidélité aux intentions de son mari, malgré les objurgations du catéchiste qui était une de ses relations. Elle se mit aussi à avoir pour son fils d’autres ambitions que celles spécialement relatives à la pratique de la religion et de son salut éternel.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 31 :
Il s’attendait à ce que les gradés blancs le désignent subitement du doigt, viennent l’extraire de la foule ; à chaque instant, il lui semblait qu’il s’y attendait quoiqu’il sût fort bien qu’ils ne pouvaient pas savoir, qu’ils ne viendraient pas. En même temps, il ne pouvait s’empêcher de se livrer au défi intérieur : si les Blancs, pensait-il, sont aussi intelligents qu’on le dit, qu’ils me découvrent donc tout seuls... qu’ils sachent donc ce qui s’est passé... Allez-y si vous êtes aussi fort qu’on le dit... Qu’attendez-vous ?... Venez, mettez-moi la main dessus. Je suis là dans cette foule ; je suis grand, très foncé de peau ; je porte des habits de toile kaki, je porte une cicatrice au menton ; j’ai de gros yeux qui semblent sortir des orbites... Et malgré tout, vous ne me découvrez pas ?... Mais il ne paraissait pas que les gradés blancs dussent le découvrir jamais. D’ailleurs, dit-il, c’est vrai que ce n’est pas à moi qu’ils en veulent.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 32 :
Mais alors, il se demanda pourquoi il voulait aller à la ville, plus tard ? Et peut-être qu’il avait tort de vouloir aller à la ville plus tard ? À maintes occasions auparavant, il avait déjà éprouvé combien la ville était cruelle et dure avec ses gradés blancs, ses gardes régionaux, ses gardes territoriaux et leurs baïonnettes au canon, ses sens uniques et ses « entrée interdite aux indigènes ». Mais cette fois, il avait lui-même été victime de la ville : il réalisait tout ce qu’elle avait d’inhumain. Il porta, en soupirant, la main à son œil poché : il avait désenflé depuis la veille. Et peut-être que Fort-Nègre ce n’était pas comme Tanga ? Et peut-être que Tanga était une ville à part ? Et peut-être que le caractère farouche et récalcitrant des habitants du pays expliquait l’extrême sévérité des autres ? Oui, est-ce que ça se passait partout comme à Tanga ? Il faudrait savoir si ça se passait partout comme à Tanga ? Il aurait donné cher pour le savoir.
Mais, n’importe comment, il ne pourrait plus continuer à vivre à Bamila, après sa mère. On ne peut pas vivre dans un grand village, comme Bamila, dont tous les anciens te détestent et dont tu détestes tous les anciens. Non ; on ne peut même pas vivre dans un village des environs ; leur haine t’y suivrait...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 33 :
La maladie grave de son fils unique chagrinait cette femme : pour tout dire, elle était au désespoir. Or, une nuit, dans son sommeil, elle reçut la visite de sa belle-mère et de son mari, tous deux morts. Ils lui indiquèrent comme médecine pour soigner l’enfant, une herbe qui croissait non loin de la case de la famille. Au lever du jour, la mère soûle d’espoir, découvrit effectivement l’herbe qui lui avait été minutieusement décrite en songe. Le petit garçon fut ainsi arraché à une mort à peu près certaine. C’est curieux, il avait toujours pensé que son père finirait par faire aussi quelque chose pour lui. Et voilà que c’était arrivé. Tout de même, à quoi ça ressemblait la vie ?
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 34 :
Ils étaient toute la journée dans leur forêt. Quand ce n’était pas pour travailler dans leur champ, c’était pour boire du vin de palme en toute sécurité, ou pour chasser ou pour se livrer à certaines activités que la « loi » réprouvait et que la forêt protégeait très maternellement. La caractéristique constante de cette catégorie d’hommes c’était surtout leur inaltérable bonne humeur, leur hâblerie, et la force de résistance au temps de leurs sentiments. En traversant ce village, Banda les entendait chanter dans les cases - parce que c’était un dimanche et que le dimanche les incursions des gardes régionaux et des gradés blancs étaient rares - et se demandait comment ils y arrivaient, à ne se soucier de rien, pas même de ce qui se passait en ce moment à Tanga, à six kilomètres.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 35 :
Ce qui frappait Odilia, c’était surtout ce contraste entre le physique misérable de cette loque humaine et la dignité des propos qu’elle tenait : elle ne pouvait pas s’empêcher d’admirer la mère de Banda. Elle se demandait ce qu’elle avait dû être dans sa jeunesse. C’est d’elle que le jeune homme devait tenir ce caractère impétueux, et volontiers généreux. Elle en avait dû penser des choses, et les remâcher et les ressasser, toujours couchée ainsi. Du coup, la jeune fille oubliait son propre malheur, son frère mort, le chagrin qui l’étreignait parfois au point qu’elle pensait suffoquer.
Quand elle venait à songer à Koumé, il se produisait dans son esprit une association automatique des images des deux jeunes gens, Koumé évoquant Banda irrésistiblement. Il lui semblait que ces deux-là avaient été créés pour se rencontrer un jour, pour se prêter main-forte, pour avancer épaule contre épaule à travers le fouillis inextricable de la vie. Quel malheur que l’un fût mort. Peut-être qu’elle aurait mieux fait hier matin de lui conter son rêve. Il s’en serait moqué ; mais peut-être qu’il aurait tout de même été impressionné. Au lieu de cela, elle l’avait querellé.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 36 :
Vois-tu, commenta la malade, vois-tu, ma fille, tous ces enfants qui abandonnent leurs villages et leurs familles et vont dans les villes, qui peut dire ce qui en résultera ? De notre temps, si un Blanc te disait : « Mets-toi à genoux !» tu ne trouvais rien de mieux à faire que de te mettre à genoux ; ou bien : « Couche-toi sur le ventre, que je te fouette le derrière ! », tu t’aplatissais sur le sol. Aujourd’hui, avec nos fils, ce n’est plus la même chose. Ils ont grandi ; ils nous méprisent parce que nous avons courbé la tête devant les Blancs. Eux, ils marchent fièrement, en se frappant la poitrine, en levant leurs bras, en brandissant leur poing. Les Blancs eux-mêmes leur avaient dit : « Venez donc dans nos écoles. » Ils sont allés dans leurs écoles ; ils ont appris à parler leur langue, à discuter avec eux, à faire des calculs sur les feuilles de papier, tout comme eux. Ils font marcher des machines terribles qui abattent les arbres, creusent les routes ; ils roulent dans les camions à des vitesses infernales ; ils font tout ce que font les Blancs. Alors, ils ne veulent plus être tenus pour de simples domestiques, pour de simples esclaves comme leurs pères, mais pour des égaux des Blancs. Et ces derniers, qu’est-ce qu’ils pensent de tout cela, je me le demande ? Est-ce qu’ils vont accepter de n’être plus les maîtres ? Ou est-ce qu’ils s’y refuseront ? Dans tous les cas, comment savoir ce qui se produira.
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 37 :
Le cadavre, disaient-ils, portait une profonde plaie sur le crâne, au-dessus de la nuque. Quelqu’un avait dû le tuer en se servant d’un marteau par exemple. Ils étaient venus le déposer sous le pont pour faire croire à une chute, peut-être, ou à tout autre accident. Tout le monde savait bien que c’étaient eux qui l’avaient tué. Qui avaient-ils bien pu charger d’exécuter ce travail ? Certainement un garde territorial. Les gardes territoriaux étaient arrivés en force la nuit dernière. Ils avaient dû finir, à force de chercher, par lui mettre la main dessus - ce n’était pas la première fois qu’on voyait une chose comme ça. Et les Blancs leur avaient dit : « Allez donc le tuer, ça lui apprendra à affronter les Blancs ; nous commencions justement à en avoir assez de ces petits enfants ; nous commencions à en avoir assez de leur turbulente arrogance. Ça ne pouvait tout de même pas durer longtemps. Allez donc le tuer, comme ça au moins il n’affrontera plus les Blancs. Malheur à qui affronte les Blancs !... voilà ce que diront les autres !... » Et, eux, ils l’avaient tué ! Ils l’avaient vraiment tué, leur frère, un garçon si jeune, presque un enfant. Le mieux quand on tuait un Blanc, c’était de se tuer soi-même, puisque n’importe comment, on était sûr de son affaire. Ce Koumé, il aurait dû se tuer lui-même ; comme ça ils ne l’auraient pas eu...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 38 :
Elle essaya d’intéresser son esprit aux gosses qui s’ébattaient nus dans la poussière, là-bas, à quelques cases d’intervalle. Plus loin, des jeunes gens sortaient des cases ou y entraient, s’interpellant, s’esclaffant sans raison apparente. Ils s’adressaient aussi entre eux des paroles vives, faisant de grands gestes tranchants. Ils portaient nonchalamment leurs pagnes noués autour de la hanche, d’une façon intentionnellement obscène. Certains portaient une culotte kaki, souvent rapiécée ou en haillons. Ils paraissaient prendre un plaisir spécial à caresser leurs pectoraux, à se donner mutuellement de grandes tapes sur le dos nu. Sans pudeur, ils racontaient à haute voix leurs exploits de toute sorte, en ponctuant leurs paroles de rires gras, à croire que dans ce village personne n’avait jamais pleuré, que c’était une euphorie sans fin. On eût dit qu’ils faisaient exprès de s’approcher, de passer et de repasser devant elle, à distance, en la gratifiant de coups d’œil réticents. À leur insouciance manifeste, elle les reconnut pour des protégés de Tonga, ses flagorneurs ; ce n’était pas étonnant qu’il les préfère à Banda, ceux-là !
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 39 :
Il ne voulait pas de ses félicitations. Tout ce qu’il désirait, c’était l’argent de Démétropoulos : il ne lui demandait rien au-dessus de son argent, pas même des paroles agréables. Brave garçon... excellent garçon, tout cela, il n’en voulait pas. Ce Démétropoulos, il le connaissait bien ; il ne le connaissait que trop bien. Il ne l’aimait pas ; pour tout dire, il ne l’aimait pas. C’est vrai qu’il ne payait pas de mine, avec son nez trop fort et crochu comme un bec d’aigle, avec son obésité récente, ses dents artificielles ; c’est vrai qu’il ne payait pas de mine. Il ne pouvait pas aimer le Démétropoulos. Un jour, il l’avait vu faire une chose atroce, horrible. C’était pendant la saison du cacao, il y avait quelques années de cela. Installé devant son magasin, Démétropoulos voulait acheter du cacao. Mais il attendait; il attendit appuyé à sa balance romaine, et entouré de ses hommes qui appelaient en vain. Les paysans passaient, emmenant leur cacao sans même daigner regarder Démétropoulos. Alors, ce salaud avait eu une idée diabolique. Il avait fait porter près de lui de menues pièces de monnaie, des morceaux de savon parfumé, des couteaux, des flacons de parfum, des peignes, tout un tas de pacotille, il s’était mis à puiser à pleine main dans ces objets et à les lancer sur la chaussée, comme ça. Les paysans n’avaient pu résister ; ils étaient accourus et s’étaient précipités. Banda se rappelait avoir vu des hommes se colleter pour un couteau ou pour un harmonica ; il avait vu des enfants rouler étroitement enlacés sur la chaussée pour une pièce de monnaie et se relever ensanglantés. Il avait vu des femmes se griffer, se mordre, s’entredéchirer pour un peigne ou un flacon de parfum. Pendant ce temps-là, le Démétropoulos s’esclaffait et se tapait sur les cuisses. Pourquoi avait-il fait cela ? Est-ce qu’il avait voulu les appeler à lui de cette façon, ou est-ce qu’il avait voulu se venger d’eux, comme ils l’avaient dédaigné ? Pourquoi avait-il fait cela ? Sûr qu’il ne pourrait jamais aimer ce Démétropoulos. Et il avait des magasins à travers tout le pays. Et l’on disait qu’il y avait dix ans, venant de chez lui, il était débarqué à Fort-Nègre, dépourvu de tout. Il n’avait alors pour tout bien qu’une mauvaise valise de carton, des chaussures de toile, un short kaki, une chemisette de cotonnade, toutes choses qu’il portait d’ailleurs sur lui en débarquant. Et voilà que maintenant il avait des camions, de grosses voitures et même une femme, une belle femme, peut-être une femme de son pays
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954
Texte 40 :
Mais oui, mère. Ces gens-là sont surprenants. Par exemple, ne sais-tu pas que toutes les églises catholiques recèlent un os humain quelque part, très souvent à l’autel ? Un os de saint... Ils adorent des souvenirs comme ça. Comme souvenir de quelqu’un, il n’y a rien pour eux qui vaille un os ou des cheveux. Mère, tu ne peux pas savoir : ce sont des gens étranges.
- Tu es bien sûr de ce que tu dis, fils ? Un os humain !...
- Mais oui, mère, un os humain...
- À l’église !
- Un os de saint, une « relique », comme ils disent.
- Et c’est pour quoi faire, cet os ?
- Oh ! pas bien grand-chose. De temps en temps, ils le découvrent, et l’exposent. Alors, tous viennent le regarder et le contempler tout simplement. Parfois aussi, ils le touchent, mais ça, c’est plus rare.
- Fils, conclut-elle, tu en sais long sur la religion, et plus long que moi.
- Est-ce que je ne l’ai pas toujours dit, mère ?
- Et pourquoi ne crois-tu pas ?
- C’est justement parce que j’en sais trop long sur eux et leur religion. Alors, je ne veux plus croire : je n’ai pas confiance en eux.
- Comment ça ?
- C’est beaucoup trop difficile à expliquer, mère. N’en parlons plus, veux-tu ?
- Fils, tu n’as pas commencé par en savoir si long. Autrefois, quand tu n’avais que treize ou quatorze ans, pourquoi ne voulais-tu pas assister au cours de catéchisme, fils ?
- Je ne sais pas, mère ? N’en parlons plus, je t’en supplie...
Eza Boto, Ville cruelle, Présence Africaine, 1954