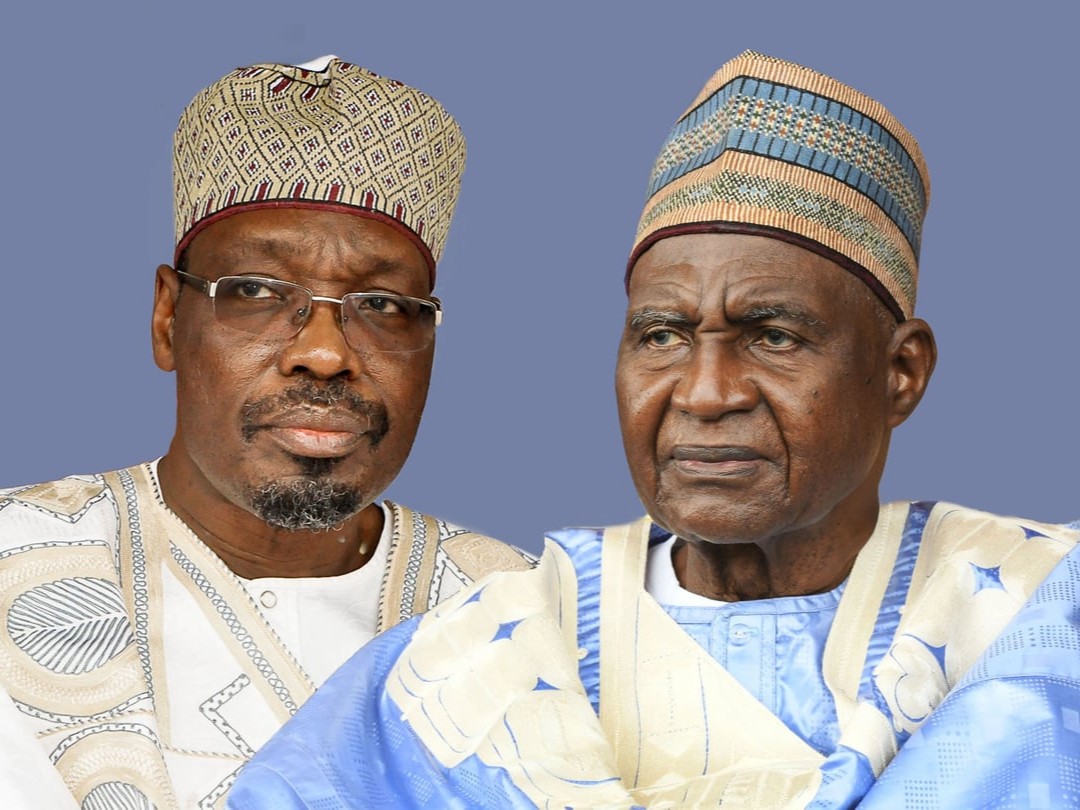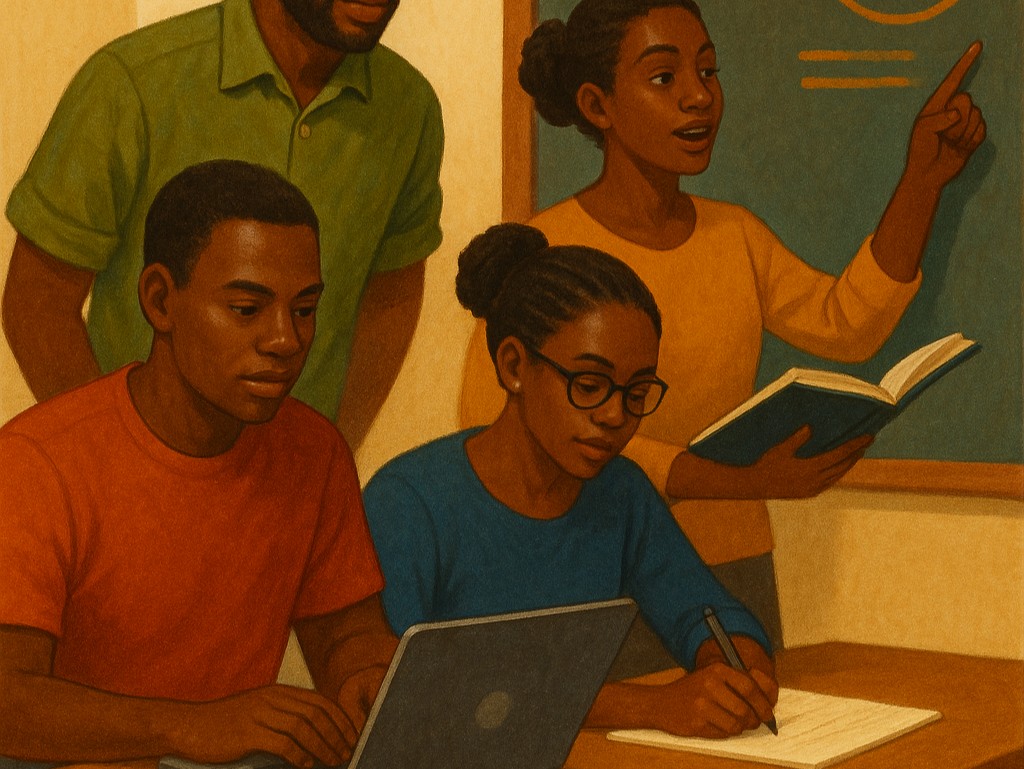Épouser le frère de son défunt mari : est-ce une forme de déchéance ?
La question peut sembler choquante pour certains, inconcevable pour d’autres. Pourtant, avant de juger, il est essentiel de replacer cette pratique dans son contexte culturel et historique africain.
Un héritage culturel souvent diabolisé
Rappelons tout d’abord que nos sociétés africaines ont affronté l’Occident sur le plan militaire et ont connu la défaite. Cette guerre n’était pas seulement une guerre des armes, mais aussi une guerre culturelle : il fallait effacer notre univers de pensée et imposer un autre modèle. L’Église a joué un rôle déterminant dans cette entreprise, diabolisant et méprisant encore aujourd’hui bien des aspects de la culture africaine.
Dans le mouvement actuel de renaissance et de réappropriation culturelle, porté par diverses organisations et intellectuels africains, il devient urgent non pas seulement de refaire ce que faisaient nos ancêtres, mais de comprendre pourquoi ils le faisaient. Imiter servilement est un acte de paresse ; comprendre, puis adapter, est un acte de courage et d’intelligence.
La pratique du lévirat : pourquoi existait-elle ?
Dans beaucoup de sociétés africaines, lorsqu’un homme mourait, sa femme pouvait épouser son frère ou, à défaut, un autre membre proche. Le choix revenait toujours à la femme. Aujourd’hui, cette pratique est largement combattue, perçue comme un vestige d’un passé révolu. Mais pour bien juger, il faut revenir à ses justifications culturelles et sociales.
1- La protection et l’avenir des enfants
Le premier motif, sans doute le plus important, est la gestion des enfants. Lorsqu’un frère meurt, son frère biologique est le mieux placé pour élever ses enfants, qui partagent le même sang. Les sœurs et la mère du défunt peuvent aussi soutenir cette femme et ses enfants. Dans cette configuration, les enfants continuent de grandir dans leur famille paternelle, sans rupture affective ni sociale.
En revanche, lorsqu’une veuve se remarie hors de la famille, son nouveau mari peut éprouver des réticences à considérer les enfants du défunt comme les siens. Cela complique souvent l’éducation et le bien-être de ces enfants.
2- La signification profonde de la dot
Contrairement à une idée reçue, la dot n’est pas la vente d’une femme. Elle représente une compensation offerte par la famille de l’homme à celle de la femme, en reconnaissance du rôle central qu’elle jouera : éduquer les enfants, cultiver, soutenir le foyer. La dot est versée par la famille du mari, pas par lui seul. La femme devient ainsi un membre à part entière de sa belle-famille.
C’est pourquoi, selon la logique ancestrale, au décès du mari, il n’était pas normal qu’elle reparte dans sa famille d’origine ou cherche à reconstruire sa vie ailleurs, surtout si elle a déjà des enfants. L’un des frères du défunt pouvait alors l’épouser, lui permettant de rester intégrée et protégée au sein de cette famille.
3- Les enfants appartiennent à celui qui a doté
Dans la culture africaine, les enfants « appartiennent » à celui qui a doté la mère, et non au père biologique au sens strict. Si, après le décès de son mari, une femme a des enfants avec un autre homme sans que la dot du premier mariage n’ait été remboursée, ces enfants sont juridiquement et culturellement considérés comme ceux du premier mari. Même la dot perçue lors du mariage d’une fille née après le décès reviendrait à la famille de celui qui avait doté.
C’est pour éviter ces complications que les anciens ont estimé préférable qu’une veuve épouse le frère de son défunt mari, et que la dot des enfants filles soient reversée tout simplement à son frère ou son père ayant épousé sa veuve.
4- L’organisation spatiale de la famille
Les maisons des frères sont souvent regroupées dans la même concession ou le même espace familial. La veuve vit donc déjà au cœur de cette famille élargie. Il serait irrespectueux et perturbant qu’un étranger vienne « l’emmener » hors de ce cadre. En restant dans cette famille, elle protège ses enfants et garde ses repères.
Une pratique à comprendre, non à condamner
Cet article ne vise pas à imposer cette pratique, mais à en rappeler le sens profond. La décision finale appartient toujours à la femme, qui peut choisir ou non d’épouser un membre de la famille de son défunt mari.
Ce regard porté sur la culture africaine montre qu’avant de juger, il est essentiel de comprendre. Car imiter sans réfléchir n’est pas mieux que rejeter sans savoir.