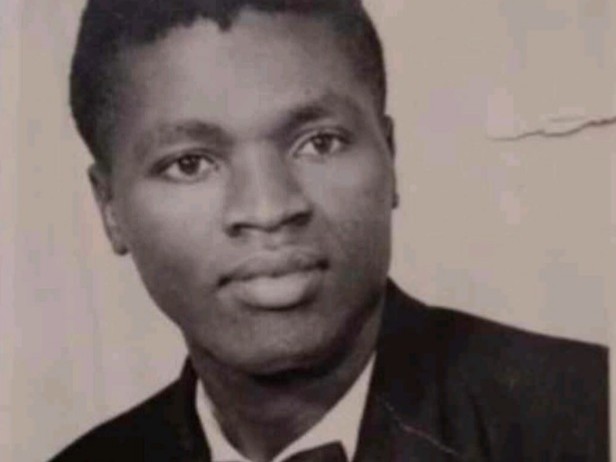Le retrait du Niger de la Francophonie : un pas vers la souveraineté africaine ou une victoire incomplète ?
1- La Francophonie : une organisation sous influence
La Francophonie regroupe les pays partageant la langue française, avec pour objectif affiché de promouvoir la langue et la culture francophones, tout en développant la coopération entre ses membres. Financée principalement par les contributions des États membres et des dons divers, cette organisation incarne en réalité une forme d'influence politique et économique de la France sur ses anciennes colonies.
Cheikh Anta Diop dénonçait déjà ces "faux ensembles sans lendemain historique" comme la Francophonie et le Commonwealth, affirmant qu’ils empêchent l’Afrique de suivre son propre destin fédéral. Pour lui, ces organisations maintiennent les pays africains dans une dépendance culturelle et économique, les éloignant de la voie de l’unité africaine.
2- Une langue qui ferme plus qu’elle n’ouvre
Le français, présenté comme une passerelle vers le savoir, agit paradoxalement comme un verrou. Contrairement à l’anglais, langue dominante dans la recherche scientifique, la technologie et les affaires mondiales, le français limite l’accès aux connaissances internationales. Cette situation empêche les jeunes Africains de s’ouvrir au monde et d’explorer de nouvelles perspectives.
De plus, la posture souvent condescendante de la France envers ses anciennes colonies rend l’usage du français presque humiliant. La langue devient le symbole d’une soumission culturelle imposée. Le Rwanda a bien compris cela : après le génocide, il a officiellement quitté le français et adopté l’anglais comme langue d’enseignement et d’administration. Ce choix stratégique a accéléré son développement économique et son intégration dans la communauté internationale.
3- Une organisation politique, pas neutre
La Francophonie a montré son vrai visage en excluant rapidement les États de l’Alliance des États du Sahel (AES) à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso après les coups d’État. Ce positionnement révèle que cette organisation n’est pas un simple outil de coopération linguistique, mais un instrument politique au service des intérêts français.
Le Niger, suivi par le Burkina Faso, n’a fait qu’acter cette rupture déjà consommée en sortant de la Francophonie. Ce retrait marque un pas de géant vers la souveraineté, affirmant que la dignité nationale prime sur l’appartenance à une organisation perçue comme néocoloniale.
4- La souveraineté ne se négocie pas
Le bloc AES a prouvé qu’une Afrique unie devient une force redoutable. Trois États seulement, soudés par un idéal commun, font déjà trembler les puissances occidentales. Ni les sanctions de la CEDEAO, ni les menaces militaires n’ont réussi à les faire plier. L’unification de leurs armées, avec l’engagement mutuel de défendre tout membre attaqué, illustre une solidarité exemplaire. Cette sortie de la Francophonie représente une nouvelle étape vers une souveraineté africaine pleine et entière.
Le Mali pourrait bien suivre ce chemin, renforçant ainsi ce front panafricaniste émergent. Ces pays offrent une leçon de courage politique à l’ensemble du continent.
5- Une victoire politique… mais une bataille inachevée
Malgré ce pas historique, quitter la Francophonie sans se défaire du français limite l’impact du geste. Tant que la langue de l’ancien colonisateur reste la langue d’enseignement, d’administration et de culture, le risque de retour à la dépendance persiste. Un changement de régime pourrait ramener ces pays dans le giron francophone.
Pour solidifier leur rupture, les États de l’AES doivent engager une révolution culturelle profonde. L’introduction du swahili dans les écoles serait une avancée symbolique et pratique. Cette langue africaine largement répandue est la future langue fédérale d’une Afrique unie.
6- Devenir l’embryon de la nation africaine unie
Les États de l’AES doivent se voir comme le noyau d’une future grande nation africaine. Ce rôle implique de repenser leurs systèmes éducatifs, de développer une industrie cinématographique panafricaine pour contrer la propagande occidentale, et de stimuler la production locale. La bataille est avant tout économique et culturelle.
Ahmed Ben Bella, premier président de l’Algérie indépendante, avertissait déjà que son pays, après la victoire militaire sur la France, n’avait gagné qu’un hymne et un drapeau, mais restait ligoté par le système capitaliste mondial. Ce constat montre que sans une base économique solide, les victoires politiques restent fragiles. L’histoire regorge d’exemples de nations africaines ayant remporté leur indépendance politique pour retomber ensuite dans le néocolonialisme par la dépendance économique.
7- Économie et culture : les armes décisives
L’exemple de la Chine est édifiant. Sa puissance actuelle repose moins sur sa révolution politique que sur sa transformation économique et culturelle. La révolution lui a donné les outils, mais c’est son essor industriel et son influence culturelle qui lui ont permis de s’imposer sur la scène mondiale.
Les États de l’AES doivent suivre cette voie : sans industries et sans contrôle de leur économie, leurs victoires politiques resteront éphémères. Gagner la guerre contre le néocolonialisme exige de maîtriser la production, le commerce, les médias et l’éducation.
8- Une guerre médiatique à organiser
Enfin, la bataille se joue aussi sur le terrain de l’information. Les ennemis de l’AES déploient d’immenses ressources pour contrôler le récit mondial. Les États de l’AES doivent cesser de laisser leurs partisans se débrouiller avec des moyens dérisoires. Ils doivent financer une armée numérique d’influenceurs panafricains capables de défendre leurs actions, de contrer les campagnes de désinformation et de mobiliser l’opinion publique internationale.
Depuis Laurent Gbagbo, trop de leaders africains comptent sur la bonne volonté de leurs militants. Pendant ce temps, leurs adversaires rémunèrent leurs propagandistes. L’AES doit professionnaliser son influence médiatique pour transformer chaque victoire politique en victoire d’image durable.
Conclusion : Un combat total, économique et culturel
Le retrait du Niger de la Francophonie est une victoire éclatante, mais insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une révolution économique et culturelle. L’AES incarne l’espoir d’une Afrique forte, mais cet espoir ne deviendra réalité que si ces États brisent les chaînes mentales et économiques qui perpétuent la domination.
La souveraineté politique est une première étape. La souveraineté économique et culturelle sera la victoire finale. Pour cela, l’AES doit mobiliser toutes ses ressources, toutes ses forces, et surtout, tous les Africains.
Douala, le 18 mars 2025
Abonnez vous au Site pour lire plus d'articles.